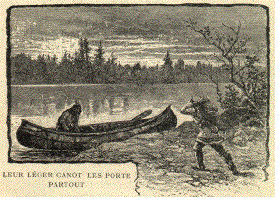En Canot et en traîneau
À CHIENS
Parmi les Indiens CREE et SALTEAUX
CHAPITRE VII
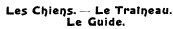
Ces sauvages contrées du Nord sont si
entièrement dépourvues de routes que
leurs tribus ne possèdent aucun mot pour
désigner des véhicules quelconques.
Pour rendre wagon ou chariot dans la langue Cree il
faut dire traîneau à chiens. Les lacs
et rivières y sont si nombreux que, durant
la saison d'été, le besoin de routes
ne se fait pas sentir. Nous avons vu comment le
léger canot de l'habitant le porte dans
toutes ses expéditions, moyennant qu'il le
porte sur ses épaules aux endroits qui ne
sont pas navigables ou pour le transporter d'un
cours d'eau à un autre. Les villages ou les
campements sont naturellement situés au bord
des eaux, en tout cas à peu de distance.
Mais l'été est court ; on ne
peut guère compter que sur cinq mois de
navigation. Pendant les sept autres, le seul mode
de locomotion est le traîneau et la seule
bête de trait le chien.
À mesure que les années
s'écoulaient, ma paroisse prenait des
proportions plus considérables ; du
nord au sud, elle s'étendait sur un maximum
de huit cents kilomètres et, dans le sens
opposé, sur plus de cinq cent cinquante.
Durant l'hiver mes attelages de chiens me
transportaient d'un point à l'autre de ce
vaste district. Au premier abord cela ne me
semblait pas sérieux et j'éprouvais
comme un sentiment de révolte à cette
nécessité qui avait l'air d'un
amusement ; mais je dus bientôt
reconnaître que le système
n'était point méprisable et que je
n'avais pas toujours eu à ma disposition des
coursiers d'autant de valeur.
Les chiens qu'on emploie
généralement sont de la race
esquimau, bien que dans certaines parties du pays
ils aient été tellement
croisés avec d'autres variétés
qu'ils soient à peine reconnaissables. La
race pure est robuste et bien bâtie, chaque
individu pesant de trente-cinq a cinquante-cinq
kilogrammes. Leur robe bien fournie, chaude,
semblable à une fourrure, varie de couleur.
Leurs oreilles sont courtes et pointues, leur queue
touffue et frisée. Ce sont les voleurs les
plus fieffés. Je n'ai jamais réussi
à en détourner aucun
entièrement de cette funeste habitude ;
elle semble faire partie de leur
nature. J'en ai acheté de tout jeunes et les
ai nourris abondamment, essayant patiemment de les
élever dans la bonne voie, mais je n'ai
jamais pu obtenir qu'ils y restassent ; ils
voulaient voler et Ils volaient chaque fois que
l'occasion se présentait.
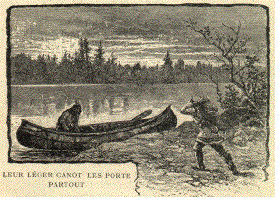 LEUR
LÉGER CANOT LES PORTE PARTOUT
LEUR
LÉGER CANOT LES PORTE PARTOUT
Ce grave défaut peut provenir de la
négligence constante et incurable avec
laquelle leurs maîtres les traitent presque
toujours. En un sens, ils les aiment et ne s'en
séparent pas volontiers, si ce n'est pour un
bon prix, cependant, à
part le moment où ils les emploient, ils les
nourrissent très rarement. Ces pauvres
bêtes sont donc réduites à
vivre de rapine. La pêche ou la chasse
ont-elles été fructueuses, les chiens
comme leurs maîtres sont gras et
prospères, les vivres deviennent-ils rares,
la ration du chien est la première
supprimée. Lorsqu'une troupe de Peaux-Rouges
errante et païenne visitait en passant notre
village, un coup d'oeil sur eux et leurs attelages
nous révélait de suite comment leurs
affaires avaient marché. Si les uns et les
autres avaient bonne tournure et se montraient de
bonne composition, c'est qu'ils avaient
trouvé abondance de nourriture. Mais si,
tandis que les hommes avaient une apparence pas
trop mauvaise, les bêtes étaient
maigres et que leur allure rappelât celle du
loup, cela indiquait une prospérité
très relative. Enfin si les hommes
étaient chétifs et
décharnés, les chiens avaient
habituellement disparu ; les temps ayant
été durs, on avait été
réduit à les manger pour se maintenir
soi-même en vie.
Ils dévorent absolument tout ce
qui est mangeable et même bien des choses qui
semblent ne l'être à aucun
degré ; ils hurlaient de satisfaction
lorsque de vieux mocassins de cuir, des harnais,
fouets, bonnets de fourrure ou
autres objets de ce genre tombaient en leur
possession ; ils les dévoraient avec
avidité. Une fois rassasiés, ils
enterraient avec beaucoup de ruse ce qui pouvait
être de reste. En été, ils
entreprennent volontiers de lointaines
expéditions de pêche. Au cours de
l'une de mes tournées, j'en rencontrai un
jour une troupe à plus de cent cinquante
kilomètres de chez leur propriétaire.
À première vue, de loin, nous les
avions pris pour des fauves et nous étions
préparés à la lutte, mais
l'oeil exercé de mes compagnons discerna
bientôt ce qui en était ; alors,
déposant nos fusils, nous passâmes un
moment à les examiner. À ma grande
surprise, je vis qu'ils péchaient pour leur
propre compte et, comme cela m'était
nouveau, je les regardai faire avec beaucoup
d'intérêt. Le long de la
rivière se trouvait une espèce de
marais garni de roseaux où la profondeur de
l'eau variait de quelques pouces à un pied.
Ces basses eaux sont peuplées à
certaines saisons de différentes
variétés de poissons et surtout du
Jackfish ou brochet qui mesure volontiers plus d'un
mètre ; parfois leur nageoire dorsale
dépasse le niveau peu élevé de
l'eau, le chien l'aperçoit aisément,
il nage doucement dans sa direction et le saisit.
En dépit de ses
résistances, il est porté en triomphe
sur la rive et dévoré de la belle
façon. Après quelques semaines de ces
parties de pêche, les chiens
réintègrent leur domicile en beaucoup
meilleur état qu'ils ne l'avaient
quitté.
Pendant l'hiver de la première
révolte des Riel où tous les vivres
nous avaient été coupés, ma
brave femme et moi nous étions las de nous
nourrir vingt et une fois par semaine de poisson,
remplacé seulement de temps à autre
par un quartier de chat sauvage ou un bouillon de
rats musqués ; aussi,
l'été venu, lorsque j'eus à me
rendre à l'établissement de la
Rivière Rouge, je fis emplette d'un mouton
que je ramenai avec mille précautions et
installai dans un enclos palissadé de quatre
mètres de haut. Les chiens surent y
pénétrer et s'en
régalèrent. L'été
suivant, je ramenai un couple de porcs ; je
les mis dans une petite construction en troncs
d'arbres munie d'une porte en planches de deux
pouces d'épaisseur. Une nuit, mes affreux
voleurs pratiquèrent de leurs dents
acérées un trou dans cette porte et
mes porcs furent engloutis à leur tour. Au
fait, Ils tenaient pas mal du loup. Beaucoup
d'entre eux ne montraient point d'attachement pour
leurs maîtres et l'on ne pouvait jamais se
fier entièrement à eux.
Cependant je fis l'expérience
que, même avec ces animaux, la douceur et la
patience étaient plus efficaces que la
rigueur pour leur enseigner ce qu'on attendait
d'eux et les amener à accepter leur
situation. Il en est qui sont naturellement
paresseux, leur éducation offre donc une
occasion de premier choix pour l'exercice de la
vertu cardinale qu'est la patience.
Comme mon oeuvre s'étendait de
plus en plus, je compris que pour visiter tous ceux
qui soupiraient après la Parole de vie,
j'aurais à circuler presque tout l'hiver et
que, même en faisant pour le mieux, je
n'arriverais pas à visiter plus de deux fois
par an les groupements les plus
éloignés. Après quelques
expériences déplorables avec les
chiens indigènes et pendant une
période d'intenses souffrances dans une de
ces terribles tournées en plein hiver, je me
pris à songer aux magnifiques Saint-Bernard
et Terre-Neuve que j'avais vus en pays
civilisés, auxquels on ne demande rien en
retour des soins et de l'affection qu'on leur
prodigue. Dès mon retour chez moi, je tentai
quelques démarches pour m'en procurer. Mes
directeurs furent surpris et amusés de ce
qu'on appela « mon unique
requête » ; cependant,
grâce aux bons offices de quelques-uns
d'entre eux et de quelques amis, je me trouvai, au
début de la saison
suivante, à la tête d'une petite
troupe de splendides animaux qui devaient
singulièrement faciliter ma tache. Avec ce
nouvel équipage bien dressé, je
pouvais si bien abréger mon voyage de cinq
cents kilomètres, qu'au lieu de sept ou huit
nuits que je passais à grelotter dans une
tanière creusée dans la neige, je
n'en avais plus que quatre ou cinq. Ceux qui savent
ce que sont les campements dans la forêt par
une température de trente-cinq à
cinquante degrés centigrades au-dessous de
zéro, conviendront que deux ou trois nuits
de gagnées, ce n'était pas
rien !
L'expérience m'apprit que les
races du Saint-Bernard et de Terre-Neuve ont toutes
les qualités et aucun des défauts de
l'esquimau. La bonté unie à la
fermeté les domptait facilement ;
dès lors le fouet ne servait plus que comme
appendice décoratif du pittoresque
équipement du conducteur. J'eus quelquefois
jusqu'à vingt de ces braves bêtes
à ma disposition. Le plus grand et le
meilleur de tous était Jack, un
Saint-Bernard à la robe de jais de
trente-trois pouces, - quatre-vingt-trois
centimètres - de haut à
l'épaule.
Bien soigné pour le travail, il
pesait soixante-quinze kilos. Il était sans
pair dans toute cette région boréale.
À plusieurs reprises il me sauva la vie,
ainsi que je le raconterai plus
tard. Jamais le fouet n'effleura sa belle fourrure.
Aucun danger ne pouvait le distraire de son travail
lorsque sa remarquable intelligence lui avait fait
saisir ce qu'on attendait de lui. Aucune
tempête, si traîtresse et capricieuse
ou si violente fût-elle, ne le retenait loin
du campement projeté, lors même que
ses compagnons de labeur eussent failli et que les
guides eux-mêmes abandonnassent la
partie.
La distance que nous pouvions franchir
dépendait naturellement beaucoup de la
contrée que nous avions à traverser.
Sur la surface gelée du Winnipeg, pour peu
que la tourmente ne nous aveuglât pas, que
notre attelage fût bon et notre chargement
pas trop lourd, nous courions cent vingt à
cent cinquante kilomètres par jour. Un
hiver, j'allai de Fort-Garry à Norway-House
six cent cinquante kilomètres - en cinq
jours et demi. Lorsqu'il fallait nous frayer un
chemin dans la neige, à travers
d'épaisses forêts ou dans une
région sillonnée de ravins et de
collines, c'était naturellement bien
différent.
Le traîneau consiste en deux
planches de chêne ou de bouleau d'un pouce ou
un pouce et demi d'épaisseur et de quatre
mètres de long. On les
pose à huit ou neuf pouces de distance et on
les assujettit solidement l'une à l'autre
part des traverses. Puis l'une des
extrémités est amincie au rabot et
soumise à l'action de la vapeur ou de l'eau
chaude jusqu'à ce qu'on puisse
aisément la courber de manière
à former ce qu'on appelle la tête du
véhicule. On les rabote de nouveau, on y
place des boucles qui serviront, celles du devant
à fixer les traits des chiens, celles des
côtés à assujettir le
chargement. Une fois terminé, un bon
traîneau mesure neuf à dix pieds de
long - trois mètres - et seize à
dix-huit pouces - quarante-cinq centimètres
- de large. Quelquefois il est pourvu de
côtés en parchemin et d'un dossier
confortable ; on le nomme alors
carriole.
Lorsque mon attelage était assez
fort, que la vole était suffisamment
foulée ou que nous parcourions la surface
des grands lacs gelés, je pouvais me faire
traîner la plus grande partie du temps ;
ce n'était alors ni fatigant ni
désagréable. Mais tout aussi souvent
mes itinéraires d'hiver me conduisaient dans
de vastes forêts où abondaient les
arbres morts et tombés et où les
vivants se serraient étroitement les uns
contre les autres. Par surcroît, ils
s'étendaient volontiers aux flancs de
collines escarpées et la neige y atteignait
par endroits de grandes
hauteurs. J'étais alors contraint de marcher
et même il me fallait aider mes hommes
à fouler la neige pour que les pauvres
chiens pussent tirer leur lourde charge.
Quatre chiens constituent un attelage on
les dispose en tandem, précisément
à cause des forêts qui couvrent toute
cette immense contrée au nord des prairies.
La manière esquimau qui consiste à
donner un trait à chaque animal et à
les laisser se déployer en éventail
n'est pas praticable ici. Le harnais, en peau
d'élan, est souvent orné de rubans et
de clochettes qui font leur joie et les excitent
à la course. À tel d'entre eux on ne
pouvait infliger de correction plus sensible que de
lui enlever ses sonnailles. C'est du chef de file
que dépend dans une grande mesure
l'agrément, le succès et même
la sécurité de la caravane ;
aussi un bon leader a-t-il sa valeur. Il en est
d'assez intelligents pour n'avoir pas besoin de
guide humain, sauf pourtant sur les pistes mal
tracées dans les fourrés
épais. J'en avais un certain blanc, haut sur
pattes, de race mélangée, qui
semblait toujours considérer le guide comme
gênant, lorsqu'une fois sa grosse tête
avait saisi ma pensée.
Dépouillé de son harnais,
Vieux-Routier, comme nous l'appelions, était
une brute insociable, éminemment
maussade et obstinée, si
difficile à aborder que, pour pouvoir le
saisir, nous lui faisions
généralement traîner une corde
de vingt mètres. Lorsque nous voulions
l'approcher, nous partions dans la direction
opposée, car il n'était jamais
disposé à se laisser prendre et
rusait comme un renard. Nous errions de ci, de
là, jusqu'à ce qu'il ne prît
plus garde à nos mouvements ; alors
nous pouvions attraper l'extrémité de
sa corde et l'attirer à nous. Une fois sous
son collier et à la tête de la troupe,
il était sans rival. Quel que fût le
nombre des traîneaux voyageant ensemble,
personne n'avait l'idée de passer devant
lui. Sur le lac Winnipeg dont la côte est
découpée de larges et profondes
baies, les traîneaux passent en
général en ligne droite d'un
promontoire à l'autre. Après nous
être arrêtés sur tel d'entre eux
pour prendre notre repas ou pour le campement de
nuit, nous n'avions qu'à tourner sa
tête dans la direction voulue et lui montrer
le point à atteindre, il y filait sans
dévier.
Si j'entre dans tous ces détails,
c'est que ce mode de voyager est peu connu en
dehors du pays où il se pratique et que sans
doute il appartiendra bientôt au
passé ; à mesure que les natifs
se fixent dans leurs Réserves, chaque tribu
ou peuplade reçoit un missionnaire à
demeure et ces longues et
pénibles pérégrinations ne
seront plus aussi nécessaires.

Les compagnons humains de mes longues excursions
étaient les fameux coureurs indiens du nord.
Celui qui jouait le rôle principal portait le
titre de guide. C'est à lui qu'incombait la
responsabilité de nous conduire par la voie
la plus sûre et la plus courte auprès
de la tribu à laquelle nous voulions porter
le message du salut. Il précédait les
chiens, à moins qu'un sentier bien battu ou
une surface gelée ne leur permit de se
conduire seuls. Plusieurs de ces hommes
étaient merveilleusement doués. Que
le lecteur se souvienne qu'en général
nous ne trouvions aucune route, ni même aucun
vestige de sentier ; durant plusieurs
étapes successives, le guide ne rencontrait
aucune autre trace que celle des fauves. Souvent le
trajet entier devait s'effectuer dans les
épaisses forêts encore vierges dont je
parlais tout à l'heure et dans une neige
épaisse. Il était entendu que notre
conducteur, muni de ses larges raquettes, devait
triompher de tous les obstacles, nous tirer de tous
les mauvais pas et que nous n'avions qu'à le
suivre avec toute la rapidité que
permettaient la charge de nos
traîneaux ou nos membres
fatigués et parfois blessés. Ces
hommes vaillants avançaient toujours, sans
nulle hésitation et sans délai
inutile. Cependant, à certains moments, les
vastes étendues de neige reflétaient
les rayons du soleil avec tant d'éclat que
nos yeux ne pouvaient littéralement le
supporter et que nous étions contraints de
nous arrêter. Les yeux noirs des
indigènes sont extrêmement sensibles
à ce malaise qu'ils appellent aveuglement de
neige et qui est en effet très
douloureux ; je puis le dire par
expérience. Il semble qu'on vous jette du
sable brûlant sur le globe de l'oeil. Mes
fidèles conducteurs en souffraient parfois
si cruellement que, si stoïques qu'ils soient
par nature, je les entendais gémir et
même parfois pleurer comme des enfants. Un
jour, près du lac Oxford, nous
rencontrâmes deux natifs que cet
éblouissement avait rendus
complètement aveugles. Heureusement ils
étaient parvenus à atteindre la
forêt, à y camper et à se
préparer un peu de nourriture avant que leur
cécité fût devenue
complète. Nous nous détournâmes
de notre itinéraire pour les conduire
auprès de leur tribu.
Pour éviter ce danger redoutable,
surtout en mars et avril, alors que les jours
s'allongent et que les rayons du soleil ont
une grande puissance, il nous
arrivait de ne voyager que de nuit. Au coucher du
soleil nous levions le camp. À minuit,
à la clarté des étoiles ou de
l'aurore, nous ramassions à tâtons du
bois mort ou de l'écorce de bouleau et nous
allumions du feu pour cuire le souper, puis nous
reprenions notre marche jusqu'à ce que le
matin commençât à luire. Alors,
après avoir déjeuné et
prié, on s'endormait jusqu'à ce que
l'éclat du soleil eût
passé.
Il me semblait que la tache des guides
devenait alors bien plus difficile encore ;
cependant ils m'assuraient que non. En effet, que
les étoiles étincelassent dans le
beau ciel arctique ou que les nuages le couvrissent
d'un voile noir, ils pointaient au but avec une
exactitude parfaite.
Parfois l'aurore boréale
éclatait, d'une splendeur indescriptible.
Par moments, le firmament dans son entier
était comme incendié de sa
lumière légère, puis
différentes parties du ciel s'illuminaient
successivement de ses puissantes colonnes toujours
changeantes. Les plus grandioses productions de la
pyrotechnie pâlissent et deviennent
insignifiantes en regard de ces visions de gloire
céleste. Il m'est arrivé d'en
être saisi et impressionné à
tel point, des heures durant, que j'en perdais le
sens des lieux ; j'aurais été
incapable de m'orienter. Le
guide, lui, était si absorbé par sa
tâche qu'il n'en éprouvait aucun
trouble ; cette constatation m'a souvent
surpris, car les indigènes de ces
contrées ont un sentiment très vif
des beautés de la nature. Ils sont
très sensibles et leurs âmes sont
pleines de poésie, comme le prouvent les
noms expressifs qu'ils savent se donner. Comme
païens, ils voyaient dans les grandes barres
colorées et scintillantes de l'aurore
boréale les esprits de leurs ancêtres
se précipitant à la bataille et ces
visions merveilleuses de la nuit les
intéressaient intensément.
J'ai conservé de la plupart de
mes guides et compagnons un excellent souvenir.
Sauf de rares exceptions, ils m'ont servi
loyalement et ceux qui étaient
chrétiens se réjouissaient avec moi
de pouvoir, au cours de ces longs voyages, porter
la lumière à leurs
congénères encore plongés dans
la nuit du paganisme, mais qui désiraient
avec ardeur en sortir. Il s'en trouva plus d'un
parmi eux qui n'était pas embarrassé
pour joindre ses exhortations aux miennes et tous
pouvaient, à l'exemple de Paul, raconter
comment ils avaient trouvé le Sauveur. Mon
coeur bat plus fort au souvenir de ces serviteurs
fidèles ; telle circonstance me revient
où ils ont exposé leur vie pour moi,
telle période de disette
où, durant plusieurs
jours consécutifs, ils se sont mis sans
ostentation au quart de ration pour que leur
bien-aimé missionnaire ne souffrît pas
de la faim. Plusieurs d'entre eux ont maintenant
achevé leur course. En suivant la voie
éclairée d'en haut et le guide par
excellence, ils ont franchi les cieux des aurores
boréales et des astres radieux, pour
atteindre le trône même de
l'Éternel.
|