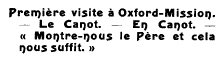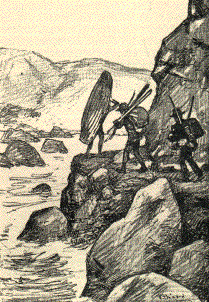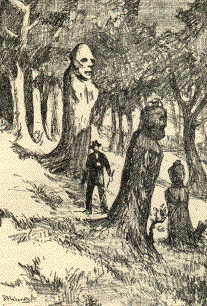En Canot et en traîneau
À CHIENS
Parmi les Indiens CREE et SALTEAUX
CHAPITRE VI
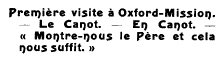
Mon comité m'avait recommandé
d'aller, aussitôt que je le pourrais, visiter
la mission d'Oxford qui, après une
période de prospérité,
était alors en souffrance. Un temple et une
maison missionnaire avaient été
construits à la Baie Jackson, et il y avait
eu un certain nombre de conversions mais ce village
était trop éloigné du poste de
la Compagnie, où les natifs se rassemblaient
tout naturellement pour leur commerce. Pendant
plusieurs années cette station avait
été confiée à un
évangéliste indigène, ce qui
était devenu à la longue une cause de
faiblesse.
Ayant donc pris tous les arrangements
nécessaires pour que ma propre station
n'eût pas à souffrir de mon absence,
je la quittai un beau jour en compagnie de deux
hommes dont l'un était
mon interprète. Ce fut pour moi la
première occasion de faire intime
connaissance avec cette merveilleuse petite machine
qu'est un canot d'écorce de bouleau. Dans ce
pays sauvage, aux vastes lacs, aux rivières
rapides, aux ruisseaux sinueux, il est de toutes
les embarcations la plus appropriée. Il est,
pour le Peau-Rouge de cette région, ce
qu'est le cheval pour son frère plus
belliqueux des vastes prairies et le chameau pour
l'habitant ou le voyageur de l'Arabie. Ici,
où il n'existe d'autre route que les cours
d'eau enchevêtrés, il est
indispensable. Quoique extrêmement
frêle, il peut être chargé
jusqu'au ras de l'eau et, sous l'habile direction
des natifs, qui sont sans contredit des canotiers
hors de pair, il répond au moindre mouvement
de l'aviron ou de la rame et semble doué de
vie et de raison. J'ai souvent été
absolument émerveillé du parti qu'ils
savent en tirer. Cependant, si nous nous souvenons
que tel d'entre ces chasseurs passe dans son canot
environ cinq mois de l'année, cela
s'explique en partie. Tantôt il porte son
homme, tantôt son homme le charge sur sa
tête, soit au delà de quelque chute ou
rapide, soit à l'emplacement où il
lui servira, la nuit, de refuge ou d'abri, car il
s'en couvre parfois pendant son sommeil. C'est lui
qui m'a permis de porter de lieu
en lieu la Bonne Nouvelle aux tribus errantes
disséminées dans mon vaste
diocèse. Avec lui j'ai franchi des milliers
de milles, tantôt sur des rivières
étroites et torrentueuses, tantôt sur
des lacs à une grande distance de tout
rivage. À travers les vagues
écumantes ou les vents menaçants et
traîtres, mes fidèles bateliers se
sont montrés à la hauteur de toutes
les situations. La sûreté de leur
jugement et la rapidité de leurs mouvements
leur faisaient toujours faire, au moment
précis, l'acte précis que
réclamait l'occurrence, si bien que j'en
vins à me sentir aussi à l'aise en
canot que n'importe où.
Sa construction exigeant pas mal
d'adresse et d'habileté, les bons
constructeurs sont peu nombreux et les canots
vraiment bien réussis sont très
recherchés. Pour dépouiller l'arbre
de son écorce, on y pratique
premièrement une longue incision verticale,
puis une autre horizontale tout autour du tronc
à la hauteur où commence la
première. Avec un couteau effilé on
la détache alors peu à peu d'un seul
morceau. Cette délicate opération
terminée les plus grandes précautions
sont nécessaires pour manier et transporter
la plaque d'écorce, car elle est des plus
fragiles. Lorsqu'on peut se procurer du
cèdre pour la carcasse en bois, on n'y
manque pas, mais, dans la
région que j'habitais, nous étions au
nord de la zone où il croît ;
aussi fallait-il se contenter du sapin en le
fendant très fin. Pour l'assemblage des
feuilles d'écorce et pour les fixer à
l'intérieur de cette carcasse, on se sert
des radicelles du larix, - variété de
pin, - qu'on a préalablement
mouillées et frottées jusqu'à
ce qu'elles aient atteint la flexibilité de
minces lanières de cuir. Une fois le travail
de couture achevé, on insère les
nombreuses petites pièces de sapin à
leurs différentes places, donnant à
l'ensemble les proportions et la force
requises ; puis les ajoutures et les parties
faibles sont enduites d'une poix que les indiens
tirent du sapin. Pour s'assurer que l'esquif est
parfaitement étanche, on le suspend entre
deux arbres et on le remplit d'eau. La moindre
fissure est marquée et soigneusement revue.
 POUR
DÉPOUILLER L'ARBRE DE SON'
ÉCORCE...
POUR
DÉPOUILLER L'ARBRE DE SON'
ÉCORCE...
Le style et les dimensions du canot varient.
Chaque tribu a son propre modèle
admirablement adapté au caractère de
ses eaux. Les plus grands et les plus beaux sont
ceux que faisaient autrefois les Indiens du Lac
Supérieur. Ces « grands canots du
nord », comme on les appelait, portaient
facilement une douzaine ou une vingtaine de rameurs
avec un chargement d'une couple de tonnes. Aux
jours anciens de la
rivalité des trafiquants en fourrures et
avant que les vapeurs ou même les grands
voiliers eussent pénétré sur
ces lacs arctiques, ils y jouaient un rôle
fort important. Chargés des riches
dépouilles des fauves
habitants des immenses forêts, ils
descendaient dans l'Ottawa et suivaient ce puissant
fleuve souvent même jusqu'à
Montréal. J'ai déjà fait
allusion aux expéditions fantastiques de Sir
George Simpson, le gouverneur énergique mais
despotique et sans principes de la Compagnie de la
Baie d'Hudson. C'est dans ces canots de bouleau
que, partant de Montréal, il remontait
l'Ottawa, atteignait la Baie Géorgienne par
le Lac Nipissing, puis, par le Lac
Supérieur, la Baie du Tonnerre. De
là, avec un courage indomptable, il
s'enfonçait dans l'intérieur,
traversant le Lac des Bois, suivant le fleuve
tourmenté du Winnipeg et franchissant dans
toute sa longueur le lac du même nom. Ainsi
faisait-il chaque année pour aller
présider le conseil de la plus riche des
compagnies de fourrures qui ait jamais
existé. Il veillait ses
intérêts avec un oeil d'aigle et
imprimait à chacun de ses
départements le cachet de sa forte
personnalité. De merveilleux récits
circulent autour des feux de bivouac sur
l'endurance et les exploits de son fameux
équipage iroquois. Aujourd'hui que de
puissants vapeurs sillonnent de toutes parts nos
grandes eaux, on a peine à croire que ces
expéditions invraisemblables comptent encore
des centaines de témoins vivants.
Nous partîmes pour Oxford-Mission
le 8 septembre. Nous avions à franchir plus
de trois cents kilomètres dans la
contrée la plus sauvage qu'on puisse
imaginer. Dans tout ce trajet nous
n'aperçûmes pas une seule habitation,
sauf pourtant celles des castors. Notre pagaie nous
conduisait à travers des sites plus
pittoresques les uns que les autres. À moins
que des vents violents ne vinssent nous contrarier,
nous pouvions courir de quatre-vingts à cent
kilomètres par jour.
À la tombée de la nuit,
nous campions sur le rivage, ce qui était
parfois très agréable et point
dépourvu de poésie mais lorsque la
tempête faisait rage et que la pluie nous
trempait de telle sorte que pendant bien des jours
nous n'avions plus sur nous un fil de sec, cela
nous paraissait moins poétique. Pour peu que
le temps fût favorable, nous nous mettions en
route de très bonne heure le matin,
avançant aussi rapidement que possible, dans
la pensée que le vent pouvait d'un instant
à l'autre se lever et entraver notre course.
Ce voyage n'avait vraiment rien de banal. Parfois,
à travers les lacs grands ou petits, les
pagayeurs s'aidaient d'une voile improvisée
avec l'une de mes couvertures fixée à
une paire d'avirons. Tantôt nous suivions de
larges et belles
rivières, tantôt
d'étroits ruisselets tout garnis de roseaux
et de joncs.
À neuf reprises il nous fallut
contourner des cataractes ou des rapides. Dans ces
occurrences, l'un des Indiens chargeait le canot
sur sa tête, l'autre faisait un ballot de la
literie et des provisions. Ma charge consistait en
deux fusils, les munitions, deux chaudrons, mon sac
d'effets de rechange et un paquet de livres
destinés aux indigènes que j'allais
visiter.
J'étais émerveillé
de la rapidité de la marche de mes hommes.
Souvent le sentier n'était qu'une
étroite corniche au flanc d'un énorme
rocher ; ailleurs il s'enfonçait dans
les marais mouvants. Pesamment chargés comme
ils l'étaient, avec leurs grandes
enjambées et le balancement propre à
leur race, ils ne tardaient pas à me laisser
loin en arrière. Dans certaines de mes
expéditions, les trajets à faire
ainsi étaient de plusieurs milles et
à travers des régions ou rien ne
pouvait m'orienter lorsque je me trouvais seul.
Alors je les suivais aussi longtemps que je savais
être dans la bonne voie. S'il m'arrivait de
la perdre, je m'arrêtais et attendais
patiemment que l'un d'eux, ayant
déposé sa charge au but, revînt
me chercher. Ramassant vivement la mienne, il
reprenait sa course et, même
débarrassé de tout
fardeau, c'était à peine si je
pouvais lui tenir pied.
Le lac d'Oxford est l'un des plus beaux
que j'aie jamais vus. Il a une cinquantaine de
kilomètres de long sur plusieurs de large.
Les eaux claires et transparentes sont
semées d'îles de toutes les formes.
Quand aucun souffle n'en ride la surface, on peut
voir ses profondeurs de cristal et les grands
poissons qui y circulent avec une sorte de
solennité. J'y amenai un jour un de nos
directeurs pour visiter la tribu qui pèche
dans ses eaux et chasse sur ses rivages. La course
avait été pénible.
Trempé par la pluie et harcelé par
les moustiques qui s'acharnaient contre lui, le
pauvre Docteur gémissait sur son malheureux
sort avec citations classiques à l'appui.
Cependant lorsque nous atteignîmes le lac,
l'engeance maudite nous laissa quelque
répit, le soleil parut dans sa splendeur et
nous pûmes jouir de quelques jours d'une rare
beauté. Le bon Docteur retrouva alors sa
sérénité coutumière et
rit de bon coeur lorsque je le raillai sur les
épithètes malsonnantes dont il
s'était servi pour qualifier cette
contrée. Je m'empressai de tirer la morale
qui devait ressortir pour lui de cette
expérience de quelques jours, à
savoir la sympathie qu'il était de son
devoir (comme de celui de tout
directeur de mission)
d'éprouver pour les missionnaires qui vivent
durant des années dans ces lieux
infestés.
Notre campement s'installa sur l'un des
points les plus ravissants, nous avions deux canots
manoeuvrés par quatre ressortissants de la
station de Norway-House. Comme le Docteur
était un pêcheur
émérite, il désira passer
là la matinée pour se livrer à
cet exercice. Sa première capture fut un
brochet de plus de deux pieds de long ; il en
fut tout excité ; son éloquence
native se donna libre carrière, nous en
fûmes comme inondés. Nos hommes le
regardaient tout ébahis tandis qu'il
célébrait le lac, les îles, le
ciel et les flots. - « Attendez, Docteur,
je puis ajouter à la sauvage beauté
de ce site une scène qui charmera vos yeux
d'artiste. » je fis alors partir un canot
monté par deux hommes pour une île qui
s'élevait abrupte au-dessus de l'onde claire
et profonde, couronnée d'un groupe charmant
de pins et de baumiers. Là, déployant
une longue canne à pêche et prenant
une attitude en harmonie avec le cadre, ils se
tinrent immobiles jusqu'à ce que toute ride
eût disparu de la surface du lac. Nous
pûmes alors contempler le tableau le plus
idéal. Le canot, les pêcheurs, les
îles et les rocs semblaient aussi
réels dans l'eau qu'au-dessus.
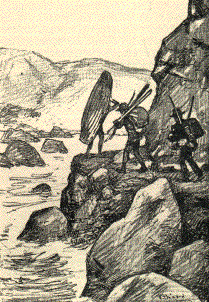 SOUVENT LE SENTIER N'ÉTAIT
QU'UNE ÉTROITE CORNICHE
SOUVENT LE SENTIER N'ÉTAIT
QU'UNE ÉTROITE CORNICHE
Aux points où l'air et
l'eau se rencontraient, on eût dit qu'un fil
seul les séparait. Aucun souffle n'agitait
ni l'un ni l'autre. C'était un de ces
spectacles d'un charme exceptionnel, tels qu'il est
rarement donné à l'homme d'en admirer
et dans lesquels Dieu nous donne un aperçu
de ce que notre terre a dû être avant
que le péché l'ait souillée.
Mon coeur était plein de louange et je
demandai à mon compagnon ce qu'il pensait de
cette vision. Se levant alors sur le grand rocher
qui nous portait, il donna libre cours à ses
sentiments ; sa voix d'abord émue
s'affermit peu à peu : « je
connais et j'aime les lacs de mon Écosse,
ceux de l'Irlande et de l'Angleterre ; j'ai
parcouru longtemps les splendides lacs
américains j'ai vu Tahoe dans sa
beauté cristalline j'ai ramé sur le
Bosphore et remonté le Nil en felucca ;
j'ai flâné en gondole sur les canaux
de Venise et sillonné la mer de
Galilée et l'antique Jourdain ; j'ai pu
contempler au cours de mes longs voyages bien des
sites d'une rare beauté.... celui-ci les
dépasse tous ! »
Jamais plus ce lac ne se présenta
ainsi à mes yeux. J'eus parfois à y
lutter plus que partout ailleurs contre les
éléments
déchaînés. Un jour, en fuyant
d'une île à l'autre, en nous tenant
autant que possible sous le vent, nous
perçâmes notre quille sur un
roc pointu ; il fallut
ramer désespérément vers le
rivage ; quand nous l'atteignîmes, il
était temps ; le canot était
à moitié rempli. Nous nous
hâtâmes d'allumer du feu et de faire
fondre de la poix pour réparer l'avarie.
Provisions et couvertures étaient
naturellement submergées.
En hiver, sur sa surface gelée,
les souffrances soit des hommes soit des chiens
étaient terribles. Une fois, en dépit
de tout ce dont j'avais pu m'envelopper qui
n'entravât pas ma marche - car le gel intense
rendait impossible tout moyen de locomotion -
toutes les parties de mon visage que je ne pouvais
garantir furent piteusement gelées ;
mon nez, mes joues, mes sourcils, mes lèvres
elles-mêmes, me firent souffrir ensuite
pendant des jours. Cuffy, le meilleur de mes
terre-neuve, eut les quatre pattes gelées et
même Jack, que je présenterai plus
tard au lecteur, en fut estropié pour
plusieurs jours. Mes fidèles guides
souffraient également et nous fûmes
d'accord pour affirmer que le vent glacé est
autrement éprouvant que les moustiques de
l'été, si pénibles
soient-ils.
Malgré ces inconvénients
très sérieux, c'était pour moi
une joie que de visiter deux fois par an -
l'été en canot, l'hiver avec le
concours de mes chiens - les habitants de cette
région. Dieu bénissait ces
visites. Les anciens membres de
la communauté étaient
fortifiés et réjouis par la
prédication de l'Évangile et la
participation aux sacrements et quelques
païens renonçaient à leur
mauvaise vie. Après moi deux de mes
collègues ont exerce là leur
ministère et maintenant c'est Edouard
Papanekis, un indigène, qui y remplit les
fonctions de missionnaire. Je l'avais connu
adolescent, insouciant et adonné au
péché. Un jour, sous l'action d'une
liqueur enivrante, il s'était
élancé chez moi, menaçant de
me frapper. Ensuite il s'était ouvert
à l'influence de l'Évangile et
j'avais eu la joie de le voir venir humilié
au pied de la croix. Plus tard le souhait de mon
coeur se réalisa : il annonce
aujourd'hui fidèlement cet Évangile
béni à ses compatriotes.
À mesure que je répondais
aux cris de Macédoniens qui retentissaient
autour de moi, mon district s'agrandissait et bien
souvent en voyage. Il m'arriva de lancer mon canot
au printemps, avant que les glaçons
flottants eussent disparu ; nous cheminions
alors dans les passages qu'ils laissaient libres,
ce qui présentait souvent un grand danger.
Ainsi, dans l'une de ces expéditions, les
champs mouvants de glace s'étendaient devant
nous sur des milles de longueur, un étroit
canal nous permettant seul la
circulation : nous nous y engageâmes
hardiment, désireux que nous étions
de poursuivre notre route. J'étais sans
crainte, connaissant la grande expérience de
mes mariniers, mais je m'attendais à voir du
nouveau et j'en vis effectivement !
Nous avions compté que le vent
élargirait notre canal, mais, après
avoir franchi quelque distance, force nous fut,
malgré notre désappointement, de
constater que la voie libre se
rétrécissait au contraire, d'une
manière lente et sûre la glace se
refermait autour de nous. Comme elle mesurait un
mètre cinquante ou deux mètres
d'épaisseur et qu'elle eût facilement
écrase un vaisseau de fort tonnage, notre
frêle canot d'écorce semblait
voué à une perte certaine. Je me
disais qu'au moment critique nous pourrions sauter
sur l'îlot de glace, mais ensuite
qu'adviendrait-il ? Mes Indiens demeurant
parfaitement calmes, je gardai pour moi mes
réflexions et continuai de ramer en
attendant la suite des événements.
Bientôt le canal eut à peine une
douzaine de mètres de large ;
derrière nous il s'était
refermé et nous entendions dans
différentes directions le frottement et le
craquement des énormes masses qui se
heurtaient. Peu après il était
réduit à six ou sept mètres et
mes hommes ramaient toujours sans se troubler et je
ramais à l'unisson. Quand
les parois qui nous enserraient se furent assez
rapprochées pour que nous puissions les
toucher de l'extrémité de nos deux
rames, l'un deux me dit :
« Missionnaire, donne-moi ta rame, je te
prie. » je la lui tendis vivement et il
s'empressa de la glisser avec la sienne sous le
canot tenant leur poignée dans l'eau de
telle sorte que leurs extrémités
plates se trouvassent en l'air du côté
opposé. Son camarade fit la même
manoeuvre de l'autre côté du canot.
Presque aussitôt la glace les toucha mais,
comme elles s'élevaient plus haut que sa
surface, elles s'y appliquèrent
naturellement ; c'est ce qu'avaient
prévu mes hommes, ils trouvaient un point
d'appui ; retirant lentement à eux les
poignées qu'ils tenaient submergées,
ils soulevèrent le canot au-dessus des
glaçons qui bientôt après se
rejoignirent au-dessous de nous avec un craquement
significatif. Nous nous trouvâmes ainsi
trônant sur l'élément solide
sans avoir quitté nos sièges et sans
que notre esquif eût éprouvé la
moindre avarie. J'exprimai chaleureusement à
mon équipage mon admiration pour ce haut
fait. Cependant il fallait nous hâter de
sortir du canot et de l'emporter loin de ces
parages dangereux. Non sans peine, nous
gagnâmes un rivage où nous dûmes
attendre patiemment pour
poursuivre notre voyage que le
vent et le soleil eussent ou raison de la
glace.
Mon plan était de passer au moins
une semaine dans chaque village ou campement
indigène, prêchant trois fois le jour,
tenant école pour les enfants et suppliant
hommes et femmes dans des entretiens particuliers
d'être réconciliés avec Dieu.
Cette tournée fut bénie. Au retour
nous eûmes mille peines à nous frayer
notre voie sur les lames écumeuses, glissant
de l'une à l'autre, tantôt sur une
crête élevée, tantôt
entre deux murailles mobiles. À un moment
donné le choc du canot contre la vague fut
si violent que la quille se fendit ;
naturellement l'eau pénétra
rapidement et d'autant plus que nous ramions
vigoureusement ; à chaque effort la
fente s'ouvrait et lui donnait passage.
J'étendis une couverture à
l'intérieur et m'agenouillai dessus pour
parer à cet inconvénient dans la
mesure du possible et l'un des hommes quittant la
rame se mit à puiser avec la bouilloire d'un
mouvement rapide et régulier pendant que
nous ramions de toutes nos forces pour notre
précieuse vie dans la direction des
îles des Araignées dont nous nous
trouvions à 1.500 mètres environ.
Grâce à Dieu, nous parvînmes
à y aborder et là nous pûmes
nous associer aux paroles du roi David
exprimées au Psaume CVII,
V. 26 à 28, mais ce ne fut qu'après
avoir tiré le canot sur le rivage et que, y
ayant péché tout ce qui s'y trouvait
et l'ayant retourné nous eûmes vu la
grande fente béante, que nous
réalisâmes l'étendue du danger
que nous avions couru et la portée de la
délivrance dont nous avions
été les objets. Alors mieux encore il
nous appartint de
« célébrer la bonté
de l'Éternel et ses merveilles parmi les
fils des hommes ».
Nous eûmes vite fait d'allumer du
feu, de faire fondre la poix dont les
indigènes ont toujours soin de se munir pour
de telles éventualités, d'y tremper
un morceau de drap qui fut étendu sur la
déchirure. On en versa encore par-dessus, en
séchant elle durcit rapidement. Après
avoir pris un peu de nourriture, nous le
lançâmes de nouveau et notre voyage
s'acheva sans autre incident sérieux.
À la joie d'avoir été des
hérauts de la croix dans des lieux si
reculés, s'ajouta la reconnaissance de nous
retrouver sains et saufs dans nos foyers.
Dans l'une de mes excursions en
quête de tribus païennes dans le
district de la rivière Nelson, j'en appris
long sur les intenses aspirations de leurs coeurs
enténébrés. Après dix
ou douze jours de voyage, au
campement du soir, pendant que mes hommes
très affairés cherchaient du bois et
préparaient le souper, j'escaladai une
colline boisée que je voyais à une
certaine distance. Arrivé au sommet, je fus
tout saisi de me trouver en présence des
preuves évidentes d'un grossier
paganisme.
Une épaisse forêt avait
recouvert cette éminence, mais environ le
tiers des arbres avaient été
coupés à un mètre cinquante,
deux mètres ou trois mètres du sol et
ces fûts avaient été
grossièrement taillés en formes
humaines. Des fours à chiens étaient
disséminés entre eux - simples trous
creusés dans le sol et garnis de pierres
dans lesquels, à certaines saisons et
d'après certains rites religieux, les natifs
faisaient rôtir quelques-uns de leurs chiens
favoris, les blancs de préférence,
puis ils les dévoraient au milieu de
beaucoup d'excitation. Çà et
là s'élevaient les tentes des vieux
conjureurs et
« médecins », lesquels,
en combinant quelque connaissance des maladies et
de tel ou tel moyen curatif avec une grande dose
d'abominables superstitions, maintenaient le peuple
dans une grande crainte. C'étaient pour la
plupart de vieux paresseux qui s'entendaient, par
la terreur qu'ils inspiraient à leurs
compatriotes, à faire affluer de leur
côté les cadeaux en poisson et en
gibier de choix. Ils
possèdent l'art, qui est un secret
professionnel, de composer quelques poisons si
meurtriers qu'il suffit d'une quantité des
plus minimes, introduite dans les aliments de la
personne qui a encouru leur déplaisir, pour
causer sa mort aussi rapidement qu'avec une dose de
strychnine.
D'autres de leurs drogues, au lieu de
causer la mort immédiate de leurs victimes,
les affectent et les défigurent à tel
point que, jusqu'à ce que la mort vienne les
délivrer, leurs souffrances sont atroces et
leur aspect terrifiant. Tous les tristes indices de
la condition déplorable de ce peuple
étaient là épars autour de
moi. J'allais d'une idole à l'autre,
constatant que la plupart avaient, soit devant
elles, soit sur leurs têtes plates, des
offrandes de tabac, de nourriture, de coton rouge,
etc. Mon coeur était douloureusement
impressionné et je sentais
profondément à quel point j'avais
besoin de la sagesse et du secours d'en haut pour
pouvoir, lorsque je rencontrerais les gens de la
tribu qui adorait là ses idoles, leur
présenter Christ de telle sorte qu'ils
fussent pour ainsi dire contraints de l'accepter
comme leur Sauveur. Tandis que j'étais
là, absorbé dans mes
réflexions et dans ma prière, les
ombres de la nuit tombèrent sur moi et
m'enveloppèrent puis la pleine lune se leva
à l'orient et ses rayons
d'argent brillant à travers les arbres sur
ces figures grotesques, la scène
revêtit un aspect plus étrange encore.
Lorsque je retournai à notre bivouac, mes
amis indiens, alarmés de ma longue absence,
vu que la contrée était
infestée de bêtes féroces,
étaient venus à ma recherche. Peu
après nous prenions notre repas, puis,
après avoir chanté un cantique et uni
nos prières, nous nous enveloppions dans,
nos couvertures et nous étendions sur le roc
pour passer la nuit. Malgré que la couche
fût dure et qu'aucun toit ne nous
abritât, notre sommeil fut doux, car la
journée avait été fatigante et
point dépourvue d'émotions.
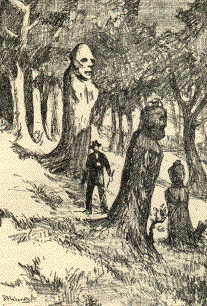 LA
SCÈNE REVÊTÎT UN ASPECT PLUS
ÉTRANGE ENCORE
LA
SCÈNE REVÊTÎT UN ASPECT PLUS
ÉTRANGE ENCORE
Le jour suivant, à soixante-cinq
kilomètres de là, nous
rencontrâmes les habitants de cette partie du
pays et nous nous établîmes au milieu
d'eux pour plusieurs semaines. Ils me
reçurent tous avec beaucoup de
cordialité, à l'exception des vieux
conjureurs qui nourrissaient à mon
égard des sentiments analogues à ceux
des fabricants des petits temples
d'Éphèse. Ils tremblaient pour leur
métier, car ils n'ignoraient pas que, si je
réussissais à persuader leurs
compatriotes de devenir chrétiens, c'en
serait fait de leur prestige et que, s'ils ne
voulaient mourir de faim, ils seraient
réduits à se mettre au travail.
Je les visitai comme les autres
habitants du camp, mais leur coeur était
plein d'inimitié bien que je n'eusse pas
connaissance de tous leurs efforts pour me nuire et
même pour se débarrasser de ma
personne, je comprenais bien qu'ils étaient
menaçants. Cependant celui qui a dit :
« Voici je suis avec vous tous les
jours, » veillait
miséricordieusement sur moi et me
protégea contre leurs mauvais desseins. Mes
deux fidèles compagnons montaient la garde
et priaient avec une vigilance inlassable. Leur
loyauté et leur dévouement pendant
ces longs voyages n'auraient pu être plus
complets et me laissent un précieux
souvenir. Tout ce qui pouvait être fait pour
ma sécurité ou pour ma satisfaction,
ils le faisaient de bon coeur et
gracieusement.
Nous avions chaque jour trois services
religieux et entre temps nous apprenions aux gens
à lire les caractères
syllabiques.
Un jour, en conversant avec un vieillard
à la figure intelligente et sympathique, je
lui demandai :
« Quelle est ta
religion ? Si tu en as quelque idée
claire, dis-moi quelle est ta croyance.
- Nous croyons en un bon Esprit et en un
mauvais.
- Et pourquoi donc, repris-je,
n'adorez-vous pas le bon Esprit ? J'ai
traversé vos lieux
sacrés et j'ai vu les arbres que vous avez
coupés. Vous en avez employé une
partie pour cuire votre viande d'ours ou de daim,
et du reste vous avez fait une idole que vous
adorez. Comment une partie de l'arbre est-elle plus
sacrée que l'autre, et pourquoi d'ailleurs
fabriquez-vous et adorez-vous des
idoles ? » Je n'oublierai jamais sa
réponse ni le ton impressif, presque
passionné dont il la fit :
« Missionnaire, l'esprit de
l'Indien est obscur : il ne peut saisir
l'invisible. Il entend la voix du grand Esprit dans
le tonnerre et dans la tempête. Il voit tout
autour de lui les preuves de son existence, mais ni
lui ni ses pères ne l'ont jamais vu ;
ils n'ont jamais rencontré non plus
quelqu'un qui l'eût vu, ainsi il ne peut
savoir à quoi il ressemble ; mais
l'homme étant de toutes les créatures
celle qui est la plus élevée, il
donne à ses idoles l'apparence humaine. Nous
ne les adorons que parce que nous ne savons pas
comment nous représenter le grand
Esprit. »
Soudain la requête de Philippe au
Seigneur Jésus se présenta à
ma mémoire : « Montre-nous le
Père et cela nous suffit », et la
merveilleuse réponse qu'il
reçut : « Il y a si longtemps
que je suis avec vous et tu ne m'as pas
connu ! Philippe, celui qui m'a vu a vu mon
Père ; comment montre-nous le
Père ? » J'ouvris ma Bible
indienne à ce magnifique aperçu
d'amour désintéressé (le XIVe
chapitre de St-Jean) et leur annonçai
Jésus dans sa double nature divine et
humaine. Tout en proclamant l'oeuvre
rédemptrice du Fils de Dieu, je parlai de
Lui comme de notre frère aîné
intimement uni à nous, qui ne demande
qu'à nous délivrer de nos
perplexités et de nos doutes aussi bien que
de notre péché, et qui conserve sa
forme humaine pour intervenir maintenant en notre
faveur devant le trône de son Père.
J'insistai sur ces vérités
bénies et montrai comment l'amour du Christ
l'a tellement rapproché de nous qu'avec le
regard de la foi nous pouvons le voir et en Lui
Dieu le Père dont notre coeur est
altéré... « Lequel vous
aimez quoi que vous ne l'ayez point vu, est-il
dit ; en qui vous croyez quoique vous ne le
voyiez point encore et, en croyant, vous vous
réjouissez, d'une joie ineffable et
glorieuse. »
Durant bien des jours je ne cherchai pas
d'autre texte. Ils m'écoutaient
attentivement et le Saint-Esprit appliquait ces
enseignements à leurs coeurs et à
leurs consciences de telle sorte qu'ils les
reçurent. Quelques visites
subséquentes les enracinèrent dans la
vérité. Ils ont dès lors
abattu leurs idoles, comblé les fours
à chiens,
déchiré les tentes des conjureurs,
nettoyé la forêt de tout vestige de
leur ancienne vie. Et là même
où ils célébraient leurs rites
païens au milieu d'horribles orgies et de
hurlements, où les crécelles et le
roulement des tambours des conjureurs
retentissaient jour et nuit, s'élève
aujourd'hui un petit temple où ces
mêmes hommes, transformés par le
glorieux Évangile du Fils de Dieu, sont
assis a ses pieds « habillés et
dans leur bon sens ».
Je me convainquis bientôt de la
nécessité d'envoyer là un
missionnaire qui pût y séjourner, et
en réponse à mes appels Dieu mit au
coeur du révérend Semmens, qui
était venu m'aider à Norway-House,
d'aller se fixer au milieu d'eux. Il était
animé d'un zèle ardent et
parfaitement qualifié pour ce
ministère ardu, mais mes paroles sont
impuissantes à décrire les
souffrances qu'il eut à endurer ; elles
sont inscrites là haut, le Maître qui
les connaît se chargera de lui donner la
récompense, C'est à ses efforts
personnels qu'est due l'érection du temple
dont je viens de parler. La dernière lettre
que j'ai reçue de ce pays contient les
nouvelles les plus réjouissantes.
« Le désert et le lieu aride se
réjouiront, la solitude s'égaiera et
fleurira comme un narcisse. » Cette
prophétie s'est magnifiquement
réalisée et rend
insignifiantes les privations et les souffrances
que j'ai pu endurer moi-même dans mon travail
de pionnier au début de cette oeuvre. D'un
coeur joyeux, je dis avec l'apôtre
Paul : « C'est à moi, le
moindre de tous les saints, qu'a été
donnée cette grâce d'annoncer parmi
les gentils les richesses incompréhensibles
du Christ. »
|