En Canot et en traîneau
À CHIENS
Parmi les Indiens CREE et SALTEAUX
CHAPITRE VIII
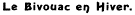
En janvier 1869, je partis pour ma
première expédition d'hiver à
Nelson River. Il y avait là des natifs qui
n'avaient jamais encore vu ni entendu de
missionnaire. Leurs principaux groupements se
trouvaient aux entours du petit port de commerce de
la Burut-Wood River. Leurs chasses
s'étendaient très loin dans la
direction du nord jusqu'à la limite de
celles des Esquimaux avec lesquels toutefois les
Indiens n'ont aucune relation. Il n'y a pas trace
d'affinité entre ces deux races voisines,
qui diffèrent entièrement
d'apparence, de langage, de coutumes et de
croyances. Quoiqu'elles soient rarement en
hostilités ouvertes, elles sont plus
rarement encore en paix et, en
général, elles se tiennent aussi
éloignées que possible l'une de
l'autre. Il faisait amèrement froid puisque
le thermomètre marquait de trente-cinq
à cinquante-cinq degrés Farenheit
au-dessous de zéro -
trente-huit à quarante-huit degrés
centigrades.
Nous pointions invariablement sur le
nord, traversant tantôt d'immenses
forêts riches en gibier à poil dont
nous apercevions souvent les traces - parfois aussi
nous tombions sur celles de leurs chasseurs -
tantôt de petits lacs, au nombre d'une
trentaine, dont la largeur variait de un à
cinquante kilomètres. Là, nous
pouvions nous accorder le luxe de monter dans nos
véhicules et nos chiens nous menaient grand
train, tandis que sur terre ferme notre marche ne
pouvait être que très lente et que, le
plus souvent, nous étions tous à la
tête de la colonne, piétinant et
foulant la neige et nous servant de nos haches pour
frayer un sentier aux traîneaux pesamment
chargés. Rude tâche ! Il me
fallait déployer toute mon agilité,
ici pour escalader des arbres tombés,
là pour ramper sous d'autres qui ne
touchaient pas terre. À ce labeur, nos
figures s'écorchaient et nos pieds se
meurtrissaient. Du reste les courroies de mes
raquettes lacéraient si bien mes pauvres
pieds, que le sang en coulait au travers de ma
chaussure et le tissu de la raquette et marquait
parfois notre sentier. Nous voyagions toujours en
file indienne. Lorsque je fus devenu capable de
conduire un attelage, ma place
était en tête, derrière le
guide, trois autres traîneaux suivaient,
conduits par trois indigènes.
J'ai fait allusion à nos lourdes
charges, c'est que les contrées que nous
avions à traverser étaient parmi les
plus désolées et les moins
peuplées du globe, sur des parcours
considérables, on n'y rencontre aucune
habitation, très rarement un chasseur
isolé dont on ne peut attendre aucun
secours. Aussi, en dépit de toutes nos
combinaisons pour prendre seulement
l'indispensable, nous ne pouvions autrement que
d'avoir beaucoup de bagages : provisions
personnelles, provisions des chiens, chaudrons,
vaisselle d'étain, haches, literie, fusils,
vêtements de rechange et tant de choses qui
devaient nous mettre en mesure de faire face aux
éventualités.
La seule provende de nos coursiers
représentait, pour une expédition
d'une semaine, cent à cent vingt livres par
attelage, c'est-à-dire par traîneau,
chaque chien consommant, à son unique repas,
deux bons poissons blancs de quatre à six
livres. Quant aux humains, la température
rigoureuse et l'exercice violent auquel ils se
livraient leur procuraient un appétit solide
qui nécessitait également un poids
considérable de vivres.
Pour nos bêtes, il nous fallait
aussi un assortiment de
chaussures. Leurs pattes sont délicates et
sujettes à bien des accidents ; elles
s'usent parfois jusqu'au sang sur la glace polie
tandis que, dans les lieux raboteux, elles perdent
facilement un ongle ou sont coupées par des
échardes qui s'insinuent dans la
palmure ; il arrivait que de vieilles
bêtes qui avaient éprouvé les
services que peut rendre un soulier,
arrêtassent subitement tout le convoi et, en
présentant une patte malade, en disaient
avec beaucoup d'éloquence, quoique sans
paroles, le motif. Lorsqu'on lui avait
enfilé l'espèce de moufle de laine et
qu'on l'avait solidement fixée avec un
morceau de peau souple, l'animal
s'élançait vivement à sa
tâche, témoignant sa gratitude par de
joyeux aboiements. Quelques-uns tiennent tellement
à ces chaussons douillets, qu'on les voit la
nuit quitter leur trou dans la neige et contraindre
leurs maîtres à se lever pour en
pourvoir leurs quatre membres. Ce n'est
qu'après cette opération qu'ils
réintègrent leur tanière en
donnant toutes les marques d'une reconnaissance
émue.
Nous stoppions
généralement une demi-heure avant le
coucher du soleil pour avoir le temps de
préparer notre campement avant que
l'obscurité nous enveloppât. Tout en
marchant, nous avions pu nous
apercevoir, depuis un temps plus
ou moins long, que le guide scrutait du regard
tantôt la droite, tantôt la gauche,
cherchant un coin propice, pourvu si possible de
mélèzes et de quelque peu de bois
mort pour alimenter notre feu.
Les chiens étaient de suite
dételés, à leur grande
satisfaction. On ne les attachait pas ;
cependant jamais ils ne nous ont faussé
compagnie ni n'ont fait mine de retourner sur leurs
pas. Les plus jeunes prenaient parfois des
fantaisies sportives et organisaient, sous leur
propre responsabilité, une chasse au lapin
tandis que les aînés, assagis par
l'expérience, se mettaient de suite en
quête d'une retraite pour y passer la nuit.
Ils grattaient la place choisie, écartant la
neige pour mettre le sol à découvert
puis, des dents et des pattes, ils travaillaient
à l'aplanir. Cela fait, ils s'y
pelotonnaient et attendaient patiemment qu'on les
appelât pour souper. Notre travail, une fois
les chiens déharnachés,
c'était de couper avec nos haches des
branches vertes de mélèzes et les
arbres morts et secs ; puis, nous servant de
nos raquettes comme de pelles, à l'instar de
nos chiens, nous débarrassions le sol de
l'épaisse neige qui le recouvrait,
l'amoncelant de notre mieux sur les
côtés et au fond de l'emplacement
où nous allions camper.
Là, sur le sol, nous disposions les branches
vertes tandis que, sur le devant et placé de
telle sorte que le vent chassât la
fumée dans la direction opposée, nous
entassions le bois mort et allumions notre feu.
Bientôt nos deux chaudrons étaient
suspendus sur la flamme, pleins de neige ;
à mesure qu'elle fondait, nous les
emplissions de nouveau jusqu'à ce que nous
eussions obtenu assez d'eau pour faire, dans l'un,
bouillir un morceau de viande de bonne dimension
et, dans l'autre, infuser notre thé.
À ma première
expédition, je m'étais muni d'un
petit bassin, d'une savonnette et d'une serviette
de toilette et lorsqu'il y eut de l'eau dans le
chaudron, j'en demandai un peu au guide.
Soupçonnant l'usage que j'en voulais faire,
il ne se hâta pas de me satisfaire.
« Que veux-tu en faire ?
Laver ma figure et mes
mains. » Il me pria alors très
sérieusement de n'en rien faire, mais j'en
éprouvais un tel besoin que je ne m'en
laissai pas dissuader. Nous avions traversé,
des heures durant, une contrée
ravagée l'été
précédent par l'incendie et nous nous
étions frottés maintes fois aux
troncs carbonisés, nous y accrochant
même souvent lorsque nous avions à
descendre dans des ravines. J'insistai donc
malgré ses protestations, pensant qu'avec
une serviette bien sèche
et devant un feu flambant je ne risquais pas
grand'chose. Mais je ne devais pas tarder à
regretter mon obstination, car, après une
minute ou deux de satisfaction et de
bien-être, j'éprouvai une
étrange sensation sur les mains : elles
se crevassèrent et se mirent à
saigner, elles me firent beaucoup souffrir et ne se
guérirent que plusieurs semaines plus tard.
Cette expérience me suffit quant à la
toilette en plein air par quarante-cinq
degrés centigrades au-dessous de
zéro.
Dans la suite, je laissai le savon
à la maison et me contentai de la serviette
dont je me servais pour me frictionner à sec
quand j'en sentais par trop le besoin. À mon
retour, ma chère femme trouvait que je
ressemblais au vieil acajou poli et je laisse
à penser quel était mon premier
soin.
Quant à la nourriture, nous
préférions, par ces basses
températures, la chair la plus grasse que
nous pussions nous procurer. Après
expérience personnelle, je puis signer les
affirmations des explorateurs arctiques sur la
valeur des corps gras, de l'huile ou de la graisse
de baleine comme comestibles, toute la machine
humaine en a soif, rien ne semble fournir une somme
équivalente de chaleur intérieure.
Tandis que notre ration de viande
bouillait dans le grand chaudron, nous
préparions la pitance des chiens. Le poisson
gelé était aussi dur que la pierre,
il eût été cruel de le donner
tel quel aux braves bêtes qui nous servaient
si bien ; aussi le placions-nous
préalablement contre une bûche devant
le feu, de manière à ce que la
chaleur fût aussi intense que possible sans
qu'il y eût combustion. Les bêtes
affamées s'apercevaient vite des
apprêts de leur repas et s'attroupaient,
impatientes, autour nous. Il fallait
tempérer leur vivacité, ce qui
n'était pas toujours facile. Avant de les
leur livrer, il fallait que nous puissions plier
les poissons et jusque-là il
s'écoulait parfois un intervalle assez long.
Pendant ce temps, chacun voulant être au
premier rang, une bataille pouvait éclater
et c'était alors toute une affaire. Deux
chiens d'un même équipage se
querellent très rarement. Compagnons de joug
et de labeur, ils sont trop sages pour chercher
à se nuire dans de vains conflits. Au
contraire, en cas de désaccord entre deux
individus de différents attelages, ils se
rangent rapidement autour de leur camarade
respectif et bientôt ce n'est plus un corps
à corps mais une lutte de deux camps. Au
début, je trouvais cruel de ne pas les
alimenter plus fréquemment, mais
je vérifiai ce que me
disaient les conducteurs
expérimentés. Lorsque, dans l'ardeur
de ma sympathie, je leur accordais un bon
déjeuner le matin, cela ne tournait pas
à leur avantage : ils étaient
indolents et essoufflés et en somme moins
prospères qu'avec leur repas unique. Je
constatai aussi que le poisson blanc, de bonne
qualité, leur convient mieux que n'importe
quel autre aliment.
Les chiens repus, c'est à notre
tour d'assouvir notre faim. On étend des
branchages près du feu, on y déploie
la nappe (généralement un sac
à farine vide et fendu sur l'un des
côtés) nos plats d'étain sont
disposés en ordre et, l'appétit
aidant, nous faisons honneur au repas. Si nous
sommes assez heureux pour posséder du pain,
nous le faisons dégeler et il
agrémente le bouilli et la mesure de
thé, sinon on s'en passe. De légumes
il n'est naturellement pas question. Le matin
à midi et le soir, et souvent entre temps,
nous nous rassasions de viande grasse. Si le menu
subit quelque variation, ce ne sera que par un
emprunt à celui des chiens ; on mettra
bouillir le soir une chaudronnée de
poisson.
Durant le souper,
« Maître Frimas » nous
aiguillonnait de belle façon. J'ai vu
remettre la pièce de viande trois fois de
suite sur le feu pour la
réchauffer et les pintes de thé
bouillant se couvrir de glace en un
instant.
Après souper, nous coupions le
bois pour le feu du matin et nous réparions
les avaries qui avaient pu se produire dans nos
vêtements ou nos harnais afin que rien ne
vînt retarder le départ. Lorsque le
guide qui avait l'oeil à toutes ces choses
pouvait constater que tout était en ordre,
il déclarait avec une évidente
satisfaction : « Missionnaire, nous
sommes prêts pour la
prière. » Les Indiens apportaient
alors la Bible et le recueil de cantiques et se
groupaient autour de moi. Quel tableau ! comme
fond le rideau de mélèzes aux
branches fléchissant sous la neige, comme
premier plan le feu flambant et, tout autour de
nous, notre attirail : traîneaux,
raquettes, harnais, etc., plus quelques-uns des
chiens qui tenaient à ne pas se retirer dans
leurs quartiers avant que leurs maîtres se
fussent eux-mêmes livrés au repos et
qui ajoutaient par leurs attitudes variées
au pittoresque du coup d'oeil. Au-dessus de nous,
les brillantes étoiles et parfois l'aurore
étincelante. Tête nue, quelle que
fût l'intensité du froid, mes hommes
écoutaient religieusement la portion des
saints livres que je lisais dans leur langue, puis
ensemble nous chantions un cantique,
souvent celui du soir dont voici
la première strophe en Cree :
- « Ne mahmechemou ne muntome
- Kahke wastanahmahweyan,
- Kah nah way yemin Kechahyah
- Ah
kwah-nahtahtah-kwahnaoon. »
Ensuite la prière. Rien d'étonnant
que nous éprouvassions là bien
vivement le sentiment qu'on devrait avoir partout,
celui de notre dépendance absolue
vis-à-vis de notre puissant Père
céleste et c'était le désir
intense de notre coeur que nous exprimions en
chantant encore :
- « Keep me, o keep me, King of
kings
- Beneath Thine own AImighty
wings »
« Garde, ô garde-moi, Roi des
rois, à l'ombre de tes ailes
toutes-puissantes. »
Nous sommes à une énorme
distance de chez nous ; point d'autres murs
pour nous protéger que ceux que nous avons
faits en déblayant notre emplacement ;
point de toit ; le feu va tout à
l'heure s'éteindre ; un pied de neige
va peut-être recouvrir nos corps quand nous
nous serons étendus et elle serait la
bienvenue car elle atténuerait
l'intensité du gel plus redoutable encore
que les loups gris qui peuvent venir rôder
autour de nous. Quiconque connaît
l'efficacité de la prière doit sentir
avec quelle ferveur nous approchant de notre Dieu
« par des
prières et des supplications avec des
actions de grâces » nous
l'implorions, Lui qui jamais ne dort ni ne
sommeille.
Le culte terminé, le guide
s'écriait « Maintenant
missionnaire, je vais arranger ton lit. »
Il en faisait son affaire. Sur la couche de
branchage, il déployait une toison de buffle
et une couverture. Je m'y étendais, la
tête aussi éloignée que
possible du feu. Se déshabiller dans ces
conditions est une chose à éviter
à moins que, par le fait du violent exercice
de la journée, le linge de corps ne soit
trop humide de transpiration et par suite
dangereux.
Quelques voyageurs se glissent dans un
sac en fourrure qu'ils se font attacher autour du
cou. Un grand capuchon de fourrure sur leur
coiffure ordinaire complète leur toilette de
nuit. Moi je passais un lourd pardessus sur mes
vêtements de la journée, j'enfilais
des bottes de buffle, des moufles de fourrure, un
bonnet, un collet : ainsi accoutré,
j'éprouvais quelque difficulté
à me « mettre au lit »
lors même qu'il fût ouvert et au niveau
du sol. Une fois en position, j'étais encore
recouvert d'une couverture et d'une toison, puis
avec beaucoup d'adresse et de rapidité, avec
une douceur toute maternelle, le guide me bordait
des pieds à la tête, faisant passer la
toison par-dessus mon crâne pour la
replier sous mes épaules.
La première fois qu'il
m'empaqueta de la sorte, je ne le supportai qu'une
ou deux minutes ; j'étais sûr
d'étouffer, aussi, brusquement, je me
débattis et j'envoyai couverture et toison
se promener. « Tu veux m'étouffer,
je ne puis endurer cela ! »
m'écriai-je. Sans montrer aucun dépit
de ma vivacité, il me répondit avec
calme : « je sais que vous autres
blancs trouvez dur de dormir la tête
couverte, mais ici il le faut, sinon tu
gèlerais à mort. Sois prudent, car
cette nuit paraît devoir être
mauvaise. » Il me rappela les bruits
semblables au tonnerre que nous avions entendus
dans le lointain durant la soirée.
C'était, m'avait-il dit, la glace du grand
lac - deux mètres d'épaisseur - qui
craquait par l'action froid. « Regarde la
fumée, ajouta-t-il, elle traîne
à ras de terre, elle ne fait cela que dans
les nuits de grand froid. » Par
intervalles nous entendions autour de nous dans les
arbres des détonations qui auraient pu nous
faire croire, si nous avions été
nerveux, à des coups de pistolets
tirés sur nous par des ennemis en
embuscade ; mes compagnons expliquaient que
c'était la sève gelée des
troncs qui les faisaient éclater.
Tout en admirant la sagacité et
la bonté du brave homme, je lui
déclarai qu'on m'avait enseigné que
tout individu a besoin de tant
et tant de pieds cubes d'air respirable et que,
quelle que fût la température, il ne
pouvait prétendre que, ma tête
étant couverte comme il le désirait,
mes poumons fussent satisfaits. « Ici il
faudra te contenter de moins de pieds
cubes, » dit-il ; et il se mit en
devoir de me recouvrir de nouveau pendant que je
m'efforçais de manoeuvrer de manière
a m'assurer au moins une faible partie du
nécessaire. Il me raisonnait patiemment et
quand il eut fini son empaquetage :
« Maintenant, missionnaire, bonne nuit et
fais attention de ne pas bouger, tu
dérangerais tes couvertures et tu pourrais
mourir gelé sans te
réveiller. » - « Ne
bouge pas, » quel ordre à donner,
pensai-je, à un pauvre voyageur dont tous
les os sont meurtris, dont les nerfs et les muscles
sont détendus et qui trouverait du repos
rien qu'à allonger ses jambes et à se
retourner de temps à autre.
Malgré cette disposition d'esprit
et cet ordre que je sentais devoir être
obéi, je finis par m'endormir, car
j'étais exténué. Au bout d'un
certain temps, je m'éveillai partiellement
et me trouvai tarabustant ce que je crus être
le manche d'une petite hache. Dans mon état
de demi conscience, j'avais l'impression qu'un
Indien négligent avait dû en laisser
une juste derrière ma
tête et que, dans la nuit,
le manche m'en était tombé en travers
de la figure ; j'en tenais maintenant
l'extrémité. Heureusement pour moi je
m'éveillai tout à fait et
m'aperçus que c'était mon propre nez
que je tenais et secouais ; il était
horriblement gelé et mes deux oreilles
étaient dans un état analogue. Je
suppose que l'injonction du guide résonnant
à mes oreilles, tout était en bon
ordre quand j e m'étais endormi, mais
qu'inconsciemment, par le fait de la sensation
d'étouffement, je devais avoir
écarté les couvertures de ma figure
et de l'une de mes mains. Cependant, après
quelques nuits de cette sévère
discipline, je m'habituai à dormir la
tête couverte aussi bien qu'un
Peau-Rouge.
Sous un édredon
supplémentaire de quarante ou cinquante
centimètres de neige, nous ne dormions que
mieux, je l'ai dit, et nous nous reposions alors
volontiers une couple d'heures de plus, souvent
cela compensait le manque de sommeil des nuits
précédentes où il ne nous
avait pas été possible de nous
endormir du tout ou bien où il nous avait
paru trop dangereux de l'essayer. L'effort le plus
difficile, c'était de sortir d'une telle
couche en un tel lieu. Il nous arrive,
malgré la rigueur de la température,
d'être en moiteur grâce à toutes
nos enveloppes ; lorsque nous les
dépouillons et que nous
nous mettons sur pied, Maître Gel nous saisit
d'une terrible étreinte, et tel d'entre nous
ne peut que pleurer d'angoisse. Heureusement le
bois est toujours préparé de la
veille et un grand feu ne tarde pas à
flamber. Le thé fort et la viande grasse
sont dépêchés et produisent
leur effet salutaire.
Il me souvient d'une matinée
dramatique. C'était dans un trajet de deux
cent cinquante à trois cents
kilomètres. Par motif d'économie, je
n'avais pris avec moi qu'un seul natif, un
garçon de seize ans environ. Nous avions
chacun notre attelage. Vieux-Troupier étant
de la partie faisait l'office de leader, nous ne le
dirigions que de la voix et il se montra à
la hauteur de notre confiance. Un matin nous nous
réveillâmes sous la neige. Notre bois
était de qualité très
inférieure, car nous n'étions
arrivés que tard la veille au lieu du
campement et nous avions dû nous contenter de
ce que nous avions pu recueillir à
tâtons dans le voisinage
immédiat ; cependant comme il avait
suffi pour faire cuire notre souper, nous
étions sans inquiétude pour le
déjeuner ; mais voici que la neige
fraîche l'avait mouillé et que nos
allumettes ne parvenaient pas à le faire
prendre. Ennuyés d'abord, nous fûmes
vite positivement alarmés. Il nous
avait naturellement fallu
quitter nos épaisses moufles pour frotter
les allumettes, si bien qu'avant que nous eussions
pu réussir dans notre entreprise nos mains
étaient si engourdies qu'il n'y avait plus
moyen de tenir cet objet si menu.
Nous persévérâmes
aussi longtemps que possible puis j'essayai de
prendre une allumette entre mes dents et en
secouant la tête vivement de
côté et d'autre de la frotter sur le
fer d'une hache que je tenais des deux mains devant
moi. Inutile ! J'eus alors la conscience
très-nette que, si nous ne pouvions obtenir
du feu, c'en était fait de nous, et,
regardant mon compagnon, je vis qu'il avait saisi
la situation et qu'il en était
terrifié. « Dieu est notre secours
et notre délivrance, lui dis-je. Si nous
n'avons ni feu ni par conséquent de
déjeuner, il nous a donné d'autres
moyens de nous réchauffer. Mets tes
raquettes, vivement, ton capuchon, tes
moufles ; je vais faire de même, et
courons ; voyons si tu
m'attraperas ! » Ainsi fut
fait ; nous nous mîmes à lutter
de vitesse, l'un rejoignant l'autre alternativement
comme une paire d'écoliers turbulents.
À nous voir, un spectateur n'aurait pas
deviné en nous un missionnaire et son
escorte luttant pour leur vie. Après une
demi-heure environ de ce violent exercice, nous
sentîmes la chaleur nous
gagner. Quand le sang circula de nouveau dans nos
mains et que nous pûmes remuer et plier les
doigts, nous retournâmes au camp. Ayant
trouvé de l'écorce de bouleau qui se
détache aisément des troncs et qui
est très inflammable, nous eûmes peu
à peu la joie de voir briller notre feu et
de pouvoir préparer notre déjeuner.
Au culte qui suivit, l'action de grâce ne
manqua pas et l'esprit de reconnaissance nous
accompagna dans la suite de notre voyage. Le roi
des épouvantements nous avait
regardés en face et bien peu s'en
était fallu qu'il eût
été vainqueur.
Le jour étant très court
sous ces latitudes élevées durant les
mois d'hiver, nous nous levions en
général plusieurs heures avant qu'il
fit clair. Mes hommes essayaient de me devancer
afin qu'à mon réveil je pusse de
suite me réconforter. Cependant cela
n'arrivait pas souvent, car ma couche n'invitait
pas à la douce rêverie et en
général après quatre ou cinq
heures de suffocation j'étais reconnaissant
de pouvoir me lever aussitôt que j'entendais
l'un de mes hommes remuer. Je me disais alors que
je préférais la mort par le gel
à la mort par l'étouffement. Il m'est
même arrivé maintes fois d'être
le premier debout, d'allumer le feu et de faire le
déjeuner avant d'appeler
mes compagnons qui, dès longtemps
accoutumés à ces misères,
pouvaient dormir plus solidement que moi. Mes
hommes ainsi éveillés consultaient
les étoiles si elles étaient visibles
et il leur arrivait de dire :
« Assam weputch ! » - Bien
de bonne heure ! - je n'avais alors
qu'à tirer gravement ma montre et cela les
contentait. Le déjeuner
expédié, les prières dites,
les traîneaux étaient chargés,
les chiens capturés et harnachés - si
c'étaient des esquimaux, la tâche
pouvait être malaisée - et... en
route ! Lorsque dans telle matinée nous
franchissions quarante ou cinquante
kilomètres avant le lever du soleil, mes
hommes commençaient à penser que les
étoiles pouvaient avoir eu raison
après tout et que la montre de leur
missionnaire avançait quelque peu. Cependant
comme ils étaient tout aussi désireux
que moi de voyager rapidement, ils ne me trouvaient
pas à redire. Je leur donnais un
supplément de paie toutes les fois que nous
avions pu diminuer le nombre de nuits
prévues dans l'itinéraire. Notre
premier voyage à Nelson-River dura six
jours ; les années suivantes, nous le
fîmes en quatre jours.
La route, ou plutôt la piste,
traverse une des régions du nord-ouest les
plus riches en fourrures. Les indiens errants
y trouvent leur subsistance en
traquant le renard noir ou le renard argenté
aussi bien que les variétés plus
communes de cet animal.
On y trouve la loutre, la martre, le
castor, l'hermine, l'ours, le loup et bien d'autres
espèces de gibier à poil. Les ours
noirs y sont très abondants. Un
été, dans une excursion en canot,
nous n'en vîmes pas moins de sept ; nous
en tuâmes un et en vécûmes
plusieurs jours durant. Les trafiquants toujours
aventureux vont sur les lieux faire emplette de ces
fourrures précieuses et réalisent
parfois ainsi de grandes fortunes. Si des hommes
qui ne recherchent que le gain s'accommodent
volontiers de l'inhospitalité de la
contrée et des privations qu'elle comporte,
quelle honte pour nous, serviteurs de Dieu, si
l'amour des âmes et la joie de leur annoncer
le Sauveur ne nous donne pas le courage de les
suivre ou même au besoin de leur montrer le
chemin !
|