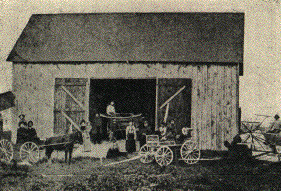En Canot et en traîneau
À CHIENS
Parmi les Indiens CREE et SALTEAUX
CHAPITRE XIV

Au premier printemps, nous apprîmes avec
une vive émotion que la petite vérole
avait éclaté dans les grandes plaines
des Saskatchewan. Apparemment, elle avait
été apportée par quelque
trafiquant blanc, venu de l'État de Montana,
et elle se répandit avec une rapidité
et une gravité extraordinaires.
Pour rendre le fléau plus
meurtrier encore, un clan en hostilité avec
un autre transporta secrètement sur son
territoire, et en un lieu où ils devaient
immanquablement être trouvés et
enlevés, des effets de ses propres membres
décédés. La maladie fut ainsi
communiquée à une nouvelle tribu qui
perdit de ce fait des milliers de
personnes.
Les missionnaires Mac Dougall et
Campbel, aidés par leurs convertis, prirent
toutes les mesures possibles
contre l'extension de l'épidémie,
mais en dépit de leurs efforts, elle
continua à faucher les indigènes et
les blancs. Dans l'espoir de sauver quelques-uns de
ses gens de la mission Victoria, Mac Dougall les
avait engagés à quitter leurs
demeures et à s'isoler sur les grandes
prairies ; ainsi fût fait.
Cependant les païens, rendus
furieux par les coups répétés
de la verge qui les frappait et impuissants
à l'arrêter, résolurent de se
venger sur les blancs sans défense. Ils
apostèrent une bande de guerriers pour faire
périr tous ceux qui étaient
établis dans la contrée. Ce fut
précisément à la mission
Victoria, sur la rivière Saskatchewan,
qu'ils rencontrèrent les premières
« faces pâles ».
Fidèles à leur tactique habituelle,
ils ne les attaquèrent pas ouvertement, mais
ils s'embusquèrent en masse dans les longues
herbes tandis que quelques-uns d'entre eux
pénétraient d'un air nonchalant dans
la maison missionnaire. Là, ils
découvrirent, à leur grande surprise,
que la petite vérole avait fait ses victimes
aussi bien qu'ailleurs. Rapidement et doucement ils
se glissèrent dehors et allèrent
rapporter à leurs camarades ce qu'ils
avaient vu. Ils tinrent conseil tous ensemble et
arrivérent à la
conclusion que ce n'était pas le
missionnaire qui dispensait la maladie, car, si
c'eût été lui, il se serait
arrangé pour que les siens en fussent
indemnes. Ce devaient donc être les
trafiquants en fourrures ;
conséquemment ils partirent pour le poste.
Là, ils suivirent la même ligne de
conduite et, à leur stupéfaction, ils
apprirent que le directeur de ce poste
lui-même avait succombé au
fléau. Un autre conseil fut aussitôt
tenu, qui les fit arriver à la conviction
qu'ils avaient commis une erreur, si bien qu'ils
reprirent le chemin de leurs wigwams sans avoir
fait de mal à personne.
Néanmoins, le missionnaire et sa
famille étaient environnés de
périls ; les natifs étaient
excités ; et leurs anciens conjureurs
étaient prêts en tout temps à
les inciter à des actes de violence ;
la puissance de Dieu seule préserva ses
serviteurs d'un massacre.
Un jour, la femme du missionnaire et
quelques-uns des siens travaillaient au jardin,
tandis que onze Pieds Noirs venus pour tuer et
piller étaient tapis à moins de cent
mètres de là ; ils
déclarèrent plus tard qu'ils avaient
été mystérieusement
empêchés de faire feu. Une autre fois,
quelques-uns des guerriers de la même tribu,
altérés de sang, se glissèrent
en rampant dans un champ d'orge,
et surveillèrent longtemps les mouvements de
la famille après quoi ils se
retirèrent sans nuire à aucun d'entre
eux. Entendre le sifflement d'une balle à
son oreille, n'était pas un
événement rare dans la vie de
plusieurs dès premiers missionnaires parmi
ces tribus irritées.
J'ai dit que, aussi longtemps que la
petite vérole fit rage dans la région
du Saskatchewan, des efforts vigoureux furent faits
pour éviter qu'elle gagnât d'autres
districts. À cette époque, le
territoire du Manitoba qui venait d'être
érigé en province, se remplissait de
colons blancs. L'ancien nom de Fort Garry avait
été changé en celui de
Winnipeg ; et cette localité devenait
rapidement une ville florissante. C'est de
là que, depuis des années, partaient
à époques fixes de longs convois de
charrettes pour ravitailler le lointain domaine des
Saskatchewan. Ces véhicules, construits sans
une seule pièce de fer, s'entendaient
d'aussi loin qu'ils se voyaient, même sur les
prairies unies, car leurs conducteurs indiens ne
les graissaient jamais. Ils étaient
tirés chacun par un boeuf et devaient
transporter de quatre à six cents kilos,
outre la nourriture et les
effets du conducteur qui était toujours
censé faire route à pied. Cet
affrètement par charrettes sur les prairies,
est la contre-partie des transports par bateaux ou
par canots sur les rivières du nord dont
nous avons parlé ailleurs.
 LA
POSTE EN TRAÎNEAU A CHIENS
LA
POSTE EN TRAÎNEAU A CHIENS
L'arrivée de la
« brigade », apportant les
vivres et les nouvelles du monde, était le
grand événement de l'année
pour ces établissements isolés sur
l'immense plaine. Mais, dans
cette période de mortalité, des
mesures très strictes avaient dû
être prises, nous l'avons dit.
Le gouverneur de la province du Manitoba
avait publié un arrêté
interdisant, de la manière la plus absolue,
tout commerce et toute communication avec le
district infesté, par conséquent tout
départ de charrettes, soit en convois, soit
isolées. Cette défense impliquait de
grandes privations et beaucoup de souffrances pour
les blancs, missionnaires, trafiquants, colons ou
aventuriers qui avaient
pénétré dans cette
contrée reculée, où la poste
elle-même ne parvenait guère que deux
fois par an et par traîneaux à chiens.
Quantité de buffles erraient encore sur les
plaines, il est vrai, mais l'on n'ignorait pas que
les munitions tiraient à leur fin aussi bien
que les autres denrées, y compris les
médicaments plus nécessaires alors
que jamais. Des personnes intéressées
à la chose insistèrent auprès
du gouverneur pour le faire revenir sur sa
décision, mais, à cause du risque
qu'il ferait par là courir à la
province sur laquelle il était
établi, il demeura inflexible, tout en
sympathisant aux souffrances qu'il savait devoir en
résulter pour quantité de
gens.
« Que pourrait-on tenter pour
venir en aide à tant de
malheureux qui, outre les douleurs que leur cause
l'épidémie, sont maintenant
exposés à la famine et à la
privation d'objets
indispensables ? » Telle
était la question qui se posait à
bien des coeurs compatissants. En désespoir
de cause et comme dernière ressource, on
décida d'adresser un appel aux Indiens
convertis de Norway-House pour qu'ils formassent
une « brigade » de bateaux et
allassent ravitailler ces pauvres gens en remontant
le fleuve du Saskatchewan. L'officier
supérieur de la Compagnie de la Baie de
l'Hudson vint me trouver, moi, le missionnaire de
cette station, et nous discutâmes la chose
ensemble. Les dangers auxquels on s'exposerait
étaient considérables ; aucun de
mes hommes n'avait été vacciné
et ils devaient traverser, sur des centaines et des
centaines de kilomètres, une contrée
ravagée par le fléau. Cependant, il
semblait qu'un effort devait être
tenté et, en agissant avec une grande
sagesse, il y avait possibilité que les
sauveteurs échappassent à la
contagion. Nous décidâmes donc de
réunir l'église et de la
consulter.
Lorsque, à l'appel de la cloche,
on se fut rassemblé dans la
« salle du conseil », se
demandant ce qui arrivait, je fis le tableau de la
situation et présentai la requête que
cent-soixante d'entre eux
voulussent bien, avec vingt bateaux de vivres, se
porter au secours de ces blancs. Je leur dis
ceci : « je sais que votre race n'a
pas toujours été traitée
loyalement par les blancs, mais oubliez cela. Voici
pour vous l'occasion d'accomplir un acte glorieux
et de montrer au monde et surtout au Seigneur Dieu
dont vous êtes les enfants, que vous savez
aussi bien que les plus civilisés faire des
sacrifices et courir des dangers lorsque le devoir
vous y appelle. »
Nous leur expliquâmes qu'en
naviguant constamment au milieu du fleuve, sans
jamais descendre à terre, il était
possible qu'ils échappassent tous ;
qu'ils seraient abondamment pourvus de nourriture
de manière à n'avoir pas besoin de
chasser. Et, m'adressant à l'un de mes
meilleurs directeurs de classe, un des fils du
patriarche centenaire dont j'ai parlé dans
un précédent chapitre :
« Samuel Papanekis, dis-je, c'est toi qui
seras le guide et le chef de cette
expédition. » Au premier abord, il
parut troublé de la responsabilité
dont je le chargeais, mais, après un moment
de réflexion, il dit avec calme :
« Veux-tu nous donner un peu de temps
pour en parler entre nous ? » Ainsi
fut fait ; nous les quittâmes. Leur
décision prise, ils nous envoyèrent
chercher et Samuel parla pour
eux tous. « Missionnaire, nous irons au
secours de nos frères blancs et de leurs
familles comme tu le demandes. Veux-tu nous laisser
passer encore un dimanche à l'église
et nous donner la sainte Cène avant que nous
nous mettions en route pour ce périlleux
voyage. Sans doute, répondis-je, d'ailleurs,
la préparation de vos chargements demandera
plusieurs jours ; nous aurons donc encore une
journée de repos et d'adoration en
commun. »
Ce fut un dimanche mémorable.
Chaque homme, chaque femme. chaque enfant qui
pouvait venir à l'église y vint.
Quelques-unes des femmes pleuraient à la
pensée du danger qu'allaient affronter leurs
maris, leurs frères ou leurs fils ;
d'autres, au contraire, semblaient se rendre compte
de l'esprit qui animait les hommes et se sentaient
fiers d'eux. À l'issue du service du matin,
eut lieu la communion, solennelle et impressive.
À mesure qu'ils s'approchaient pour
participer aux emblèmes du sacrifice de
l'amour rédempteur, la pensée de son
immolation volontaire nous saisissait tous, et bien
des coeurs tressaillirent, en sentant qu'ils
étaient jugés dignes de courir
quelques risques pour faire une bonne
action.
L'après-midi nous réunit
encore pour une assemblée fraternelle.
Aucune vantardise, aucune
recherche de sympathie ne se fit jour dans les
allocutions. Quelques-uns ne firent aucune allusion
aux circonstances du moment, tandis que d'autres
demandèrent nos prières pour eux
tous. Il y en eut qui, sous l'impression du service
du matin, exprimèrent la pensée de la
communion des souffrances de Christ et
rappelèrent la parole de Saint Paul.
« Si nous souffrons avec Lui, nous serons
aussi glorifiés avec
lui. »
Deux ou trois jours plus tard, ils se
mirent en route, les vingt bateaux
manoeuvrés chacun par huit hommes et tous,
sous la conduite de Samuel Papanekis,
remontèrent la jolie rivière qui
passe à Norway-House, arrivèrent au
lac Winnipeg et, en contournant son
extrémité nord-ouest, atteignirent la
large rivière Saskatchewan qu'ils devaient
remonter très loin dans la direction de
l'Orient. Cet été fut excessivement
chaud et, durant des semaines, les braves
peinèrent à leurs lourdes rames, ne
se reposant que quelques heures pendant la nuit,
les bateaux étant ancrés au milieu du
fleuve. Le dimanche, ils les amarraient aussi
près que possible les uns des autres sur
quelqu'un des hauts fonds qui abondent dans ce
cours d'eau, et célébraient le jour
du repos par des services religieux.
Parfois, ils voyaient sur le rivage des
wigwams abandonnés, soit
que la mort en eût moissonné les
habitants, soit qu'ils se fussent enfuis
apeurés. Ailleurs des bêtes sauvages
se promenaient ou venaient étancher leur
soif à portée de leurs fusils, les
instincts chasseurs des jeunes gens surtout avaient
peine à se contenir, ils demandaient la
permission de tirer, mais le chef toujours en
éveil la refusait nettement.
Enfin, au bout de dix semaines qui nous
avaient semblé bien longues et durant
lesquelles nous les avions entourés de nos
prières sans pouvoir jamais recevoir de
leurs nouvelles, nous les vîmes revenir
pleins de louanges et d'actions de grâces.
Ils étaient tous présents à
l'appel, tous heureux et en bonne santé,
à l'exception de leur chef, pour lequel la
responsabilité avait été trop
lourde et la tension nerveuse trop forte. Il devait
payer son dévouement de sa vie. Son
indomptable force de volonté le soutint
jusqu'à ce qu'il pût voir son dernier
bateau amarré dans notre port et sa petite
troupe accueillie et saluée par l'affection
de toutes les familles. Il prit encore part au beau
service d'actions de grâces, dans notre
chapelle bondée, mais, aussitôt
après, il commença à
fléchir et à s'éteindre, en
dépit de tout ce que nous-mêmes et les
fonctionnaires de la Compagnie, qui lui
étaient très attachés,
pûmes faire pour lui. La
fin fut bientôt là. C'était une
très belle journée et, comme il
respirait avec peine, on le transporta hors de sa
demeure sur une couche de branchages et de
fourrures. Il en parut reconnaissant et
soulagé. Après un entretien
bienfaisant sur les grandes et précieuses
promesses et sur « il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon
Père », il s'assoupit doucement.
Peu après, il s'éveilla et se rendit
compte que le moment de son départ
arrivait ; il se disposa alors au
délogement. Une première question que
je lui posai resta sans réponse ; alors
me penchant sur lui et élevant un peu la
voix je répétai :
« Samuel, mon frère, tu es dans la
vallée de l'ombre de la mort,
qu'éprouves-tu ? » Son regard
s'éclaira et je vis qu'il m'avait compris.
Il leva son bras amaigri et fit le geste de saisir
quelque chose : « Missionnaire, je
tiens ferme à Dieu, il est toute ma joie et
mon espérance, » puis son bras
retomba sans force... mon frère indien
entrait triomphant dans le « pays
meilleur »

C'est ici le lieu de dire ce qui advint de sa
veuve et de ses enfants. Peu après sa mort,
ils quittèrent leur maison dans le village
de la mission pour prendre leurs
quartiers avec plusieurs autres
familles au delà du fort à une
certaine distance. À ce moment-là,
nous leur avions porté secours d'une
manière efficace, mais, dès lors, je
ne les avais vus qu'aux services divins et je ne
savais donc pas comment marchaient leurs affaires.
À l'entrée de l'hiver, je m'entendis
avec mon collègue pour faire en
traîneau une série de visites
pastorales dans toutes les familles des environs,
afin de nous enquérir de leur
prospérité matérielle et
spirituelle. Nos visites étaient toujours
pour nos gens une grande joie. Ils aimaient que
nous prissions intérêt à toutes
leurs circonstances, à leur pêche et
à leur chasse, pour nous réjouir avec
eux de leurs succès, ou compatir à
leurs mécomptes ou à leurs
difficultés. Ils écoutaient ensuite
avec bonheur une lecture biblique et une
prière.
Un jour de froid intense, nous
arrivâmes vers le soir à une bien
pauvre cabane. Je frappai à la porte et,
à un accueillant
« entrez », je l'ouvris. Nos
coeurs se serrèrent à la vue de la
pauvreté qui régnait dans cette
demeure. Elle était construite en troncs de
peupliers dont les interstices étaient
bouchés par de la mousse et de la
boue ; le sol était nu et pas un seul
meuble : ni lit, ni table, ni chaise ;
dans un coin, un maigre feu autour duquel se
blottissaient une veuve et
quelques enfants dont l'un était
estropié. Après quelques paroles de
salutation amicale, je dis tristement :
« Tu sembles être très
pauvre, Nancy, tu n'as aucun confort, ni rien pour
te rendre heureuse. » La réponse
vint très vite, et sur un ton bien
différent : « Il est vrai que
je n'ai pas grand'chose, mais je ne suis pas
malheureuse, missionnaire. - Chère femme,
dis-je encore, as-tu de la venaison - Non. - As-tu
de la farine ? Non. - As-tu du
thé ? - Non. - As-tu des pommes de
terre ? » - À cette
dernière question, la veuve de Samuel
Papanekis leva la tête : « je
ne puis avoir de pommes de terre, car Samuel est
parti au secours des blancs au moment où il
aurait fallu les planter. Il n'est plus là
pour tuer du gibier, ni pour prendre les martres,
les hermines ou les castors qu'on échange
contre de la farine ou du thé. - Qu'as-tu
donc, pauvre Nancy ? - Je possède
quelques filets pour la pêche. - Et quand il
a fait trop mauvais temps pour lever les filets,
qu'as-tu fait ? - Quelquefois des hommes des
autres maisons les ont levés pour moi et
m'ont apporté le poisson. - Et quand
personne ne pouvait y aller ? - Quand je
n'avais rien, nous avons fait sans
rien. » En la regardant, elle et ses
nombreux orphelins, et en pensant au départ
triomphant du chef de la famille
pour les demeures où il n'y a plus ni faim
ni soif et où Dieu essuie toute larme, je
fus si saisi du contraste que, pour cacher mon
émotion, je sortis
précipitamment à la suite de mon
collègue plus affecté encore que moi
si possible. Nous étions entrés pour
prier, mais nous ne le pouvions dans ces
circonstances il fallait auparavant manifester nos
sentiments chrétiens d'une manière
tangible.
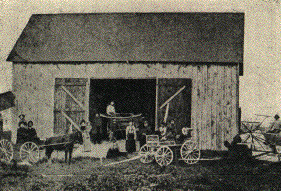 GRANGE D'UN INDIEN CHRÉTIEN
(MISSION DU LAC SCUGOG)
GRANGE D'UN INDIEN CHRÉTIEN
(MISSION DU LAC SCUGOG)
Mon collègue avait atteint nos
traîneaux et j'y arrivais lorsque la veuve
m'appela de sa porte :
« Ayumeaookonou - maître qui pries
- il ne faut pas te chagriner ainsi pour moi. Il
est vrai que depuis la mort de Samuel nous avons
souvent eu faim et nous avons durement senti le
froid, mais, missionnaire et sa figure ne portait
aucune trace de chagrin, - tu m'as entendue dire
que, comme mon Samuel avait donné son coeur
à Dieu, je l'ai fait moi aussi, et Celui qui
l'a aidé et qui l'a soutenu de telle sorte
qu'il est mort heureux est mon Sauveur. Là
où est mon Samuel, je vais moi aussi ;
j'en approche chaque jour ; cette
pensée me réjouit toute la
journée. » Ces paroles
m'allèrent au coeur, mais je ne trouvai
point de réponse ; rejoignant mon ami,
je criai aux chiens
« Marchez ! » et
bientôt nous fûmes chez moi. Notre lit
s'appauvrit d'une couverture et nos provisions
furent sérieusement drainées.
Ensuite, je fis part de la triste situation de
cette famille à ceux de nos gens qui
étaient les plus
fortunés ; plusieurs
d'entre eux donnèrent très
généreusement pour elle. La
libéralité est du reste remarquable
parmi ces Indiens convertis ; ils donnent
à plus misérables qu'eux,
jusqu'à ce qu'ils soient réduits
à leur tour à la
misère.
Les touchantes paroles de Nancy nous
furent un grand encouragement dans notre oeuvre. La
puissance de l'Évangile rayonnait dans sa
chétive demeure comme elle avait
rayonné dans la vallée de l'ombre de
la mort, alors que son mari l'avait
traversée. Nous nous étions
apitoyés sur sa grande misère ;
cependant, peu après, en considérant
la chose à la lumière de
l'Éternité, nous étions
contraints de nous écrier : heureuse
veuve ! Ah ! qu'il vaut mieux habiter une
hutte au sol nu, sans chaise ni lit, privé
de farine, de thé, de pommes de terre, de
l'indispensable, semble-t-il, dépendant
uniquement, quant à la nourriture, de filets
plongés dans le lac, quand on a constamment
comme hôte le Seigneur Jésus, que de
vivre dans une demeure princière, où
l'on est entouré de tout le confort et de
tout le luxe même que peut procurer la
fortune, si l'on est privé de sa
présence.
C'est un grand sujet de joie et de
reconnaissance que de constater les progrès
faits dans tous les domaines par des milliers
d'Indiens dans
différentes régions du Canada. La
mission indienne du Lac Scugog en offre de
frappants exemples. On y voit des Indiens
chrétiens posséder des fermes riches
en grains et possédant tous les instruments
aratoires les plus perfectionnés.
|