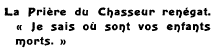En Canot et en traîneau
À CHIENS
Parmi les Indiens CREE et SALTEAUX
CHAPITRE XI
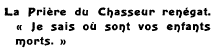
Si, dans notre ministère au milieu des
Indiens Cree, il nous arrivait de traverser des
heures sombres où notre foi était
mise à l'épreuve, il en était
d'autres où nous étions
profondément réjouis et
encouragés. Je veux raconter ici un de ces
encouragements qui illustre la courte parabole
rapportée par Saint Marc (IV, 26 à
29) sur la semence qui pousse sans que l'homme le
sache et sans qu'il intervienne.
Une après-midi de juin où
je travaillais dans ma chambre d'étude
à Norway House, absorbé dans mes
pensées, un bruyant
« Hem ! » prononcé
derrière moi me fit tressaillir et bondir
sur mes pieds. Je vis alors un natif de belle
stature dont la physionomie m'était
entièrement étrangère. Il
s'était glissé dans ma chambre
à la manière de tous ses
congénères,
c'est-à-dire comme un
chat. Les indigènes répugnent
à frapper aux portes et, comme ils sont
chaussés de mocassins qui ne rendent aucun
son, ils pourraient entrer chez vous par vingtaines
sans que vous vous en doutiez. Je tendis la main
à mon visiteur et, après lui avoir
adressé quelques paroles auxquelles je
remarquai qu'il ne prêtait nulle attention,
je le priai de s'asseoir, mais il n'en fit rien et
s'approcha au contraire tout près de moi
pour me demander avec un profond
sérieux :
Missionnaire, veux-tu m' aider à
devenir chrétien ?
- Certainement, répondis-je,
c'est pour cela que je suis ici.
- Veux-tu aussi aider ma femme et mes
enfants à le devenir ?
- Sans doute, car ma chère femme
et moi nous avons quitté notre pays
précisément dans ce but. Dis-moi qui
tu es et d'où tu viens. »
Il me raconta alors l'histoire que
voici. Que ne puis-je mettre dans ce récit
le pathétique et la mimique expressive qu'il
y mit lui-même.
« J'étais un pauvre
enfant orphelin ; mes père et
mère étaient morts sans laisser
personne qui pût prendre soin de moi. J'avais
bien quelques parents, il est vrai, mais,
n'étant pas chrétiens, ils
n'éprouvaient pas grand attrait pour moi et
ne se sentaient pas d'obligation à mon
égard. Ce fut le bon missionnaire Evans qui
me recueillit dans sa propre
maison et m'entoura de son affection. Il me donna
des vêtements, de la nourriture ; il
m'enseigna l'alphabet qu'il avait composé
pour mon peuple et me parla beaucoup du Grand
Esprit et de son fils Jésus. Il m'enseigna
à prier. Que pouvais-je souhaiter de
plus ? Mais je ne sus pas apprécier mon
bonheur.
Au bout de deux ou trois ans, je fis la
connaissance d'une famille qui venait de loin pour
vendre ses fourrures à la Compagnie. Ces
gens me parlaient souvent, ils avaient l'air de
m'aimer. Ils me disaient qu'ils n'avaient point de
petit garçon dans leur wigwam et que, si je
voulais partir avec eux, je m'en trouverais
beaucoup mieux que de rester auprès de
l'homme blanc à qui j'étais
obligé d'obéir.
Enfant insensé que
j'étais, je les écoutai, et
lorsqu'ils furent prêts à partir, je
m'évadai dans la nuit et nous nous en
fûmes à toute vitesse de rames, car
nous savions fort bien que nous agissions mal, et
nous avions peur d'être poursuivis. Il nous
fallut plusieurs jours pour atteindre leurs chasses
et leur campement et là je ne me trouvai pas
du tout aussi heureux qu'ils me l'avaient fait
espérer. Quelquefois nous avions très
peu à manger et souvent ils se montraient
cruels envers moi, mais je n'osais me sauver ;
où serais-je allé, si ce n'est chez
d'autres indiens tout aussi inhumains, ce
qui n'aurait fait qu'aggraver ma
situation. Cette tribu tout entière
était très méchante. Ils
craignaient leurs médecins et n'adoraient
que le mauvais esprit, car ils le redoutaient et
cherchaient à se le rendre propice. Je
devins aussi mauvais qu'eux, essayant d'effacer de
ma mémoire les prières et tous les
enseignements du missionnaire.
À l'âge d'homme,
j'étais un affreux païen, mais en
même temps un bon tireur, et l'un de ces
hommes me vendit sa fille pour être ma
femme ; j'ai toute une famille que j'aime, et
envers laquelle je ne suis pas cruel, car il m'est
resté du temps de mon bonheur le souvenir
que les indiens chrétiens traitent leurs
femmes et leurs enfants beaucoup mieux que les
païens. Tu te souviens que, l'hiver
passé, la neige est tombée
très épaisse. J'avais emmené
ma famille dans la région du daim et je m'y
établis pour la saison. Nous tendîmes
nos pièges, et nous prîmes pas mal de
petit gibier à fourrure, mais le gros gibier
dont la chair se mange fut très rare, si
bien que nous connûmes la disette. Impossible
de gagner les lacs pour pêcher ; nous en
étions trop éloignés. À
la longue, voyant tous mes efforts échouer,
je me décourageai complètement et je
dis : j'essaierai une seule fois encore, si je
ne puis arriver à tuer un daim ou un
élan, je me tuerai moi-même ; je
pris donc mon fusil et quittai
tristement ma pauvre famille.
Le premier jour je ne pus même pas
trouver une piste ; je me couchai
affamé et transi ; durant tout le jour
suivant je ne tirai qu'un lapin que je
dévorai à mon campement solitaire.
Le lendemain je chassai encore jusqu'au
milieu du jour, puis me sentant très faible
et très irrité, je me laissai aller
au désespoir. Je mis une double charge dans
mon fusil, et le plaçai de telle sorte que
je pusse tirer la détente avec mon orteil et
recevoir les deux balles à la tempe.
À cet instant précis, une voix
m'arrêta :
« William ! »
Je détournai le canon du fusil,
car j'étais effrayé et je regardai
tout autour de moi, mais je ne vis personne. Je
découvris alors que la voix parlait en
moi ; elle venait de mon coeur, et je
l'entendis qui me disait :
« William, ne te souviens-tu pas de ce
que le missionnaire t'enseignait au sujet du Grand
Esprit lorsque tu étais un jeune
garçon ? Ne disait-il pas qu'il est bon
et qu'il pardonne même à ceux qui se
sont détournés bien loin de lui,
s'ils sont attristés de ce qu'ils ont fait
et qu'ils reviennent ?
Ne disait-il pas aussi que, s'il nous
arrive des épreuves terribles, le Grand
Esprit est le meilleur ami auquel nous puissions
nous adresser pour en sortir ? Tu es dans une
très grande épreuve, William, ne
penses-tu pas que tu ferais
mieux de retourner à Lui ? »
Mais je tremblais et j'hésitais, car j'avais
honte ; je revoyais toute ma vie :
comment je m'étais enfui de chez mon
bienfaiteur, comment je m'étais
efforcé d'oublier tout ce qu'il m'avait
enseigné du contenu du bon livre, et
comment, lâchement, j'avais affirmé
aux païens au milieu desquels j'étais
allé vivre, que je ne savais rien de la
religion de l'homme blanc. J'avais conscience
d'avoir été très coupable, de
m 'être égaré bien loin ;
pouvais-je rebrousser chemin et revenir à
Lui ? Cependant la voix me
répondait : « C'est cela
qu'il te faut faire. » Je m'assis tout
tremblant, sentant la profondeur de ma
misère ; et la voix me dit
encore : « Si le missionnaire a dit
vrai, rester éloigné serait une
lâcheté plus grande que les
autres. » Tandis que j'étais dans
la plus pénible hésitation, il me
sembla que j'entendais ma femme et mes enfants
pleurant de faim, là-bas dans mon wigwam.
Cela me décida ; je m'agenouillai dans
la neige, auprès du tronc qui m'avait servi
de siège, et je commençai à
prier. Comment le fis-je ?
Je m'en souviens à peine ;
ce que je sais, c'est que je demandai au Grand
Esprit de pardonner au pauvre indien qui avait fui
loin de lui. Je lui dis que j'en avais beaucoup de
chagrin et que je désirais faire mieux, et
je lui promis là
même que, s'il me pardonnait, s'il voulait me
donner quelque nourriture pour ma famille, j'irais
sûrement, aussitôt que la neige et la
glace auraient fondu, trouver le missionnaire et
lui demander de m'aider à devenir
chrétien. Tandis que je priais, je me sentis
réconforté, et j'eus l'impression que
le secours venait ; lorsque je me relevai,
j'étais fortifié comme par de la
nourriture, j'oubliai que je n'avais pas
mangé et qu'il faisait froid. D'un coeur
joyeux je ramassai mon fusil et me remis en route.
Je n'avais pas marché longtemps qu'un gros
daim fila devant moi ; je fis feu et le tuai.
Oh ! que j'étais content ! Vite
j'allumai du feu, je l'écorchai ; je
cuisis et mangeai un morceau. Puis je ployai un
petit arbre et j'attachai à la cime un
quartier de ma bête qui, l'arbre reprenant sa
position normale, devait planer hors de l'atteinte
des loups et des louves jusqu'à ce que je
pusse revenir le chercher. Tout ce que je pus
charger sur mon dos, je l'emportai aux miens.
À partir de cette heure, le succès a
couronne mes efforts et nous n'avons plus souffert
de la faim.
Le Grand Esprit a bien été
pour nous tout ce que le missionnaire avait dit
qu'il serait. Il a pris soin de nous ;
maintenant je n'ai pas oublié la promesse
que je lui ai faite dans ma détresse :
les lacs et les rivières sont
débarrassés de
leur glace, j'ai lancé mon canot et je suis
là, avec femme et enfants, pour te demander
de nous instruire pour que nous puissions
être des
chrétiens. »
Ce récit me toucha beaucoup. Ma
femme et quelques personnes qui nous avaient
rejoints dans ma chambre s'en réjouirent
avec moi et quand nous apprîmes que la
famille du voyageur était là tout
près, attendant les
événements, nous courûmes la
chercher et nous leur offrîmes de bon coeur
un repas substantiel prélevé sur nos
rares provisions, faisant notre possible pour leur
faire comprendre que nous voulions être pour
eux des amis et les aider de notre mieux dans la
voie nouvelle où ils étaient
entrés. Nous constatâmes avec joie
que, depuis le jour de sa prière et de son
exaucement, cet homme avait fidèlement
enseigné aux siens tout ce dont il avait pu
se souvenir des vérités apprises dans
son enfance. Ils les avaient reçues avec
empressement et ne demandaient qu'à en
entendre davantage. Je rassemblai quelques hommes
du village et leur présentai William et sa
famille ; quelques-uns des plus anciens se
souvinrent de son adoption par M. Evans,
après la mort de ses parents qu'ils
n'avaient pas oubliés. joyeux
chrétiens eux-mêmes, ils souhaitaient
de voir tous leurs compatriotes
partager leur foi et leur
espérance ; aussi le retour du fugitif
dans ces conditions fut-il pour eux une vraie
fête ; ils lui firent
immédiatement une place dans leur cercle et
lui rendirent les services nécessaires au
début. Profonds et durables ont
été les changements que la
grâce de Dieu a opérés dans ces
coeurs.

Cependant mon ministère n'était
pas toujours aussi désiré et mes
exhortations aussi bienvenues. Il me souvient d'une
tribu païenne que je visitai sur les berges
d'une rivière sauvage à une centaine
de kilomètres du lac des Castors et qui
semblait déterminée à rester
sourde à mon message, à
résister à tous nos appels. Ces gens
étaient si insensibles, que j'en
étais écoeuré. Et pourtant,
c'était au prix de rudes efforts que nous
étions arrivés jusqu'à eux et
je ne pouvais prendre mon parti de les abandonner
sans avoir obtenu aucun résultat. L'Esprit
de Dieu me suggéra de me servir de la clef
dont j'ai parlé plus haut. Qu'on me permette
le récit de cette tentative.
C'était la saison de la
navigation. La plupart de mes Indiens étant
à ce moment-là enrôlés
dans les convois qui transportaient les fourrures
à la factorerie d'York et
ramenaient les provisions pour l'hiver suivant, je
n'avais pu trouver aucun pagayeur qui connût
dans son entier le trajet que je désirais
effectuer. Faute de mieux, je louai les services de
deux hommes dont l'un en avait parcouru la plus
grande partie. Pendant les huit jours de voyage,
nous n'aperçûmes pas un être
humain et nous eûmes beaucoup à
souffrir, soit de l'absence de gibier qui nous
obligea plus d'une fois à nous
étendre sans souper sur nos couches de
granit, soit de la pluie qui, des jours durant,
nous trempa si bien que nous soupirions
après le soleil pour nous sécher et
nous réchauffer, soit de la nature de la
route, car à maintes reprises il nous fallut
contourner à pied des rapides ou des chutes
en portant notre bagage, canot y compris, sur notre
dos ou sur nos épaules, plusieurs fois
même à travers des marécages
où nous enfoncions jusqu'aux genoux, et cela
sur des espaces de plusieurs kilomètres.
Nous arrivâmes ainsi au Lac des
Castors, à quatre cents kilomètres
environ de chez moi. Il nous fallut en franchir une
centaine encore avant d'avoir l'espoir de
rencontrer aucune créature humaine ; et
nous étions dans l'ignorance la plus
complète sur la direction à suivre.
Nous passâmes la nuit sur le rivage et
pûmes goûter un doux
repos sur des rochers
plats ; le matin de bonne heure, voyant autour
de nous quelques collines, nous convînmes
d'en gravir chacun une pour voir si nous
découvririons quelque lointaine
fumée, quelque indice d'un campement. Je
partis, armé de mon fusil, et, arrivé
au pied de celle qui m'avait été
assignée, je m'apprêtais à
m'engager dans les broussailles qui en garnissaient
les flancs, lorsque je remarquai, au bord d'un
ruisseau d'une pureté cristalline, des
empreintes de sabots de toutes dimensions.
Étourdiment, oubliant la latitude sous
laquelle nous nous trouvions, je m'imaginai qu'un
troupeau domestique était venu là
étancher sa soif et que ses gardiens ne
pouvaient être bien éloignés.
Je m'empressai de retourner au camp et de faire
signe à mes hommes de revenir sur leurs pas,
puis de les conduire, non sans quelque
fierté, au lieu de ma découverte. Ils
avaient souri à mon récit, mais trop
polis pour faire part de la certitude où ils
étaient de mon erreur, ils me suivirent. Je
fus couvert de confusion quand, après avoir
jeté un coup d'oeil sur les empreintes, ils
articulèrent doucement ce seul mot :
« élans ! »
Ne pouvant découvrir aucun indice
utile, nous prîmes le parti de nous
embarquer, et, au bout de quelques, heures de
navigation, de remonter une
belle rivière à l'embouchure de
laquelle nous nous trouvions, en suivant de
près l'une de ses rives sablonneuses.
Bientôt, l'un des pagayeurs se leva vivement
dans le canot en fixant attentivement quelques
petites traces sur le sable. On s'approcha, on mit
pied à terre, et après quelques
instants mes guides s'écrièrent avec
assurance : « Nous y sommes,
missionnaire, maintenant nous t'aurons
bientôt conduit auprès des Indiens. -
Je ne vois là rien qui nous dise où
ils sont. - Mais nous le voyons très bien.
Tu leur as fait dire que tu les visiterais à
cette lune. Ils étaient dispersés
pour la chasse, mais maintenant ils se rassemblent
au lieu du rendez-vous ; un de leurs canots a
remonté cette rivière hier et leur
chien les accompagnait en suivant la rive ;
ces empreintes sont celles qu'il a
laissées. » J'objectai que la
contrée était pleine d'animaux
sauvages et que ces empreintes pouvaient aussi bien
être celles de pattes de loup, par
exemple ; mais ils étaient sûrs
de leur affaire. Ils me firent reprendre place dans
le canot et se remirent allégrement à
ramer. Il ne s'écoula pas longtemps avant
que je pusse voir de mes yeux l'endroit où
des hommes avaient campé la veille ; le
feu était à peine éteint. Vers
le soir nous les avions rejoints comme mes
compagnons l'avaient prédit.
J'ai dit que l'accueil que je
reçus de leur part ne fut pas très
cordial. Ils étaient attristés par la
mort de bon nombre d'entre eux, surtout des enfants
emportés par la scarlatine, inconnue
jusqu'alors dans ces contrées, mais que des
trafiquants y avaient apportée
l'année précédente. Sauf un ou
deux conjureurs, personne ne m'était
ouvertement hostile, mais je ne parvenais pas
à éveiller
l'intérêt ; cependant nous
étions les premiers à leur apporter
la bonne nouvelle de l'amour rédempteur et
nous nous sentions tenus de la proclamer
fidèlement devant eux. Un matin qu'il
pleuvait, nous nous étions réunis,
aussi nombreux que possible, dans le plus grand de
leurs wigwams, et mes deux compagnons
chrétiens m'aidaient en ajoutant leur
témoignage personnel aux enseignements et
aux appels du Saint Livre. Impassibles, les
auditeurs continuaient à fumer, sans que
rien semblât pouvoir les tirer de leur morne
indifférence. À une question que je
leur adressai, ils me répondirent
seulement :
« Comme nos pères ont
vécu et sont morts, ainsi voulons-nous vivre
et mourir. » Épuisé de
fatigue et de tristesse, j'étais
néanmoins en communion avec le Saint-Esprit
et je priais intérieurement. Dans cette
extrémité, le secours
nécessaire et
imploré m'arriva d'une
manière si distincte, que j'eus subitement
l'assurance du succès. Je me levai et
m'écriai joyeusement : « je
sais où sont les enfants que vous avez
perdus, la mort les a saisis de sa froide
étreinte et ils ne sont plus au milieu de
vous, mais je sais avec certitude où sont
les enfants des bons et des méchants, des
Blancs et des Indiens ! » Ah !
cette fois j'avais touché juste !
quelque chose remuait en eux. Ceux qui n'ayant pas
la place de s'asseoir se tenaient debout, la
figure, enveloppée de leur couverture,
telles des momies alignées, les
rejetèrent brusquement et fixèrent
leurs yeux sur moi avec une intense attention et je
poursuivis :
« Oui, vos enfants ont
quitté les feux de bivouac et les
wigwams ; leurs hamacs sont vides, leurs
petits arcs et leurs flèches gisent
abandonnés. Vos coeurs mènent deuil
sur ces bébés dont vous n'entendez
plus la voix et qui ne répondent plus
à votre appel. Ah ! combien je suis
heureux que le Grand Esprit m'autorise à
vous dire que vous pouvez les revoir, ces petits
bien-aimés, et être pour toujours
heureux avec eux. Mais pour cela il vous faut
écouter les paroles qu'il a dites ;
elles se trouvent dans le livre que je vous
apporte. Il faut apprendre à l'aimer et
à le servir. Il n'y a qu'un
chemin qui conduise à ce
beau pays où Jésus, le Fils du Grand
Esprit, est allé et où il conduit
tous les jeunes enfants qui meurent. Maintenant que
vous avez entendu son message, il vous faut suivre
ce chemin si vous voulez entrer, vous aussi, dans
ce beau pays. »
Tandis que je parlais, un robuste
gaillard s'élança tout près de
moi et me dit en se frappant la poitrine :
« Missionnaire, mon coeur est vide, je
mène deuil car aucun de mes enfants n'est
demeuré parmi les vivants ; mon wigwam
est bien solitaire. J'ai soif de les revoir et de
les serrer dans mes bras. Dis-moi, missionnaire,
que dois-je faire pour plaire au Grand Esprit et
pour qu'Il me permette d'aller dans le beau pays
où ils sont ? » Et il
s'affaissa à mes pieds sur le sol, les yeux
pleins de larmes. Plusieurs de ses compagnons
firent de même, brisés par le chagrin
et anxieux d'entendre les enseignements
évangéliques. Alors j'ouvris de
nouveau le Saint Livre et je lus ce que
Jésus a dit des petits enfants. Nous
répétâmes avec autant d'amour
et de simplicité que possible la vieille
histoire toujours nouvelle. Ce fut le commencement
d'une oeuvre bénie dans ces coeurs tout
à l'heure fermés. Peu à peu la
grande majorité se donna sincèrement
à Dieu. Ils ont dès lors
persévéré.
.
CHAPITRE XII
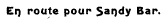
En décembre 1877, j'allai rendre
visite aux Indiens de Sandy Bar. Les
expériences que je fis au cours de ce
voyage, différent assez de celles que j'ai
faites ailleurs pour que je les raconte. Dans ce
temps-là, nous étions
domiciliés à Berens River et
l'endroit où nous devions nous rendre se
trouvait à cent cinquante kilomètres
au sud. Comme la tribu que j'allais voir
n'était pas encore entièrement des
nôtres au point de vue spirituel et que,
d'ailleurs, elle était pauvre, nous voulions
lui être à charge le moins possible et
ma chère femme nous avait pourvus de
nourriture pour un mois. Bien heureusement
c'était à un moment où elle
possédait le nécessaire, ce qui
à cette époque n'était pas
toujours le cas. En effet, il me souvient d'un
matin où nous n'avions eu pour toute
ressource qu'un gigot de chat sauvage, rôti
aussi insipide que coriace et tandis que nous le
dégustions, ma femme m'avait dit :
« Mon cher ami, si tu
ne tues quelque gibier ce matin, je crains que nous
n'ayons rien à dîner. » Sur
quoi j'avais endossé mon vêtement de
cuir et m'étais mis en devoir de fournir de
la venaison.
Pour ce voyage, elle avait fait cuire
abondance de viande et préparé tout
un sac d'une espèce de pâtisserie
aussi grasse que possible. Une fois les
préparatifs terminés, on fixa le
départ à une heure du matin ;
les traîneaux furent chargés en temps
utile, mais il s'éleva une si violente
tempête de neige que force nous fut
d'attendre ; aussi le jour
commençait-il à poindre quand il
devint possible de s'aventurer dehors et d'atteler
les chiens. En route ! Mais la tempête
ne s'était calmée que
momentanément. À peine avions-nous
franchi une trentaine de kilomètres, qu'elle
se déchaîna de nouveau, balayant la
neige, récemment tombée sur la
surface gelée du Winnipeg, avec une telle
violence et nous aveuglant si bien qu'il nous
fallut renoncer à la lutte et nous enfuir
vers la forêt pour y camper. J'ai dit plus
haut comment cette opération se pratiquait
et la manière de préparer les repas
pour hommes et bêtes. Le culte
terminé, il était encore de bonne
heure, mais, comme nous ne nous étions
guère reposés la nuit
précédente, nous n'étions pas
fâchés de nous
étendre et de nous
laisser bercer par les mugissements du vent. Vers
dix heures, je m'éveillai et,
découvrant ma tête, je constatai que
la tempête était apaisée. En un
clin d'oeil, je fus sur pieds et j'allumai un beau
feu.
Pendant que la neige fondait dans le
chaudron, j'appelai mes deux compagnons et quelques
jeunes gens qui nous avaient rejoints avec leurs
attelages de chiens. Mes hommes cherchèrent
immédiatement des yeux la grande ourse qui
est l'horloge nocturne des natifs et je vis bien
à leur mine qu'ils avaient envie de me dire
que je m'étais grossièrement
trompé si je croyais que le matin fût
proche, mais je ne leur en donnai pas l'occasion et
j'activai le déjeuner et le chargement des
traîneaux. Après le culte on attela,
puis je jetai sur le feu les branches qui nous
avaient servi de lit ; la lumière
qu'elles répandaient devait nous permettre
de sortir de l'obscurité de la forêt
et de gagner le lac où régnait une
clarté suffisante. Je pris la tête de
la colonne avec mes excellents coursiers qui
adoptèrent une si bonne allure que, lorsque
le soleil vint nous réconforter, nous
étions à soixante kilomètres
de notre bivouac. Après une halte à
Dog's Head où se trouvaient quelques
indigènes avec leur excentrique chef Pied
épais, nous pointâmes sur
Bull's Head, qui est
situé sur l'autre rive du lac, pour y passer
la seconde nuit. De ce côté, le rocher
est si escarpé qu'il était impossible
de l'escalader avec nos lourdes charges ; il
fallut établir nos couches et notre feu dans
l'amoncellement de neige qui se trouvait à
sa base : pauvre dortoir ! Nous n'avions
aucun abri contre le vent, qui, par surcroît,
changea tout à coup de direction. Lorsque
semblable contre temps nous arrivait dans la
forêt, nous nous empressions de
déplacer le feu ; ici, pas moyen ;
tout ce que nous pouvions faire, c'était de
l'élever, mais cet expédient
était inefficace, si bien que nous
dûmes choisir entre la fumée
suffocante et le vent glacial.
Pendant que nous installions notre
literie, c'est-à-dire nos fourrures, dans la
neige, (pas question là de branches vertes
pour augmenter le confort) nous vîmes arriver
plusieurs natifs qui, en descendant le lac, avaient
aperçu notre feu. Ils me firent grande
fête, ce qui dans ces circonstances
signifiait : donne-nous du thé et de la
nourriture. Une bande de chiens efflanqués,
affamés, semblables à une horde de
loups les escortait. J'accueillis ces gens avec
bienveillance, mais je n'étais pas sans
crainte pour nos provisions et même pour nos
harnais et autres effets pour lesquels
je connaissais l'appétit
des chiens esquimaux, aussi engageai-je nos
visiteurs à camper un peu plus loin
où ils pourraient, leur dis-je, s'arranger
plus commodément. Cette insinuation ne
rencontra que de bruyantes protestations : En
aucun cas ils ne sauraient se refuser le plaisir de
passer au moins une nuit dans le camp du
missionnaire dont ils avaient tant entendu
parler ; n'était-il pas le grand ami
des Peaux-Rouges. Il était malaisé de
démentir une réputation si favorable
et de résister à une telle
diplomatie, mais je voyais des ennuis à
l'horizon, et effectivement ils ne
manquèrent point. Dans la pensée de
sauver quelque chose, je sacrifiai aux chiens loups
tout notre poisson, qui aurait suffi à
sustenter les huit nôtres pendant plusieurs
jours. Il fut vite dévoré. Je
commandai à mes hommes de réunir les
harnais tout auprès de nous et
d'échafauder les traîneaux pour en
faire une sorte de petite barricade et
protéger ainsi les courroies, si possible.
Outre la provision de route, j'avais un sac de
viande et un autre de pâtisserie
préparée par ma femme que je devais
consommer pendant mon séjour auprès
de la tribu que j'allais évangéliser.
Je mis le sac de viande (gelée et dure comme
de la pierre, cela va sans dire) sous ma tête
en guise d'oreiller ; l'autre fut
confié à mes
hommes avec maintes recommandations.
J'avais eu la précaution
d'amonceler près de moi un tas de gros
morceaux de bois ramassés sur la
grève dans ce que la vague avait
déposé avant l'hiver. Ainsi muni
d'armes défensives, je m'étendis avec
mes compagnons pour dormir. Vain espoir ! Les
chiens ne tardèrent pas à se disputer
l'honneur de nettoyer notre chaudron puis à
se mettre en quête de quelque autre chose.
Ils se promenaient sur nos corps et bientôt
se rassemblèrent autour de ma tête
d'une manière significative. Je me levai
d'un bond et leur envoyai mes projectiles si
vigoureusement qu'ils prirent le large, mais pas
pour longtemps. Dix minutes plus tard, alors que je
m'étais de nouveau enseveli sous mes
multiples enveloppes, je dus renouveler la
manoeuvre, et cela plusieurs fois ;
jusqu'à ce que, mes projectiles
épuisés, je me figurai qu'ils en
avaient reçu suffisamment pour se tenir cois
désormais. Je me recouchai et m'endormis
vite cette fois, car j'étais harassé
de fatigue. Hélas ! Le matin je
constatai qu'il ne restait pas une once de viande
sous ma tête, ni une miette de pitance dans
le sac que l'Indien avait ordre de garder comme un
trésor. Triste moment dans ce lieu
inhospitalier, avec un
misérable feu qui
persistait à brûler à l'envers
et à nous envoyer toute sa fumée dans
les yeux, si bien que nos joues étaient
sillonnées de larmes et, par surcroît,
nos exécrables voleurs postés autour
de nous dans la neige, l'estomac bien garni,
surveillaient tous nos mouvements de l'air le plus
innocent du monde.
Par bonheur, un de mes compagnons avait
par devers lui un petit sac d'une espèce de
biscuit de mer qu'il destinait à un ami. Il
les exhiba et nous pûmes ainsi en y ajoutant
du thé et du sucre - tout ce qui nous
restait - tromper la faim et le froid.
Récriminer, nous n'en avions pas le loisir,
il s'agissait de faire diligence, car nous savions
que nous n'avions aucune chance de trouver quoi que
ce soit à manger avant d'avoir descendu une
centaine de kilomètres plus au sud et nous
savions aussi, par d'autres expériences,
qu'il nous fallait lutter de vitesse avec la faim
qui, dans peu d'heures, nous attraperait
sûrement après notre léger
déjeuner. Nous nous agenouillâmes dans
la neige, remettant au Seigneur notre
journée, puis, fouette cocher ! Mes
braves chiens se montrèrent à la
hauteur des circonstances car, avant que cette
courte journée de décembre fût
achevée, et que le lac fût
enveloppé d'obscurité, les
étincelles qui s'échappaient des
toits des huttes amies nous
avertirent que la bataille était
gagnée, mais elle n'avait pas
été exempte de dangers et de
blessures.
Mon plus grand chien Jack était
tombé dans une fissure de la glace et
après lui deux indigènes qui nous
suivaient. Ces fissures sont choses très
dangereuses, on le comprend. Elles se produisent
inopinément ; la glace épaisse
de plusieurs pieds craque tout d'un coup avec une
très forte détonation, l'eau jaillit
alors et remplit immédiatement la crevasse,
la surface gèle rapidement et on n'y
aperçoit rien d'anormal, mais il faut un
certain temps pour que le gel solidifie toute la
couche d'eau et, si l'on y passe avant que la
partie solide soit assez résistante, on
enfonce. J'ai vu plus d'une fois mon guide
disparaître ainsi, quoique jamais d'une
manière fatale. Souvent aussi je me suis vu
moi-même tout près d'y tomber. Cette
fois-ci, j'étais sur mon
traîneau ; le premier chien, puis le
second passèrent, ce fut le
troisième, Jack, qui sombra. Les deux
premiers et le quatrième firent si bien leur
devoir, que nous le sauvâmes, mais la pauvre
bête en peu de minutes fut recouverte d'une
épaisse carapace de glace. Elle comprit si
bien le danger de sa situation, qu'à peine
avais-je fait franchir la crevasse au
traîneau, elle repartait comme un trait dans
la direction de la forêt
encore éloignée. Elle
entraînait ses compagnons et moi-même.
Ce fut l'affaire d'une heure, pour toucher terre.
Il y avait là abondance de bois sec. Un bon
feu flamba vite, devant lequel la bonne bête
étendue sur une peau de buffle put se
dégeler, puis se sécher. Elle se
retournait d'elle-même de moment en moment
pour exposer à la chaleur tantôt une
partie, tantôt une autre de son être.
Quand les indigènes qui avaient
partagé le même sort arrivèrent
à leur tour, elle était revenue
à son état normal. Nous
suspendîmes le chaudron à thé
avant de reprendre notre course. Ce fut la seule
halte ce jour-là ; et je m'en tirai avec le
nez et quatre doigts gelés.
Les braves gens chez qui nous allions
nous reçurent à bras ouverts. J'en
connaissais la plus grande partie, plusieurs
étaient de Norway-House. A cause de
l'accroissement rapide de cette station, le gibier
et le poisson y étaient devenus insuffisants
; sur la foi de récits séduisants,
ils avaient émigré en assez grand
nombre dans cette nouvelle contrée.
Arrivés de l'été
précédent, ils s'étaient
construit des cabanes qui n'étaient ni
spacieuses ni chaudes. Il y en avait une douzaine
outre un grand nombre de wigwams. Je trouvai
là avec les chrétiens une foule de
païens, attirés eux
aussi par la réputation
de ce coin de pays. Toutefois, la pêche
n'avait pas donné ce qu'ils en
attendaient ; aussi avaient-ils beaucoup de
misères à me conter. Je demeurai huit
jours au milieu d'eux, et, vu mon dénuement,
ils me fournirent généreusement de
leur disette. Par bonheur, les lapins pris au
piège s'ajoutaient aux rares poissons. Ce
fut là mon menu pour les trois repas
quotidiens et je n'eus pas à en
souffrir.
Selon mon habitude, je prêchais
trois fois par jour et tenais école entre
les services. J'organisai une
« classe » de trente-cinq
membres dont dix nouveaux convertis. Ce fut pour
moi une grande joie, car je voyais en eux des
fruits de la semence répandue les
années précédentes parmi
beaucoup de déboires. Le dimanche je
célébrai la sainte Cène ;
ce fut un service mémorable ; nous
sentions la présence du Sauveur et tous nous
renouvelions notre alliance avec Lui.
Comme conducteur spirituel de ce petit
troupeau perdu dans la solitude, j'eus le bonheur
de trouver en Benjamin Cameron un homme très
qualifié. Autrefois cannibale, il avait
été touché par la grâce
divine et tiré de son abjection. Ses pieds
étaient affermis sur le Roc, sa bouche
pleine de louanges. On pouvait dire de lui
comme d'Étienne, qu'il
était un homme de foi plein du
Saint-Esprit.
Les heures que je passai là avec
les enfants me laissent un excellent souvenir. Les
aînés lisaient déjà pas
mal et je fus très content de leur
connaissance du catéchisme en Cree et en
Anglais. Je distribuai de nouveaux livres. J'eus
aussi la satisfaction de laisser aux familles les
plus pauvres quelques vêtements chauds
fournis par des amis de Montréal, qui
auraient été bien
récompensés s'ils avaient pu voir
à quel besoin ils répondaient et
quelle reconnaissance ils provoquaient.
Je fêtais Noël au milieu de
ces pauvres gens et comme l'un d'entre eux avait eu
la chance de prendre dans son piège quelques
bêtes à fourrure précieuse et
qu'il les avait échangées à un
trafiquant de passage contre de la farine et des
fruits secs, il confectionna en mon honneur un Plum
pudding ! Hélas ! mon souvenir est
encore hanté par ce chef-d'oeuvre culinaire
aussi n'entrerai-je dans aucun détail
à son sujet.
Le retour au logis ne nous prit que deux
jours, favorisé qu'il fut par un temps de
choix.
|