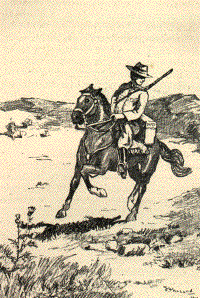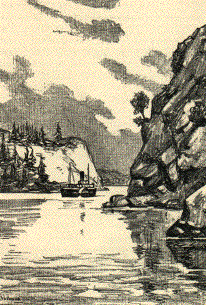En Canot et en traîneau
À CHIENS
Parmi les Indiens CREE et SALTEAUX
CHAPITRE III

Plusieurs lettres me furent apportées un
jour dans mon cabinet de travail où
j'étais occupé au milieu de mes
livres. J'étais alors pasteur de l'une des
églises de la ville de Hamilton. De grandes
bénédictions venaient de nous
être accordées : plus de cent
quarante nouveaux membres avaient été
admis récemment dans l'église.
J'avais profité des vacances de Noël
pour me marier et je venais de rentrer à mon
poste avec ma bien-aimée. Parmi ces lettres,
l'une était ainsi conçue :
« Bureau des Missions, Toronto ....
1868
Au Révérend Egerton
Young,
CHER FRÈRE,
Dans une importante séance que le
Comité des Missions a tenue hier, il a
été décidé unanimement
de vous adresser un appel comme
missionnaire des tribus indiennes à
Norway-House et dans les territoires du Nord-Ouest,
au delà du lac Winnipeg. Une prompte
réponse apportant votre acceptation obligera
vos affectionnés E. Wood - L.
Tailor. »
Ayant lu cette lettre, je la tendis
à travers la table à Madame Young,
mon épouse de quelques jours. Elle la lut
à son tour attentivement, puis après
un instant de recueillement bien naturel, elle
demanda :
« Qu'est-ce que cela veut
dire ?
- Je le sais à peine,
répondis-je, mais il est évident que
cela veut dire beaucoup.
- T'es-tu offert comme missionnaire pour
ce pays lointain ?
- Mais non, quoique je
m'intéresse beaucoup à l'oeuvre
missionnaire que poursuit notre église et
qu'elle m'ait de tous temps attiré, je n'ai
fait aucune démarche dans ce sens. Il y a
quelques années j'en ai eu la
pensée ; il me semblait que j'aimerais
à travailler dans un champ lointain, mais en
dernier lieu, comme le Seigneur nous a tellement
bénis ici, qu'Il nous a donné un si
beau réveil, j'aurais cru manquer à
mon devoir en m'offrant ailleurs.
- Eh bien, que vas-tu
répondre ?
- Ah ! c'est justement ce que je
voudrais savoir.
- Il y a une chose que nous pouvons
faire, » dit-elle.
Alors, d'un commun accord, nous nous
agenouillâmes ensemble et
« déployâmes la lettre
devant l'Éternel », - comme jadis
Ézéchias - en lui demandant la
sagesse dont nous sentions le besoin pour nous
guider dans cette affaire importante qui se
présentait à nous d'une
manière si imprévue et qui, au cas
où nous l'accepterions, devait modifier
entièrement les plans et projets que, dans
la joie de notre lune de miel, nous venions
d'élaborer. Après avoir
imploré de tout notre coeur la
lumière et prié que la volonté
divine nous fût si clairement
révélée que nous ne puissions
nous méprendre sur la voie à suivre,
nous nous relevâmes et je demandai à
ma femme : « As-tu quelque
impression quant à la décision
à prendre ? » Ses yeux se
remplirent de larmes, mais sa voix presque basse
était ferme lorsqu'elle
répondit : « Cet appel
était bien inattendu, mais je crois qu'il
vient de Dieu ; nous
irons. »
Mon église et principalement son
conseil s'opposèrent fortement à ce
que je les quittasse et surtout dans un tel moment
lorsque, disaient-ils, tant de nouveaux convertis
avaient été ajoutés à
l'église par mon moyen. Je consultai mes
collègues et tous, sauf un, me
répondirent : « Restez
où vous êtes et où Dieu a si
visiblement béni vos
travaux. » Quant
à la réponse du frère qui
n'était pas d'accord avec les autres, je ne
l'ai jamais oubliée et, comme elle peut
faire du bien, je la rapporterai ici. Lorsque je
lui demandai son avis, je le vis avec surprise
devenir très agité et se mettre
à pleurer comme un enfant ; puis, quand
il put maîtriser son émotion, il me
dit :
« Pour répondre
à votre question, laissez-moi vous raconter
quelque chose de ma propre histoire. Il y a de cela
de longues années ; j'avais un
ministère très heureux dans ma
patrie. J'étais passionnément
attaché à mon oeuvre, à mon
home, à ma femme. Je jouissais de la
confiance et de l'estime de mon église et me
disais que j'étais aussi heureux qu'on peut
l'être de ce côté-ci de la
tombe. Un jour je reçus un appel du bureau
des Missions Wesleyennes de Londres me demandant si
je serais disposé à partir pour la
Mission dans les Indes occidentales. Sans prendre
la chose en considération et sans en faire
un sujet de prière, je répondis de
suite par un refus catégorique.
À partir de ce jour, tout changea
pour moi ; le sourire du ciel parut me
quitter, je perdis l'action que j'avais sur mes
gens, sans que je puisse dire comment ;
l'influence que j'exerçais
s'évanouit ; mon foyer, naguère
heureux, fut dévasté et, dans ma
peine, je ne trouvai pas
même de sympathie auprès de mon
église ou de la paroisse. Je dus
résilier mes fonctions et quitter l'endroit.
Je tombai dans l'obscurité et perdis le
contact avec mon Dieu. Il y a quelques
années, j'ai émigré dans ce
pays, Dieu m'a rendu la lumière de sa face.
L'église a été très
sympathique et indulgente. Il m'a été
donné de travailler pendant plusieurs
années dans son sein et j'en suis
reconnaissant, mais, ajouta-t-il solennellement, il
y a longtemps que j'ai résolu, si nos
églises m'appellent aux Indes occidentales
ou dans n'importe quel autre champ de mission, de
ne pas répondre par un refus
précipité. »
Je méditai sur ses paroles et sur
son expérience et j'en parlai avec mon
excellente femme. Nous décidâmes que
nous partirions. Nos amis furent d'abord tout
saisis de notre résolution, mais
bientôt ils nous donnèrent leur
bénédiction en y joignant des marques
tangibles de leur affection. Une douce paix remplit
nos âmes et il nous tarda d'être
à l'oeuvre dans le nouveau champ qui
s'était si subitement ouvert à
nous.
Le service d'adieu eut lieu à
Toronto au commencement de mai. La vieille
église de la rue Richmond
était comble et l'enthousiasme très
grand. Celui qui présidait cette
solennité était le modérateur
de la conférence de cette
année-là, le vénérable
pasteur Elliot, des mains duquel j'avais
reçu la consécration pastorale
quelques mois auparavant. Parmi les nombreux
orateurs je nommerai le pasteur G. Mac Dougall qui
possédait une grande expérience
missionnaire ; ce qu'il avait à dire
valait d'être entendu. M. George Young qui
prenait congé de l'église dont il
était depuis longtemps le pasteur
aimé et qui allait partir en même
temps que moi parla aussi d'une manière fort
intéressante. Le Dr Punshon qui venait
d'arriver d'Angleterre prononça une de ses
allocutions inimitables ; le souvenir de ses
paroles pleines d'affection chrétienne nous
soutint durant les jours qui suivirent.
Ce fut aussi pour nous une grande joie
d'avoir auprès de nous, sur l'estrade,
pendant cette émouvante
cérémonie, mon
vénéré père, le
révérend William Young. Il faisait
partie de cette bande héroïque de
ministres pionniers du Canada qui en
établissant l'église sur une solide
base ont contribué pour leur large part au
développement spirituel du pays. Sa
bénédiction a été une
des faveurs bien appréciées de ces
heures mémorables au début de
notre nouvelle carrière.
Mon père avait connu très
particulièrement W. Case et J. Evans dont il
a déjà été fait
mention ; il avait même, par
intervalles, partagé leur activité en
faveur des Indiens. Il croyait en la puissance de
l'Évangile pour sauver cette nation et
maintenant il se réjouissait de
posséder un fils et une fille
consacrés à cette oeuvre.
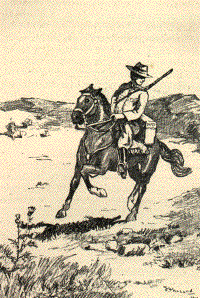 LE
RÉVÉREND MAC-DOUGALL
LE
RÉVÉREND MAC-DOUGALL
Comme nous avions en perspective un voyage de
bien des centaines de kilomètres dans les
États de l'Ouest, au delà des
localités desservies par les voitures ou les
bateaux à vapeur, il fut
décidé que nous prendrions avec nous
nos propres chevaux et nos wagons recouverts de
toile. Notre départ s'effectua de Hamilton
même ; le lundi 11 mai 1868, notre
petite troupe quitta cette petite ville,
défilant dans la direction de
Sainte-Catherine où nous devions prendre
passage sur un « propulseur »
à destination de Milwaukee. Notre aventureux
voyage était commencé.
Notre caravane était
composée comme suit :
D'abord le révérend Mac
Dougall qui après avoir, durant de longues
années, déployé une
activité bénie parmi les Indiens du
Saskatchewan à quinze cents
kilomètres du Territoire de la
Rivière Rouge, était revenu au Canada
chercher du renfort et avait
réussi à en trouver. Comme il
possédait une certaine expérience des
voyages dans l'Ouest, il était le chef de
l'expédition.
Venait ensuite le révérend
George Young avec sa femme et son fils. Il avait
consenti à aller comme prédicateur
pionnier dans les établissements de la
Rivière-Rouge où le méthodisme
ne s'était pas encore implanté ;
il devait y réussir pleinement.
Puis c'était le génial
révérend Peter Campbell qui, avec sa
brave femme et deux petites filles,
échangeait une paroisse agréable
contre une station perdue des prairies. Deux
frères de Mme Campbell qui se destinaient
à l'enseignement dans la même
contrée étaient encore des
nôtres, ainsi que plusieurs autres jeunes
gens, et dans le Dacotah nous fûmes rejoints
par deux jeunes Indiens, Job et Joe. Avec ma femme
et moi cela faisait quinze ou vingt personnes.
 MADAME YOUNG
MADAME YOUNG
À Sainte-Catherine nous embarquâmes
nos effets et prîmes passage sur l'Empire
pour Milwaukee, un port important sur le lac
Michigan que nous devions atteindre en traversant
successivement sur presque toute leur longueur les
trois lacs Erié, Huron et Michigan. Nous y
arrivâmes en effet le dimanche 17,
après une traversée
fatigante par le fait de la cohue
des passagers et du mauvais temps que nous
essuyâmes sur ce dernier grand lac. Milwaukee
était alors une ville
américo-allemande très
éveillée et remuante. Parmi les
foules que nous rencontrâmes, il ne semblait
pas y avoir un grand respect pour le jour du
Seigneur. Les « affaires »
battaient leur plein dans la plupart des rues comme
si c'eût été un jour ouvrier.
Sans doute il y avait un certain nombre d'habitants
qui « n'avaient pas souillé leurs
vêtements » et qui ne profanaient
pas ce jour de repos, mais, voyageurs
fatigués, nous n'avions pas le loisir de les
rechercher.
Malgré que nous eussions pris la
précaution d'expédier tous nos colis
en transit et qu'un certificat du consul
américain déclarât que nous
avions accompli toutes les formalités
exigées, nous fûmes soumis à
quantité de vexations et de dépenses.
si bien que nous dûmes
télégraphier aux employés
supérieurs à Washington. La
réponse ne tarda pas à arriver,
donnant l'ordre aux subalternes trop
zélés de nous laisser sans
délai poursuivre notre voyage. Nous n'en
avions pas moins perdu deux jours
précieux.
Nous quittâmes cette ville
malencontreuse pour La Crosse sur le haut
Mississipi. Là nous
reprîmes un steamer pour St-Paul. Les grands
steamers à fond plat que l'on a
lancés sur ces rivières de l'Ouest
sont une vraie trouvaille. N'ayant que quelques
centimètres de tirant d'eau, ils glissent
sur les bancs de sable presque à fleur d'eau
et, se balançant contre le rivage, ils
abordent et reçoivent sans peine passagers
ou cargaison là où les quais sont
inconnus et où, du reste, s'ils existaient,
ils seraient sujets à être
emportés par les grandes crues du
printemps.
Dans bien des endroits, le paysage est
magnifique le long des rives du Mississipi
supérieur ; de hautes éminences
se dressent dans une étonnante
variété de formes et de pittoresque.
Parfois elles se composent de rocs
dénudés, tandis qu'ailleurs elles se
revêtent jusqu'au sommet d'une riche verdure.
Il n'y a que peu d'années que le cri de
guerre des Peaux-Rouges résonnait seul ici
et que les troupeaux de buffles se jouaient autour
de ces escarpements et étanchaient leur soif
dans ces eaux. Maintenant le sifflet strident du
vapeur trouble la solitude et se répercute
d'écho en écho, avec une
singulière netteté, des falaises
abruptes aux fertiles vallées.
Le jeudi, au matin, nous abordâmes
à Saint-Paul, ville très
affairée, elle aussi, admirablement
située sur la rive orientale.
Ici nous eûmes à nous
démener pendant des heures pour organiser
notre caravane, nous fournir de provisions et
prendre les derniers arrangements en vue du long
voyage que nous avions maintenant à faire
dans d'autres conditions, car le « cheval
de fer » n'avait pas encore
pénétré plus avant, et la
grande vague houleuse d'immigration qui, si
tôt après, devait couvrir tous ces
fertiles territoires, ne s'annonçait encore,
pour ainsi dire, que par des gouttes d'eau
isolées.
Nos splendides chevaux qui avaient
été emprisonnés dans la cale
du vaisseau, puis serrés comme des ballots
dans des wagons, allaient désormais avoir
l'occasion d'exercer leurs membres et de montrer
leur valeur. Vers le soir nous sortîmes de la
ville en procession. Cette première
chevauchée dans la prairie reste vivante
dans mon souvenir. C'était une de ces
journées glorieuses qui ne nous sont que
rarement accordées pour nous montrer ce que
devait être la terre avant la chute. Le ciel,
l'air, le paysage, tout semblait dans une telle
harmonie et si splendide, que je m'écriai
involontairement : « Si le
marchepied de Dieu est si beau, que doit être
son trône ? »
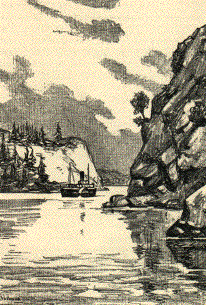 MAINTENANT LE SIFFLET DU VAPEUR
TROUBLE LA SOLITUDE .....
MAINTENANT LE SIFFLET DU VAPEUR
TROUBLE LA SOLITUDE .....
Au bout de quelques milles nous campâmes
pour la nuit, tous dans les meilleures
dispositions, nous
réjouissant de ce que nous tournions le dos
à la civilisation et nous enfoncions dans le
désert. Cependant, les premiers jours, nous
devions passer dans le voisinage de villages et
d'établissements de frontière, mais,
à mesure que nous avancions, ils diminuaient
rapidement en nombre.
Après bien des jours de marche,
nous fîmes halte sur la rive droite du
Mississipi, près de l'emplacement où
s'élève aujourd'hui la ville
florissante de Clear-Water. Comme quelques-uns de
nos véhicules et certaines parties de notre
train de campagne commençaient à
montrer des signes de faiblesse, nous
trouvâmes prudent de passer le tout
sérieusement en revue avant de pousser plus
loin, puisque désormais nous n'avions plus
à espérer aucun secours de nos
semblables.
Notre campement se composait de huit
tentes, quatorze chevaux, quinze à vingt
personnes en comptant petits et grands, blancs et
indiens. À chaque fois que nous nous
arrêtions pour la nuit, nous lâchions
les chevaux dans la prairie luxuriante,
après avoir pris soin de les entraver en
liant ensemble leurs deux jambes de devant. Au
premier abord cela paraissait cruel et quelques-uns
des plus vifs y furent très sensibles et se
débattirent tant qu'ils
purent contre cette atteinte
portée à leur liberté.
Cependant ils s'y accoutumèrent
bientôt et nous atteignîmes notre but
qui était de les empêcher de
s'éloigner par trop de nous pendant la
nuit.
À un endroit où nous
fûmes obligés de stationner plusieurs
jours pour réparer des essieux, j'eus une
aventure mémorable. Quelques braves colons
étaient venus à nous et nous avaient
donné l'avis désagréable
qu'une bande de voleurs de chevaux rôdait
dans le pays et que nous ferions bien de ne pas
perdre de vue nos splendides canadiens.
Comme il y avait à quelque
distance une grange isolée, construite par
l'un des colons qui ne s'en servait pas avant la
moisson, il nous autorisa à y enfermer pour
la nuit nos montures tant que nous resterions
là. Deux d'entre nous y étaient
détachés chaque soir pour monter la
garde. J'y allai à mon tour avec le fils de
mon homonyme. Comme nous partions, j'entendis notre
chef dire d'un ton plaisant :
« Voilà de fameux gardes !
Mes gamins indiens pourraient aller dérober
leurs chevaux jusqu'au dernier sans courir le
moindre risque. » Piqué au vif par
cette remarque, je rétorquai :
« Je crois, M. Mac Dougall, que j'ai la
meilleure bête de toutes ; si
vous-même ou l'un de vos indiens
réussissez à la
prendre entre le coucher et le lever du soleil, je
vous en fais hommage. »
Nous les attachâmes tous en une
ligne et assujettîmes toutes les ouvertures
de la grange, sauf la grande porte de devant, puis
nous disposâmes nos sièges de telle
sorte que, sans être en vue nous-mêmes,
nous pouvions surveiller soit les chevaux soit
chacune des portes, les ayant à
portée de nos fusils. Sans élever la
voix nous bavardâmes jusque vers une heure
puis tout devint silencieux. La nouveauté de
ma situation m'impressionnait et, assis là
en pleine nuit, je la comparais avec celle que
j'avais occupée peu de semaines seulement
auparavant : alors pasteur d'une église
de ville, au milieu d'un beau réveil,
entouré de tout le confort de la
civilisation ; aujourd'hui près de
cette grange dans le Minnesota, siégeant sur
un tas d'herbe des grandes prairies à
travers les longues heures de la nuit, une carabine
sur les genoux, protégeant de fougueux
coursiers contre une bande de voleurs.
Mais, chut ! qu'est ceci ?
Certainement une main cherche à tâtons
le loquet de bois de la porte de derrière et
nous nous disons mentalement :
« monsieur le voleur, tu as fait trop de
bruit, tu t'es trahi ! » La porte
s'entr'ouvre et, la nuit étant tout
éclairée par les
étoiles, nous distinguons nettement un homme
de haute stature. Je le couche en joue, mais au
moment de presser la détente, la
pensée me vient rapide comme
l'éclair : « Avant de tirer,
assure-toi que cet homme a de mauvaises intentions,
car c'est une chose sérieuse que d'envoyer
une âme dans
l'éternité. » Toujours
épaulant mon fusil, je crie :
« Qui va
là ?
- Eh ! c'est votre ami Mathieu, dit
le grand homme qui s'approche alors dans
l'obscurité ; c'est drôle que
vous ne me connaissiez pas encore. »
À la pensée de ce que
j'avais été si près
défaire, un étrange malaise m'envahit
et, jetant loin mon arme, je m'affaissai, tremblant
comme une feuille au vent. Cependant le brave homme
se doutant peu du danger auquel il venait
d'échapper et ne se rendant pas compte de
l'effet que son étourderie produisait sur
moi, expliquait qu'il faisait si chaud
là-bas dans les tentes et si
étouffant que, ne pouvant dormir, il avait
trouvé bon de venir nous rejoindre pour
finir la nuit dans la grange. Au matin il y eut
grande agitation au camp et des paroles
sévères à l'adresse de celui
qui n'avait pas tenu compte de l'ordre très
précis qui avait été
donné, portant que, sous aucun
prétexte, personne n'approcherait de la
grange tandis qu'on y veillait.
Ailleurs, toujours dans le Minnesota,
nous tombâmes sur une colonie en train de
« restaurer ses lieux
désolés », disons : de
reconstruire ses demeures détruites par la
terrible guerre des Sioux. Ayant presque tous
soufferts de cette effroyable lutte, ils
nourrissaient des sentiments très amers
à l'égard des Indiens, ignorant
complètement ce fait que les blancs seuls
étaient responsables de cette révolte
sanguinaire, où neuf cents vies avaient
été perdues et où un
territoire plus étendu que quelques-uns des
états de la Nouvelle-Angleterre avait
été entièrement
dévasté. C'est maintenant un fait
reconnu et incontesté que c'est la
cupidité et la déloyauté des
agents du gouvernement des États-Unis qui
ont causé cette guerre. L'agent principal du
gouvernement avait reçu six cent mille
dollars en or, appartenant aux Indiens et qui
devaient être versés entre les mains
de « la petite Corneille » et
d'autres chefs ou membres de sa tribu. L'or faisant
très forte prime à ce
moment-là, l'agent en profita : il
l'échangea contre du papier et, mettant la
différence dans sa poche, prétendit
payer les Sioux avec des billets de banque.
Lorsque les paiements
commencèrent, « la petite
Corneille » connaissant les droits que
lui donnaient le traité,
déclara : « Dollars or valoir
plus que dollars papier ; toi
payer or ! »
L'agent refusant, la révolte éclata.
Ce n'est là qu'un exemple entre des
vingtaines, où l'égoïsme et
l'ambition de quelques individus ont amené
des soulèvements dont les résultats
se chiffrent par des centaines de morts et des
millions, perdus pour le Trésor. En outre,
ces mêmes fonctionnaires sans scrupule,
désireux de cacher l'énormité
de leurs crimes et de distraire l'attention
d'eux-mêmes et de leurs malversations,
subornent la presse et d'autres complices pour
discréditer systématiquement leurs
victimes et représenter cette race sous un
faux jour.
« Demeurez avec nous et soyez
notre pasteur, me dirent un jour un groupe de
colons, nous vous procurerons un bon
emplacement ; nous vous aiderons à
faire quelques récoltes, et ferons tout
notre possible pour que vous vous trouviez bien au
milieu de nous. » Voyant que leurs
instances ne nous ébranlaient pas, ils
changèrent de tactique et l'un d'eux se mit
à dire : « Vous ne franchirez
jamais le territoire des Indiens du nord avec ces
jolis chevaux et tout votre bel attirail. - Oh que
si ! répliqua M. Mac Dougall ;
nous avons un petit drapeau qui nous fera traverser
sûrement n'importe quelle tribu de
l'Amérique. » Ils mirent fortement
en doute cette assertion. Cependant elle se
réalisa
littéralement, en tout cas
en ce qui concerne les Sioux, car lorsque, quelques
jours après, nous les rencontrâmes,
notre bannière étoilée
fixée à un manche de fouet leur fit
jeter leurs fusils dans l'herbe et accourir vers
nous les mains étendues, nous faisant savoir
par le moyen de ceux qui comprenaient leur langage
qu'ils étaient heureux de nous voir et de
fraterniser avec des sujets de leur
« grande mère » au
delà des eaux.
 CAMPEMENT D'INDIENS
CAMPEMENT D'INDIENS
Lorsque, continuant notre route vers le Nord,
nous atteignîmes leur domaine et que nous les
vîmes descendre sur nous, nous conformant aux
ordres de notre chef, nous cachâmes nos armes
dans les wagons et nous allâmes à leur
rencontre comme des amis sans défiance. Ils
fumèrent le calumet - pipe - de paix avec
ceux d'entre nous qui pouvaient faire usage de
l'herbe détestable qu'ils y consomment et
burent du thé en compagnie des autres. Avec
ma femme et moi qui ignorions aussi
complètement leur langue qu'ils ignoraient
eux-mêmes la nôtre, Ils ne purent
s'entretenir que par quelques signes, mais, par M.
Mac Dougall et par les Indiens qui faisaient partie
de notre troupe, ils nous assurèrent de leur
amitié. Ce soir-là nous
dressâmes nos tentes, entravâmes nos
chevaux et les lâchâmes comme de
coutume, puis nous nous mimes
à faire cuire notre repas, à dire nos
prières, à dérouler nos lits
de camp et à nous coucher sans aucune
sentinelle, ni aucune protection humaine quoique
nous pussions voir à peu de distance les
feux de bivouac de cette tribu
« traîtresse et
altérée de sang » et que
leurs yeux perçants fussent sur nous. Telles
furent nos relations avec un peuple qui, s'il est
prompt à ressentir l'offense, est non moins
sensible aux bons procédés et qui se
montre aussi fidèle que
n'importe quelle race à
ses promesses et aux obligations que lui imposent
les traités.
Nous mîmes trente jours à
franchir la distance qui sépare St-Paul des
établissements de la Rivière-Rouge.
Il fallait passer à gué nombre de
rivières naturellement veuves de ponts. Plus
d'une fois, trois ou quatre jours s'étaient
écoulés avant que nous eussions, pu
faire passer à l'autre rive toute la
caravane. Parfois tel des wagons restait pris dans
le sable mouvant ou bien dans une fondrière
et il ne fallait rien moins que les forces
combinées de toute la partie masculine de
notre petite armée pour le tirer de ce
mauvais pas. Souvent les dames se
déchaussaient et pataugeaient bravement
à travers de larges cours d'eau là
où les voyageurs filent maintenant à
toute vapeur, faisant soixante kilomètres
à l'heure, dans des wagons-salons et des
coupés-lits.
Somme toute, le temps fut
agréable, toutefois nous eûmes
à essuyer plus d'une fameuse averse. Dans
ces moments-là l'entrain de quelques-uns
d'entre nous subissait une éclipse et ils se
demandaient ce qui avait jamais pu les inciter
à quitter leurs foyers, asiles de la joie et
du confort, pour un tel exil et de telles
misères. Un soir que nous campions sur la
berge occidentale de la Rivière-Rouge, nous
fûmes assaillis par une
effroyable tempête, une sorte de cyclone. Les
tentes furent instantanément
renversées, les lourds wagons poussés
au large et pendant un temps il régna une
confusion extrême. Par bonheur personne ne
fut blessé et la plupart des objets qui
avaient été emportés par le
vent purent être retrouvés le
lendemain.
Nos dimanches étaient des
journées de paisible repos et de
délicieuse communion avec Dieu. Ensemble
nous adorions Celui qui ne demeure pas dans des
temples bâtis par la main des hommes.
Nombreuses furent les heures d'intimité
bénie avec Celui qui, dans d'autres
circonstances, avait été notre
Consolateur et notre Refuge et qui, nous appelant
à une vie toute différente de celle
que nous avions connue jusque là et à
une nouvelle activité, accomplissait envers
nous avec amour sa promesse :
« Voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. »
|