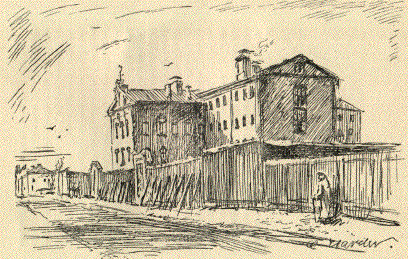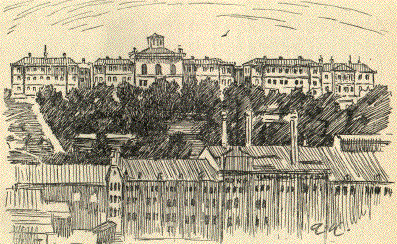Ténèbres et
Lumières
NOUVEAUX SOUVENIRS
DE MATHILDA WREDE
Une destinée.
I
C'était un jeune garçon de petite
taille et d'un aimable aspect, fort bien
doué pour les arts et surtout pour le chant.
Il allait et venait dans la maison paternelle ; il
dessinait, chantait et nourrissait dans sa jeune
tête des idées extraordinaires, qui
donnaient fort à penser à son
père et à sa mère. «
C'est un drôle de corps que ce
garçon-là ! disait son père.
Il réfléchit à des masses de
choses auxquelles moi-même je n'ai jamais
pensé ». Quand il en eut l'âge,
il alla à l'école; mais il n'y fut
jamais qu'un médiocre élève.
Il rêvait et « creusait des sabots
», jouait et chantait ; dès qu'il se
trouvait sur les bancs de la classe, il
était si peu à son affaire qu'il
était incapable de répondre aux
questions de son maître. On eut beau le
mettre dans une autre classe, le placer sous la
direction d'un autre pédagogue : les
résultats ne furent pas meilleurs. À
l'âge de seize ans, il avait
fréquenté plusieurs collèges
sans aucun succès. « Ce jeune homme
n'est pas normal), disait-on couramment de lui. On
ne savait quelle carrière choisir pour lui.
On se décida finalement à en faire un
matelot,
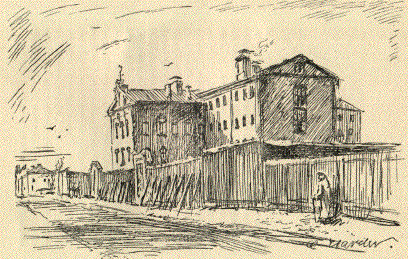 La
prison de Wasa, où débuta l'oeuvre de
Mathilda Wrede.
La
prison de Wasa, où débuta l'oeuvre de
Mathilda Wrede.
Sur le navire, il mena une vie
toute différente de celle de ses camarades.
Il n'aimait pas le tabac et les boissons fortes et
ne prenait point part aux ripailles des mariniers ;
il vivait seul, toujours seul. Mais, quand il se
trouvait en plein air, sous le ciel de Dieu,
brillant d'étoiles, quand la tempête
faisait grincer les cordages et la mâture, ou
quand, peu à peu, les vagues retombaient
dans un calme profond, alors il entendait des voix,
que les autres ne percevaient pas, il voyait des
choses que les autres ne discernaient pas: les
merveilles de Dieu dans l'Océan, les
merveilles de Dieu dans les nuées ! Il
entendait des mélodies sublimes qui
l'émouvaient et il se sentait
pénétré d'étranges
sensations, faites de mélancolie et de joie
intime.
Ses camarades se moquaient de lui ;
mais il ne s'en préoccupait nullement ; il
n'était point accoutumé à ce
que les hommes le comprennent. Il était
consciencieux dans l'accomplissement de sa
tâche ; personne n'aurait jamais pu le
contester. C'est ainsi que se passèrent les
années les unes après les autres ;
les nécessités de sa vie de matelot
le poussèrent tantôt ici, tantôt
là, d'un pays à l'autre, de continent
en continent. Il vécut des aventures
extraordinaires; il essuya des naufrages ; pendant
des jours entiers il parcourut les forêts
vierges du Brésil. Il passa un certain temps
sur les bords de l'Amazone, dans une plantation de
cannes à sucre où il fut
exposé plusieurs fois à des dangers
mortels. Ainsi par une journée de chaleur
accablante, il prenait un bain dans un fleuve,
quand tout à coup il entendit des cris
d'épouvante, qui partis du rivage,
l'avertissaient de la présence de
plusieurs crocodiles sur un banc
de sable voisin. Avec beaucoup de calme, il sortit
de l'eau et remercia Dieu de ce que ces bêtes
féroces ne lui eussent pas fait de mal.
Quelque temps après, nous le retrouvons sur
les lacs de l'Amérique du Nord. Finalement,
et irrésistiblement le mal du pays le ramena
en Finlande.
En son âme profonde, il
soupirait après un peu d'amour, un peu de
compréhension. Mais, à son foyer, au
milieu de ses bien-aimés, il se sentit de
nouveau seul, comme jadis, au temps de sa lointaine
enfance. Personne ne le comprenait ;
n'était-il pas totalement différent
des autres êtres humains ? Or, voici qu'un
soir, il était déjà
allé se reposer, il entendit la plus jeune
de ses soeurs revenir à la maison tout en
larmes et bouleversée. Un homme qui l'avait
déjà poursuivie plusieurs fois,
l'avait attendue dans l'escalier et avait tente de
l'embrasser. Elle n'avait pu lui échapper
qu'à grand-peine. Toute la nuit le
frère réfléchit sans pouvoir
trouver un instant de sommeil. N'était-il
pas l'aîné de la famille et, en cette
qualité, tenu de protéger sa jeune
soeur ? Le lendemain la même scène se
reproduisit; sa soeur rentra à la maison
toute baignée de larmes ; en bas se tenait
l'homme qui la menaçait. Le frère
aîné alla se livrer au repos : les
pensées s'agitaient avec violence en son
cerveau ; la tête lui faisait mal. Son devoir
était, il en avait conscience, de
protéger sa soeur ; mais comment le faire ?
Il avait peur, il était inquiet. Le matin,
il s'empara de son revolver, se rendit dans la
demeure de l'homme, frappa à sa porte, entra
et le trouvant assis à sa table de travail
il l'abattit d'un coup de feu.
Puis il se rendit au poste de police
pour avouer son forfait. L'employé, au
premier abord, crut avoir affaire à un fou ;
il lui paraissait impossible que celui qu'il avait
la devant lui, cet homme aux traits fins et
à l'air profondément malheureux,
fût un criminel.
- Allez-vous-en chez vous! lui dit
le fonctionnaire. Nous avons de l'ouvrage ; nous
sommes pressés; nous n'avons pas le temps de
vous écouter plus longtemps !
- J'ai tué un homme !
répéta-t-il. On ne lui
répondit rien; mais il recommença. Au
même instant la police apprit, par un message
téléphonique, que, dans telle maison,
un homme venait d'être tué.
- C'est précisément de
cette maison que je sors, s'écria le jeune
homme, dont le regard avait quelque chose tout
à la fois de profond et de clair.
Alors on l'arrêta.
   II
II
C'est en prison qu'il fit la connaissance de
Mathilda Wrede et le coeur de « l'amie des
prisonniers », ce coeur chaud, se remplit pour
lui de compassion et d'amour
chrétien.
« Moi, qui jamais, le sachant
et le voulant, n'aurais écrasé une
fourmi... moi, j'ai tué un homme ! »
murmurait-il en gémissant. Son esprit qui
jamais n'avait été très
solide, était incapable de supporter toute
la peur et tous les tourments qui l'accablaient :
il tomba sérieusement malade. Alors
commença, pour Mathilda,
un temps extrêmement fatigant. Chaque jour la
trouvait assise auprès du malade. Avec la
tendresse d'une mère, elle cherchait
à le consoler, à lui donner un peu de
courage. Un soir, de son propre mouvement, elle
alla consulter un médecin spécialiste
des maladies nerveuses, qui se rendit à son
appel et déclara dangereux l'état du
malade ; il ne fallait absolument pas le laisser
seul. Personne d'autre que Mathilda n'aurait su
veiller cet homme, que bouleversaient la maladie et
la terreur. Elle ne pouvait certes pas l'abandonner
dans l'angoisse de son âme et dans son
profond désespoir. Le directeur de
l'établissement pénitentiaire trouva
lui aussi que la meilleure chose à faire,
c'était de laisser Mathilda au chevet de ce
malheureux : elle y demeura donc. Ce fut une longue
et douloureuse nuit. L'homme se plaignait,
gémissait pleurait à chaudes
larmes.
- Couchez-vous, mon ami, dit
Mathilda au malade qui se tenait appuyé
à la paroi, le visage d'une blancheur de
cire.
- Il faut que je reste debout. Ne
suis-je pas un arbre ?
- Oui, sans doute, mais cet arbre
est si fatigue! il faut absolument lui procurer du
repos, lui répondit Mathilda, en le prenant
par le bras pour le ramener auprès de sa
couche. Sans lui opposer la moindre
résistance, il se laissa conduire par elle
et, comme elle ne réussissait pas à
l'amener à se coucher, elle le poussa avec
prudence jusqu'au bord du lit et put enfin le
contraindre à s'asseoir. Le surveillant de
la prison arriva; le pauvre homme
fut mis au lit; Mathilda prit
place à son chevet. «Maintenant
dit-elle, tenez-vous tout à fait tranquille.
Tâchez de dormir! Je vous promets de rester
toute la nuit auprès de vous.» En
dépit du narcotique qui lui avait
été administré, il ne put
guère trouver le sommeil. Il tenait dans sa
main la main de Mathilda et se mit à
raconter sa vie entière, tout ce qui l'avait
oppressé, tout ce qui l'avait
tourmenté. Au lever de l'aurore, la crise
était surmontée, mais l'état
du malade ne s'améliora qu'avec une
extrême lenteur.
De bonne heure, quand le travail
quotidien reprit dans la prison, la tâche de
Mathilda était terminée, et c'est le
coeur très lourd que, traversant le quartier
d'Helsingfors, nommé Skatudden, elle rentra
chez elle. Le supplice du pauvre homme l'avait si
profondément empoignée, qu'elle
croyait ne plus jamais pouvoir sourire.
   III
III
En sortant de l'infirmerie de la prison,
à une certaine distance devant elle, elle
aperçut un homme ivre qui venait à sa
rencontre en titubant. Elle éprouva une
sensation très désagréable en
constatant que le premier homme en liberté
qu'elle rencontrait, en ce matin d'hiver,
s'était mis dans un pareil état.
L'ivrogne la vit venir, arrêta sa marche
chancelante, fit un ultime effort
cérébral et prononça, par
saccades, les paroles suivantes :
- En l'année 1891, celle-ci
était Mathilda Wrede; mais, si dès
lors, elle s'est mariée, et ici sa voix prit
un accent larmoyant, comment
pourrais-je savoir quel nom elle porte ?
Alors la vivacité du
tempérament, l'humour de Mathilda Wrede se
donnèrent libre carrière :
- Je suis exactement la même
Mathilda Wrede qu'autrefois, il y a des
années,... mais vous-même qui
êtes-vous ?
- Mais, je suis L. Comment cette
demoiselle ne me reconnaît-elle pas
?
- Êtes-vous L. ? Comment
aurais-je pu vous reconnaître sous la forme
d'un voyageur matinal qui titube ? N'avez-vous donc
point de travail ?
- Oui, certes, j'en ai. je suis
asphalteur.
- Avez-vous un salaire satisfaisant
?
- Oui, certes !
- Alors, vous portez, sans doute,
votre argent à la banque ?
- Oui, bien sûr ! chaque
semaine je porte beaucoup d'argent à la
banque.
- Ça, c'est bien ! Mais dans
quelle banque déposez-vous cet argent
?
- Tout est absorbé par la
Banque Sinebrychoff. (C'est une des grandes
brasseries d'Helsingfors).
- Mais, L., c'est terriblement
triste. Si vous n'avez pas l'énergie d'agir
autrement, donnez-moi l'argent. Je le placerai pour
vous dans une vraie banque.
- Non, merci, je m'en garderai bien,
dit-il. je suis habitué à la
bière ; il faut que j'aie de la
bière, aussi longtemps qu'on pourra en
obtenir une goutte.
« Aussi longtemps qu'on pourra
en obtenir une goutte », ces
mots résonnaient aux oreilles de Mathilda en
accents désespérés. Quand
tarira-t-il jamais ce fleuve meurtrier des boissons
enivrantes, ce fleuve qui engloutit les foyers, les
corps et les âmes ?
Quelque temps après, Mathilda
fut citée au tribunal comme témoin en
l'affaire de son ami, le matelot. On supposait que,
possédant toute la confiance du
prévenu, elle pourrait indiquer les mobiles
qui avaient pousse celui-ci à cet acte de
désespoir. Lorsqu'elle fut invitée
à prêter serment, elle s'y refusa. Le
président du tribunal lui fit cette remarque
:
- Et si, mademoiselle Wrede, je vous
fais observer que tout citoyen finlandais,
cité comme témoin, est tenu de
prêter serment, est-ce que vous le refuserez
encore ?
- Oui, la Bible interdit de
prêter serment. Nous y lisons : Que votre oui
soit oui et voire non, non; tout ce qu'on dit de
plus vient du malin. La même
vérité que j'énoncerais
après avoir prêté serment, je
l'énoncerai aussi sans ce
serment.
- Appartenez-vous, mademoiselle,
à quelque secte qui interdise le serment
?
- Non, je suis née dans
l'église luthérienne je lui
appartiens encore présentement. Mais ma
conscience m'interdit de prêter
serment.
Le procureur général
intervint alors et déclara que, dans ces
circonstances, il renonçait à exiger
du témoin la prestation du serment. Peu de
temps après, on put lire dans les journaux
que le tribunal d'Helsingfors avait reçu une
réprimande de l'instance suprême, pour
n'avoir pas exigé
impérieusement, du
témoin Mathilda Wrede, la prestation du
serment usuel.
La sentence du tribunal portait que
l'accusé serait mis en observation dans
l'asile d'aliénés de Lappvick, et le
condamnait en outre à huit ans de prison ;
aussi fut-il ultérieurement
transféré dans la prison de Kakola,
à Abo.
   IV
IV
Pour atténuer quelque peu l'aspect
lugubre de la prison, on donna au détenu une
quantité de petits objets en bois qu'il
pourrait peindre à sa fantaisie. Ces divers
objets, dont plusieurs étaient
décorés avec un art réel,
furent plus tard vendus dans le magasin de la
prison. Un jour, il offrit à Mathilda une
cuiller de bois sur laquelle A avait peint, en la
,Misant, une renoncule. « De ma fenêtre,
lui expliqua-t-il, je pouvais apercevoir dans la
cour poussiéreuse de notre prison, une
petite plante qui poussait vaillamment.
J'étais hanté de la crainte que
quelque pied pesant ne l'écrasât. Mais
il se pourrait aussi que d'autres qui vont et
viennent là-bas, aient remarque, dans notre
cour désolée, ce petit être
vivant et aient soigneusement évité
de le fouler. Il n'y avait d'abord que deux
petites, feuilles vertes, d'un vert plein d'espoir.
Plus tard, apparut un petit bouton, qui, peu
à peu, se transforma en une fleur. Oh !
combien n'ai-je pas aimé cette fleur ! Puis,
quand elle s'est flétrie, ses graines
commencèrent à voltiger
çà et là, comme si elles
avaient voulu ensemencer la cour tout
entière.
Cette fleur, je l'ai peinte pour
vous, mademoiselle, car elle est réellement
un symbole de votre vie. Vous avez osé ici,
au milieu de tout le chagrin, de tout le mal, de
toute la souillure qu'enclosent ces murailles,
venir jusqu'à nous et nous faire l'offrande
de votre sympathie, nous apporter le
réchauffant soleil de votre amour
chrétien. Aussi ici même, à
Kakola, beaucoup de grains d'une précieuse
semence ont-ils été répandus.
»
Lorsque Mathilda, à une autre
occasion, lui faisait une nouvelle visite, elle lui
dit, pleine de compassion pour sa misère :
« je vais prochainement essayer d'adresser une
requête au Sénat. Peut-être
consentira-t-il à abréger le temps de
votre séjour ici.»
L'homme ne répondit rien.
Lorsqu'elle revint, elle le trouva abattu et
désabusé. Il se frotta le front, la
considéra et lui dit :
- Je vous ai beaucoup aimée,
mademoiselle maintenant je ne puis plus retrouver
la confiance que j'avais en vous. Dieu ne
connaît-il pas toutes choses et, par suite,
ne sait-il pas que je suis condamné à
huit ans de prison ? C'est pourquoi personne ne
saurait avoir la hardiesse de tenter d'apporter
à la sentence qui m'a frappée aucune
modification quelconque. Comment pouvez-vous,
mademoiselle, vous qui êtes une croyante,
avoir seulement la pensée de travailler
à l'encontre de ce que Dieu a permis
?
Pendant toute la durée de la
longue détention à laquelle il avait
été condamné en expiation du
plus grave manquement de sa vie, il se montra
content de tout, consciencieux, paisible, d'une
confiance sereine et d'une foi enfantine dans les
directions de la Providence. Il
arriva un jour que quelques fonctionnaires
supérieurs vinrent à Kakola et
visitèrent la cellule de ce prisonnier
original. « Cette cellule est fort exiguë
assurément », dit aimablement l'un
d'entre eux, en la considérant avec
attention.
« Sa grandeur ou sa petitesse,
dépend de celui qui l'habite »,
répondit-il. « Pour un
éléphant, la cellule serait
évidemment très petite, pour une
fourmi, immensément grande, mais pour un
être humain, elle est exactement ce qu'il
faut ».
Les employés
demeurèrent surpris de la justesse de cette
déclaration et de la modération des
désirs de cet homme.
- Êtes-vous vraiment
fâchée contre le diable, mademoiselle
? demanda-t-il un jour à
Mathilda.
- Oui, il en est réellement
ainsi.
- Ah ! vous avez bien tort
!
- Comment donc ?
- Aucun homme ne pourrait comprendre
l'incommensurable bonté de Dieu, s'il n'y
avait pas un autre être, radicalement oppose
à cette bonté même. Il faut
donc qu'il y ait une lumière parfaite et une
obscurité parfaite. C'est pourquoi le diable
nous rend de bons services, dont on devrait lui
être reconnaissant.
Un soir, il souffrait de violents
maux de tête. Silencieux et abattu, il
était assis quand Mathilda entra dans sa
cellule.
- Comment allez-vous aujourd'hui
?
- Le directeur et les
employés me font peine.
- Pourquoi donc ?
- Parce qu'ils ont de vilaines
occupations. Il n'en est pas autrement des
surveillants.
Un jour il tendit à Mathilda
une image qu'il avait peinte : elle
représentait un cimetière, avec
d'innombrables tombeaux. Une femme, à la
taille élevée, un parapluie à
la main, était courbée, comme si elle
cherchait quelque chose sur le sol. La
légende portait ces mots : « Mathilda
Wrede cherche son tombeau ». « Il y a
dans un cimetière tant de tombes
différentes ; elles fort une impression de
froideur et de prétention ; elles parlent
à haute voix et tiennent des propos
fanfarons ; elles pourraient bien,
néanmoins, avoir mauvaise conscience. Ces
morts ont, peut-être rencontré, de
leur vivant, peu d'affection ; maintenant, qu'il
est trop tard, il faut réparer nos
manquements à leur égard. Il y a
aussi des croix blanches; qui nous dira si
là ne reposent pas les cendres d'un homme
à l'âme noire ? Ici et là, nous
voyons une croix de bois, humble et sans apparence
; mais l'homme que cette croix recouvre est
peut-être grand devant Dieu, Des esprits de
tous genres flottent au-dessus de ces tombes
».
Quand il se laissait aller à
exprimer ainsi ses plus secrètes
pensées, Mathilda Wrede se sentait
émue jusqu'au fond de l'âme et plus
d'une fois, il lui arriva de se dire : « Il
est plus juste que moi ».
Le directeur de la prison
lui-même s'intéressait à ce
prisonnier d'une espèce si
particulière. Un jour, en franchissant le
seuil de la cellule, il l'appela par son nom de
baptême. Avec beaucoup de simplicité
et de naturel, celui-ci répondit : «
Mon oncle ! » Rendu attentif à la
familiarité inconvenante de ce terme, le
prisonnier tout surpris éclata de rire, d'un
rire cordial et naïf et s'écria:
- Pardonnez-moi ; j'avais totalement
oublie que vous êtes le directeur et moi un
simple prisonnier.
Mathilda s'entretint souvent avec le
directeur de cet homme qui jamais n'avait
prononcé une parole qui ne fût pas
l'expression exacte de la vérité et
jamais n'avait intentionnellement, depuis sa
condamnation, commis une mauvaise
action.
Un jour que Mathilda discutait avec
le directeur de la possibilité d'une
amnistie, ils tombèrent, d'accord qu'en
cette affaire c'est de l'empereur lui-même
que devait venir la grâce : c'est ainsi
seulement que pouvaient être
écartés les scrupules, du prisonnier.
Cette grâce, l'empereur la lui accorda,
à l'occasion de la naissance de
l'héritier présomptif de la couronne
: celui qui avait été condamné
à huit ans de prison obtint, en toute bonne
conscience, le don de la liberté, et cela
quelques mois plus tôt qu'il ne s'y
était attendu. Peu de temps après, il
partit pour l'Amérique.
Revenu dans sa patrie, il se
décida à prendre la direction d'une
entreprise commerciale. Il se rendit auprès
de Mathilda et lui raconta qu'il avait
acheté à Helsingfors un café
donnant sur un parc, nommé Kaisaniemi. Il
avait en outre eu le rare bonheur de trouver, pour
le diriger, une hôtesse
distinguée.
- Comment donc l'avez-vous
trouvée ?
Et il se mit à raconter
:
- À peine avais-je conclu
cette affaire que, sur la place de la gare, je
rencontrai une femme d'un extérieur
agréable. je m'arrêtai et lui demandai
si elle était capable de diriger un
café. « Comment cela
? » demanda-t-elle. « J'ai acheté
un café et j'ai besoin de quelqu'un pour le
conduire. « je pourrais bien venir »,
dit-elle. Elle vint, mais c'était une
horrible femme. Des clients venaient chaque jour,
elle leur donnait gratuitement à boire et
à manger et leur faisait même des
cadeaux : du beurre, du sucre et bien d'autres
choses encore disparaissaient dans la poche des
consommateurs. Quant au propriétaire de
l'établissement, il n'avait pas grand'chose
à dire. Il avait la permission de venir
jusqu'au seuil de la maison - mais pas plus loin -
et encore cette autorisation ne lui avait-elle
été concédée qu'avec
peine... Il n'était bon qu'à fendre
le bois et à courir çà et
là pour faire les emplettes. Aussi Mathilda
dut-elle de nouveau intervenir pour écarter
toutes ces difficultés. On renvoya
l'hôtesse pour en prendre une autre. Le
propriétaire du café, pendant les
pénibles mois qu'il venait de vivre,
s'était dégoûté de son
entreprise et un beau jour, il déclara
à Mathilda : « Je retourne en
Amérique. »
- Et alors qu'adviendra-t-il du
café ?
- Ça, c'est Mathilda Wrede
qui s'en occupera, répondit-il avec un calme
imperturbable.
Pendant trois longs mois, Mathilda
dut se tourmenter à propos de ce
café, jusqu'à ce que fût
échu le terme de la location, qui sonna
l'heure de la liberté. Les seules personnes
qui tirèrent quelque profit de cette
entreprise commerciale, furent les pauvres, les
amis de Mathilda : hommes, femmes, enfants, tous y
reçurent l'hospitalité.
   V
V
Plusieurs années passèrent.
Mathilda Wrede avait eu une longue et
pénible maladie; elle avait de la peine
à s'en remettre et pouvait, non sans effort,
aller et venir dans sa chambre. Un beau jour on
sonna à sa porte. Chancelante, elle alla
ouvrir. À sa grande surprise, elle trouva
son ami là, debout devant elle ; il lui
tendit la main, en lui disant d'un ton joyeux :
« Un salut de l'Amérique.
»
Lorsqu'il eut pris place dans un
fauteuil à bascule, et Mathilda sur le
canapé, il lui raconta que, quelques
semaines auparavant il avait été
saisi d'un irrésistible désir de
revoir le meilleur ami qu'il avait sur la terre.
Aussi avait-il résolu de se faire
transporter en Norvège. De là il lui
serait plus facile de passer en Finlande, afin d'y
séjourner pendant quelques semaines.
À Stockholm, il avait appris, de la bouche
d'une de ses connaissances, que Mathilda, durant
des semaines, avait été retenue au
lit par la maladie et que peut-être elle
était déjà morte.
Bouleversé par cette nouvelle, il
s'était, dès son arrivée
à Helsingfors, enquis de l'adresse de
Mathilda, et voilà qu'elle était
encore là et qu'ils pouvaient se revoir. Il
visita chaque jour Mathilda et s'efforça de
lui rendre toute sorte de menus services. Il n'y a
pas de chose qu'il n'aurait voulu faire pour son
amie.
Mais ce séjour ne fut pas de
longue durée. Le matelot repartit et de
nouveau plusieurs années
s'écoulèrent. Un soir, l'auteur du
présent récit (Evy Fogelberg)
était auprès de Mathilda Wrede;
c'était peu de temps avant
Noël. On sonna et, suivant son habitude,
Mathilda alla ouvrir elle-même. jamais je
n'oublierai le spectacle qui s'offrit à mes
regards. Un homme, au teint pâle, maigre,
entra dans la chambre en toussant. Mathilda lui
tendit les deux mains : «Soyez le bienvenu au
pays. »
- J'ai pris froid, dit-il,
après s'être commodément
installé dans un fauteuil. J'ai voyage dans
l'entrepont et j'ai eu froid; de plus je suis
fatigué et sale. Ne pourrais-je pas me laver
en quelque endroit ?
Mathilda lui en fournit l'occasion,
et, tandis qu'il procédait à sa
toilette, elle réchauffa de la soupe aux
pois et prépara du café chaud. Son
bagage était encore sur le navire ; il ne
savait où aller coucher. C'est par
téléphone que Mathilda prit les
mesures nécessaires. Lorsqu'il fut
réchauffé, corps et âme, il
perdit tout empire sur lui-même ; de grosses
larmes commencèrent à rouler sur ses
joues et il s'écrie. : « Mathilda
Wrede, c'est pour moi mille fois plus que tous mes
parents réunis. Elle est seule à me
comprendre ; aucune mère n'aurait jamais pu
me recevoir avec plus de tendresse qu'elle. »
Tous les deux étaient aussi émus l'un
que l'autre : le marinier malade et Mathilda Wrede.
Bouleversée profondément
moi-même, je les quittai, sans même
prendre congé.
L'été suivant,
Mathilda se rendit par hasard à Helsingfors
et trouva son ami, debout devant sa porte. Il
l'aida à porter ses bagages, pour la quitter
tôt après, mais son absence ne dura
que quelques instants. Bientôt il
était de nouveau là.
- J'étais contraint de
revenir, déclara-t-il, car Dieu me parla au
moment précis où j'étais sur
le point d'entrer à
l'hôtel.
- Dieu vous a-t-il dit quelque chose
? Prenez place et racontez-moi ce que c'est, lui
dit Mathilda pour l'encourager. Il s'assit, se
frotta le front suivant son habitude, puis il
reprit la parole :
- Dieu m'a commandé de
revenir sur mes pas et de dire à Mathilda
Wrede que, si elle a besoin d'argent, elle peut
obtenir de moi 9000 marcs finlandais.
- Neuf mille marcs, dit-elle, vous
avez réellement avec vous autant
d'argent.
- Oui, j'en ai dix mille
!
- Et de ces dix mille, vous m'en
prêteriez neuf mille. Un cordial merci, mon
cher ami, mais je n'en ai pas besoin.
- Assurément Mathilda Wrede a
beaucoup de connaissances qui ont besoin d'argent
et Dieu m'a dit de vous les offrir. Ainsi donc, si
vous avez besoin d'argent, n'oubliez pas de sonner
à l'hôtel, de me faire appeler et vous
le recevrez sur l'heure.
- Je vous remercie de tout mon
coeur. Dans le cas où cet argent pourrait
m'être utile, je ne manquerai certes pas de
m'adresser à vous.
Mathilda qui n'était pas
accoutumée à trouver tant
d'intelligent esprit de sacrifice, était
heureuse, mais fière aussi de son ami.
Néanmoins, elle ne voulut pas le priver du
fruit de ses économies qui pouvaient lut
être indispensables.
Or, un jour Mathilda, en ouvrant le
journal, lut sous la rubrique : Publication des
bans de mariage, le nom de son ami. Qu'est-ce que
cela pouvait bien signifier ? Peu
de temps après il vint lui-même
très abattu.
- Alors, mon ami, j'ai lu l'annonce
de vos promesses de mariage, lui dit Mathilda, en
le saluant.
- Je ne suis pas fiancé, fut
sa réponse.
- Mais vous avez bien l'intention de
vous marier?
- C'est précisément ce
que je ne veux pas.
- Qu'est-ce que cela peut donc bien
signifier ?
- J'ai rencontré une femme
qui a un enfant et, pour cette raison-là,
les hommes se comportent fort mal avec elle. Elle
est poitrinaire et a déjà eu des
crachements de sang. Tous les deux m'inspirent une
profonde pitié. Un jour je leur ai
acheté des souliers, maintes fois du lait,
du beurre et ce dont ils pouvaient avoir besoin. Un
jour, elle, me dit : « Ne devrions-nous pas
faire publier les bans ? » « Pourquoi pas
? » lui répondis-je. Et nous
allâmes trouver le pasteur. je ne comprenais
pas du tout que cela signifiait notre intention de
nous marier l'un avec l'autre. J'étais
déjà allé cependant dans des
consulats, des comptoirs et autres endroits
semblables.
- Est-ce que vous l'aimez ? demanda
Mathilda.
- Mais non ! elle me fait
pitié !
- Tout cela est plus absurde que
tout ce que l'on peut imaginer.
- Mais cela aurait pu être
beaucoup plus absurde encore.
- Comment cela ?
- Certes, si Mathilda Wrede n'avait
pas été en ville en ce
moment-ci.
- Entendez-vous par là que
c'est à mol qu'il appartient de mettre en
ordre toute cette affaire ?
- Naturellement.
Mathilda ne put s'empêcher de
rire. Cette situation, de quelque côté
qu'on l'envisageât, lui paraissait du dernier
comique.
- Pardonnez-moi d'avoir ri et ne
m'en veuillez pas, dit-elle.
- Je ne vous en veux absolument pas,
fut la réponse. Mathilda Wrede ose bien rire
: son rire n'a rien d'un rire moqueur.
- Eh bien ! je vais mettre de
nouveau tous mes soins à débrouiller
cet écheveau, continua-t-elle. Restez
tranquillement assis ici, tandis que je vais au
presbytère pour m'informer des voles
à suivre pour vous tirer
d'embarras.
Quelques instants après, elle
revint et lui raconta que le lendemain, elle devait
se rendre à Borga auprès du Chapitre
des chanoines et chercher avec eux la solution du
problème. La confiance enfantine de l'homme
dans le savoir-faire de Mathilda, dans sa puissance
de tout mettre en ordre et de trouver une issue
à toutes les situations, même les plus
embarrassantes, avait quelque chose de
touchant.
Au Chapitre des chanoines on montra
une réelle compréhension. Le doyen du
Chapitre prodigua à Mathilda les meilleurs
conseils sur la manière dont il fallait agir
et termina son entretien par cette question :
« Est-il vrai, mademoiselle, que c'est
exclusivement pour cette affaire que vous
êtes venue à Borga ? » Et sur sa
réponse affirmative, il ajouta ces mots :
« Il est bon qu'il se trouve des êtres
humains pour s'occuper de cas semblables. »
Alors, un beau matin, Mathilda,
conjointement avec les deux fiancés se
rendit au presbytère d'Helsingfors. Ils
furent reçus par le pasteur, avec la plus
grande amabilité ; d'un commun accord, ils
déclarèrent que la publication des
bans reposait sur un malentendu. On en dressa un
procès-verbal, qui fut signe des deux
parties, avant d'être envoyé au
Chapitre des chanoines et quelques semaines plus
tard tous les deux avaient recouvré leur
pleine liberté.
Plus tard, quand l'occasion s'en
présenta, Mathilda raconta la
séparation des deux « fiancés
» : celle-ci avait été simple et
digne. Le matelot donna à la femme
poitrinaire mille marcs finlandais. Cette
dernière se tourna vers Mathilda et lui posa
cette question :
- Est-ce que cela ne vous parait pas
difficile de donner une aussi forte somme
?
- Acceptez tranquillement ce qu'il
vous offre, répondit Mathilda.
Elle était très
heureuse de constater combien de finesse et de tact
tous deux avaient montré en se
séparant.
Bientôt après, le
matelot repartit pour l'Amérique. En
quittant Mathilda, il lui dit :
- Maintenant nous sommes deux vrais
amis dans le Seigneur et pourtant je n'ai pas de
peine à prendre congé de vous. Voici
pourquoi : la terre est si petite ! le temps est si
court ! Quand deux êtres humains se sentent
unis l'un à l'autre, par l'Esprit, qu'est-ce
que cela peut faire qu'ils ne se voient point ?
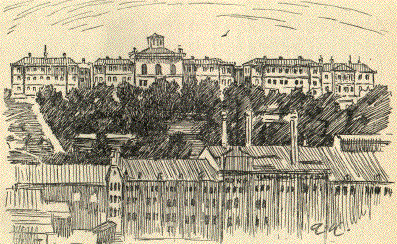 Kakola,
près d'Abo, le plus grand pénitencier
d'hommes de Finlande.
Kakola,
près d'Abo, le plus grand pénitencier
d'hommes de Finlande.
|