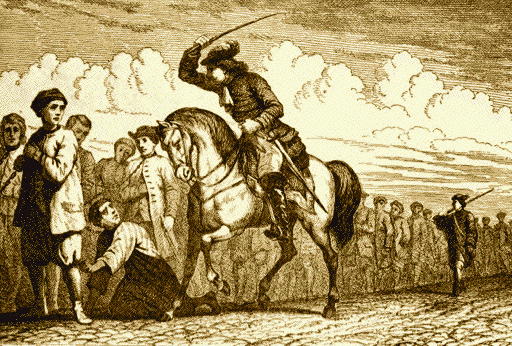MÉMOIRES D'UN PROTESTANT
CONDAMNÉ AUX GALÈRES DE FRANCE
POUR CAUSE DE
RELIGION.
Suite (p 305)
Avant que de détailler ce second
enlèvement, qui ne se fit pas moins
mystérieusement que celui de Dunkerque, je
vais régaler mon lecteur d'un petit
incident, assez surprenant par sa
singularité, et qui acheva de confirmer le
capitaine d'armes dans l'idée que nous
étions des prophètes.
Le quinzième jour de notre résidence
au Havre, sur les neuf heures du soir, comme nous
commencions à souper, et que nos gardes en
faisaient autant, je me sentis frapper sur
l'épaule. En tournant la tête pour
voir qui c'était, je vis une jeune
demoiselle de considération, fille d'un des
premiers banquiers de la ville, à qui
j'avais prêté quelques jours
auparavant un tome de sermons. Elle était
enveloppée d'une écharpe, qu'elle
ouvrit pour me dire fort précipitamment et
toute en pleurs : « Tenez, cher
frère ; voilà votre livre, que
je vous rends. Dieu soit avec vous dans toutes vos
épreuves ! On vous enlève,
continua-t-elle, cette nuit à douze heures.
Quatre chariots sont ordonnés à cet
effet, et la porte blanche restera ouverte pour
votre sortie de la ville. »
Je la remerciai de la peine qu'elle avait voulu
prendre, de venir elle-même nous donner cet
avis à une heure si indue, et lui demandai
comment elle avait pu
s'introduire dans notre chambre. « Ce
détail, me dit-elle, ne vous touche en
rien ; il est plus expédient de vous
dire, chers confesseurs, qu'on va vous conduire
à Paris dans l'affreuse prison de la
Tournelle, pour vous joindre à la grande
chaîne, qui se rend de cette ville, tous les
ans, à Marseille. J'ai bien voulu,
continua-t-elle, vous annoncer cette triste
nouvelle, afin que vous n'ayez pas
d'inquiétude sur votre destinée, et
que vous vous prépariez à souffrir
constamment cette nouvelle
épreuve. »
Cela dit, elle s'en alla aussi invisiblement
qu'elle était entrée, sans qu'aucun
de nos gardés s'en aperçût. Il
est très apparent, que cette demoiselle
obtint du garde de l'arsenal la permission d'entrer
par sa maison, qui communiquait à la
Corderie où nous étions. Quoi qu'il
en soit, cela arriva de la manière que je
viens de le dire. Nous continuâmes à
souper fort tranquillement ; après
quoi, au lieu d'étendre nos matelas pour
nous coucher à l'ordinaire, nous nous
mîmes à plier notre petit bagage.
Pendant que nous étions dans cette
occupation, notre capitaine, suivant sa coutume,
passa dans notre chambre pour
discourir une heure avec nous, en fumant sa
pipe ; et nous voyant ramasser notre bagage,
au lieu de préparer nos lits, il nous
demanda ce que nous faisions. « Nous nous
préparons à partir à minuit,
Monsieur, lui dis-je ; et vous n'avez
qu'à en faire autant.
- Vous êtes fou, me dit-il ; d'où
vous vient cette frénésie ?
- Je vous dis, répliquai-je, qu'à
minuit précis, quatre chariots se trouveront
à la porte de l'arsenal pour nous faire
sortir par la porte blanche, qui restera ouverte
à cet effet ; et vous continuerez
à nous conduire jusques à Paris, et
nous livrerez aux prisons de la Tournelle pour y
joindre la grande chaîne de Marseille.
- Je vous dis, repartit-il, que vous êtes
fou, et qu'il n'y a rien de tout ce que vous venez
de dire. J'ai été prendre les ordres
de l'intendant à huit heures, comme j'ai
coutume de faire, et il m'a dit qu'il n'y avait
rien de nouveau.
- Eh bien, Monsieur, lui dis-je, vous le
verrez. »
Comme nous finissions ce discours, le laquais de
l'intendant entra pour lui dire d'aller sur l'heure
lui parler. Il ne tarda pas à revenir, et
entra dans notre chambre, en faisant des
exclamations et joignant les
mains. « Au nom de Dieu, me dit-il,
dites-moi si vous êtes sorciers ou
prophètes. Je crois cependant, que c'est
Dieu qui vous favorise ; car vous êtes
trop dévots et trop honnêtes gens pour
implorer le secours du diable.
- Non, lui dis-je, Monsieur, nous ne sommes ni l'un
ni l'autre ; et il n'y a rien que de
très naturel dans ce qui cause votre
surprise.
- Je n'y comprends donc rien, dit le
capitaine ; car j'ai appris de la bouche de
l'intendant même, que personne dans la ville
ne sait rien de votre départ que lui et
moi ; et quoi que vous puissiez dire, on ne
m'ôtera jamais de l'esprit, que Dieu est avec
vous autres.
- Je l'espère, » lui dis-je ;
et lui et nous continuâmes à nous
préparer au départ.
Il me semble entendre le lecteur demander, comment
cette demoiselle pouvait savoir ce secret. Je
l'ignorerais moi-même encore, si le
père de cette demoiselle ne nous l'eût
dit dans la prison de Rouen, où il vint
exprès pour nous remettre le montant d'une
collecte, qu'on avait faite pour nous au
Havre-de-Grâce, dans la vue de nous procurer
du soulagement dans la
pénible route que nous
allions faire de Paris à Marseille. Il nous
dit donc, que sa fille était
recherchée en mariage par le
secrétaire de l'intendant du
Havre-de-Grâce : que l'intendant ayant
reçu son paquet de la Cour la veille de
notre départ, le secrétaire y lut
l'ordre qui nous regardait ; et comme il
savait, nous dit-il, que ma fille vous
affectionnait, il accourut d'abord lui porter cette
nouvelle. Quant à son entrée
mystérieuse dans la Corderie où vous
étiez, je n'en sais pas plus que vous, ne
lui ayant point fait de question sur cet
article.
Je reviens à notre départ du Havre.
À minuit les quatre chariots ne
manquèrent pas de venir nous prendre. Nous
riions en nous-mêmes du secret
mystérieux, qu'on observa pour nous enlever.
Les roues des chariots, ainsi que les chevaux qui
les tiraient, étaient
déferrés, afin que l'on ne nous
entendît pas passer dans la rue. On couvrit
chaque chariot d'une voile, comme s'ils n'eussent
contenu que des balles ou des paquets de
marchandise ; et sans lanternes ni fanaux,
l'on nous fit sortir de la ville. Il ne nous arriva
rien de remarquable jusqu'à
Rouen.
En y arrivant, nous fûmes conduits devant la
maison de ville pour recevoir du magistrat l'ordre
pour notre logement, qui fut à l'ordinaire
une prison. Mais nous fûmes bien surpris de
nous voir refusés par le geôlier de
celle où l'on nous mena. Le capitaine
d'armes lui montra l'ordre du magistrat, lui
faisant des instances pour l'engager à nous
recevoir : ce que le geôlier refusa
constamment de faire, disant qu'il aimait mieux
quitter son office que de nous prendre sous sa
garde.
On nous envoya à une autre, où il en
fut de même ; finalement on nous mit
dans une tour destinée pour les plus
insignes criminels. Le geôlier, qui ne nous
reçut qu'à son corps
défendant, nous fit entrer dans un cachot
affreux, et à l'aide de cinq ou six
guichetiers, qui avaient le sabre à la main,
il nous enferra les pieds sur de grosses poutres,
de manière que nous ne pouvions nous
remuer ; et sans nous donner ni
lumière, ni pain, ni quoi que ce fût,
il referma le cachot et s'en alla avec ses
guichetiers. Nous avions faim et soif, et nous
criâmes à tue-tête plus de deux
heures, pour qu'on nous apportât quelque
nourriture pour notre argent. Enfin quelqu'un vint
au guichet, et nous entendîmes que l'on
disait : « Ces gens-là
parlent bon français. »
Ce discours nous fit juger, qu'il y avait quelque
malentendu, et quelque mystère dans la
conduite que l'on tenait à notre
égard. Nous nous mîmes encore à
crier, et à prier qu'on nous aidât
pour notre argent, que nous étions
prêts de donner d'avance. Là-dessus le
geôlier ouvrit la porte, et entra
accompagné de ses six guichetiers ; et
après nous avoir examinés les uns
après les autres, il nous demanda, si nous
étions Français de nation. Nous lui
dîmes que oui. « Mais pourquoi donc
n'êtes-vous pas chrétiens, nous
dit-il, et adorez-vous le diable, qui vous rend
plus méchants que lui ? »
Nous lui répondîmes, qu'il voulait
apparemment badiner, et qu'il nous ferait plus de
plaisir de nous donner à boire et à
manger. Et en même temps je lui donnai un
louis d'or, le priant instamment de nous donner
pour cet argent ce qui nous était
nécessaire, et ajoutant, que, s'il n'y en
avait pas assez, je lui en donnerais d'autre.
« Vraiment, dit le geôlier, vous ne
me paraissez pas tels qu'on vous
a dépeints. Dites-moi donc franchement ce
que vous êtes ; car depuis huit jours
que l'on vous attend ici, on ne fait que parler de
vous comme de gens, qui êtes du pays du Nord,
tous sorciers, et si méchants, qu'on n'a
jamais pu vous vaincre sur les galères de
Dunkerque, et qu'on vous envoie à Marseille
pour vous mettre à la raison ; ce qui a
été la cause que je vous ai
reçus avec tant de répugnance dans
cette prison. »
À ce trait de noirceur, qui avait si bien
prévenu en notre faveur, je reconnus
facilement, qu'il venait des Jésuites, qui
avaient semé ce bruit, pour nous mettre en
horreur et exécration dans la ville de
Rouen, où il y a beaucoup de bons
réformés. Dans cette idée, je
me mis à converser avec ce geôlier. Je
lui racontai notre petite histoire, et lui dis la
raison pour laquelle nous allions de Dunkerque
à Marseille. Sur ce propos, notre capitaine
d'armes arriva dans le cachot pour nous faire
donner notre étape, Le geôlier le tira
à part, et. lui demanda si nous
étions aussi dociles que nous le
paraissions. « Oui certainement, dit le
capitaine ; j'entreprendrais de
les conduire moi seul par toute
la France ; et tout leur crime est
d'être huguenots.
- N'y a-t-il que cela ? dit le
geôlier ; les plus honnêtes gens
de Rouen sont de cette religion. Je ne l'aime pas,
ajouta-t-il ; mais j'aime les personnes qui en
sont ; car ce sont de braves
gens. »
Et s'adressant à nous, il nous dit :
« Vous séjournez ici demain ;
j'aurai soin d'avertir divers de vos gens, qui ne
manqueront pas de vous venir voir, et mes portes
leur seront toujours ouvertes. »
II ordonna ensuite à ses guichetiers de nous
déferrer, et de nous laisser seulement nos
chaînes ordinaires, pendant qu'il nous allait
chercher des rafraîchissements.
Le lendemain il nous tint parole et nous amena
plusieurs personnes de la religion
réformée, qui bientôt rendirent
publique la nouvelle de notre arrivée ;
de sorte que ce jour-là, notre cachot qui
était assez grand, ne désemplit pas.
Ce fut là, que le père de cette
demoiselle du Havre-de-Grâce, nous apporta la
collecte, dont j'ai parlé ci-dessus. Je n'ai
jamais vu de personnes si zélées que
ces messieurs de Rouen. Ils nous rendaient confus
par les éloges, même outrés,
qu'ils donnaient à la
constance de notre foi. Ils nous exhortaient d'une
façon si pathétique à la
persévérance, que nous ne pouvions
retenir nos larmes. Leur ardeur fut si grande,
qu'une partie de ces messieurs voulaient absolument
(après en avoir demandé la permission
au capitaine d'armes) nous conduire publiquement
à notre départ, jusqu'à une
lieue de la ville, pour nous aider à porter
nos chaînes sur leurs épaules :
ce que nous ne voulûmes jamais souffrir, tant
par l'humilité dont nous faisions
profession, que pour leur épargner de
s'attirer de mauvaises affaires.
Nous partîmes donc de Rouen, toujours en
chariot. Je ne puis assez exprimer les
bontés, que nous témoigna notre
capitaine pendant cette route. Car outre les
gratifications, qu'il reçut à Rouen
de nos amis, il se persuadait fermement, que nous
étions des saints favorisés de Dieu,
et que nous avions le don de prophétie.
Lorsque l'argousin prenait ses précautions
ordinaires, soit en visitant nos chaînes ou
autrement, il lui disait qu'il prenait des soins
inutiles, et que nous voulions bien aller
volontairement, où le Roi voulait ;
qu'autrement, ni ses
précautions, ni toutes celles des hommes, ne
nous sauraient tenir. Nous avions beau le vouloir
désabuser de cette opinion, nous ne pouvions
le dissuader, qu'il y avait en nous du
surnaturel.
Ce fut le dix-sept novembre mil sept cent douze,
sur les trois heures de l'après-midi, que
nous arrivâmes à Paris. Nous
descendîmes devant le château de la
Tournelle, qui était autrefois une maison de
plaisance de nos Rois, et qui sert
présentement de lieu d'entrepôts aux
malheureux, condamnés aux galères
pour toute sorte de crimes. On nous fit entrer dans
le vaste mais lugubre cachot de la grande
chaîne.
Le spectacle affreux, qui s'y présenta
à nos yeux, nous fit frémir, d'autant
plus, qu'on nous allait joindre aux acteurs qui le
représentaient. J'avoue, que, tout
accoutumé que j'étais aux cachots,
entraves, chaînes, et autres instruments, que
la tyrannie ou le crime ont inventés, je
n'eus pas la force de résister au
tremblement qui me saisit, et à la frayeur
dont je fus frappé, en considérant
cet endroit.
Ne pouvant en exprimer toute l'horreur, je me
contenterai d'en donner une
faible idée.
C'est un grand cachot, ou pour mieux dire, une
spacieuse cave, garnie de grosses poutres de bois
de chêne, posées à la distance,
les unes des autres, d'environ trois pieds. Ces
poutres sont épaisses de deux pieds et demi,
et sont rangées et attachées de telle
sorte au plancher, qu'on les prendrait à la
première vue pour des bancs, mais qui ont un
usage beaucoup plus incommode. Sur ces poutres sont
attachées de grosses chaînes de fer,
de la longueur d'un pied et demi, et à la
distance les unes des autres de deux pieds ;
et au bout de deux de ces chaînes est un
collier de même métal. Lors donc que
les malheureux galériens arrivent dans ce
cachot, on les fait coucher à demi, pour que
la tête appuie sur la poutre. Alors on leur
met ce collier au col ; on le ferme, et on le
rive sur une enclume à grands coups de
marteau. Comme ces chaînes à collier
sont distantes les unes des autres de deux pieds,
et que les poutres en ont la plupart quarante de
longueur, on y enchaîne vingt hommes à
la file, et aux autres à proportion de leur
grandeur. Cette cave faite en
rond est si grande, qu'on peut y
enchaîner de la manière susdite,
jusqu'à cinq cents hommes. Il n'y a rien de
si affreux, que de voir l'attitude et la posture de
ces malheureux ainsi enchaînés. Car
figurez-vous, qu'un homme ainsi attaché, ne
peut se coucher de son long ; la poutre, sur
laquelle il a la tête, étant trop
élevée ; ni s'asseoir et se
tenir droit, cette poutre étant trop
basse ; si bien que je ne puis mieux
dépeindre la posture d'un tel homme, qu'en
disant, qu'il est à demi couché, et
à demi assis, partie de son corps sur les
carreaux ou planchers, et l'autre partie sur cette
poutre.
Ce fut aussi de cette manière qu'on nous
enchaîna ; et tout endurcis que nous
étions aux peines, fatigues et douleurs,
trois jours et trois nuits, que nous fûmes
obligés de passer dans cette cruelle
situation, nous avaient tellement roué le
corps et tous nos membres, que nous n'en pouvions
plus, surtout nos pauvres vieillards, qui
s'écriaient, à tout moment, qu'ils se
mouraient, qu'ils n'avaient plus la force de
supporter un pareil supplice. L'on me dira
peut-être ici : « Comment ces
autres misérables, que
l'on amène à Paris des quatre coins
de la France, et qui sont quelquefois
obligés d'attendre trois ou quatre, souvent
cinq ou six mois, que la grande chaîne parte
pour Marseille, peuvent-ils supporter si longtemps
un pareil tourment ? »
À cela je réponds, qu'une
infinité de ces infortunés succombent
sous le poids de leur misère ; et que
ceux qui échappent à la mort par la
force de leur constitution, souffrent des douleurs,
dont on ne peut donner une juste idée.
On n'entend dans cet antre horrible que
gémissements, que plaintes lugubres,
capables d'attendrir tout autre que les gens
féroces commis pour la garde de ce terrible
lieu. Les plaintes sont un soulagement pour les
malheureux ; mais on ôte encore cette
douceur aux esclaves dignes de pitié, qui y
sont enfermés ; car toutes les nuits
cinq ou six bourreaux de guichetiers font la garde
dans ce cachot, et se ruent sans miséricorde
sur ceux qui parlent, crient, gémissent et
se plaignent, les assommant avec barbarie à
coups de nerf de boeuf. À l'égard de
la nourriture, ils l'ont assez bonne. Des
espèces de béguines, que
l'on nomme Soeurs Grises, y
apportent tous les jours à midi de la soupe,
de la viande, et de bon pain, qu'on leur donne
suffisamment. À propos de ces
béguines, il faut pour désennuyer un
peu mon lecteur, que je raconte ici un trait de la
mère supérieure de celles qui
desservent la prison de la Tournelle.
Leur congrégation n'est pas fort ancienne,
et a pour fondateur celui des pères de la
Mission. Leur fonction est de servir les pauvres
des paroisses de Paris, à qui elles portent
tous les jours le nécessaire, leur donnant
même les médicaments dont ils peuvent
avoir besoin. Elles ont outre cela la direction de
plusieurs hôpitaux, surtout de ceux qui sont
fondés pour les militaires ; et par
leur règle elles sont obligées de
visiter les prisonniers et de les soulager. Dans
quelques endroits elles sont aussi chargées
d'instruire les jeunes personnes de leur
sexe ; on va bientôt juger par ce que je
vais dire, si elles en sont bien capables.
La mère supérieure, qui venait tous
les jours dans notre cachot pour distribuer la
soupe aux galériens, s'arrêtait
toujours un quart d'heure avec
moi, et me donnait plus à manger que je n'en
avais besoin. Les autres galériens m'en
raillaient souvent, m'appelant le favori de la
mère abbesse. Un jour, après m'avoir
donné ma portion, elle me dit entre autres
choses, que c'était bien dommage, que nous
ne fussions pas chrétiens. « Qui
vous l'a dit, ma bonne mère ? lui
dis-je ; nous sommes chrétiens par la
grâce de Dieu.
- Eh ! oui, dit-elle, vous l'êtes ;
mais vous croyez à Moïse.
- Ne croyez-vous pas, lui demandai-je, que
Moïse était un grand
prophète ?
- Moi ! dit-elle, croire à cet
imposteur, à ce faux prophète qui a
séduit tant de Juifs, comme Mahomet a
séduit les turcs ; moi ! croire
à Moïse, oh ! que non.
Grâces au Seigneur, je ne suis pas coupable
d'une pareille
hérésie. »
Je haussai les épaules à un discours
aussi ridicule, et me contentai de lui dire, que ce
n'était pas le lieu ni le temps de discuter
cette matière ; mais que je la priais
seulement de se confesser de ce qu'elle venait de
dire, et qu'elle verrait que son confesseur lui
dirait certainement, s'il était plus savant
qu'elle, que ce qu'elle avait dit de Moïse
était un très grand
péché.
L'on peut juger à
présent, si ces bonnes filles sont en
état de donner des instructions à la
jeunesse.
Je reviens à ce qui nous arriva dans la
Tournelle. J'ai dit plus haut que nous ne
restâmes que trois jours et trois nuits
enchaînés sur les poutres.
Voici comment nous en fûmes
délivrés si tôt.
Un bon protestant de Paris, nommé M.
Girardot de Chancourt, riche négociant,
ayant appris notre arrivée à la
Tournelle, fut prier le gouverneur de ce
château de lui permettre de nous voir et de
nous assister dans nos besoins. Le gouverneur, tout
son ami qu'il était, ne voulut jamais lui
permettre d'entrer dans le cachot pour nous
parler ; car on n'y laisse jamais entrer que
des ecclésiastiques. M. Girardot donc ne put
obtenir de nous voir de plus près que de la
cour de ce château, au travers d'un double
grillage de fer dont les croisées du cachot
étaient garnies. Il ne put même nous
parler, la distance qu'il y avait de lui à
nous étant trop grande, et ce n'était
qu'avec peine qu'il pouvait entrevoir quelqu'un de
nous, qu'il ne distinguait que par notre casaque
rouge. Mais nous voyant dans l'attitude affreuse
où nous étions, la
tête clouée sur ces poutres, il
demanda au gouverneur, s'il n'y aurait pas moyen de
nous enchaîner par la jambe comme
quelques-uns, des autres galériens qu'il
voyait être près des grillages des
croisées en dedans du cachot.
Le gouverneur lui dit que ceux qu'il voyait ainsi
payaient pour cela par mois un certain prix fait.
« Si vous vouliez, Monsieur, lui dit M.
Girardot, mettre ces pauvres gens dans cette
liberté, et faire le prix avec eux, je vous
le paierai d'abord à leur défaut.
« Le gouverneur lui dit qu'il verrait
s'il y avait place au grillage, et qu'en ce cas il
le ferait : sur quoi M. Girardot se
retira.
Le lendemain au matin le gouverneur entra dans le
cachot et demanda au premier de nous qui s'offrit
à sa vue, qui était celui qui
était chargé de la dépense. On
me montra.
Le gouverneur vint à moi et me demanda si
nous serions bien aises d'être à la
grille, la chaîne au pied. Je lui dis que
nous ne demandions pas mieux ; et enfin nous
convînmes de lui payer cinquante écus
pour le temps que la chaîne resterait
à la Tournelle. Je payai sur-le-champ cette
somme de la bourse commune dont
j'étais le trésorier.
Aussitôt le gouverneur nous fit
décramponner de ces affreuses poutres et
nous fit mettre le plus proche possible de la
grille qu'il put, la chaîne au pied. Depuis
plusieurs années nous étions
accoutumés à cette dernière
espèce d'enchaînure ; c'est
pourquoi nous nous trouvâmes fort
soulagés. Notre chaîne, qui
était attachée au plancher et qui
nous tenait à un pied, était de la
longueur de deux aunes ; de sorte que nous
pouvions être droits sur nos pieds, assis ou
couchés tout de notre long ; et vu
l'état où nous avions
été sur les poutres, nous nous
trouvions dans une très heureuse
situation.
M. Girardot nous vint visiter et nous parla avec
beaucoup de facilité au travers du grillage,
mais avec prudence et circonspection, à
cause des autres galériens qui nous
environnaient. Nous ne jouîmes de ce repos
qu'un mois, au bout duquel nous partîmes avec
la chaîne le dix-sept décembre. Le
lecteur ne sera pas fâché de lire la
description de ce départ que je vais lui
donner.
Les Jésuites ont la direction du spirituel
du château de la
Tournelle. Huit jours avant le départ de la
chaîne, un de leurs novices, qui nous parut
un grand ignorant dans ses prédications, y
vint prêcher tous les jours, pour
préparer ces misérables
galériens à se confesser et à
recevoir le Saint Sacrement.
Ce prédicateur prenait toujours le
même texte, c'était ce précepte
de l'Évangile : « Venez
à moi, vous tous qui êtes
chargés et travaillés, et je vous
soulagerai. »
II soutenait et s'efforçait à prouver
par divers passages des Pères, que le
Sauveur, par les paroles de ce texte, enseignait
qu'on ne pouvait venir à lui que par la
confession auriculaire. Nous entendions ses
sermons, et nous étions outrés de ses
absurdités ; mais nous n'eûmes
jamais l'occasion de lui pouvoir parler ; car
il craignait notre conversation comme le feu,
croyant que nous étions tous des ministres
huguenots très dangereux et très
propres à surprendre les bons catholiques,
comme le bruit s'en était répandu
dans Paris. De sorte que ce pauvre novice, soit en
entrant, soit en sortant du cachot, prenait
toujours un grand détour pour nous
éviter. Cependant
plusieurs Pères
jésuites confessèrent tous ces
malheureux et leur apportèrent le Saint
Sacrement qu'ils leur firent prendre dans cette
effroyable attitude, la tête clouée
sur la poutre ; action qui paraissait si
indécente, même à nous qui
n'avions pas la foi pour ce mystère, que
nous en avions horreur.
Je remarquai qu'après leur avoir
donné l'hostie, on leur faisait boire un peu
de vin dans un calice. Je demandai à l'un
d'eux s'ils recevaient la communion sous les deux
espèces. Il me répondit que non, et
que le vin qu'on leur donnait dans ce calice
n'était pas consacré, que ce
n'était qu'une précaution qu'on
prenait à la Tournelle, pour leur faire
avaler l'hostie, et cela depuis qu'un malheureux
galérien, au lieu de l'avaler, l'avait
gardée, ayant fait un pacte avec le diable,
par lequel il s'obligeait de lui fournir une
hostie, à condition que sur la route il
mettrait tous les galériens en
liberté ; ce que le diable n'avait pas
manqué de faire une belle nuit ; car
ayant rompu les fers de toute la chaîne, tous
les forçats, au grand étonnement des
gardes, s'étaient sauvés.
J'aurais pu embarrasser celui
qui venait de me faire ce
récit, en lui demandant quel usage pouvait
faire le diable de cette hostie, puisque, selon
leur communion, elle renfermait réellement
le corps et le sang du Christ, le Sauveur du monde,
qui était venu établir sur la terre
le règne de Dieu, et précipiter Satan
jusques au fond de l'abîme. Mais j'aimai
mieux me taire et ne me pus attirer quelque
mauvaise affaire de la part des Jésuites,
qui s'efforcent de faire accroire cette fable, tout
absurde qu'elle soit, et ne la croient pas
eux-mêmes.
Je crois avoir dit plus haut que le départ
de la chaîne fut fixé au dix-sept
décembre. En effet, ce jour-là,
à neuf heures du matin, on nous fit tous
sortir du cachot et entrer dans une spacieuse cour
devant le château. On nous enchaîna par
le cou, deux à deux, avec une grosse
chaîne de la longueur de trois pieds, au
milieu de laquelle il y avait un anneau rond.
Après nous avoir ainsi
enchaînés, on nous fit tous mettre
à la file, couple devant couple ; et
alors on passa une longue et grosse chaîne
dans tous ces anneaux, si bien que nous nous
trouvâmes tous enchaînés
ensemble. Notre chaîne
faisait une très longue file, car nous
étions environ quatre cents. Ensuite on nous
fit tous asseoir par terre, en attendant que le
Procureur général du Parlement
vînt pour nous expédier et nous mettre
entre les mains du capitaine de la chaîne.
C'était pour lors un nommé Langlade,
exempt du guet, ou de M. d'Argenson, lieutenant de
police de Paris.
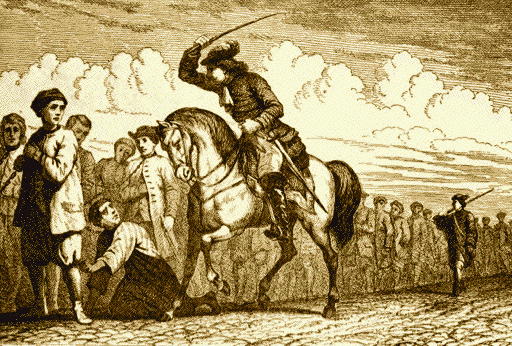 La chaîne
des galériens.
La chaîne
des galériens.
Sur le midi le Procureur général
et trois Conseillers du Parlement vinrent à
la Tournelle, nous appelèrent tous par nos
noms, nous lurent à chacun le précis
de notre arrêt de condamnation, et les
remirent tous en main du capitaine de la
chaîne.
Cette formalité nous arrêta trois
bonnes heures dans la cour, pendant lesquelles M.
Girardot, qui ne s'endormait pas à notre
égard, fut supplier M. d'Argenson de nous
recommander au capitaine de la chaîne ;
ce qu'il fit fortement, ordonnant audit capitaine
de nous distinguer des autres, de nous procurer
tous les soulagements qui dépendraient de
lui, et de lui rapporter, après son retour
de Marseille, un certificat par lequel nous
attesterions que nous étions contents de
lui. Il lui ordonna de plus de
régler avec M. Girardot ce qui concernait
notre soulagement durant la route. Pour cet effet,
M. Girardot vint dans la cour de la Tournelle, alla
saluer le Procureur général et le
pria d'avoir la bonté de permettre qu'il
entretînt et assistât ces vingt-deux
réformés qui étaient à
la chaîne ; ce que le Procureur
général lui ayant accordé avec
beaucoup de douceur, il vint nous embrasser tous
avec une affection digne des sentiments de
christianisme qui le faisaient agir.
Ensuite il s'entretint avec le capitaine, qui lui
dit qu'il était nécessaire de lui
remettre l'argent que nous pourrions avoir, parce
qu'au premier logement où la chaîne
s'arrêtait on la fouillait, et qu'alors
l'argent que l'on trouve aux galériens est
perdu pour eux.
M. Girardot nous demanda si nous voulions confier
au capitaine l'argent que nous avions. Nous lui
dîmes que nous ne demandions pas mieux ;
et comme notre argent était dans une bourse
commune que je gardais, je la remis sur-le-champ
entre les mains de M. Girardot, qui compta au
capitaine cet argent, lequel consistait en sept ou
huit cents livres.
Après cela le capitaine
dit à M. Girardot qu'y ayant parmi nous des
malades et des infirmes, il était de toute
nécessité que nous fussions pourvus
d'un ou de deux chariots, suivant le besoin que
nous pourrions en avoir pendant la route. Il ajouta
qu'il ne pouvait faire à ses frais cette
dépense qu'après avoir chargé
de coups de bâton ceux qui ne pouvaient
marcher, pour s'assurer qu'ils ne faisaient pas les
malades exprès pour se faire voiturer.
M. Girardot comprit d'abord ce que ce discours
signifiait, et aussitôt accorda que nous
paierions audit capitaine cent écus, et cela
sur-le-champ, afin que, lorsque nous nous
plaindrions de ne pouvoir marcher, on nous
mît sur des chariots sans nous donner de
coups, ou faire d'autres mauvais traitements ;
de sorte qu'à proprement parler, les cent
écus qu'il prit de notre bourse commune
étaient pour nous racheter des coups de
bâton pendant la route.
Pour notre sûreté, M. Girardot fit
signer un reçu au capitaine, avec promesse
qu'en nous remettant notre argent et la caisse de
nos livres (que nous conditionnâmes qu'il
ferait voiturer jusques à
Marseille sur le marché des cent
écus) il rapporterait quittance du tout avec
notre attestation que nous étions contents
de lui. Cela fait et le capitaine ayant reçu
ses ordres et ses expéditions pour le
départ de la chaîne ; sur les
trois heures après midi on nous fit sortir
de la Tournelle et traverser une partie de la ville
de Paris, pour aller coucher à Charenton.
Une grande quantité de gens de la religion
réformée se tenaient dans les rues
par où la chaîne passait, et
malgré les bourrades que nos brutaux
d'archers leur portaient pour les empêcher de
nous approcher, ils se jetaient sur nous pour nous
embrasser, car nous étions reconnaissables
à nos casaques rouges. D'ailleurs nous vingt
et deux étions tous ensemble à la
queue de la chaîne.
Ces bonnes gens, parmi lesquels il y en avait
beaucoup de distinction, nous criaient tout
haut : « Courage, chers confesseurs
de la vérité ; souffrez
constamment pour une si belle cause, pendant que
nous ne cesserons de prier Dieu, qu'il vous fasse
la grâce de vous soutenir dans vos rudes
épreuves ; » et autres
discours de ce genre,
très consolants pour nous. Quatre messieurs,
gros marchands de Paris, nous accompagnèrent
même jusques à Charenton, avec la
permission du capitaine, grand ami de l'un d'eux,
et firent promettre audit capitaine de leur
permettre de nous donner à souper à
Charenton et qu'il nous détacherait de la
grande chaîne, pour pouvoir être en
particulier avec ces messieurs, dans une chambre de
l'hôtellerie, où la chaîne
logerait. Nous arrivâmes à Charenton
sur les six heures du soir au clair de la lune. Il
gelait, comme on dit, à pierre fendre. La
peine que nous avions à marcher, et
l'excessive pesanteur de nos chaînes (qui
était de cent cinquante livres pesant pour
chacun, suivant le dire du capitaine même)
nous avait réchauffés du grand froid
que nous avions enduré dans la cour de la
Tournelle ; mais échauffés
à tel point, qu'arrivant à Charenton,
nous étions en sueur, comme si on nous avait
plongés dans l'eau.
Étant donc arrivés à
Charenton, on nous logea dans l'écurie d'une
hôtellerie : mais quel logement,
hélas ! et quel repos nous
préparait-on pour nous refaire de cette
grande fatigue ! La chaîne était
clouée au râtelier,
de manière que nous ne pouvions nous coucher
ni même nous asseoir que difficilement sur le
fumier et les immondices des chevaux ; car,
comme le capitaine conduit la chaîne à
ses dépens jusques à Marseille,
moyennant vingt écus par tête, de ceux
qu'il livre à Marseille, il épargne
jusques à la paille, et nous n'en avons pas
eu pendant toute la route.
On nous laissa donc ainsi reposer (si tant est que
ce repos ne soit pire que la fatigue que nous
avions eue) jusque sur les neuf heures du soir pour
nous préparer une autre scène la plus
cruelle qu'on puisse s'imaginer, comme je vais la
dépeindre. Cependant nos quatre messieurs de
Paris, qui nous avaient suivis jusques à
Charenton, logèrent dans la même
hôtellerie, où était la
chaîne, y arrêtèrent la plus
grande chambre, et ordonnèrent le souper
pour trente personnes, pour nous
régaler ; comptant que le capitaine
leur tiendrait parole. Mais quel régal, bon
Dieu ! autre qu'ils ne s'attendaient,
n'eûmes-nous pas et eux aussi, par la vue
d'un spectacle, qui me fait frémir toutes
les fois que je me le rappelle. Le
voici.
À neuf heures du soir, qu'il faisait un
grand clair de lune, et une gelée, par un
vent de bise, que tout glaçait, on
décramponna la chaîne, et on nous fit
tous sortir de l'écurie dans une spacieuse
cour, close d'une muraille, qui régnait
devant cette hôtellerie. On fit arranger la
chaîne à un bout de cette cour ;
ensuite on nous ordonna, le nerf de boeuf à
la main, qui tombait comme grêle, sur les
paresseux, de nous dépouiller
entièrement de tous nos habits, et de les
mettre à nos pieds. Il fallut
obéir ; et nous vingt et deux, ni plus
ni moins que toute la chaîne, nous
subîmes ce cruel traitement. Après
donc que nous fûmes dépouillés,
nus comme la main, on ordonna à la
chaîne de marcher de front jusques à
l'autre bout de la cour, où nous fûmes
exposés au vent de bise pendant deux grosses
heures ; pendant lequel temps, les archers
fouillèrent et visitèrent tous nos
habits, sous prétexte d'y chercher couteaux,
limes, et autres instruments propres à
couper ou rompre les chaînes.
On peut juger, si l'argent, qui se trouva,
échappa des mains de ces harpies. Ils
prirent tout ce qui les
accommodait, mouchoirs, linge
(s'il était un peu bon), tabatières,
ciseaux, etc., et gardèrent tout, sans
jamais en avoir rien rendu ; et lorsque ces
pauvres misérables leur demandaient ce qu'on
leur avait enlevé, ils étaient
accablés de coups de bourrade de leurs
mousquetons, et de coups de bâton.
La visite de nos hardes étant faite, on
ordonna à la chaîne de remarcher de
front jusques à la place, où nous
avions quitté nos habits. Mais, ô
spectacle cruel ! la plupart de ces
malheureux, de même que nous étions si
roides du grand froid que nous avions souffert,
qu'il nous était impossible de marcher,
quelque petit espace qu'il y eût de l'endroit
où nous étions jusques à nos
habits. Ce fut alors que les coups de bâton,
et de nerf de boeuf, plurent ; et ce
traitement horrible ne pouvant animer ces pauvres
corps, pour ainsi dire, tout gelés, et
couchés les uns roide morts, les autres
mourants, ces barbares archers les traînaient
par la chaîne de leur col, comme des
charognes, leur corps ruisselant du sang des coups
qu'ils avaient reçus. Il en mourut ce
soir-là, ou le lendemain, dix-huit. Pour
nous vingt-deux, on ne nous
frappa ni traîna,
grâces à Dieu, et à nos cent
écus, que nous éprouvâmes dans
cette occasion, avoir été bien
employés. Les archers nous aidèrent
à marcher, et en portèrent même
quelques-uns entre leurs bras, jusques
où étaient nos habits, et par une
espèce de miracle, il n'y eut aucun de nous,
qui y pérît, ni pendant la route,
où on nous fit encore trois fois cette
barbare visite en pleine campagne, avec un froid
aussi grand et même plus rude qu'il
n'était à Charenton.
Il est à remarquer, que pendant qu'on nous
fit ce cruel traitement à Charenton, ces
quatre messieurs de Paris le voyaient des
fenêtres de leur chambre, qui donnait dans
cette cour. Ils criaient, et se lamentaient,
demandant au capitaine, les mains jointes, de nous
épargner ; mais il ne les
écoutait pas, et tout ce que ces bons
messieurs purent faire, ce fut de nous crier de
nous recommander à Dieu, comme on fait
à des patients, à qui on va faire
subir le dernier supplice ; et depuis nous ne
les avons jamais revus ; car on nous recloua
nos chaînes au râtelier de
l'écurie, comme auparavant. Jugez, je vous
prie, si ces messieurs eurent l'appétit et
le courage de se régaler
du grand souper qu'ils avaient fait préparer
pour nous. Le capitaine ne voulut même jamais
permettre, qu'ils entrassent dans l'écurie
pour nous voir, et nous secourir dans l'accablant
état où nous étions, ni qu'on
nous apportât le moindre
rafraîchissement, et il fallut nous contenter
d'un morceau de pain, d'une once de fromage, et
d'un demi-setier de mauvais vin pour chacun, que le
capitaine nous fit distribuer. Ce qui nous aida le
plus à nous réchauffer, et qui
vraisemblablement, après Dieu, nous sauva la
vie, ce fut le fumier des chevaux de cette
écurie, sur lequel nous étions assis
ou à demi couchés. Pour moi, je me
souviens que j'eus la facilité de m'y
enterrer entièrement. Ceux qui purent le
faire s'en trouvèrent bien, se
réchauffèrent, et se remirent
bientôt. Tout extrême et vilain que ce
remède était, nous rendîmes
grâces à Dieu, de bon coeur, de nous
l'avoir procuré.
Le lendemain au matin, nous partîmes de
Charenton. On mit sur les chariots quelques-uns de
nous vingt-deux, qui le requirent, sans qu'on les
maltraitât le moins du monde ; mais
les autres malheureux,
accablés de leurs souffrances du soir
précédent, et quelques-uns à
l'article de la mort, ne purent obtenir cette
faveur, qu'après avoir passé par
l'épreuve du nerf de boeuf ; et pour
les mettre sur les chariots, on les
détachait de la grande chaîne, et on
les traînait par celle qu'ils avaient au col,
comme des bêtes mortes jusques au chariot,
où on les jetait comme des chiens, leurs
jambes nues, pendantes hors du chariot, où
dans peu elles se gelaient, et leur faisaient
souffrir des tourments inexprimables ; et, qui
pis est, ceux qui se plaignaient ou lamentaient sur
ces chariots des maux qu'ils souffraient, on les
achevait de tuer à grands coups de
bâton.
On demandera ici, pourquoi le capitaine de la
chaîne n'épargnait pas plus leur vie,
puisqu'il recevait vingt écus par tête
pour ceux qu'il livrait vivants à Marseille,
et rien pour ceux qui mouraient en chemin. La
raison en est claire. C'est que le capitaine devant
les faire voiturer à ses dépens, et
les voitures étant chères, il ne
trouvait pas à beaucoup près son
compte à les faire charrier. Car, à
faire charrier, par exemple, un homme jusques
à Marseille, il lui en
aurait coûté plus de quarante
écus, sans la nourriture ; ce qui fait
voir, qu'il lui était plus profitable de les
tuer, que de les faire voiturer. Il en était
quitte d'ailleurs, en laissant au curé du
premier village, qui se présentait, le soin
d'enterrer ces corps morts, et en prenant une
attestation dudit curé.
Enfin nous traversâmes l'Ile-de-France, la
Bourgogne et le Mâconnais jusques à
Lyon, faisant tous les jours trois et quatre
lieues ; ce qui est beaucoup, chargés
de chaînes, comme nous étions,
couchant tous les soirs dans des écuries sur
le fumier, mal nourris, et, quand le dégel
vint, toujours dans la boue jusques à
mi-jambes, et souvent la pluie sur le corps, qui ne
se séchait qu'avec le temps sur nos corps
mêmes, sans compter les poux et la gale,
inséparables d'une misère pareille.
Nous n'ôtions cette vermine de nos corps
qu'à pleines mains ; mais pour la gale,
dont tous ces misérables de la chaîne
étaient ulcérés, nous
vingt-deux en fûmes exempts, et pas un de
nous ne la gagna, quoique pendant la route nous
eussions été séparés
les uns des autres, et que plusieurs de nous
fussent accouplés avec
quelques-uns de ces malheureux. Pour moi, je
l'étais avec un, qui était
condamné pour désertion.
C'était un bon enfant. On l'accoupla avec
moi à Dijon en Bourgogne, parce que le
réformé, qui était
enchaîné avec moi, était
incommodé d'un pied, et qu'il fut mis sur un
chariot. Ce pauvre déserteur donc
était si infecté de la gale, que tous
les matins c'était un mystère, pour
me dépêtrer d'avec lui. Car comme le
pauvre misérable n'avait qu'une chemise
à demi pourrie sur son corps, que le pus de
sa gale traversait sa chemise, et que je ne pouvais
m'éloigner de lui tant soit peu, il se
collait tellement à ma casaque, qu'il criait
comme un perdu lorsqu'il fallait nous lever pour
partir ; et qu'il me priait, par grâce,
de lui aider à se décoller d'avec
moi. Cependant je ne gagnai pas cette incommode
maladie, qui se prend si facilement.
En arrivant à Lyon, on mit toute la
chaîne dans de grands bateaux plats pour
descendre le Rhône jusques au pont
Saint-Esprit : de là par terre à
Avignon, et d'Avignon à Marseille, où
nous arrivâmes le dix-sept janvier mil sept
cent treize, tous vingt-deux, grâces
à Dieu, en bonne
santé. Des autres il en était mort
beaucoup en chemin, et il y en avait très
peu, qui ne fussent malades, dont divers moururent
à l'hôpital de Marseille.
Voilà la fin de notre route de Dunkerque
à Marseille ; route qui m'a fait plus
souffrir, principalement depuis Paris, que pendant
les douze années précédentes
de ma prison et de mon séjour sur les
galères. Dieu soit loué, que d'ici en
avant, je n'aurai plus à raconter que les
événements, qui
précédèrent et accomplirent
enfin notre chère liberté :
événements qui n'ont, Dieu merci,
rien de tragique, mais qui méritent bien la
curiosité du lecteur. On y verra la malice
noire et la haine invétérée
des missionnaires de Marseille, et la grâce
de Dieu envers ses enfants triompher de leurs
implacables ennemis.
On nous mit tous vingt-deux sur la galère,
nommée la Grande Réale, qui servait
d'entrepôt aux nouveaux venus et aux infirmes
des trente-cinq galères, qui étaient
pour lors dans le port de Marseille. Ces nouveaux
venus n'y restent que peu, on les partage
bientôt sur les autres galères ;
mais nous vingt-deux ne
fûmes pas partagés,
parce qu'on comptait que les six chiourmes de
Dunkerque reviendraient à Marseille, et
qu'on nous remettrait alors chacun sur les
galères, d'où nous étions
sortis. Nous grossîmes donc le nombre de nos
frères qui se trouvaient sur cette Grande
Réale, si bien que nous y étions au
delà de quarante réformés.
Ces chers frères nous reçurent avec
embrassements, et larmes de joie et de douleur tout
ensemble : de joie, de nous voir tous sains et
saufs, constants et résignés à
la volonté de Dieu ; et de douleur, des
souffrances que nous avions eues, louant la divine
Providence de nous avoir soutenus dans de si
longues et douloureuses épreuves.
Le supérieur des missionnaires de Marseille,
nommé le Père Garcin, s'était
trouvé à Paris dans le temps que nous
y étions. Il nous était venu voir
dans le cachot de la Tournelle, et nous y avait
exhortés de son mieux par des promesses
mondaines à changer de religion ; car
c'est là presque toujours le texte de leur
mission. « Vous êtes ici, nous
disait-il, à portée d'être
délivrés dans deux fois vingt-quatre
heures, si vous voulez changer,
et je me fais fort d'obtenir dans ce peu de temps
votre délivrance. À quoi vous
allez-vous exposer ? continua-t-il. Il y a
toute apparence, que les trois quarts de vous
périrez d'ici à Marseille dans la
rude saison où nous sommes ; et puis,
quand ceux de vous, qui en échapperont,
seront à Marseille, ils feront comme tous
les autres protestants, qui étaient en
galère, et qui ont tous fait abjuration
entre mes mains. »
Nous lui répondîmes, que ceux qu'il
disait n'avaient rien fait pour nous, ni nous rien
pour eux, et que chacun devait prendre garde
à son propre salut. Il s'en alla, et fut
plus tôt de retour à Marseille que
nous. Ce même Père Garcin donc nous
vint voir le lendemain de notre arrivée sur
la Grande Réale, et nous ayant tous fait
venir dans la poupe de la galère, il nous
compta, et ayant trouvé le même nombre
qu'il avait vu à Paris :
« C'est bien merveille, dit-il, que vous
ayez tous échappé. N'êtes-vous
pas encore las de souffrir ?
- Vous vous trompez fort, lui dis-je, Monsieur, si
vous croyez que les souffrances affaiblissent notre
foi. Nous éprouvons au contraire ce
que dit le Psalmiste, que
plus nous souffrons de maux, et plus il nous
souvient de Dieu.
- Chansons, dit-il.
- Ce n'est pas tant chanson, lui repartis-je, que
celle que vous nous chantiez à Paris, que
tous nos frères des galères de
Marseille avaient fait abjuration entre vos mains.
Il n'y en a pas un qui l'ait fait, et si
j'étais à votre place, j'aurais honte
toute ma vie de m'être exposé à
avancer une chose, qui me convaincrait
d'imposture.
- Vous êtes un raisonneur, » me
répondit-il brusquement, et s'en alla.
Deux ou trois mois se passèrent depuis notre
arrivée à Marseille, sans qu'il nous
arrivât rien de particulier ; mais
environ le commencement d'avril, les missionnaires
firent une exhortation générale
à nous tous pour nous persuader de changer
de religion, employant à cela plutôt
des promesses mondaines que des arguments
démonstratifs. Ils se flattaient, que du
moins ils en gagneraient quelques-uns, ne
fût-ce qu'un ou deux, pour exécuter un
dessein diabolique qu'ils avaient formé,
comme on le verra bientôt. Je dois remonter
un peu plus haut pour en donner
l'intelligence.
Pendant le congrès d'Utrecht pour la paix
générale, nous vivions en
espérance que cette paix nous procurerait
notre délivrance. Nous savions que les
puissances protestantes s'y intéressaient
fortement. Mais la France n'en voulant point
entendre parler, la paix se conclut sans faire
mention de nous ; si bien que toute
espérance du côté des hommes
nous étant ôtée, nous la
tournâmes toute du côté de Dieu,
et nous nous résignâmes à sa
sainte volonté.
Nous étions dans ces termes lors de
l'exhortation des missionnaires, qui se
persuadaient qu'ayant perdu toute espérance
humaine, il leur serait facile de nous tenter par
leurs belles promesses, et d'en séduire
quelqu'un pour jouer leur rôle ; mais
par la grâce de Dieu ils ne réussirent
pas.
Nous ne savions rien de ce qui se passait en
Angleterre en notre faveur : mais les
missionnaires qui savent tout, avaient avis que la
Reine Anne était fortement sollicitée
d'employer ses bons offices pour nous auprès
du Roi de France ; et en bons politiques, ils
se persuadaient, que si la Reine nous demandait, le
Roi, pour les raisons qu'un chacun sait, ne la
refuserait pas.
C'est ce qui fit prendre la résolution
à ces messieurs de s'opposer, par toutes
sortes de voies, à notre liberté, en
faisant accroire au Roi, de qui ils étaient
très écoutés, que les
hérétiques qui étaient sur les
galères, rentraient tous dans le giron de
l'Église romaine ; afin que le Roi
eût cette raison à opposer aux
sollicitations que la Reine Anne lui pourrait faire
pour notre délivrance. Mais n'ayant pu
persuader aucun de nous de se rendre, et ayant
besoin de quelqu'un pour exécuter leur
projet, que firent ces fourbes pour en imposer au
Roi ? Ils sollicitèrent deux malheureux
forçats, qui étaient
condamnés, l'un pour vol, l'autre pour
désertion, tous deux catholiques romains
d'origine, et qui, depuis plusieurs années,
qu'ils étaient aux galères, avaient
fait constamment profession de cette
religion ; ils les sollicitèrent,
dis-je, à feindre qu'ils étaient de
la religion réformée, et à se
faire ensuite catholiques ; après quoi
ils leur promettaient leur délivrance.
La condition était flatteuse pour ces deux
malheureux. Aussi ne se firent-ils pas tirer
l'oreille pour y acquiescer. Nous ignorions
parfaitement cette manigance, et
nous fûmes tout surpris, qu'un dimanche,
lorsqu'on disait la messe sur les galères,
ces deux soi-disant réformés se
plièrent dans leur capote, et se
couchèrent dans leur banc, à la
manière des véritables
réformés, en qui l'on tolérait
cette manière d'agir, qui désignait
qu'ils n'avaient aucune foi pour la messe.
Mon lecteur sera, je m'assure, bien aise, que je
sorte pour un moment de mon sujet pour lui dire,
aussi brièvement qu'il me sera possible,
l'origine de cette tolérance, qui surprend
sans doute ceux qui ne la savent pas, et qui
connaissent l'esprit des ecclésiastiques
romains, surtout des missionnaires, peu
disposés à souffrir impunément
une telle indécence à l'égard
d'un mystère, qu'ils exaltent si fort. La
voici.
Après la paix de Ryswyk, les missionnaires
entreprirent de forcer les protestants des
galères, lorsqu'on dirait la messe, de se
mettre à genoux, tête nue, et dans la
posture de dévotion, que les catholiques
romains observent. Pour y réussir, ils
n'eurent pas beaucoup de peine à mettre dans
leur parti M. de Bonbelle,
major-général des galères, le
plus grand et le plus
acharné des persécuteurs. Ils
conclurent avec lui de faire donner la bastonnade
à tous les réformés,
jusqu'à ce qu'ils eussent consenti à
se tenir dans cette posture, lorsqu'on dirait la
messe. Et pour rendre cette exécution
d'autant plus effrayante qu'elle durerait plus
longtemps, on convint que le major commencerait
à un bout des galères (il y en avait
quarante), et ferait donner la bastonnade, à
une ou deux galères par jour, et ainsi
jusqu'à l'autre bout, pour recommencer
encore par ceux qui resteraient opiniâtres,
et continuer ainsi jusqu'à ce qu'ils se
soumissent ou mourussent sous la corde.
Bonbelle commença cette effroyable
exécution, et chaque jour, il la continuait
d'une galère à l'autre ; et les
termes favoris dont il se servait pour exhorter ces
pauvres martyrs à obéir,
étaient ceux-ci, qui font frémir
d'horreur : « Chien, disait-il,
mets-toi à genoux quand on dira la messe, et
dans cette posture, si tu ne veux pas prier Dieu,
prie le diable, si tu veux ; que nous
importe ? »
Tous ceux qui furent exposés à ce
supplice, y résistèrent saintement et
courageusement, en louant Dieu, au
milieu de leurs peines.
Cependant quelques bonnes âmes en
informèrent les ambassadeurs des puissances
protestantes, qui étaient à la cour
de France, et qui, frappés d'une injustice
aussi atroce, présentèrent des
mémoires au Roi, où ils
alléguaient entre autres, qu'il était
du dernier injuste que des gens, qui souffraient
actuellement la peine des galères, pour
n'avoir pas voulu se conformer à
l'Église romaine, fussent violentés
par de nouvelles peines pour les y porter. Le Roi
avoua, que cela était très injuste,
et déclara qu'on avait commis cette
violence, sans ses ordres, et envoya incontinent
ordre à Marseille, de cesser ces
excès, et d'en faire réparation aux
prétendus réformés des
galères ; ce qui se fit assez
faiblement, en disant que c'était un
malentendu, qui n'arriverait plus. Et depuis ce
temps-là on toléra, que les
réformés se couchassent dans leur
banc, quand on disait la messe sur les
galères, comme je l'ai dit plus haut.
Je reprends le fil de l'histoire des deux faux
réformés, que les missionnaires
faisaient agir. Ces malheureux s'étant donc
couchés dans leur banc
pendant la messe, le comite, qui avait le mot et
qui observe ordinairement que chacun fasse son
devoir en pareil cas, les voyant ainsi hors de la
posture convenable, leur en demanda la raison. Ces
misérables lui répondirent, en
jurant, qu'ils étaient huguenots, à
cause que leurs parents l'étaient aussi. Les
comites en avertirent les aumôniers ;
car c'était sur deux galères
différentes, que se passait cette
scène. Les aumôniers les
exhortèrent de rentrer dans le giron de
l'Église. Ils se firent un peu tirer
l'oreille, et enfin se rendirent. Nous jugions bien
que c'était un tour de politique des
missionnaires ; mais nous ne
pénétrions pas à quoi tout
cela aboutirait, et nous ne le
développâmes que quelques jours
après, que les missionnaires eux-mêmes
le mirent au jour, comme on le va voir.
|