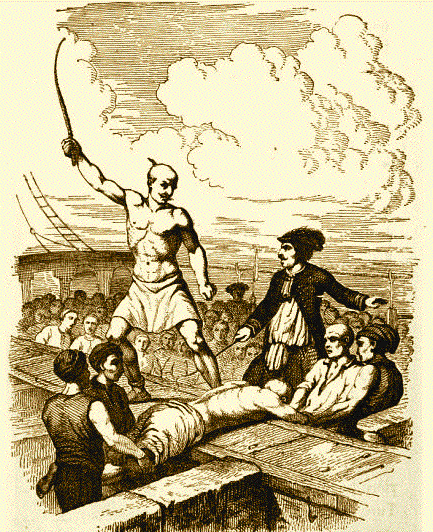MÉMOIRES D'UN PROTESTANT
CONDAMNÉ AUX GALÈRES DE FRANCE
POUR CAUSE DE
RELIGION.
CHAPITRE III
HISTOIRE DE LA DÉTENTION DES SIEURS DUPUY,
MOURET
Et LA VENUE ET DES DEMOISELLES MADRAS Et
CONCEIL.
Le sieur Dupuy nous dit qu'il n'y avait rien que
d'ordinaire depuis leur départ de Bergerac
avec un bon guide ; qu'ils avaient
traversé la France sans aucun accident ni
obstacle, jusqu'au passage de l'Escaut, à
deux lieues de Tournai, où ils avaient
été arrêtés par la
trahison d'un malheureux paysan, en qui leur guide
et eux s'étaient fiés pour leur faire
passer la rivière. En voici, nous dit-il,
l'affligeante histoire.
Arrivés aux environs de la rivière de
l'Escaut, qui séparait la France du Pays-Bas
espagnol, notre guide nous
conduisit de nuit chez un paysan de sa
connaissance, qui faisait métier de passer
les réfugiés sur cette rivière
avec un petit bateau. Ce paysan fut ravi de voir
qu'il se présentait une si bonne aubaine
pour lui : car nous accordâmes de lui
payer d'avance chacun deux louis d'or de vingt
livres pour nous passer de l'autre
côté de la rivière. Il nous
donna quelque chose à manger en attendant
l'heure qui n'était pas encore convenable
à cause des patrouilles qui se faisaient le
long de l'Escaut.
Le paysan jetant les yeux sur un manteau gris de
bonne étoffe que portait le sieur Mouret, le
convoita et le lui demanda. Mouret lui dit qu'il ne
lui donnerait pas ce manteau pour toute chose au
monde, parce qu'il appartenait à son
père, qui était réfugié
à Amsterdam, et qu'il voulait avoir le
plaisir de le lui apporter. Le paysan fit beaucoup
d'instances pour avoir ce manteau, mais Mouret le
refusa constamment. Enfin ce fatal manteau fut la
cause de notre malheur, car le paysan
conçut, par dépit de ce refus, la
résolution de nous faire arrêter,
à quoi il réussit trop bien, et voici
comment il s'y prit.
II nous amusa dans sa maison jusques environ
minuit ; après quoi il nous dit de le
suivre jusqu'à l'endroit où
était son bateau. Nous le suivîmes en
effet, la joie au coeur d'être bientôt
en sûreté. Ce scélérat
nous conduisit dans un cabaret qui n'était
pas loin de sa maison, nous disant qu'il fallait
attendre encore un peu et qu'il allait amener son
bateau à l'endroit convenable pour nous
passer. Nous étions tous dans une chambre de
ce cabaret, en attendant notre paysan. Notre guide,
qui était avec nous, ne se méfiait de
rien, non plus que nous. Le paysan resta bien une
bonne heure à revenir, au bout de laquelle
il entra dans la chambre où nous
étions, et prenant le guide en particulier,
le fit sortir avec lui et le passa de l'autre
côté de la rivière. Ensuite il
vint, accompagné d'une vingtaine de paysans
armés, qui nous arrêtèrent et
nous conduisirent ici.
Voilà l'histoire de la détention de
ces messieurs. Mais, pendant que je suis sur leur
sujet, il faut que je raconte de quelle
manière ce paysan, nommé Batiste,
reçut le juste salaire de sa perfidie dans
la ville de Tournai.
Il faut savoir que de la ville d'Ath à cette
dernière ville, dans ce temps, il se faisait
journellement une grande contrebande. Un jour
Batiste et un de ses camarades ayant appris qu'un
marchand de Tournai venait d'Ath avec un chariot
chargé de contrebande, résolurent
d'aller sur le grand chemin pour faire mine
d'arrêter ce chariot, mais en effet pour
rançonner ce marchand.
Le chariot paraît avec le marchand ; les
deux paysans, le fusil en joue, l'arrêtent
pour le mener, disent-ils, à la douane, pour
y être confisqué. Le marchand leur
présente dix pistoles pour lui laisser faire
son chemin. C'est ce que nos drôles
demandaient. Ils reçurent l'argent et s'en
allèrent. Mais il arriva que le chariot fut
arrêté par les commis aux portes de la
ville de Tournai, et confisqué au profit des
fermiers.
Le marchand, voyant qu'il avait perdu ses
marchandises, ne songea qu'à se venger de
ces deux paysans qui l'avaient
rançonné sur le grand chemin comme
des voleurs. Pour cet effet, il fut les
dénoncer à M. de Lambertie,
grand-prévôt de Flandre, qui envoya
enlever ces deux malheureux, qui furent
conduits dans les prisons du
Beffroi, mais non pas dans le même cachot
où nous étions. Le
grand-prévôt, qui savait depuis
longtemps que Batiste était un
scélérat et homme à commettre
toutes sortes de crimes, et qu'il était
même extrêmement
soupçonné de favoriser les
protestants au passage de l'Escaut, pour de
l'argent, ce qui était un cas
pendable ; quoique jusqu'à ce temps il
n'eût eu aucun dénonciateur contre
lui, crut pour le coup le pouvoir faire rouer vif
pour la violence et le vol par lui commis à
l'égard de ce marchand.
Il se mit donc à lui faire son
procès. Il l'interroge exactement. Mais
Batiste, qui était un fin compère,
savait bien sa leçon, et se défendit
à merveille sur l'accusation du vol du grand
chemin, alléguant pour sa justification, que
chacun pouvait et même devait faire ce qu'il
avait fait, que les ordonnances du Roi et celles
des fermiers généraux promettaient et
donnaient en effet récompense aux
dénonciateurs ; et que de bonne foi lui
et son compagnon n'avaient eu d'abord d'autre
pensée que celle de faire l'office de
dénonciateur ; mais que ce marchand de
lui-même, sans qu'ils
eussent rien demandé, les avait
tentés par son présent de dix
pistoles, et qu'en reconnaissance ils lui avaient
laissé faire son chemin.
Le grand-prévôt fut trompé dans
son calcul d'avoir moyen de faire mourir ce
méchant homme, car sa défense sur le
prétendu vol de grand chemin avait un air si
plausible que l'on ne crut point devoir passer
outre à procéder sur ce crime. Mais
il arriva dans cette affaire un cas qui vaut la
peine d'être détaillé ; le
voici :
II faut savoir qu'après la détention
des trois messieurs et des deux demoiselles dont
j'ai parlé ci-dessus, leur procès fut
bientôt fait par la juridiction ou Bailliage
de la ville de Tournai; et en attendant que le
Parlement eût confirmé la sentence, ce
qui dura cinq à six semaines, on laissa ces
messieurs dans notre cachot pour les envoyer
ensuite aux galères.
Pendant ce temps-là le geôlier venait
souvent auprès de nous fumer sa pipe ;
et dans la conversation le sieur Dupuy lui fit un
jour le récit de leur prise par la perfidie
de Batiste. Il lui raconta comment ce
misérable leur avait nommé plusieurs
de ses compatriotes et autres personnes de
leur connaissance, qu'il avait
passées avec son bateau, se louant fort de
ces gens-là, qui l'avaient bien payé.
Il lui dit encore que Batiste, avant de les faire
arrêter, était venu prendre son bon
ami notre guide, dans le cabaret, et lui avait fait
passer la rivière, soit par amitié,
ou, ce qui est bien plus apparent, afin que ce
guide ne le pût pas accuser de ses mauvaises
pratiques. Quoi qu'il en soit, Batiste, suivant les
principes de la France et de ses ordonnances,
méritait la mort, quand bien même il
n'aurait commis d'autres crimes que d'avoir
passé le guide à l'autre bord de
l'Escaut.
Or, il arriva que le grand-prévôt,
descendant de la chambre où il tenait son
tribunal au Beffroi, parla au geôlier pour
lui recommander de garder étroitement et
dans le plus fort de ses cachots ledit Batiste,
pendant qu'il chercherait des preuves convaincantes
de divers crimes dont ce malheureux était
soupçonné. Le geôlier
là-dessus lui dit qu'il pouvait avoir des
preuves certaines, que Batiste avait passé
souvent sur l'Escaut des gens de la religion
réformée qui s'enfuyaient hors du
royaume, et tout de suite il lui
raconte ce que Dupuy cl ses
compagnons, qui étaient encore dans sa
prison, lui avaient dit, même avant que
Batiste fût arrêté.
Le prévôt fut ravi d'entendre une
telle déposition, et au plus tôt il
s'en vint à notre cachot, et appelant par
leurs noms et surnoms ces trois messieurs, leur
dénonça que le lendemain, à
dix heures du matin, il les citait à
comparaître devant son tribunal pour dire
vérité, sous serment, de ce en quoi
ils seraient interrogés au sujet de Batiste,
qui les avait fait arrêter :
« Mais, Messieurs, je vous exhorte,
ajouta-t-il, de ne point nourrir dans vos coeurs
aucun sentiment de vengeance contre ce
misérable, mais de dire la pure
vérité sur ce qui vous sera
demandé » ; après quoi
il se retira.
Ces trois messieurs d'abord parurent ravis de joie
de pouvoir se venger de la perfidie de Batiste, en
déclarant ce qu'ils savaient, sans engager
leur conscience. J'avoue que je fus dans le moment
de leur sentiment ; mais ensuite, ayant fait
réflexion sur les conséquences de
leur déposition, je changeai d'avis et leur
communiquai ma pensée, telle que la
voici :
« II est certain, Messieurs, leur dis-je,
qu'en déposant la pure
vérité au sujet de Batiste, ce
malheureux sera pendu sans rémission. Mais,
je vous prie, considérons ici deux choses
que cela produira. La première ne vous fera
aucun honneur parmi nos amis, et elle vous sera un
sujet de reproche de la part de nos ennemis ;
car l'un et l'autre parti concluront qu'il y aura
eu de la vengeance dans votre fait : car tout
le monde est naturellement porté à
médire de son prochain, et vous ne sauriez
absolument vous laver de cette calomnie, puisque
vous ne pourriez donner des preuves visibles et
parlantes de ce qui réside dans votre coeur,
et que notre intégrité ne nous
justifie qu'envers Dieu, qui connaît seul nos
plus secrètes pensées.
« La seconde chose que votre
déposition causera, ce sera une injustice
tacite que vous commettrez en faisant pendre ce
misérable ; car il est certain que vous
serez cause de la mort d'un homme qui, selon les
réformés, n'a commis aucun crime en
facilitant l'évasion de nos frères,
puisque, lorsque quelqu'un nous rend cet office,
nous le payons comme méritant salaire, non
pour sa peine, mais pour le
risque qu'il court en nous
rendant ce service, qui est regardé chez les
papistes comme un crime digne de mort, et chez les
réformés comme une vertu digne de
récompense.
Voilà, Messieurs, à quoi votre
déposition, toute sincère et
véritable qu'elle sera, vous expose, et ce
qu'à mon avis vous ne pouvez
éviter.
- Mais, s'écrièrent ces messieurs,
faut-il donc faire un faux serment pour sauver la
vie à cet homme, et éviter les deux
précipices que vous nous faites
envisager ?
- Non, leur dis-je, pour rien au monde vous ne
devez faire un faux serment.
- Que faire donc ? me dirent-ils.
- C'est ce qui m'embarrasse, leur
répondis-je : mais il y faut penser
mûrement et chercher s'il n'y aurait pas un
milieu qui vous empêchât de commettre
une injustice, et qui sauvât en même
temps la vie à Batiste.
Il me vient une pensée, leur dis-je, mais je
ne sais si elle pourra s'exécuter, parce que
je ne suis pas sûr du fait, ne connaissant
pas les lois des procédures civiles et
criminelles. La voici :
« J'ai souvent entendu dire que tout
homme condamné aux galères est
récusable dans le témoignage qu'il
rend, et que même aucun
magistrat ni juge ne le doit ni ne le peut
contraindre à rendre aucun témoignage
par serment. À votre place
j'éprouverais si vous pouvez éviter
de rendre un témoignage assermenté,
en en faisant le refus au grand-prévôt
et lui alléguant ce que j'ai dit ci-dessus,
qu'un galérien est dispensé de faire
un tel acte.
Si je me trompe, et qu'on puisse, suivant les lois,
vous contraindre à déclarer la
vérité par serment, à la bonne
heure, dites la vérité. C'est une
épreuve que, selon moi, vous devez faire,
continuai-je ; du moins cette démarche
vous empêchera d'être accusés
d'user de vengeance, puisque l'on verra que vous ne
rendrez témoignage contre Batiste
qu'à votre corps
défendant. »
Ce conseil fut approuvé et suivi.
Le lendemain matin, sur les dix heures, le
geôlier et deux huissiers vinrent prendre ces
messieurs pour les conduire en haut dans la chambre
prévôtale, où ils
trouvèrent le prévôt et ses
conseillers assemblés, et le
misérable Batiste garrotté et assis
sur la sellette criminelle, plus mort que vif, de
voir comparaître ceux de qui sa vie
dépendait, et qui avaient tant de raisons de
se venger de la trahison qu'il
leur avait faite.
D'abord le prévôt lui demanda s'il
connaissait ces messieurs. Il dit que non.
« Nous te les ferons bien
connaître, » lui repartit le
prévôt. En même temps il demande
à ces messieurs s'ils connaissaient ce
criminel. Ils ne manquèrent pas de dire
qu'ils le connaissaient pour celui qui les avait
fait arrêter.
Jusque-là ils ne disaient rien à la
charge de Batiste, sur quoi le prévôt
leur dit : « Levez la main et
promettez à Dieu et à la Justice de
dire la vérité sur ce qu'on vous
interrogera. »
Ces messieurs répondirent hardiment qu'ils
n'en feraient rien, qu'ils étaient hors du
monde par leur sentence de galère, et qu'ils
n'étaient pas obligés de
témoigner, encore moins de prêter
serment. Le prévôt leur dit, d'un air
moins doux : « Quoi ! vous
dites que vous faites profession de la
vérité, et vous refusez de la
dire !
- Nous faisons profession, Monsieur, lui
répondit Dupuy, de la vérité
de l'Évangile, mais non pas de la dire pour
faire pendre un homme, lorsque les lois nous en
dispensent.
- Quelle vertu ! » dit le
grand-prévôt, en levant les yeux au
ciel. Puis se tournant vers Batiste, qui
était extasié
d'entendre ses ennemis, au lieu de se venger,
défendre sa cause ; le
prévôt, dis-je, s'adressant à
lui, lui dit : « Malheureux, baise
les pas de ces honnêtes gens, qui
t'ôtent la corde du cou. Tu les as fait
condamner aux galères ; tu leur y
tiendras compagnie. » Et se levant de son
siège judicial, il rompit
l'assemblée, et chacun des prisonniers fui
reconduit dans son cachot.
Nos trois messieurs ne se sentaient pas d'aise
d'avoir si bien réussi, en
déchargeant Batiste sans charger leurs
consciences. Enfin la sentence du
grand-prévôt fut prononcée
contre Batiste et Pitous (c'était son
compagnon). Ils furent condamnés aux
galères perpétuelles pour avoir
rançonné ce marchand sur le grand
chemin.
La sentence aussi de ces trois messieurs
étant confirmée, six archers vinrent
les prendre pour les conduire à Lille,
à la chaîne des galériens qui
s'y assemblait. On les attacha deux à deux
par les mains, et ensuite tous les cinq
ensemble ; et le sort voulut, ou
peut-être ce fut un ordre du
prévôt, que Batiste fût
attaché avec le sieur Dupuy. On les sortit,
ainsi attachés, sur les dix heures du matin,
pour les conduire à Lille.
Toute la ville de Tournai sut bientôt ce qui
s'était passé, et la
généreuse et chrétienne action
de ces messieurs, qui avaient sauvé la vie
à leur perfide et traître ennemi. Une
affluence de peuple s'assembla devant le Beffroi,
et les rues étaient pleines de monde pour
voir, disaient-ils, la vertu attachée avec
le crime ; et chacun faisait des huées
et des imprécations horribles contre ce
scélérat et traître Batiste et
souhaitait toutes sortes de
bénédictions à ces trois
messieurs.
Nous voilà encore privés pour la
seconde fois de nos nouveaux hôtes,
compagnons de cachot ; ce qui nous affligea
beaucoup. Leur piété nous
édifiait, et leur conversation nous
égayait. Il y avait longtemps que le
grand-vicaire ne nous était venu voir ;
il vint enfin après le départ de ces
trois messieurs. « Je viens voir, nous
dit-il, si nos anciennes conversations ne vous ont
pas fait faire des réflexions favorables
à votre conversion. » Nous lui
dîmes que les réflexions
que nous y avions faites, nous
fortifiaient de plus en plus dans les sentiments
que nous lui avions témoignés.
« Sur ce pied-là, nous dit-il, mes
visites sont inutiles, et je ne viendrai que pour
apprendre si je vous suis utile en quelque
chose ; cependant, continua-t-il, Mgr
l'Évêque doit dégager sa parole
avec M. le Procureur général du
Parlement, et il m'a ordonné de lui aller
faire compliment de sa part, et de lui offrir de
vous remettre dans les prisons du
Parlement. » À ces mots nous
pâlîmes de crainte de retourner dans
cette affreuse prison, où nous avions tant
pâti. Il s'en aperçut. « Je
vois, dit-il, que vous craignez d'y
retourner ; si vous souhaitez, je prierai ce
seigneur de vous laisser ici, et que, lorsque le
Parlement voudra faire la révision de votre
procès, il ne vous fasse pas
transférer dans leur prison ; et je
vous viendrai dire sa réponse aujourd'hui
même. » Nous lui
témoignâmes que nous lui serions bien
obligés de ce bon office ; car nous
craignions la prison du Parlement comme le feu. Il
s'en fut, et le même jour, il nous vint dire
que nous n'avions qu'à nous
tranquilliser ; qu'on ne
nous transférerait plus. Nous le
remerciâmes de sa grande bonté pour
nous. Il nous quitta fort ému de compassion
pour nous, et je lui vis même répandre
quelques larmes.
Quelques jours après, un Conseiller du
Parlement, que je ne nommerai pas pour raison, vint
nous voir dans notre prison, et nous dit que nous
lui étions fortement recommandés, et
qu'il voudrait bien voir quelque jour à nous
tirer d'affaire. Nous ne pouvions nous imaginer
d'où nous venait cette recommandation,
à moins que nos parents, à qui nous
avions écrit depuis que nous étions
au Beffroi, ne l'eussent fait faire par quelques
personnes de considération de leurs amis.
Cependant, n'ayant aucune nouvelle de nos parents,
qui nous donnât avis de cette recommandation,
et aucun des réformés de Tournai, qui
nous venaient voir souvent, ne nous ayant fait
connaître qu'elle nous vînt par leur
canal, nous ne pouvions jeter notre soupçon
que sur notre bon ami le grand-vicaire, qui nous
avait assuré d'une manière qui nous
paraissait très sincère, qu'il
désirait ardemment de nous voir libres.
Quoi qu'il en soit, ce Conseiller
resta une bonne heure avec nous, et nous interrogea
sur notre route, en quel endroit nous avions
été arrêtés, et de
quelle manière. Nous le satisfîmes sur
tous ces points. Il nous fit redire
l'événement de Couvé ; et
il nous demanda si nous pourrions bien prouver que
nous avions passé et logé dans un
cabaret de cette petite ville. Nous lui
répondîmes que rien n'était
plus facile que de le vérifier ; sur
quoi il nous dit : « Prenez courage,
mes enfants, j'espère que vous sortirez
d'affaire. Demain je vous enverrai un homme de loi,
qui vous portera une requête à
signer ; signez-la, et vous en verrez les
effets. » Après quoi il
sortit ; et depuis nous ne le vîmes plus
qu'assis au rang de nos juges en Parlement,
où nous comparûmes peu de jours
après, comme on le verra bientôt.
Le lendemain de la visite du Conseiller, l'homme de
loi, dont il nous avait parlé, vint dans
notre prison, et nous fit lire la requête
qu'il avait dressée et que nous
signâmes.
Cette requête, adressée à nos
juges en Parlement, portait en substance, que, pour
être de la religion réformée,
nous n'étions pas sujets aux peines
portées par l'ordonnance,
qui défend à toute personne du
royaume de sortir de France sans permission de la
cour ; et que nous offrions de faire preuve
que nous ne sortions pas du royaume, puisque nous
en étions déjà sortis, et y
étions rentrés ensuite, en passant
par Couvé, ville du Prince de Liège,
où il y avait garnison hollandaise ;
mais que n'ayant aucune envie de sortir du royaume,
nous ne nous étions servis que du passage
par ladite ville, ne pouvant aller de Rocroy
à Mariembourg qu'en la traversant ; que
si nous avions eu dessein de sortir de France, nous
n'avions qu'à nous mettre sous la protection
du gouverneur hollandais de Couvé, qui nous
aurait fait conduire sans difficulté par les
terres de Liège jusqu'à Charleroi.
Cette requête fut mise sur la table de la
chambre criminelle du Parlement.
Deux jours après, trois huissiers du
Parlement nous vinrent prendre pour nous y
conduire, où étant, le
Président, nous montrant la requête,
nous demanda si nous avions signé et
présenté cet écrit. Nous
répondîmes que oui, et que nous
priions la vénérable assemblée
d'y avoir égard. Le
Président nous dit qu'ils avaient
examiné ladite requête, et qu'ils y
avaient vu que nous offrions de faire preuve que
nous avions passé par Couvé ;
mais qu'il ne suffisait pas de prouver cet
article ; que la preuve n'en était pas
même nécessaire, puisqu'elle
était toute faite, et qu'il était de
notoriété publique que nous ne
pouvions venir à Mariembourg sans passer par
cet endroit : « Mais, nous dit-il,
vous avez une autre preuve à faire, sans
laquelle la première est nulle ; c'est,
continua-t-il, qu'il faut prouver, qu'étant
à Couvé, vous étiez pleinement
informés que cette ville-là
était hors des terres de
France. »
Franchement, nous ne nous attendions pas à
cette question. Cependant nous
répondîmes assez hardiment, et sans
hésiter, que nous le savions
parfaitement.
- « Comment pouviez-vous le savoir ?
nous dit-il. Vous êtes de jeunes
garçons, qui n'aviez jamais sorti du coin de
vos foyers ; et Couvé est à plus
de deux cents lieues de chez vous. »
Pour moi, je ne savais que répondre ;
car de dire que nous l'avions appris étant
sur la frontière, cela n'était pas
prouver : mais mon camarade
s'avisa de dire que, pour lui il
le savait, même avant de partir de
Bergerac ; parce qu'ayant servi en
qualité de barbier dans une compagnie du
régiment de Picardie, qui s'était
trouvé lors de la paix de Ryswyk en garnison
à Rocroy, il avait été
témoin des limites, qui furent
réglées dans ce pays-là ;
que de là son régiment avait
été transféré à
Strasbourg, où il avait été
réformé ; et que, s'il avait
voulu sortir de France, soit pour aller en
Hollande, soit pour se retirer en Allemagne, il lui
aurait été très facile de le
faire, étant dans le service.
- « Si vous avez, lui dit le
Président, été
réformé du service, vous devez en
avoir un bon congé.
- Aussi l'ai-je, dit-il, Monseigneur, et en bonne
forme. »
Sur quoi il sortit son portefeuille de sa poche, et
en tira effectivement ledit congé
imprimé et en bonne et due forme, et le
présenta au Président, qui le livra
de main en main à l'assemblée ;
après quoi le greffier l'attacha à la
requête, et on nous fit retirer, et
reconduire au Beffroi.
Pour l'intelligence de ce fait il est bon de dire,
qu'à la vérité Daniel le Gras,
mon camarade, avait été frater
dans le régiment de
Picardie ; et
qu'après la paix de Ryswyk il avait
été réformé à
Strasbourg ; mais il n'avait jamais
été à Rocroy, ni dans les
environs ; il supposa ce fait pour notre
défense laissant au Parlement à faire
rechercher s'il était vrai que ce
régiment eût été
à Rocroy à la paix de Ryswyk ou
non ; ce que ces messieurs n'approfondirent
pas, car il est vrai de dire que le Conseiller,
notre protecteur, avait brigué plusieurs
voix au Parlement en notre faveur, et qu'en un mot
ce corps était, ou tout entier, ou pour la
majeure partie, incliné à notre
élargissement.
Deux heures après que nous fûmes de
retour dans la prison, le geôlier, tout
essoufflé, courut à notre cachot,
pour nous féliciter de notre
délivrance prochaine. Un clerc du Parlement
était venu la lui annoncer, ayant vu de ses
propres yeux la résolution de
l'assemblée, qui nous avait en plein absous
de l'accusation d'avoir voulu sortir du royaume.
Nos bons amis de la ville nous vinrent
aussitôt féliciter en foule, et nous
crûmes la chose si réelle, que nous
attendions d'heure en heure notre
élargissement. Cependant il n'en fut rien,
quoiqu'il fût très
vrai que le Parlement nous avait
absous. Mais, comme nous étions des
criminels d'État, le Parlement ne pouvait
nous élargir qu'en conséquence des
ordres de la cour.
Le Procureur général en
écrivit donc au marquis de la
Vrillière, ministre d'État, lui
disant que nous avions fait preuve parfaite de
notre innocence à sortir du royaume, et que
le Parlement attendait ses ordres pour la
destination des prisonniers. Le ministre
répondit qu'ils prissent garde que cette
preuve ne fût pas équivoque et de la
bien examiner.
Le Parlement, qui ne voulait pas se
démentir, récrivit que la preuve
était complète et sans
réplique. Il se passa bien quinze jours
avant que les ordres définitifs de la cour
vinssent. Ils vinrent enfin pour nous ôter la
flatteuse espérance de notre prochaine
délivrance, et pour ne nous laisser plus
douter de notre sort, car le Parlement nous ayant
fait comparaître devant leur pleine
assemblée à la chambré
criminelle, le Président nous demanda si
nous savions lire, et après avoir dit que
oui : « Lisez donc, »
dit-il, après nous avoir donné la
propre lettre du marquis de la Vrillière.
Sa brièveté m'en a
toujours fait retenir les propres termes, que
voici :
« Messieurs,
« Jean Marteilhe, Daniel le Gras,
s'étant trouvés sur les
frontières sans passeport, Sa Majesté
prétend qu'ils seront condamnés aux
galères. Je suis, Messieurs, etc.
Le marquis de la Vrillière. »
« Voilà, mes amis, nous dirent le
Président et divers Conseillers, votre
sentence émanée de la cour et non de
nous, qui nous en lavons les mains. Nous vous
plaignons et vous souhaitons la grâce de Dieu
et du Roi. »
Après quoi, on nous ramena au Beffroi, et
sur le soir du même jour, un Conseiller et le
greffier du Parlement vinrent à cette
prison, et nous ayant fait venir dans la chambre du
geôlier, le Conseiller nous dit de nous
mettre à genoux devant Dieu et la justice,
et de prêter attention à la lecture de
notre sentence. Nous obéîmes, et le
greffier nous lut notre sentence, portant en
substance, après le préambule, ce qui
suit :
« Avons lesdits, Jean Marteilhe et Daniel
le Gras, dûment atteints et convaincus de
faire profession de la religion
prétendue réformée et de
s'être mis en état de sortir du
royaume, pour professer librement ladite
religion ; pour réparation de quoi, les
condamnons à servir de forçats sur
les galères du Roi, à
perpétuité, etc. »
La lecture de cette sentence finie, je dis au
Conseiller :
- « Comment, Monsieur, le Parlement, un
corps si vénérable et si judicieux,
peut-il accorder la conclusion de cette sentence
(atteints et convaincus) avec la
délibération de nous absoudre, comme
il l'avait effectivement fait ?
- Le Parlement, nous dit-il, vous a absous ;
mais la cour, qui est supérieure aux
Parlements, vous condamne.
- Mais où reste la justice, Monsieur, qui
doit diriger et l'un et l'autre tribunal ?
- N'allez pas si avant, me
répondit-il ; il ne vous appartient pas
d'approfondir ces choses. »
II fallut donc se taire et prendre notre mal en
patience. Cependant je suppliai ledit Conseiller de
nous faire donner copie authentique de notre
sentence, ce qu'il nous promit et effectua.
Trois jours après, quatre archers du
grand prévôt nous
vinrent prendre, et, après nous avoir
liés et mis les menottes aux mains, nous
conduisirent à Lille en Flandre, où
la chaîne des galériens
s'assemblait.
Nous arrivâmes le soir à cette
dernière ville, n'en pouvant plus de
fatigue, d'avoir fait ces cinq lieues à
pied, et très incommodés de nos
liens. On nous mena à la prison de la ville,
où est la tour de Saint-Pierre,
destinée pour les galériens à
cause de l'épaisseur de ses murs.
En entrant dans la prison, le geôlier nous
fouilla partout ; et comme il se trouva
là, soit par hasard, ou de dessein
prémédité, deux pères
jésuites, ils nous prirent nos livres de
dévotion et notre sentence, sans nous avoir
jamais voulu rendre ni l'un ni l'autre ; et
j'entendis que l'un de ces pères disait
à l'autre, après avoir lu ladite
sentence, que c'était une grande imprudence
au Parlement de donner copie authentique de
pareilles pièces.
Après cette Visitation, on nous conduisit au
cachot des galériens dans la tour de
Saint-Pierre, l'une des plus affreuses demeures que
j'aie jamais vues. C'est un spacieux cachot ;
mais si obscur, quoiqu'il soit
au second étage de cette
tour, que les malheureux qui y sont, ne savent
jamais s'il est jour ou nuit, que par le pain et
l'eau qu'on leur porte tous les matins ; et
qui pis est, on n'y souffre jamais de feu ni de
lumière, soit lampes ou chandelles.
On y est couché sur un peu de paille toute
brisée et rongée des rats et des
souris qui y sont en grand nombre et qui mangeaient
impunément notre pain, parce que nous ne les
pouvions voir ni nuit ni jour pour les chasser.
En arrivant dans ce cruel cachot, où il y
avait une trentaine de scélérats de
toute espèce, condamnés pour divers
crimes, nous ne pûmes savoir leur nombre
qu'en le leur demandant, car nous ne nous voyions
pas l'un l'autre. Leur premier compliment fut de
nous demander la bienvenue sous peine de danser sur
la couverture. Nous aimâmes mieux donner deux
écus de cinq livres pièce, à
quoi ces scélérats nous
taxèrent sans miséricorde, que
d'éprouver cette danse.
Nous la vîmes exercer deux jours après
à un misérable nouveau venu, qui la
souffrit plutôt par disette d'argent que par
courage. Ces malheureux avaient une
vieille couverture de
serpillière (1),
sur laquelle ils faisaient
étendre le patient ; et quatre
forçats des plus robustes prenaient chacun
un coin de la couverture, l'élevant aussi
haut qu'ils pouvaient, et la laissaient tomber
ensuite sur les pierres, qui faisaient le plancher
du cachot ; et cela par autant de reprises,
que ce pauvre malheureux était
condamné, suivant son obstination à
refuser l'argent à quoi on le taxait. Cette
estrapade me fit frémir. Ce malheureux avait
beau crier ; il n'y avait aucune compassion
pour lui. Le geôlier même, à qui
va tout l'argent que cet exécrable jeu
produit, n'en faisait que rire. Il regardait par le
guichet de la porte, et leur criait : Courage,
compagnons. Ce misérable était tout
moulu de ses chutes, et on crut qu'il en
mourrait : Cependant il se remit. Quelques
jours après, j'eus à mon tour une
terrible épreuve à essuyer ; en
voici le détail.
Tous les soirs le geôlier et quatre grands
coquins de guichetiers, accompagnés du corps
de garde de la prison, venaient faire la
visite du cachot, pourvoir si
nous ne faisions pas quelques tentatives pour nous
évader. Tous ces gens-là, au nombre
d'une vingtaine, étaient armés de
pistolets, d'épées et de
baïonnettes au bout du fusil. Ils visitaient
ainsi les quatre murailles et le plancher fort
exactement, pour voir si nous n'y faisions pas
quelque trou.
Un soir, après qu'ils eurent fait la visite,
et comme ils se retiraient, un des guichetiers
resta le dernier pour fermer la porte et le
guichet. Je m'amusai à lui dire quelques
paroles ; et comme je vis qu'il me
répondait assez aimablement, je crus l'avoir
un peu apprivoisé. Je m'avisai donc de le
prier de me donner le bout de chandelle qu'il
tenait à la main, pour voir à
chercher un peu notre vermine, mais il n'en voulut
rien faire, et me ferma le guichet au nez. Alors je
dis assez haut, ne croyant pas cependant le
guichetier assez proche pour m'entendre, que je me
repentais de ne lui avoir pas arraché des
mains son bout de chandelle ; car je l'avais
eu belle pour cela, lorsque je lui parlais au
guichet. Mon drôle m'entendit, et ne manqua
pas d'en faire son rapport au geôlier.
Le lendemain matin, que tous mes
camarades de cachot étaient levés, et
chantaient les litanies à leur ordinaire,
sans quoi ils n'auraient eu aucune charité
des jésuites, qui la donnaient tous les
jeudis, et il n'y avait que moi, qui étais
demeuré couché sur mon peu de paille,
et je m'étais endormi ; lorsque je fus
éveillé par plusieurs coups de plat
d'épée, qui portaient à plein
sur mon corps, n'ayant que ma chemise et ma
culotte.
Je me lève en sursaut, et je vois le
geôlier, l'épée à la
main, les quatre guichetiers, et tous les soldats
du corps de garde, tous armés jusqu'aux
dents. Je demandai pourquoi on me maltraitait
ainsi. Le geôlier ne me répondit que
par plus de vingt coups de plat
d'épée ; et le guichetier au
bout de chandelle, me donna un si terrible
soufflet, qu'il me renversa.
M'étant relevé, le geôlier me
dit de le suivre ; et voyant que
c'était pour me faire encore plus de mal, je
refusai de lui obéir, avant que je susse par
quel ordre il me traitait ainsi ; que si je le
méritais, ce n'était qu'au
grand-prévôt à ordonner de mon
châtiment. On me donna encore tant de coups
que je tombai une seconde fois.
Alors les quatre guichetiers me prirent, deux aux
jambes et deux aux bras, et m'emportèrent
ainsi, à mon corps défendant, hors du
cachot, et me descendirent ou plutôt me
traînèrent comme un chien mort du haut
des degrés de cette tour en bas dans la
cour, où étant, on ouvrit la porte
d'un autre escalier de pierre, qui conduisait dans
un souterrain. On me fit aussi dégringoler
ces degrés sans les compter ; quoique
je crois qu'il y en avait pour le moins vingt-cinq
ou trente, et au bas on ouvrit un cachot à
porte de fer, qu'on nomme le cachot de la
sorcière. On m'y poussa, et on ferma la
porte sur moi, et puis ils s'en
allèrent.
Je ne voyais non plus dans cet affreux souterrain
qu'en fermant les yeux. J'y voulus faire quelques
pas pour trouver quelque peu de paille en
tâtonnant, mais je m'enfonçai dans
l'eau jusqu'à demi-jambe, eau aussi froide
que la glace. Je retournai en arrière, et me
plaçai contre la porte, dont le terrain
était plus haut et moins humide. En
tâtonnant j'y trouvai un peu de paille, sur
laquelle je m'assis ; mais je n'y fus pas deux
minutes, que je sentis l'eau qui
traversait la paille. Pour lors je crus fermement
qu'on m'avait enterré avant ma mort, et que
cet affreux cachot serait mon tombeau, si j'y
restais vingt-quatre heures. Une demi-heure
après, le guichetier me porta du pain et de
l'eau, qu'il mit par le guichet dans le cachot. Je
lui rejetais sa cruche et son pain, en lui
disant : « Va dire à ton
bourreau de maître, que je ne boirai ni ne
mangerai que je n'aie parlé au
grand-prévôt. »
Le guichetier s'en alla, et dans moins d'une heure
le geôlier vint seul avec une chandelle
à la main, sans autres armes qu'un trousseau
de clefs ; et ouvrant la porte du cachot, il
me dit fort doucement de le suivre en haut.
J'obéis. Il me mena dans sa cuisine.
J'étais sale, plein du sang qui m'avait
coulé par le nez, et d'une contusion
à la tête que ces barbares guichetiers
m'avaient faite, en me laissant tomber et
traîner la tête sur les escaliers de
pierre.
Le geôlier me fit laver mon sang, me mit un
emplâtre sur ma contusion, et ensuite me
donna un verre de vin de Canarie, qui me refit un
peu. Il me fit une petite réprimande de mon
imprudence touchant la chandelle
du guichetier ; et m'ayant fait
déjeuner avec lui, il me mena dans un cachot
de sa cour, sec et clair, me disant qu'il ne
pouvait plus me remettre avec les autres
galériens après ce qui s'était
passé. « Donnez-moi donc mon
camarade avec moi, lui dis-je. - Patience, dit-il,
tout viendra avec le temps. »
Je restai quatre ou cinq jours dans ce cachot,
pendant lesquels le geôlier m'envoyait tous
les jours à dîner de sa table. Il me
proposa un jour de nous mettre, mon camarade et
moi, dans une chambre de sa prison où il y
aurait un bon lit et toutes les commodités
requises, moyennant deux louis d'or par mois. Nous
n'étions pas fort pourvus d'argent.
Cependant je lui offris un louis et demi jusqu'au
temps que la chaîne partirait. Il n'en voulut
rien faire, dont il se repentit ; car peu de
jours après nous fûmes mis dans une
belle et bonne chambre, bien couchés et bien
nourris, sans qu'il nous en coulât rien,
comme je le dirai tout à l'heure.
Un jour, il me dit que mon camarade l'avait fort
prié de me remettre avec lui, et qu'il lui
avait promis de le faire.
« Hé bien, lui dis-je,
descendez-le ici avec moi.
- Non, dit-il, il faut que vous retourniez avec les
autres galériens dans la tour de
Saint-Pierre. »
Je vis bien qu'il nous voulait mettre dans la
nécessité de lui donner les deux
louis d'or par mois pour nous mettre en
chambre ; mais consultant notre bourse, et
considérant que, si la chaîne ne
parlait que dans deux ou trois mois, nous ne
pourrions y subvenir, je me tins ferme à
l'offre que je lui avais faite ; si bien qu'il
me remit dans la tour de Saint-Pierre avec les
autres.
Mon camarade, qui me croyait perdu, fut ravi de me
sentir auprès de lui. Je dis sentir,
car pour nous voir, nous n'avions aucune
clarté pour cela.
Un matin, sur les neuf heures, le geôlier
vint ouvrir notre cachot, et nous appelant mon
camarade et moi, nous dit de le suivre. Nous
crûmes d'abord, qu'il nous allait mettre en
chambre pour notre louis et demi ; mais nous
fûmes désabusés ; car nous
ayant sortis du cachot, il nous dit :
« C'est M. de Lambertie,
grand-prévôt de Flandre, et qui est le
maître ici, qui veut vous parler.
J'espère, dit-il, en s'adressant à
moi, que vous ne lui direz rien de ce qui s'est
passé dernièrement.
- Non, lui dis-je, lorsque j'ai
pardonné, j'oublie, et ne cherche plus
à me venger. »
En disant cela, nous arrivâmes dans une
chambre, où nous trouvâmes M. de
Lambertie, qui nous fit l'accueil le plus gracieux
du monde. Il tenait une lettre de M. son
frère, bon gentilhomme d'origine
protestante, à trois lieues de Bergerac. Mon
père nous, avait procuré cette
recommandation.
M. de Lambertie nous dit donc qu'il était
bien fâché de ne nous pouvoir procurer
notre délivrance. « Pour tout
autre crime, nous dit-il, j'ai assez de pouvoir et
d'amis en cour pour obtenir votre
grâce : mais personne n'ose s'employer
pour qui que ce soit de la religion
réformée. Tout ce que je puis faire,
c'est de vous faire soulager dans cette prison, et
de vous y retenir autant que je voudrai, quoique la
chaîne parte pour les
galères. »
Ensuite il demanda au geôlier quelle chambre
bonne et commode il avait de vide. Le geôlier
lui en proposa deux ou trois qu'il rejeta, et lui
dit : « Je ne prétends pas
seulement que ces messieurs aient toutes leurs
commodités ; mais je veux aussi qu'ils
aient de la récréation, et je
prétends que tu les
mettes dans la chambre à
l'aumône.
« Mais, Monsieur, repartit le
geôlier, il n'y a que des prisonniers civils
dans cette chambre-là, qui ont des
libertés qu'on n'ose donner à des
gens condamnés.
- Eh bien ! répondit M. de Lambertie,
je prétends que tu les leur donnes ces
libertés ; c'est à toi et
à tes guichetiers à prendre garde
qu'ils ne se sauvent de la prison, donne-leur un
bon lit, et tout ce qu'ils souhaiteront pour leur
soulagement, et cela pour mon compte, ne
prétendant pas que tu prennes un sol
d'eux.
Allez, Messieurs, nous dit-il, dans cette chambre
à l'aumône ; c'est la plus belle,
la mieux aérée, et la plus
réjouissante de toute cette prison ; et
outre que vous y ferez bonne chère sans
qu'il vous en coûte rien, vous y amasserez de
l'argent.
Je prétends, dit-il encore au geôlier,
que tu fasses M. Marteilhe prévôt de
cette chambre. »
Nous remerciâmes de notre mieux M. de
Lambertie de sa grande bonté. Il nous dit
qu'il viendrait souvent s'informer à la
prison, si le geôlier observait ses ordres
à notre égard, et se retira. On nous
mit donc dans la chambre à
l'aumône,
p 116
et on m'en installa prévôt, au grand
regret de celui qui l'était avant moi, et
que l'on plaça ailleurs.
Cette chambre à l'aumône était
fort grande, et contenait six lits pour douze
prisonniers civils, qui étaient toujours des
gens de quelque considération, et hors du
commun ; et outre cela un ou deux jeunes
drôles, ordinairement coupeurs de bourse, ou
prisonniers pour des crimes légers, qui
servaient à faire les lits, la cuisine, et
tenir la chambre nette. Ils couchaient à un
coin de la chambre sur une paillasse ;
c'étaient en un mot nos valets de
chambre.
La prévôté, dont j'avais eu
l'honneur d'être gratifié,
était un emploi assez onéreux. Celui
qui est revêtu de ce titre dans la chambre
à l'aumône, est obligé de
distribuer toutes les charités qui se font
à cette prison. Elles sont ordinairement
considérables, et se portent toutes dans
cette chambre. Il y a un tronc, qui pend avec une
chaîne d'une des fenêtres, pour les
passants qui veulent y mettre leurs
charités. Le prévôt de la
chambre, qui a la clef de ce tronc, l'ouvre tous
les soirs pour en retirer l'argent, et le
distribuer à tous les prisonniers, tant
civils (s'ils en veulent) que criminels.
Outre cela, tous les matins les guichetiers vont
avec des charrettes ou tombereaux par toute la
ville recueillir les charités des
boulangers, bouchers, brasseurs et poissonniers,
chacun donnant de leurs denrées. Ils vont
aussi au marché aux herbes, à celui
des tourbes et autres ; et toute cette
collecte se porte à la chambre à
l'aumône pour être partagée et
distribuée dans toutes les chambres par le
prévôt, à proportion que chaque
chambre a de prisonniers, dont le geôlier lui
donne une liste chaque jour, et dont le total
allait, lorsque j'y entrai, à cinq ou six
cents.
Quoique je fusse devenu le distributeur
général de ces aumônes, je ne
pus cependant remédier à un abus qui
m'empêchait de faire parvenir rien aux
prisonniers destinés pour les
galères. Le geôlier recevait leur part
de l'argent du tronc pour l'employer, disait-il,
à leur faire de la soupe ; mais bon
Dieu ! quelle soupe ! C'étaient
ordinairement de sales et vilaines tripes de boeuf,
qu'il leur cuisait avec un peu de sel, dont l'odeur
seule faisait vomir.
Six semaines après avoir habité cette
heureuse chambre, M. de Lambertie nous y vint voir,
et nous dit que la chaîne
devait partir le lendemain pour Dunkerque,
où étaient six galères du
Roi ; qu'il nous exempterait de partir, en
nous faisant passer pour malades ; qu'il
fallait que nous restassions ce jour-là au
lit jusqu'à ce que la chaîne fût
partie : ce que nous fîmes. Et cela nous
procura de rester dans ce bien-être encore
trois mois. Après quoi une autre
chaîne partit, avec laquelle nous
partîmes aussi par l'occasion que je vais
dire.
Au mois de janvier mil sept cent deux, M. de
Lambertie nous vint voir, et nous dit que la
chaîne partirait le lendemain ; qu'il
pourrait encore nous exempter de la suivre, mais
qu'il avait à nous avertir (afin que nous
eussions le choix de partir ou de rester) que ce
serait la dernière chaîne qui irait
sur les galères de Dunkerque ; que par
la suite toutes les autres iraient à
Marseille, voyage de plus de trois cents lieues,
qui serait d'autant plus rude et pénible
pour nous, que nous serions obligés de le
faire à pied et la chaîne au
cou ; que d'ailleurs il faudrait qu'il
allât en campagne au mois de mars, et qu'il
ne serait plus à portée de nous
rendre service à Lille.
Qu'il nous conseillait donc de partir par la
chaîne, qui commençait le lendemain sa
route pour Dunkerque ; que cette chaîne
était sous ses ordres jusqu'à cette
ville, et qu'il nous y ferait conduire avec
distinction des autres galériens, en chariot
et commodément pendant la route, qui
n'était que d'environ douze lieues.
Ces raisons plausibles de M. de Lambertie nous
firent accepter ce dernier parti. Ce Seigneur nous
tint parole ; car au lieu de nous faire
attacher avec vingt-cinq ou trente
galériens, dont la chaîne était
composée, et qui marchaient à pied,
il nous fit mettre en chariot ; et tous les
soirs on nous faisait coucher dans un bon lit, et
l'exempt des archers qui conduisait la
chaîne, nous faisait manger à sa
table ; si bien qu'à Ypres, Fumes et
autres lieux où nous passions, on croyait
que nous étions des gens de grande
considération. Mais hélas ! ce
bien-être n'était qu'une fumée
qui disparut bientôt ; car le
troisième jour de notre départ de
Lille nous arrivâmes à Dunkerque,
où on nous mit tous sur la galère
l'Heureuse, commandée par le
Commandeur de la Pailleterie, qui
était chef d'escadre des
six galères qui étaient dans ce
port.
On nous mit d'abord chacun dans un banc à
part : par là je fus
séparé de mon cher camarade.
Le jour même de notre arrivée, on
donna la bastonnade à un malheureux
forçat pour je ne sais quoi qu'il avait
commis. Je fus effrayé de voir exercer ce
supplice, qui se fit sans aucune forme de
procès, et sur-le-champ.
Le lendemain, je fus sur le point de recevoir le
même traitement, qui m'avait fait tant
d'horreur la veille, et cela par la
méchanceté d'un grand coquin de
forçat, qui était aux galères
pour vol. Ce misérable vint dans le banc,
où j'étais enchaîné avec
six autres, et en m'injuriant de toute
manière, me demanda de quoi boire à
ma bienvenue. Je n'avais par bonheur rien
répondu à toutes les injures qu'il
m'avait dites, mais à sa demande, je lui
répondis que je ne donnais de bienvenue
qu'à ceux qui ne me la demandaient pas. En
effet, j'avais payé cinq ou six bouteilles
de vin à ceux de mon banc, qui ne me
l'avaient pas demandé.
Ce malheureux, qui se nommait Poulet, s'en fut
dire au sous-comite
(2) de la
galère, que j'avais prononcé des
blasphèmes exécrables contre la
Vierge et tous les saints du paradis. Ce
sous-comite, qui était un barbare brutal,
comme sont tous ceux de sa sorte, ajouta foi au
rapport de Poulet, et s'en vint à mon banc
me dire de commencer à me dépouiller
pour recevoir la bastonnade. On peut juger de mon
émotion. Je ne savais pas que Poulet lui
eût parlé. D'ailleurs je n'avais rien
dit ni fait, qui me pût attirer ce
châtiment. Je demandai à mes
compagnons de banc pourquoi on me voulait ainsi
traiter et si c'était la coutume de faire
passer les nouveaux venus par cette épreuve.
Eux, aussi surpris que moi, me dirent qu'ils n'y
comprenaient rien. Cependant le sous-comite s'en
alla sur le quai pour faire son rapport au Major
des galères, qui y était, et en la
présence duquel cette exécution de la
bastonnade se fait toujours.
Comme donc ce sous-comite était sur la
planche de la galère qui aboutit au quai, il
y rencontra le premier comite, à qui il dit
qu'il allait parler au Major
pour faire donner la bastonnade à un nouveau
venu, qui était huguenot, et qui avait vomi
des blasphèmes horribles contre
l'Église catholique, la sainte Vierge et
tous les saints. Le comite lui demanda s'il l'avait
entendu. Il dit que non, mais que c'était
sur le rapport de Poulet. « Bon
témoignage ! »
répondit le comite.
Ce premier comite était passablement
honnête homme, et fort grave pour un homme de
sa profession. Il s'approcha de mon banc, et me
demanda quelle raison j'avais eue de
blasphémer ainsi contre la religion
catholique. Je lui répondis que je ne
l'avais jamais fait et que ma religion même
le défendait. Là-dessus il fit
appeler Poulet, auquel il demanda ce que j'avais
fait et dit. Ce maraud eut l'impudence de
répéter la même chose qu'il
avait dite au sous-comite, qui était
présent et que le premier comite avait fait
rentrer avec lui. Celui-ci, ne voulant pas s'en
rapporter à la déposition de Poulet,
interrogea les six galériens de mon
banc ; ensuite ceux du banc au-dessus, et
celui au-dessous. Ces dix-huit ou vingt personnes
lui déposèrent toutes la même
chose, que je n'avais proféré
aucune parole, ni en bien ni en
mal, lorsque Poulet me disait les plus grosses
injures ; et que tout ce que j'avais dit,
était que je ne donnais pas la bienvenue
à ceux qui me la demandaient.
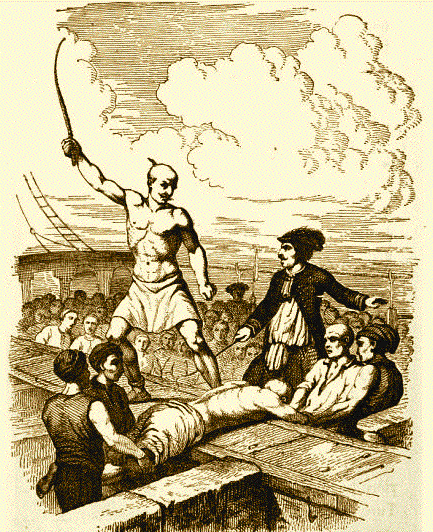
La bastonnade.
|