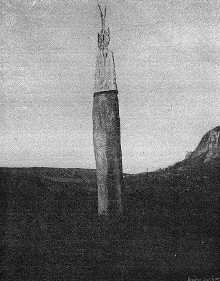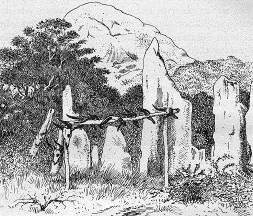RAFARAVAVY
MARIE
(1808-1848)
Une
Martyre Malgache sous Ranavalona
1re,
CHAPITRE
PREMIER
Vie
païenne
En 1809 ou 1810 mourait,
à Tananarive, Andriananipoïnimerina, le
prince qu'on a pu appeler à juste titre le
fondateur du véritable royaume hova. Bien
des princes s'étaient succédé
avant lui, mais c'étaient plutôt des
roitelets locaux dont l'autorité se limitait
à d'étroites régions. Son
arrière-grand-père,
Andriamasinavalona, avait bien réuni sous
son sceptre une assez grande partie de l'Imerina.
Mais lui-même avait partagé son
royaume entre ses quatre fils, et ce ne fut
qu'Andrianampoinimerina qui put, cent ans
après son aïeul, rassembler de nouveau
en un seul bloc les petites principautés
créées avant lui, et dont les
rivalités continuelles empêchaient le
développement réel de la puissance
hova.
Andrianampoinimerina
fut, dans son genre, un véritable homme
d'État. Il développa l'agriculture,
le commerce intérieur de Madagascar, il
conquit, par les armes ou par d'habiles alliances,
une bonne partie de la grande île. Mais il
n'eut pas la bonne fortune d'entrer en contact avec
la civilisation européenne.
Sous
son règne,
l'écriture demeura à peu près
inconnue en lmerina. Un tout petit nombre de
sorciers antaimoro (1),
connaissant les
caractères arabes, arrivèrent
à sa cour vers 1800 et furent
employés comme des sortes de
rédacteurs des archives royales. Mais ils ne
répandirent pas leur art,
considéré comme sacré.
Deux ou
trois
fonctionnaires hova parvinrent seuls à
s'assimiler cette science si nouvelle et
d'apparence si mystérieuse. Inutile
d'ajouter que le paganisme continua à
courber la population sous son joug
avilissant.
C'est
pourtant vers
la fin de ce règne célèbre que
naquirent ceux et celles qui devaient, 25 ou 30 ans
plus tard, donner leur vie en témoignage de
leur attachement à l'Évangile, en
particulier Rafaravavy Marie dont nous allons
brièvement raconter
l'histoire.
Un certain
jour de
l'année 1808, dans la grande case de bois au
toit pointu s'élançant vers le ciel,
où demeurait un important serviteur de la
Cour, Andrianjaza, homme influent de la tribu des
Mandiovats, on vit arriver en hâte une femme
guidée par un des esclaves d'Andrianjaza et
qu'on paraissait attendre avec la plus grande
impatience.
Quand elle
entra dans
la pièce centrale, cette dernière
était occupée par toute une
assemblée : on avait en effet
appelé en hâte les parents habitant
dans les environs, et tous ceux qu'une
impérieuse nécessité n'avait
pas retenus chez eux s'étaient
empressés d'accourir à
l'invitation.
Depuis
neuf mois la
femme d'Andrianjaza avait obéi
ponctuellement à toutes les prescriptions
que l'antique sagesse malgache ordonne aux futures
mères de respecter. Jour après jour,
sa vie avait été minutieusement
réglée. Elle s'était
levée de bonne heure, avait redoublé
d'activité dans la maison, pour qu'à
l'heure de la délivrance
son organisme eût la vigueur requise. Elle
s'était d'ailleurs abstenue de certaines
besognes qui, d'après les idées
ancestrales, auraient nui à l'enfant
attendu, pêche, balayage, ou lavage dans
l'eau courante.
Sa
nourriture,
surtout pendant les derniers mois, avait
été l'objet d'une attention
suivie : tant d'aliments étaient
interdits par la coutume aux personnes dans sa
position qu'elle n'avait pour ainsi dire rien pris
en dehors du riz, cuit à l'eau et sans
sel.
Elle avait
passé par bien des moments d'angoisse,
croyant toujours avoir contrevenu à
quelqu'une de ces interdictions dont la vie
païenne est comme enveloppée, mais dont
le caractère d'urgence se renforce
singulièrement pour celle qui attend de la
faveur des dieux une postérité
nouvelle.
D'ailleurs,
on
était très attaché aux rites
ancestraux dans la famille et la demeure
d'Andrianjaza. Et chaque journée avait vu,
durant la longue attente, se dérouler dans
la case familiale des sacrifices de sang de poulet
devant les grands bambous, à
l'intérieur desquels étaient
enfermées les amulettes sacrées
d'où dépendait le bonheur du logis et
de ses habitants. Plusieurs fois par mois, quelque
membre de la famille était allé
consulter le sorcier du voisinage et lui porter des
cadeaux de plus en plus abondants. Il fallait faire
montre de générosité quand on
attendait un enfant. Donner en rechignant, ou ne
pas porter assez de présents, aurait rendu
l'enfant attendu borgne ou boiteux. On était
même allé à une
demi-journée de distance
demander aide et assistance à l'esprit de
Manjai-bola et de Tsiafakarivony, dans la grotte
d'Isoavina, où cet esprit était
censé résider et rendre ses
oracles.
L'entrée
de la
dite caverne était peu visible,
cachée au milieu d'un éboulis de
roches, entassées d'assez pittoresque
façon. La grotte elle-même
n'était qu'une fente dans le roc ; sauf
en certains endroits, il était difficile de
monter deux de front. Le sol était couvert
de grosses pierres de toutes formes et de toutes
dimensions, qui rendaient la marche pénible,
d'autant plus que la déclivité et
l'humidité ajoutaient encore à la
difficulté du passage. Les consultants
devaient d'abord s'avancer sans lumière,
assez loin, jusqu'à un détour du
souterrain, puis s'écrier :
« Manjai-bola est-il là ?
Tsiafakarivony est-il là ? »,
et attendre la réponse. Cette
dernière obtenue, il fallait, avec deux
silex, obtenir l'inflammation d'un peu d'herbe,
puis d'un morceau de graisse de boeuf. Ainsi
éclairés, les suppliants
s'avançaient jusqu'à une petite
rigole, où ils s'accroupissaient durant des
heures, attendant le bon plaisir du dieu, qui
donnait son avis par la bouche d'un gardien, dont
la fantaisie s'accordait libre cours et se faisait
indulgente ou sévère, suivant la
valeur des cadeaux apportés.
La
sage-femme
entrée dans la maison d'Andrianjaza
(c'était elle qu'on avait appelée
d'urgence), avait inspecté les lieux, fait
découvrir tous les ustensiles, les paniers,
les caisses se trouvant dans la case,
demandé a tous les assistants de
déboutonner ou de desserrer
tous leurs vêtements,
s'était livrée à toutes sortes
de gestes et d'actes symboliques, comme, par
exemple, de faire jeter une petite navette de
tisserand par-dessus, le toit de la maison, enfin,
avait fait boire à la patiente toute une
mixture compliquée, formée de sept ou
huit plantes différentes, de crevettes, de
museau de boeuf, etc.
Au moment
voulu,
l'enfant était né, salué par
les cris de joie de la famille. Seulement, une
déception non équivoque se marqua sur
le visage du père. Il avait
espéré un fils et ce n'était
qu'une fille.
Il avait
heureusement
déjà d'autres enfants ; il eut
vite réprimé son premier mouvement
d'ennui.
La mère,
déjà, n'était plus jeune. Ses
nouvelles espérances l'avaient même un
peu surprise. Chacun pensait donc bien que cette
enfant n'aurait plus ni frère ni soeur plus
jeune. On ne lui donna pourtant pas tout de suite
son nom définitif de Rafaravavy (la
dernière fille).
Pour
détourner
toute mauvaise influence, pour ôter aux
esprits errants toute idée de venir
tourmenter la nouvelle-née, il fallait avoir
l'air de ne pas s'occuper d'elle, de la
considérer comme un objet
négligeable. Pendant des mois, elle ne fut
donc pour les siens que la petite lkala,
c'est-à-dire, au fond, la petite femelle,
qu'on ne paraissait même pas devoir
distinguer, par un nom spécial, de la poule
picorant autour de la case, ou de la génisse
encore non sevrée, dont on ne
s'inquiétait que pour la rentrer le soir
dans la fosse au bétail.
Toute
l'enfance de
Rafaravavy se passa comme celle
de la plupart de ses
compagnes.
Aucune éducation réelle ; on ne
s'inquiéta nullement de développer
son esprit. La seule chose dont on ne cessât
de se préoccuper fut de l'instruire du plus
grand nombre possible des interdictions religieuses
que chaque adorateur des idoles ancestrales doit
observer avec le plus grand soin.
On lui
apprit
à ne pas, se coucher sur le
côté en mangeant, pour ne pas
affaiblir ses propres parents ; à ne
pas chanter en se frappant les lèvres ou la
gorge avec les doigts, ce qui aurait sûrement
amené la disette la plus grave chez les
siens ; à ne pas, autant que possible,
jouer avec la terre, non par souci de
propreté, mais uniquement pour ne pas
produire de gerçures aux pieds ;
à ne pas écraser sous son pied des
grains de riz cuit pour ne pas attraper la
syphilis. Jour après jour, heure
après heure, Rafaravavy se heurta à
quelque prescription nouvelle, qui d'abord
l'étonnait, puis l'inquiétait,
suscitant chaque fois en elle une crainte plus
envahissante. Les jeux d'apparence les plus
innocents lui furent successivement
défendus, toujours pour des raisons
tirées de cet arsenal de rites et de
coutumes qui forme le fond de la vie
païenne.
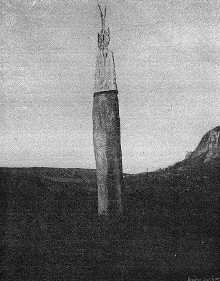 Une pierre sacrée dans la
campagne
Une pierre sacrée dans la
campagne
Son père l'emmenait de
temps à autre sur une montagne des environs,
montagne toute pelée, rocailleuse,
solitaire, au sommet de laquelle se dressait une
pierre, luisante de la graisse des sacrifices.
Là, Andrianjaza, après avoir
égorgé un poulet avec un morceau de
silex, en répandait le sang sur le monolithe
en invoquant les esprits des quatre vents et ceux
des douze collines
sacrées. Dans ces rites primitifs,
Rafaravavy saisissait quelque chose de
mystérieux que personne ne pouvait
réellement lui expliquer et qui ne faisait
qu'augmenter encore cette vague appréhension
dans laquelle elle vivait
continuellement. Dans ses jeux ou dans ses
occupations quotidiennes, elle passait sans cesse
du rire éclatant de l'insouciance à
la sourde angoisse de l'être qui se sent
traqué par des puissances
mauvaises.
Elle
gardait au coeur
l'espérance qu'à force de pratiques
accomplies elle arriverait à apaiser ces
esprits ancestraux si acharnés à
nuire ; toutefois, elle n'en était pas
bien sûre, et en devenait de moins en moins
assurée à mesure qu'elle grandissait.
Elle découvrait presque chaque jour tant et
tant d'actes dont il fallait s'abstenir, tant et
tant d'événements pouvant
entraîner avec eux les pires catastrophes,
qu'il lui arrivait de douter de la
possibilité de se protéger
efficacement. Dans son imprécise
détresse, elle ne trouvait, presque
inconsciemment, qu'un répit :
c'était de penser le moins possible et de se
laisser entraîner, sans chercher à
réagir, au gré des
circonstances.
Les seuls
rayons de
lumière dans son existence, c'était
les jours de liesse où sa famille,
mêlée à toutes celles de la
région, fêtait l'idole locale ou
manifestait son respect des morts en allant
assister à l'ouverture des tombeaux et
à la promenade des cadavres, au son des
tambours et des claquements de mains. Ces
cérémonies du retournement des morts
durent en général quarante-huit
heures et sont l'occasion de véritables
orgies. Les danses succédaient aux danses et
prenaient à la fin une allure
frénétique. Les libations devenaient
de plus, en plus abondantes, les mouvements se
faisaient de plus en plus désordonnés
et, presque chaque fois, tout se
terminait par des scènes
scandaleuses.
 Tombeaux dans la forêt avec
le pieu funéraire orné de
crânes de boeufs
Tombeaux dans la forêt avec
le pieu funéraire orné de
crânes de boeufs
Rafaravavy, enveloppée
de cette débauche dans laquelle on ne lui
avait appris à voir qu'une sorte de
manifestation de l'esprit invoqué par les
hommes, avait fini par en jouir. À quatorze
ans, il ne lui restait plus rien à
apprendre. Une jeune fille pure était
quelque chose d'à peu près inconnu
autour d'elle.
Cela
d'ailleurs ne
l'empêcha pas, quelques mois après,
d'être recherchée en mariage par un
homme de bonne famille, qui avait remarqué
son visage respirant la santé, ses longues
tresses noires et l'élégante
façon dont elle savait se draper dans son
grand lamba blanc.
Les
pourparlers de
mariage et les fiançailles ne prirent pas
beaucoup de temps. Les parents de Rafaravavy
avaient une certaine fortune. Le soupirant pouvait
aisément apporter aux parents de celle qu'il
désirait prendre pour femme le nombre de
boeufs suffisant. D'autre part, l'astrologue,
préalablement consulté, n'avait vu
aucune incompatibilité entre les destins des
deux jeunes gens. On pouvait donc conclure
l'union.
Rafaravavy
s'était laissé faire. Elle
désirait se marier, comme toutes ses
compagnes. Elle n'avait pas d'autre idéal.
Elle désirait d'ailleurs avoir des enfants.
Elle ne fit aucune difficulté d'accepter
l'époux qu'on lui présenta, et auquel
les graines sacrées du devin consulté
s'étaient manifestées favorables.
Quelques beaux cadeaux, bracelets, colliers,
étoffes, l'avaient, au reste,
disposée, ou tout au moins
résignée, à l'acceptation de
la demande faite par un jeune homme de sa caste,
que ses parents avaient agréé comme
gendre.
Elle vécut
tout d'abord de la vie qu'elle avait vu vivre
à ses parents. Elle eut ses fétiches
domestiques. Elle alla graisser les pierres
dressées, répandre du sang de poulet
sur les rochers sacrés, porter des restes de
volaille à certaines
sources ou au pied de certains arbres. Ce qu'elle
avait surtout vu dans le mariage, c'était la
perspective d'avoir des enfants ; chez la
femme malgache, la fibre maternelle est très
heureusement développée, et entourer
avec amour de ses bras et de ses soins une,
frêle créature, don
inappréciable de l'esprit divin, est pour
elle la suprême
félicité.
La
première
année du mariage se passa malheureusement
sans que l'événement
désiré répondît à
l'attente des époux, ni même se
fît pressentir. On avait pourtant eu soin,
avant de conclure l'union de Rafaravavy et de son
mari, de s'assurer que leurs destins s'accordaient.
Aucun mariage, d'ailleurs, ne se contractait
autrefois, et ne se contracte encore aujourd'hui
dans les familles restées païennes,
sans cette indispensable précaution. Le
destin de chacun est déterminé en
très grande partie par le jour de sa
naissance, et les mystères de l'astrologie
malgache ne permettaient pas certaines alliances,
qui auraient été rendues ou
stériles ou funestes par le heurt de deux
destins opposés. Un jeune homme né
sous le signe d'Alahamady, c'est-à-dire dans
les trois premiers jours d'un mois lunaire,
n'aurait jamais pu être autorisé
à convoler avec une jeune fille venue au
monde sous le signe d'Adimizana,
c'est-à-dire durant les quinzième,
seizième et dix-septième jours du
mois. Même incompatibilité entre les
quatrième ou cinquième jour et les
dix-huitième ou dix-neuvième, ou
encore entre les sixième ou septième,
et les vingtième ou vingt et unième,
etc.
Élevée
dans ces principes ancestraux immuables et dans la
vénération des devins, qui lui
semblaient les gardiens nécessaires de la
tradition sacrée, sur laquelle reposaient le
bonheur et l'existence même dit peuple,
Rafaravavy n'avait jamais consenti à
transgresser en quoi que ce soit les prescriptions
religieuses et sociales devant lesquelles tous les
siens s'inclinaient avec respect et terreur. Elle
se souvenait trop d'une scène qui
s'était passée chez un de ses proches
parents, assez riche propriétaire de la
région où elle était
née.
Une
esclave encore
jeune, et qui avait parfois joué avec
Rafaravavy, avait un jour mis au monde un enfant le
onzième jour d'un mois, jour placé
sous le destin d'Alahasati. Or le parent de
Rafaravavy, maître de l'esclave en question,
était lui-même né en Adalo,
c'est-à-dire au 25e jour du mois. Le jour de
l'accouchement de l'esclave, Rafaravavy
s'était trouvée en visite chez son
parent et avait été témoin de
l'émoi et de l'agitation qui avait
régné dans la maison. On avait vite
cherché dans les environs une autre esclave
ayant eu depuis peu un enfant et appartenant
à un maître né sous un autre
destin, et on lui avait confié l'enfant
nouveau-né, en lui faisant bien promettre de
ne jamais le laisser entrer dans la maison. La
mère eut beau gémir et supplier, il
avait absolument fallu qu'elle se
séparât de son enfant : on lui
avait fait observer que c'était
déjà une grande faveur pour elle
qu'on n'eût pas tué cet enfant et
qu'on se fût contenté de le faire
vivre ailleurs. Quelques jours après, les
parents de Rafaravavy s'étaient
entendus avec le maître de
la nourrice donnée au fils de l'esclave en
question, pour expédier loin du village,
dans un autre domaine, la dite nourrice et son
nourrisson.
Rafaravavy
s'était donc mariée sous les plus
heureux auspices, au moins astrologiquement
parlant, et pourtant, l'enfant désiré
ne semblait pas devoir venir.
Dès le
début de leur seconde année de vie
domestique, les deux époux se
décidèrent à avoir recours a
toutes les pratiques en usage, supposées
capables de favoriser la réalisation des
voeux d'une jeune femme.
Ils s'en
allèrent graisser la grande pierre plate qui
se dressait près de la place du
marché ; ils portèrent des
poulets à d'autres rochers, où
certains esprits étaient censés
résider et les arrosèrent du sang
encore chaud des bêtes sacrifiées, en
invoquant les hôtes mystérieux de ces
demeures de pierre. Ils visitèrent aussi
certaines pierres dont la configuration pouvait
suggérer l'idée de la
fécondité, et s'exercèrent
à lancer de loin dans leurs fentes les
graines de l'arbre sacré.
Toutefois
ces
pratiques, suivies par tous et par toutes, ne leur
suffirent pas. C'étaient, nous l'avons dit,
de fervents adorateurs des idoles et des dieux
ancestraux. Les voilà donc, un beau jour,
partis à la recherche d'un devin
célèbre qu'on leur avait dit habiter
non loin de la forêt de l'est, à une
grande journée de marche de leur village. En
demandant leur chemin aux uns et aux autres, ils
finirent par trouver celui qu'ils voulaient
consulter.
Il
habitait une
grande case en bois, très supérieure
comme construction à toutes celles de la
région. Les poutres de soutien du toit
étaient taillées dans un bois de fer
absolument inaltérable ; à
l'intérieur, les solives, les encadrements
de fenêtres étaient du plus beau
palissandre.
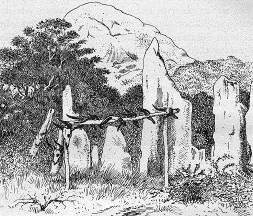 Pierres fétiches ou de
souvenir
Pierres fétiches ou de
souvenir
La pièce spacieuse
renfermait un assez joli assortiment d'escabeaux de
toutes dimensions et, dans le fond, un grand lit de
bois sculpté. Dans le coin nord
est, à la place d'honneur,
un grand tambour, lui aussi orné sur ses
flancs de figures géométriques en
relief, et, à côté, une grande
boîte rectangulaire d'un bois très
foncé, reluisant d'une couche souvent
renouvelée du mélange consacré
de miel et d'huile de ricin.
Le devin
exerçait dans toute la contrée une
très grande influence. Ses
sortilèges, d'après la
renommée qui avait débordé les
limites de sa tribu, protégeaient le pays
contre une foule de fléaux :
grêles, sauterelles, sécheresse, etc.
Il connaissait le secret des diverses maladies qui
pouvaient faire souffrir les hommes, et quelques
cadeaux judicieusement choisis, apportés
dans sa demeure selon les rites appropriés,
procuraient une guérison à peu
près certaine, à moins que le patient
ou ses amis n'eussent consciemment ou
inconsciemment transgressé quelques-uns des
innombrables fady
(2) dont est
faite la
vie du Malgache primitif.
Troublés
par
la célébrité du devin, les
deux époux ne purent s'empêcher de
trembler en arrivant devant sa case, et, avant de
demander la permission d'entrer, ils
s'arrêtèrent un assez long moment,
s'examinant l'un l'autre pour voir si rien dans
leur tenue, leur coiffure ou le port de leur lamba
ne s'était dérangé et ne
menaçait d'indisposer l'idole ou son
gardien.
Enfin,
leur
émotion surmontée, ils
frappèrent à la porte de la case en
demandant, par de nombreuses,
répétitions du terme consacré,
la permission d'entrer.
Après
quelques
moments d'attente, ou leur répondit de
l'intérieur qu'il leur était permis
de pénétrer dans la demeure du
fétiche et de son officiant.
 Idoles et fétiches
malgaches
Idoles et fétiches
malgaches
Ils entrèrent,
s'assirent modestement près du seuil,
et attendirent, enveloppés
jusqu'au-dessus du nez de leur lamba
blanc.
C'était
à l'interprète de l'idole à
parler le premier ; et sa dignité lui
interdisait toute précipitation. D'ailleurs,
qu'est-ce que le temps pour un
Malgache ?
Enfin
l'heure vint ou
le devin daigna faire attention à ses
nouveaux visiteurs. Il commença la
conversation en leur adressant de longues
salutations auxquelles il fut répondu aussi
longuement. L'entretien continua en se maintenant
longtemps dans le cercle des banalités,
ordinairement échangées entre gens
qui n'ont rien à se dire. Il en arriva enfin
à une question plus précise sur
l'objet de la visite. Après bien des
circonlocutions, le mari de Rafaravavy finit par
exposer son désir et celui de son
épouse.
Le devin,
en
réponse, s'enquit de ce que les visiteurs
avaient apporté pour se rendre le dieu
favorable. Rafaravavy et son mari avaient bien fait
les choses. Outre une assez grande quantité
de riz et de poulets, ils offraient quelques
piastres roulées dans un morceau
d'étoffe.
Les
présents
étant jugés suffisants, le devin se
mit en devoir de consulter, le sort, ce qui exigea
une grande heure. La réponse fournie par les
dessins que constituèrent les graines
sacrées sorties successivement de la main du
sorcier était en somme favorable. On pouvait
espérer que les esprits des ancêtres
accueilleraient avec, faveur la requête des
époux. Il ne restait qu'à aller
apporter en certains lieux désignés
d'autres sacrifices de graisse et de sang
de poulets et, naturellement,
à se garder de tous les gestes innombrables
interdits par la tradition.
Les époux
ne
manquèrent à aucune des prescriptions
du devin et, de fait, à quelques mois de
là, Rafaravavy put se réjouir de la
perspective de devenir bientôt mère,
à la grande joie de toute la famille.
|