Contes du
Dimanche
Récits
allégoriques
 Histoire de La Motte.
I
Histoire de La Motte.
I
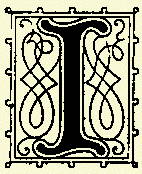 L y avait une fois, voilà bien
longtemps, un village appelé La Motte.
C'était une des localités les plus
curieuses qu'on ait jamais vues. Tous les habitants
de ce village, sans exception, portaient le
même nom, et c'était le nom de La
Motte. L'histoire raconte qu'ils étaient
tous les descendants d'un même ancêtre,
mais ce premier La Motte ne faisait guère
honneur à sa progéniture, car il
n'était venu s'établir dans ce coin
perdu qu'après avoir été
chassé pour cause d'indélicatesse
d'un très beau domaine dont il était
l'intendant. L y avait une fois, voilà bien
longtemps, un village appelé La Motte.
C'était une des localités les plus
curieuses qu'on ait jamais vues. Tous les habitants
de ce village, sans exception, portaient le
même nom, et c'était le nom de La
Motte. L'histoire raconte qu'ils étaient
tous les descendants d'un même ancêtre,
mais ce premier La Motte ne faisait guère
honneur à sa progéniture, car il
n'était venu s'établir dans ce coin
perdu qu'après avoir été
chassé pour cause d'indélicatesse
d'un très beau domaine dont il était
l'intendant.
Sa race s'était
multipliée, mais ne valait pas mieux que
lui, au contraire. Bien loin que l'harmonie et la
paix régnassent dans ce village
habité par une seule famille, il n'y avait
pas, à vingt lieues
à la ronde, de population plus querelleuse.
La vanité, la jalousie,
l'égoïsme enfin faisaient un enfer de
ce qui aurait pu être un paradis. Tous les La
Motte étaient loin de se reconnaître
pour frères ou même pour cousins. Les
esprits forts, parmi eux, déclaraient que la
commune origine des La Motte était une
légende ; d'autres allaient
jusqu'à prétendre que l'ancêtre
commun n'était pas un homme, mais quelque
animal assez semblable au singe. Le jeu
inévitable des intérêts et des
passions avait créé des
inégalités sociales : il y avait
des La Motte riches et des La Motte pauvres ;
il y en avait de lettrés et il y en avait
d'ignorants. Toutes ces classes étaient
profondément séparées.
Le seigneur du pays, dont le
château s'élevait sur un monticule au
milieu du village, se faisait appeler M. le marquis
de La Motte de Terre. Il faisait peser sa tyrannie
sur les paysans qui, cependant, étaient du
même sang que lui. Un autre La Motte, revenu
des guerres lointaines avec une jambe de moins,
prenait le nom de chevalier de La
Motte-Sanglante ; c'était un
fier-à-bras qui ne parlait que de couper les
oreilles aux pauvres La Motte qui ne le saluaient
pas assez obséquieusement. Au-dessous de
cette haute aristocratie se plaçaient
maître La Motte-Grippesou, tabellion, et
messire Esculape La Motte, médecin, qui,
avec mesdames leurs
épouses, constituaient la seule
société sortable de
l'endroit.
Quant aux La Motte roturiers et vilains,
ils se distinguaient les uns des autres par toutes
sortes de surnoms ; mais la plus nombreuse
tribu était celle des La
Motte-Foulée, laboureurs et artisans de
toute espèce. Cette société
inférieure se vengeait comme elle pouvait
des dédains de la pseudo-aristocratie qui
gouvernait le village ; elle se
réunissait, le samedi soir, chez La
Motte-Sèche, le cabaretier, et à voix
basse, quelquefois même à voix haute,
maugréait contre les grands La Motte, ou se
moquait d'eux.
« Après tout, disait
parfois La Motte-aux-Vers, le vieux fossoyeur, en
faisant retomber son hanap sur la table,
après tout, ce sont nos cousins, et au
cimetière nous serons tous
égaux ! »
La Motte-aux-Vers avait le vin triste.
II
Une étrange prophétie
s'était transmise de père en fils, et
mieux encore de mère en fille, parmi les
habitants du village. Cette prophétie
remontait, disait-on, jusqu'au premier
ancêtre, qu'elle avait consolé de sa
déchéance : un jour, une fille
de La Motte serait épousée par le Roi
en personne, et le prince qui
naîtrait de cette union ferait le bonheur de
tout le pays.
La plupart des habitants du lieu
faisaient des gorges chaudes de ces
prophéties. « Voyez-vous,
disaient-ils, notre sire le Roi, qui oncques ne
visita cette province, venir chercher ici une
épouse ? »
Mais quelques-uns y croyaient, sans trop
oser le dire ; et les femmes surtout, en leur
prime jeunesse, se prenaient à rêver
d'un prince, arrivant en grande pompe pour demander
leur main.... Plus tard, elles faisaient le
même rêve pour leurs filles. Mais le
temps passait, et l'oracle ne s'accomplissait
point.
Cependant, le marquis de La Motte de
Terre était toujours plus insolent, le
chevalier de La Motte-Sanglante toujours plus
orgueilleux, maître La Motte-Grippesou
toujours plus inexorable.... Et ce n'étaient
point les remèdes de ce pauvre Esculape La
Motte, ni le vin aigrelet de La Motte-Sèche,
qui pouvaient guérir les maux de toute cette
population querelleuse et opprimée. Il
semblait bien, en vérité, que la
seule philosophie qui valût quelque chose
fût celle du fossoyeur déjà
nommé, qui disait souvent, après
boire :
« Patience, mes bons amis, le
cimetière arrange
tout ! »
Je l'ai dit, La Motte-aux-Vers avait le
vin triste.
III
Et cependant, il arriva, le grand
événement prédit depuis tant
d'années !
Ce fut une chose merveilleuse et
charmante ; une idylle comme on n'en voit pas.
Monseigneur le Roi épousa, par mariage
authentique, avec ses principaux seigneurs pour
témoins, une humble fille du
village.
La chose ne se passa point en grande
pompe, comme l'avaient rêvé les
femmes, et, certes, celle qui fut choisie ne fut
pas celle qu'on aurait cru. Ni la famille du
marquis, ni celle du chevalier, ni celle du
tabellion ne furent honorées de la royale
alliance. La jeune fille appartenait à la
branche la plus pauvre des La Motte-Foulée.
Elle était orpheline, mais l'un de ses
ancêtres avait été un des plus
vaillants chevaliers du prince, et par ce
côté-là sa noblesse
était des plus authentiques.
Le mariage fut secret, le Roi l'ayant
voulu ainsi, pour des raisons de la plus haute
importance. Mais lorsque son Fils vint au monde, il
voulut que cette naissance fût dûment
constatée, afin que nul, plus tard, ne
pût contester la légitimité du
Prince. C'est pourquoi, une
nuit, on vit plusieurs grands seigneurs de la cour,
dans les campagnes avoisinant le village,
rassembler quelques pauvres bergers qui gardaient
leurs moutons à la clarté des
étoiles. « Allez, leur dirent-ils,
allez voir au village, dans la plus pauvre de vos
chaumières, ce qui vient d'arriver ! Le
fils du Roi vient de naître, et sa
mère est de votre
famille ! »
Epeurés à la vue de ces
magnifiques ambassadeurs (car, pour que la
constatation fût certaine, le Roi avait tenu
à ce qu'ils se montrassent en grand costume)
les bergers ne purent pas douter de leur dire, car
voici qu'en arrivant à la maison où
logeait l'orpheline qui était de leur race,
ils virent un petit enfant couché sur de la
paille, le logis étant trop pauvre et trop
exigu pour contenir un berceau !
Si les habitants de La Motte avaient eu
la moindre lueur de bon sens, dès que la
nouvelle de cette naissance extraordinaire se fut
répandue, ils seraient allés
ensemble, le haut et puissant marquis à leur
tête, rendre hommage au Prince
nouveau-né. Ce ne fut pas ce qui
arriva.
Le cruel seigneur, sans croire tout
à fait que la chose fût vraie, en fut
tout de même humilié dans son orgueil,
effrayé dans ses ambitions : à
tout hasard, il fit étrangler quelques
pauvres enfants, espérant que le
prétendu prince serait du nombre
de ses victimes. Le
chevalier de
La Motte-Sanglante se contenta de hausser les
épaules. Le tabellion resta le nez
plongé dans ses registres ;
c'était l'époque du terme, il fallait
faire rentrer l'argent des fermages, et ce souci
était bien plus absorbant pour lui que la
naissance d'un enfant, qu'il fût prince ou
roturier. Le médecin, penché sur ses
alambics, cherchait la pierre philosophale, et ne
prit pas même garde à ce qu'on lui
dit.
Hélas ! tous les La
Motte-Foulée, à peu d'exceptions
près, se montrèrent incrédules
au récit de cette naissance qui, cependant,
leur promettait le bonheur ! Rassemblés
chez le cabaretier, comme à l'ordinaire, ils
faisaient les sceptiques, et riaient de la
naïveté de ces pauvres bergers, qui
avaient fait un beau rêve et avaient cru que
c'était arrivé. Et toujours, dans ces
conversations, le dernier mot restait à La
Motte-aux-Vers :
« Ce qui finira notre
misère, mes amis, disait-il entre deux
hoquets, ce n'est pas un berceau, c'est une
tombe ! »
IV
Cependant, l'enfant protégé
secrètement par le Roi son père,
resta près de sa mère, dans la
pauvreté, et grandit sans que personne
soupçonnât sa grandeur. Il se
mêlait aux enfants du village, à ceux
du moins dont l'extraction était pareille
à la sienne, à tous les petits La
Motte-Foulée. Et il était si simple,
si naturel, si semblable à tous les autres
enfants, que sa mère elle-même, si
elle n'avait su ce qu'elle savait, n'aurait pu
reconnaître en Lui son Maître et son
Seigneur.
Vers l'âge de douze ans, il fit
une absence mystérieuse, d'où il
revint aussi soumis que jamais à l'humble
femme qui lui avait donné le jour, mais avec
la conscience nouvellement acquise de son rang et
de sa dignité. Puis, tout alla ainsi pendant
de longues années. Il fallait gagner sa vie.
Le jeune Prince se fit artisan comme tant d'autres
membres de sa famille. Il fit la corvée du
château, comme les autres ; il fut
opprimé comme les autres. Et sa mère,
et les bergers, tout vieux maintenant, et les
quelques bonnes âmes qui avaient cru à
sa royale origine, se disaient parfois tout
étonnés :
« Quand donc le Roi son
père lui donnera-t-il l'ordre de se
présenter à la cour ? Et quand
donc verrons-nous s'accomplir le reste des choses
promises : tout le pays rendu heureux par le
Prince né parmi nous ? »
V
Un jour, enfin, le Prince se
révéla. Muni des ordres secrets du
Roi, il osa se lever et appeler à lui tous
les membres de la famille opprimée. Beaucoup
se refusèrent à le suivre ; ils
ne croyaient pas en lui, et la terreur que faisait
peser sur eux le sinistre seigneur les retenait
dans l'obéissance. Pourtant, les plus
misérables de la branche de La
Motte-Foulée le suivirent ;
c'était une troupe insignifiante, en
comparaison des gens d'armes qui gardaient le
château. Mais l'amour de la liberté
les animait, et par-dessus tout, leur confiance au
jeune chef qu'ils savaient être leur seigneur
suprême. Ils ne comprenaient pas que le Roi
tout-puissant ne vînt pas à leur
secours avec ses armées ; il lui
eût été si facile de venir
reconnaître son fils, réduire leurs
ennemis à l'impuissance, et leur donner
enfin le bonheur qu'il leur avait promis !
Quand on lui parlait ainsi, le Prince
répondait : « Soyez
tranquilles ; je connais mon Père. Je
le vois souvent, bien que vous ne le voyiez pas. Il
interviendra à son jour et à son
heure ; mais il veut que, pour être
libres, vous vous montriez dignes de la
liberté. Il veut aussi que je gagne mes
éperons dans cette lutte inégale. Ne
craignez rien, combattez courageusement, et la
victoire sera pour nous ! »
La lutte fut ardente. Les pauvres serfs,
mal armés, semblaient à jamais
incapables de prendre d'assaut le château,
derrière lequel le marquis et le chevalier
se riaient de leurs efforts.
Ils ne rirent pas toujours.
Un soir, le Prince entra seul par une
poterne du château, moins bien gardée
que les autres. Ses soldats improvisés
n'osèrent le suivre. Armé d'une
épée qu'il avait reçue de son
père, il combattit seul contre la horde des
tyrans. Ce fut un combat héroïque, que
raconteront les bardes attachés au service
du Roi aussi longtemps que son trône
subsistera. Devant lui tombèrent les
guerriers les plus fameux, et ce noble chevalier de
La Motte-Sanglante, qui jusque-là, se
vantait de n'avoir reculé devant personne.
Le marquis lui-même ne dut sa vie qu'à
l'épaisseur des murailles de son donjon,
où il s'était enfermé,
tremblant de peur. La victoire
était remportée,
mais à ce moment, attaqué
lâchement par derrière, le Prince
tomba. On le crut mort. Il l'était, suivant
toute apparence, et les serfs désolés
s'apprêtaient à lui rendre les
honneurs funèbres, tandis que les vaincus de
tout à l'heure poussaient des cris de joie,
lorsque le Roi en personne arriva sur la
scène, suivi d'une nombreuse armée.
Il vit son fils gisant sur le sol, il se pencha sur
lui. Ce fut un moment solennel.
Tout à coup, on vit le fils se
relever : son père avait versé
dans ses plaies un élixir souverain ;
il revivait pour recevoir enfin la gloire qui lui
était due, le titre et les honneurs qui
revenaient à son rang, et qu'il avait
conquis par sa vaillance !
Le vieux château fut rasé.
Tous les La Motte orgueilleux furent faits
prisonniers, envoyés dans une partie
éloignée du royaume pour y maudire
à jamais leur folie et leurs crimes. Le
tabellion fut banni. Tous les La
Motte-Foulée, délivrés d'une
longue oppression, devinrent frères les uns
des autres. Le cabaret ferma ses portes, et le
vieux La Motte-aux-Vers, dont l'emploi devenait
inutile, passa désormais ses longs jours de
loisir à cultiver des fleurs dans le
cimetière.

Noël à Paris.
I
 onsieur Chamusot venait de fermer la grande
porte d'entrée ; Mme Chamusot
était montée jusqu'au
cinquième pour éteindre les becs de
gaz de l'escalier. Il était donc dix heures
du soir, pas une minute de plus ni de moins, car la
maison dont M. et Mme Chamusot étaient
depuis trente ans les concierges redoutés
était, en fait de ponctualité, le
modèle des maisons du quartier. onsieur Chamusot venait de fermer la grande
porte d'entrée ; Mme Chamusot
était montée jusqu'au
cinquième pour éteindre les becs de
gaz de l'escalier. Il était donc dix heures
du soir, pas une minute de plus ni de moins, car la
maison dont M. et Mme Chamusot étaient
depuis trente ans les concierges redoutés
était, en fait de ponctualité, le
modèle des maisons du quartier.
Une fois la porte de la loge
refermée sur eux, M. et Mme Chamusot
s'assirent en face l'un de l'autre. C'était
le 24 décembre, et la rue, l'une des plus
paisibles du faubourg Saint-Honoré,
était fort animée ce soir-là.
Si sa dignité lui eût permis de
regarder à travers les carreaux de sa
fenêtre, M. Chamusot eût aperçu
une foule de gens qui se dirigeaient vers le centre
de Paris pour voir les boutiques illuminées.
Mais qu'il y ait des passants ou non,
que les boulevards soient illuminés ou ne le
soient pas, que le monde entier se réjouisse
ou s'afflige, qu'est-ce que cela fait aux
cariatides qui soutiennent le balcon de la
façade ? Rien assurément. Elles
portent sur leurs épaules le même
poids d'un bout de l'année à
l'autre ; elles ont toujours la même
expression de contentement stupide. Il n'y a rien
de surprenant à cela, puisqu'elles sont de
pierre. Mais je ne connais personne au monde qui
ressemble autant à ces cariatides, que les
respectables concierges susnommés.
Eux aussi semblent porter la maison tout
entière sur leurs épaules ; eux
aussi sont là, immuables comme les statues
de la façade, du 1er janvier au 31
décembre, à la différence de
quelques rides de plus et de quelques dents de
moins. Noël, les joies de l'enfance ! Il
y a beau temps qu'ils ne pensent plus à ces
fadaises-là, s'ils y ont jamais
pensé. Cependant, on remarque chaque
année, vers cette époque, un
changement chez eux, une sorte de mue
passagère et incomplète : leurs
traits, ô miracle, s'adoucissent,
ébauchent même un sourire - et quel
sourire ! - au passage des locataires ;
j'entends de ceux qui logent du 1er au 4e
étage inclusivement. Mais l'Enfant de
Bethléem n'est pour rien dans ces
surprenantes aménités : la
perspective des étrennes,
voilà ce qui a transformé, pour huit
jours, le masque de nos deux cariatides.
Ce soir-là donc, leur besogne
terminée, ils sont assis en face l'un de
l'autre. Un gros chat blanc, pelotonné
devant le fourneau, ronfle doucement. Et les deux
époux, dans l'atmosphère chaude et
lourde de leur loge, enfoncés chacun dans un
vieux fauteuil, débris fort confortable de
quelque déménagement, ont l'air de se
pelotonner aussi dans leur bien-être, tandis
qu'un vent de neige souffle au dehors.
Aucun d'eux ne parle ; ils se
sont
tout dit depuis longtemps déjà, mais
soudain la vieille femme se lève, comme mue
par une pensée irrésistible. Elle
regarde son mari dans les yeux ; celui-ci fait
de la tête un signe approbateur.
La vieille ferme soigneusement les
volets extérieurs, tire les rideaux de la
fenêtre, et revient fermer à
clé la porte de la loge. Puis lentement,
avec une sorte d'hésitation, elle se dirige
vers une grande armoire de chêne, le meuble
principal. Elle a tiré de sa poche la
clé de cette armoire ; elle l'ouvre.
Pendant ce temps, le mari a étendu sur la
table un vieux châle qui couvrait le lit, et
il attend, les deux mains appuyées sur ce
tapis, les yeux rivés sur sa femme et comme
brillants de fièvre.
Aucun d'eux ne parle ; ils sont
trop émus pour cela. La femme pose sur la
table une boîte, fermée par une
serrure. Le mari, à son tour, tire une
clé de son gousset. C'est une
précaution qu'ils ont prise à
l'égard l'un de l'autre : à la
femme la clé de l'armoire, au mari celle de
la cassette. Touchante confiance entre de vieux
époux !
La boîte est ouverte, et à
la lueur du bec de gaz qui éclaire la loge,
l'or brille, mais non d'un éclat plus vif
que ces deux paires d'yeux. Leur visage, jaune
d'ordinaire, est devenu cramoisi ; ils
tremblent, ils palpitent ; de
délicieuses émotions se sont
emparées de leur coeur.
Mages, bergers, bonnes âmes de
tous les temps ! Penchez-vous sur la
crèche de Bethléem pour adorer
l'Enfant divin, et pour lui offrir ce que vous avez
de plus précieux ! Voici des gens qui
n'ont pas besoin d'aller si loin ; leur
enfant, leur trésor, leur Sauveur, leur
Dieu, le voilà ! Et puissiez-vous
adorer le vôtre comme ils savent adorer le
leur.
Ils osent enfin plonger leurs doigts
dans la cassette. Et le mari dit à voix
basse :
- Comptons.
- Comptons, répond la
femme.
Depuis des années, presque chaque
soir, ils comptent ainsi. Chacun d'eux sait la
somme d'avance, ils n'y ajoutent rien, ils n'en
retirent rien pour le placer en
rentes sur l'État, sans s'être
consultés. Mais quel plaisir que celui de
palper cet or, de sentir au bout de ses doigts le
froid du métal, plus doux qu'un
baiser !
Quand les marronniers sont en fleurs,
quand les arbres des Champs-Elysées sont
pleins de nids, quand la Seine, le soir, roule ses
ondes mystérieuses, reflétant
à la fois les clartés du ciel et
celles de la terre ; quand le divin printemps
étend sur la ville son sceptre magique et
fait circuler ses parfums sur les trottoirs
encombrés, poétisant l'asphalte
elle-même, les deux avares sont là,
devant cette table, adorant leur dieu. Ils ont,
ici, leurs fleurs, leurs oiseaux, leurs parfums.
C'est toujours le printemps pour eux ; leur
soleil est emprisonné dans cette boîte
carrée.
- Trois mille six cent vingt, dit enfin
M. Chamusot devant les piles alignées. Il
faudra placer cela, nous perdons des
intérêts.
La femme répond par un hochement
de tête qui semble dire :
« Quel dommage de s'en
séparer ! » Comme pour
prévenir cette objection, le concierge
ajoute :
- Il y aura bientôt les
étrennes.
- Au moins trois cents francs, reprend
Mme Chamusot, un peu consolée à cette
perspective.
Il n'y a plus d'or à compter,
mais il reste, dans un tiroir,
deux ou trois écus. Puis, afin de ne rien
oublier dans cet inventaire, M. Chamusot se
fouille, sa femme en fait autant ; tous deux
vident leur porte-monnaie sur la table....
Le porte-monnaie d'un avare, quel
poème ! Il a coûté treize
sous dans un bazar quelconque, et voilà
trois ans qu'il sert. Mais, si usé qu'il
soit à l'extérieur, pas un point n'y
manque ; pas un trou par où la moindre
pièce puisse s'échapper. Les gros
sous l'ont teint au dedans de leur rouille
verdâtre ; il y a de tout : des
médailles de la Vierge trouvées en
balayant le trottoir, des pièces d'un
centime, de vieux boutons. Dans le compartiment du
milieu, deux ou trois pièces blanches, la
réserve dont on ne se sépare
qu'à regret, le plus tard
possible !
Parmi ces pièces blanches, M.
Chamusot en retient une entre ses doigts.
- Elle est fausse ! dit-il en
colère. Qui me l'aura passée ?
le boucher, le boulanger peut-être ? Ils
sont tous si voleurs !
Mais Mme Chamusot est en veine de
générosité.
- Allons, ne te fais pas de mauvais
sang, dit-elle. Si tu ne peux pas la repasser
avant, tu la donneras à Louis, notre
petit-neveu, quand il viendra nous souhaiter la
bonne année.
Louis, c'est le fils d'un neveu de M.
Chamusot. M. Chamusot a perdu son frère il y
a quatre ans ; son
neveu
est mort l'année suivante, laissant trois
enfants et une veuve, qui habitent le faubourg
Saint-Antoine. Tous les ans, Louis,
l'aîné des enfants, vient voir son
grand-oncle au jour de l'an. Il y a deux ans,
celui-ci lui a donné cinq francs pour ses
étrennes, mais Mme Chamusot a trouvé
cette générosité exorbitante
et a beaucoup grondé. L'année
dernière il s'est borné à deux
francs. Cette année, le grand-oncle met
à part une pièce fausse de vingt sous
pour son petit-neveu. Et tandis qu'ils
décident ensemble cet acte de
libéralité, le mari et la femme
échangent un regard plein de
sous-entendus....
II
- Bonsoir, braves gens, dit une voix.
Les deux concierges se retournent,
effarés. Mme veut crier, mais
l'émotion l'étrangle. M. Chamusot est
devenu blême. Tous les deux, campés
devant la table, lui faisant un rempart de leurs
corps, regardent avec stupeur cet intrus qui est
entré par miracle, dans une chambre
fermée à clé !
L'intrus est un grand vieillard,
vêtu d'une vaste houppelande, de couleur
brune, qui descend plus bas que
les genoux. Ses cheveux, d'une blancheur de neige,
tombent en longues boucles sur ses épaules
légèrement
voûtées ; il porte un chapeau
à larges bords sous les ailes duquel
brillent des yeux profonds, ombragés de
sourcils aussi blancs que les cheveux. La barbe est
longue, elle a des reflets d'argent. Il tient
à la main un bâton de
voyageur.
- Bonsoir, répète-t-il
d'une voix railleuse. Je vois, monsieur Chamusot,
que vous pensez à vos héritiers, je
vous en félicite. Ce cher petit Louis
va-t-il être content de ses
étrennes !
- Qui êtes-vous ?
s'écrie le concierge hors de lui.
- Votre ami, mon cher monsieur Chamusot,
votre ami et celui de votre famille. Je vous ai
surpris ? Excusez-moi.
- Allez-vous-en ! bégaie le
malheureux portier, ou j'éveille toute la
maison.
- Vous crierez au voleur, n'est-ce
pas ? Et quand on viendra pour
l'arrêter, le voleur, savez-vous qui ce
sera ? Ce sera vous, mon cher ami, ce sera
vous ! Et l'on trouvera dans cette boîte
l'héritage de votre frère Philippe,
que vous avez dérobé à son
fils, votre propre neveu, le père de ce
petit Louis, à qui vous allez donner une
pièce fausse !
- Pas si fort, pas si fort, monsieur,
supplie la vieille femme plus morte que vive. Qui
êtes-vous ? que voulez-vous ?
- Qui je suis, cela vous importe peu,
hélas ! je suis celui qui passe chaque
année à travers le monde, semant la
joie dans tous les coeurs purs, l'espérance
dans tous les coeurs brisés, le pardon dans
tous les coeurs repentants. Si vous l'aviez voulu,
j'aurais laissé ici l'une de ces trois
choses, ou toutes les trois ensemble. Je suis
Noël.
- Noël !
répétèrent les deux vieillards
surpris.
- Ce que je viens faire chez vous, le
voici : A la mort de votre frère
Philippe, il y a quatre ans, vous avez
été un moment seul dans la chambre.
Vous en avez profité pour ouvrir un meuble,
dans lequel vous saviez que votre frère,
presque aussi avare que vous, avait mis son argent.
Vous avez pris les trois mille francs qui
étaient cachés là.
L'héritier légitime, son fils, n'a
trouvé que quelques hardes. Cet argent lui
eût été bien utile, car il
était pauvre. L'année suivante, c'est
lui-même qui est mort, tué en grande
partie par la misère. Sa femme s'est
trouvée veuve, sans ressources avec trois
enfants. Vous auriez dû restituer, vous ne
l'avez pas fait.... Je viens chercher cet
héritage pour l'apporter à votre
nièce qui en a besoin. Combien y a-t-il
là ?
- Trois mille francs, murmura Mme
Chamusot ; tout notre avoir....
- Vous mentez, il y a davantage, mais ce
sera pour les
intérêts. Vous avez autre chose
encore, car je vous laisse votre pièce
fausse, cher monsieur Chamusot.... et vos rentes
sur l'État. Allons, donnez-moi cette
cassette.
- Jamais ! crièrent à
la fois les deux concierges. L'avarice était
plus forte que la peur, plus forte que la honte,
plus forte que tout.
- Jamais ! répéta le
visiteur ; nous allons voir.
Il leva son bâton, et l'homme et
la femme reculèrent. Mais il se contenta
d'en toucher la cassette, en la regardant fixement,
d'un regard surnaturel.
Aussitôt, les pièces d'or
sautèrent d'elles-mêmes sur la table
et sur le plancher. M. et Mme Chamusot les virent
rouler dans toutes les directions. Éperdus,
n'écoutant que leur instinct, ils se
baissèrent pour les ramasser.... O
terreur ! Sous les regards de l'homme aux
cheveux blancs, les pièces d'or
s'étaient transformées à vue
d'oeil. Chacune d'elles brillait d'un éclat
insupportable. Elles s'élargirent ; des
pattes longues, multiples, affreuses, leur
poussaient comme aux araignées et aux
crabes. Alors, elles s'acharnèrent
après les deux avares ; elles
s'attachèrent à leurs jambes,
à leurs mains, jusqu'à leur cou, avec
une horrible ténacité. M. et Mme
Chamusot, haletants, se débattaient en vain.
L'or vivait, grouillait, mordait, brûlait. Et
l'on eût dit qu'une même pensée
animait tous ces êtres
ignobles ; c'est
vers le
coeur de leurs victimes qu'ils se concentraient de
plus en plus.
- Grâce grâce !
crièrent enfin les malheureux
épouvantés.
Noël les regarda, vit leur
souffrance et eut pitié d'eux. Il frappa le
plancher avec son bâton ; toutes les
pièces d'or reprirent leur forme naturelle,
et leur place dans la cassette.
- Donnez-la-moi, dit-il, et qu'il n'y
manque rien. Puis, s'emparant du trésor, il
ouvrit lui-même la porte et disparut dans le
corridor sombre en disant :
- Le cordon, s'il vous
plaît !
M. Chamusot tira le cordon, et
Noël, fermant la porte derrière lui, se
perdit parmi les passants qui, à cette
heure, se dirigeaient vers les églises pour
entendre la messe de minuit.
III
L'homme à la houppelande, cachant sa
cassette sous les plis de ce vêtement,
descendit d'un pas rapide vers la
Madeleine.
Il était onze heures ; la
foule encombrait les marches de l'église et
le péristyle ; à travers les
portes ouvertes, on
apercevait
le maître-autel resplendissant, et, dans
l'âpre vent de la nuit, des bouffées
de musique et d'encens arrivèrent jusqu'au
vieillard.
- Pauvres gens ! disait-il en
voyant cette foule. C'est là qu'ils vont
chercher l'Enfant promis au monde ! Qu'il y a
loin de tout ceci à la crèche !
Ah ! que ne cherchent-ils, là où
il se trouve, celui qu'ils prétendent
adorer !
En parlant ainsi, Noël s'engagea
sur la ligne des grands boulevards.
Voici Noël !
Sur son passage, les cochers de fiacre
engourdis par le froid, se sentent subitement
réchauffés ; les marchands, dans
leurs petites boutiques, reprennent courage,
annonçant d'une voix plus forte
« l'article de Paris, » le
nouveau jouet de l'année....
Voici Noël !
Le vent qui s'engouffre dans les plis de
son manteau, souffle moins glacial, moins lugubre
après l'avoir touché ; les becs
de gaz semblent briller plus joyeusement à
son approche ; les pavés paraissent
moins noirs ; le vagabond qui cherche chaque
soir un hangar, une porte cochère, une
charrette pour y dormir, oublie le sommeil, et la
rue elle-même devient clémente et
hospitalière pour lui.
Voici Noël !
Il marche, et le passant qui le
frôle éprouve comme une commotion
joyeuse. Mais ce mystérieux rayonnement
s'étend plus loin. Tandis que ce grand
vieillard traverse Paris, la cité tout
entière subit son influence. C'est l'heure
où les lumières brillent dans toutes
les demeures, pauvres ou riches, d'un éclat
inusité, depuis le lustre du
Grand-Hôtel jusqu'à la veilleuse
suspendue au plafond blafard des salles
d'hôpital....
Voici Noël !
C'est l'heure où, tandis que le
vent gémit dans les cheminées, les
petits enfants voient en rêve une avalanche
de jouets dégringoler dans l'âtre, et
des sourires errent autour de toutes ces
lèvres roses, dans chaque quartier, dans
chaque rue, dans chaque maison, partout où
se trouve une mère !
Voici Noël !
Rien ne l'arrête jamais. Tous les
ans, à pareille heure, on le voit
apparaître. Il est entré dans Paris
malgré le siège, et que de coeurs
n'a-t-il pas réchauffés cette
année-là ! Il est toujours
vieux, mais toujours jeune ; c'est le
juif-Errant du bonheur. Les nations changeront de
drapeau, les philosophes changeront de
systèmes, les villes changeront de
place ; mais Noël reviendra chaque
année, tant qu'il y aura un soleil pour
mesurer le cours des ans....
Cependant, il marche toujours. Il a
déjà dépassé la porte
Saint-Denis, la Place de la République, la
Bastille. Il se dirige à grands pas vers le
faubourg Saint-Antoine, qui, lui aussi, est
illuminé à sa façon et
retentit de mille bruits joyeux.
IV
Au cinquième étage d'une maison de
la rue des Boulets, dans une mansarde dont le
plafond à angle aigu n'est autre chose que
le toit de la maison, plein de crevasses à
travers lesquelles le vent de décembre passe
à son gré, une femme de vingt ans
à peine, presque une enfant, agonise sur un
grabat.
Un fourneau de fonte, dont le tuyau
passe à travers le toit, et dans lequel se
consument deux ou trois morceaux de charbon, une
chaise boiteuse, une table sur laquelle on voit une
tasse et un chandelier où brûle un
reste de bougie ; dans un coin, un sac de
paille sur lequel dort un petit enfant couvert de
quelques haillons, voilà, avec le lit
sordide sur lequel la jeune femme est
couchée, tout l'ameublement de la
chambre.
La malade est couverte d'un drap
grossier et d'une
méchante courte-pointe de laine grise, mais
son agitation est extrême ; la
fièvre la consume, elle est en proie au
délire et parle à haute
voix :
- Mourir et laisser mon enfant,
dit-elle, mon Dieu est-ce possible ? Mais qui
l'élèvera, qui prendra soin de
lui ? Laissez-moi vivre, Seigneur, et je vous
promets d'expier toutes mes fautes.... Je l'aurais
tant aimé, cet enfant, j'aurais
été, je le sens, aussi bonne pour lui
que le fut ma mère pour moi.... Ma
mère ! Faudra-t-Il que je parte sans
l'avoir revue, sans avoir reçu son
pardon ?... J'ai brisé son coeur, et je
ne sais même pas si elle vit encore !
Ah ! si je pouvais la voir, me jeter à
ses pieds ; si seulement avant de m'en aller,
quelqu'un venait me dire : Ta mère te
pardonne !
- Ta mère te pardonne ! dit
une voix, semblable à un
écho.
- Qui est là ? est-ce vous,
voisine ? s'écria la malade en se
soulevant sur son séant.
Mais elle ne vit personne, car Noël
était entré sans bruit, et la
clarté mourante de la bougie n'arrivait pas
jusqu'à la porte.
- J'aurai rêvé, se
dit-elle. Ou peut-être le bon Dieu m'a-t-il
exaucée en m'envoyant l'un de ses
anges.
- N'en doute pas, ma fille, reprit la
voix.
Elle était si douce, cette voix,
que la malade n'en ressentit
aucun effroi. Une main se posa sur son front
brûlant, et aussitôt un grand calme
l'envahit, un sentiment profond de paix et de
bien-être.
- Regarde ! dit Noël à
voix basse, en se penchant sur elle.
À cet ordre, la malade ouvre les
yeux, et voici que soudain la chambre est devenue
gaie ; la lumière s'est
ranimée ; le feu ronfle dans le
poêle. Ce ne sont plus les mêmes
meubles. Un rouet, dans un coin, tout prêt,
garni de laine, semble dormir à la place du
petit enfant. Le petit enfant, c'est elle, c'est la
pauvre fille, qui se revoit telle qu'elle
était il y a quinze ans ! Et cette
femme qui se penche sur elle, souriante, et
l'embrasse sur le front, n'est-ce pas sa
mère ?
- Endors-toi, mon enfant, dit-elle. Je
te pardonne, je te pardonne !
La malade lui tend les bras, mais elle
ne peut la saisir.
- Ma mère !
s'écrie-t-elle, et une expression
pénible se peint sur son visage ; elle
ne dure qu'un instant. La vision a disparu.
- Regarde encore ! dit le
vieillard
à voix plus haute.
La jeune femme obéit. Cette
fois-ci, elle se voit dans une grande salle
brillamment éclairée. Des chaises,
des chaises en quantité ; une estrade,
un orgue, un monsieur qui
parle.... et tout au fond, on voit un grand
écriteau rouge, avec des lettres
d'or :
« Je ne mettrai point dehors
celui qui viendra à moi, » dit
Jésus-Christ. « Quand vos
péchés seraient rouges comme le
cramoisi, ils seront blanchis comme la
neige. » « Je suis le Bon
Berger, le Bon Berger donne sa vie pour ses
brebis. »
Le monsieur qui parle, debout sur
l'estrade, a la main tournée vers cet
écriteau. Il regarde la jeune femme ;
il semble ne parler que pour elle, il lui
dit :
- Croyez-vous cela ?
- Oui, répond-elle
faiblement.
Mais, tout à coup, les
lumières se sont éteintes, l'orateur
a disparu, et l'écriteau aussi.
- Regarde ! crie Noël d'une
voix puissante.
Et il a touché, de son
bâton, l'une des crevasses du toit.
Aussitôt l'ouverture s'élargit,
devient immense ; le plafond tout entier
disparaît, le ciel bleu et profond se
dévoile. Chaque étoile
apparaît, aux yeux de la mourante, plus
brillante que celle de Bethléem ne le fut
jadis aux regards des Mages. Il ne fait pas
froid ; l'air est doux, imprégné
de parfums ; le vent du ciel passe à
travers cette mansarde, illuminée des feux
d'en haut.
La jeune femme se soulève, elle
tend les mains vers ces clartés
admirables :
- Me voici ! s'écrie-t-elle,
comme répondant à un appel
irrésistible.
Et elle retombe, inanimée, sur
son lit.
La bougie mourait dans sa
bobèche ; le toit noir s'était
refermé ; à peine une
étoile brillait-elle, ici et là,
à travers les carreaux de la lucarne et les
crevasses du plafond. Le vieillard s'approcha,
ferma les yeux de la morte, rangea le drap et la
couverture. Puis il se pencha sur le sac de paille
où gisait l'enfant endormi ; il le
prit, l'enveloppa dans sa houppelande, et
s'avança vers la porte :
- Repose en paix, pauvre fille, dit-il.
De tous ceux que je visite aujourd'hui, c'est toi,
oui, c'est toi qui es la plus heureuse !
V
Après avoir fermé la porte du
galetas, Noël descendit un étage.
Arrivé au quatrième, il
s'arrêta devant l'une des cinq ou six portes
qui donnaient sur le palier. À travers la
serrure, on voyait briller une lumière dans
la chambre. Noël entra doucement, à sa
manière, sans être aperçu de
personne.
Une femme de trente-cinq ans environ
était assise devant la table, cousant
à la clarté d'une petite lampe
à abat-jour. La chambre était pauvre,
mais propre. Dans un lit de fer dormaient deux
petites filles ; un paravent était
dressé dans un coin, derrière lequel
était couché l'aîné,
Louis, grand garçon de dix ans, le
petit-neveu de M. Chamusot. Car nous sommes ici
chez la veuve, et c'est elle qui travaille encore,
à cette heure tardive.
À quoi
travaille-t-elle ?
Des robes à recoudre, des
pantalons à rapiécer, sont
entassés devant elle. C'est pour ses enfants
que travaille, à minuit passé, Mme
Chamusot la nièce. C'est demain Noël,
demain ou plutôt aujourd'hui - et ses trois
petits doivent assister à la
fête ; on doit leur montrer un arbre
illuminé, une lanterne magique, que sais-je,
moi ? Et leur donner des prix, car ce sont eux
les meilleurs élèves de
l'école du dimanche du faubourg
Saint-Antoine.
Vous comprenez bien qu'une mère
soigneuse ne peut pas laisser ses enfants aller
comme cela, avec des trous aux coudes et aux
genoux. Et elle travaille, elle travaille, tandis
que l'on entend, dans la chambre, le souffle
égal de ces trois petites poitrines, sur
lesquelles ne pèse encore, Dieu merci, aucun
poids douloureux.
Dans la cheminée, trois paires de
souliers sont rangées par ordre de
taille ; les talons sont bien un peu
éculés, mais ce n'est pas aux talons
que les enfants regarderont ce matin au
réveil. En attendant, approchons-nous, si
vous le voulez bien, et regardons
nous-mêmes.
Dans le plus petit soulier, une
poupée de trente centimes,
élégamment habillée d'un bout
de mousseline et d'un ruban rouge. C'est le cadeau
de Marthe.
Dans le soulier moyen, un
nécessaire, composé d'une paire de
ciseaux, d'un dé à coudre et d'un
étui à aiguilles. Le tout
acheté soixante-cinq centimes au bazar de
l'Hôtel-de-Ville. Ce sera la joie de Pauline
pendant huit grands jours.
Et dans le grand soulier, une
boîte de compas. C'est un cadeau
sérieux, il a coûté un franc
vingt-cinq, ce qui représente presque une
journée de travail de la mère !
Car pour son Louis, la veuve a un faible. - C'est
un vrai petit père, dit-elle souvent, en le
regardant avec des yeux attendris.
On entend monter de la rue des chants
joyeux ; ce sont des jeunes gens qui chantent,
plus mélodieusement qu'on n'oserait
l'espérer à pareille heure :
- Minuit, chrétiens, c'est l'heure
solennelle
- Où l'Homme-Dieu descendit
jusqu'à nous....
Ah ! se dit la veuve, tout le monde est
content aujourd'hui ? Quand je pense qu'il y a
trois ans, mon pauvre homme était là,
et que maintenant il dort là-bas, à
Saint-Ouen, je n'ai pas le coeur de me
réjouir.... Allons, du courage, le bon Dieu
nous a aidés tout de même. La
santé n'a pas manqué, le travail non
plus, c'est le principal. Il y en a tant de plus
misérables que nous !
- Bon, dit-elle tout à coup,
à haute voix, en se frappant le front, et la
petite femme de là-haut que
j'oubliais ! Il y a au moins deux heures que
je n'y suis pas montée. Il faut aller voir
si elle n'a besoin de rien, ni son enfant non plus.
Il doit pleurer à cette heure, le pauvre
petit. Vite, montons.
- C'est inutile, dit Noël qui, tout
près de la porte, semblait l'avoir ouverte
au même instant. Je viens de
là-haut ; tout est fini.
- Morte ! s'écria Mme
Chamusot la nièce, sans remarquer tout
d'abord l'apparence extraordinaire du visiteur,
qu'elle prit pour le médecin qu'on avait
fait chercher la veille. Pauvre femme !
Laissez-moi vite aller chercher l'enfant.
- Le voici, dit Noël, en soulevant
les plis de son manteau. Madame Chamusot, je vous
apporte vos étrennes.
Et en parlant ainsi, il mit le petit
être dans ses bras.
- Mes étrennes, ce
petit-là ! Mais vous ne savez donc pas
que j'en ai trois et que je suis veuve !
Certainement, monsieur, que je le garderai
jusqu'à ce que sa famille le
réclame ; c'est bien le moins que je
puisse faire.
- Et s'il n'a pas de famille ?
dit
le vieillard.
- Ah ! dit la mère
embarrassée ; c'est vrai tout de
même ; on ne lui a jamais connu
personne, à la petite femme de
là-haut.... Eh bien, tant pis, ajouta-t-elle
après un instant d'hésitation, je le
garderai tout à fait, s'il le faut. Le bon
Dieu m'aidera.... Comme vous dites, ce seront mes
étrennes à moi.... une poupée
du jour de l'an, quoi ! Pauvre petit, pauvre
petit !
Et la brave femme, les yeux humides,
couvrait l'enfant de baisers.
Le vieillard la regardait,
attendri.
Mme Chamusot porta l'enfant sur son
grand lit, au fond de la chambre. Son visiteur la
suivit. À ce moment, - était-ce un
éblouissement, causé par la fatigue
et l'émotion ? - Elle vit quelque chose
d'extraordinaire. Sous le regard du vieillard, ce
même regard qui, dans l'autre maison, avait
tout à l'heure animé les
pièces d'or, le lit diminua, diminua,
jusqu'à devenir un humble berceau, quelque
chose comme une crèche. L'enfant se
transfigura ; il souriait, il tendait vers la
brave femme ses petites
mains ; une lueur divine rayonnait autour de
sa tête.
Noël, Noël, voici le
Rédempteur !
chantaient les jeunes gens dans la rue.
- Ah ! mon Dieu !
s'écria Mme Chamusot. Est-ce possible ?
Serait-ce Lui que j'aurais reçu chez
moi ?
- C'est Lui-même, dit le vieillard
en relevant la tête.
La femme tourna la sienne, mais son
étrange visiteur avait disparu. Quand ses
yeux revinrent sur l'enfant, tout était
redevenu naturel ; elle ne vit plus que son
grand lit, et le poupon donnant à poings
fermés.
Cependant, quelque chose attira son
attention. Sur la table une cassette avait
été déposée. Elle la
prit, la souleva ; elle entendit un son
métallique. La clé était
à la serrure, elle l'ouvrit. C'était
le trésor des vieux Chamusot. Un billet
ainsi conçu était posé sur les
pièces d'or :
« C'est ici l'héritage
du grand-père : Priez pour ceux qui
vous l'avaient dérobé et
pardonnez-leur. »
Et au-dessous, ce mot qui était
à la fois une date et une signature :
NOËL.

Monsieur Boulloche.
Conte de fin d'année.
 onsieur Boulloche, bien que célibataire
endurci, n'était point un méchant
homme. Industriel d'universelle renommée,
ses ouvriers étaient contents de lui, tout
aussi bien que ses clients. Il était juste
à leur égard, avec ce quelque chose
en plus qui vaut mieux que de l'argent, et qui
s'appelle la bienveillance. onsieur Boulloche, bien que célibataire
endurci, n'était point un méchant
homme. Industriel d'universelle renommée,
ses ouvriers étaient contents de lui, tout
aussi bien que ses clients. Il était juste
à leur égard, avec ce quelque chose
en plus qui vaut mieux que de l'argent, et qui
s'appelle la bienveillance.
Sa vie privée était sans
reproche ; on ne lui connaissait point de
vices. Une seule passion, bien innocente :
celle des jardins. M. Boulloche aimait les fleurs,
et le dimanche, tandis que les cloches, à
toute volée, appelaient les fidèles
au culte public, M. Boulloche, bêche ou
sécateur en main, parcourait ses
propriétés ou soignait ses
plates-bandes.
Car M. Boulloche n'avait, il faut bien
le dire, aucune religion. Athée ? Non,
pas précisément ; il croyait,
comme Voltaire, au « grand Architecte de
l'univers, » et
comme
Béranger, au « Dieu des bonnes
gens, » au nombre desquels il se
comptait. Mais il n'avait jamais pensé aux
devoirs qu'il pouvait avoir envers ce
Dieu-là ; il n'avait rien à se
reprocher, se croyait le meilleur des hommes, et
n'arrêtait jamais son esprit sur ce sujet
désagréable : la mort.
Toute sa vie s'était
passée dans l'effort vers la fortune, et il
l'avait atteinte. Et jamais cet homme, pourtant si
sage, ne se posait cette question :
« Et
après ? »
Un dimanche matin, les cloches
carillonnaient ; les gens, vêtus de
leurs plus beaux habits, se rendaient aux diverses
églises du voisinage, et M. Boulloche, a
genoux sur la pelouse qui s'étendait devant
sa maison, s'occupait à fixer dans le sol
une tige de fer peinte en vert, destinée
à servir de support à un beau
rosier.
Son travail terminé, il allait se
retirer, lorsqu'il aperçut, rampant sur le
sol, un escargot - un vulgaire escargot - qui se
dirigeait lentement vers le support de fer. M.
Boulloche était observateur et philosophe
à ses heures; il resta donc, pour
observer l'infime animal.
« Il y a pourtant, se dit-il, une
espèce de réflexion chez cet
escargot ; il a vu se dresser cette tige, et
s'imagine que c'est une plante avec de belles
feuilles au sommet. Le voilà qui entreprend
l'ascension, dans l'espoir de dévorer ces
feuilles, qui n'existent pas. » Et M.
Boulloche regarde toujours. Tout à coup, une
comparaison se fait dans son esprit, entre
l'ascension de cet escargot et la sienne. L'insecte
monte lentement. Le voici parvenu au point qui,
dans la vie de M. Boulloche, représente
l'entrée en apprentissage ; un peu plus
haut, le voici ouvrier - il lui semble que
c'était hier - le jour où il rapporta
sa première paie à la maison :
avec quelle joie il jeta les rares écus dans
le tablier de sa mère ! Un peu plus
haut : il se fait ouvrir un carnet à la
caisse d'épargne.
Plus haut encore : le voici
contre-maître. L'escargot monte toujours.
Voici le point où Boulloche tout court
devient Monsieur Boulloche : il fait
construire un atelier pour son compte. Plus haut,
il embauche des ouvriers, agrandit son immeuble,
étend ses affaires ; plus haut, et
voici la grande prospérité : les
ordres de fabrication arrivent même
d'Amérique, il a des brevets dans le monde
entier. Ses bureaux, à Paris, occupent
trente employés. Il est
millionnaire....
L'escargot est enfin arrivé au
sommet de la tige de fer. Le
pauvre animal est déçu : il
tourne et retourne sur l'étroit pivot ;
pas la moindre feuille verte !
« C'est comme moi ! » dit
à haute voix M. Boulloche, sans même
s'en apercevoir. « Oui, voilà bien
ma vie ! Travail, fatigue, et finalement
déception. Arrivé au bout, il n'y a
rien, rien, rien.... Et il faut
redescendre ! »

Il faut redescendre. En effet, l'escargot,
n'ayant trouvé ni feuille, ni brin d'herbe,
rien de tendre et de frais, rien que le fer dur et
mort, redescend vers le sol où il
s'enfouira.
Pauvre M. Boulloche ! Pauvre
millionnaire ! Pauvre vieillard, en route pour
la mort ! Que n'as-tu rencontré au
seuil de ta vie un homme vraiment sage pour te
redire les paroles de Jésus-Christ :
« Cherchez premièrement le royaume
de Dieu et sa justice.... Que servirait-il à
un homme de gagner le monde entier, s'il venait
à perdre son
âme ? »
Mais il n'est pas trop tard encore. Il y
a une ascension vers la véritable fortune,
que tu peux entreprendre, même à ton
âge avancé. Tu peux,
au lieu d'imiter le lent
escargot, comme tu l'as fait jusqu'à cette
heure, prendre tout à coup des ailes, comme
l'oiseau, et t'envoler d'un trait jusques au ciel.
Repens-toi de ta folle vie d'égoïsme et
d'orgueil ; viens avec humilité aux
pieds de Jésus, au Calvaire ; et
là, des ailes te seront données,
celles de la foi et de l'espérance, qui te
mettront, même avant de mourir, en possession
du bien suprême : la vie
éternelle.

|
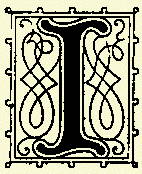 L y avait une fois, voilà bien
longtemps, un village appelé La Motte.
C'était une des localités les plus
curieuses qu'on ait jamais vues. Tous les habitants
de ce village, sans exception, portaient le
même nom, et c'était le nom de La
Motte. L'histoire raconte qu'ils étaient
tous les descendants d'un même ancêtre,
mais ce premier La Motte ne faisait guère
honneur à sa progéniture, car il
n'était venu s'établir dans ce coin
perdu qu'après avoir été
chassé pour cause d'indélicatesse
d'un très beau domaine dont il était
l'intendant.
L y avait une fois, voilà bien
longtemps, un village appelé La Motte.
C'était une des localités les plus
curieuses qu'on ait jamais vues. Tous les habitants
de ce village, sans exception, portaient le
même nom, et c'était le nom de La
Motte. L'histoire raconte qu'ils étaient
tous les descendants d'un même ancêtre,
mais ce premier La Motte ne faisait guère
honneur à sa progéniture, car il
n'était venu s'établir dans ce coin
perdu qu'après avoir été
chassé pour cause d'indélicatesse
d'un très beau domaine dont il était
l'intendant. onsieur Chamusot venait de fermer la grande
porte d'entrée ; Mme Chamusot
était montée jusqu'au
cinquième pour éteindre les becs de
gaz de l'escalier. Il était donc dix heures
du soir, pas une minute de plus ni de moins, car la
maison dont M. et Mme Chamusot étaient
depuis trente ans les concierges redoutés
était, en fait de ponctualité, le
modèle des maisons du quartier.
onsieur Chamusot venait de fermer la grande
porte d'entrée ; Mme Chamusot
était montée jusqu'au
cinquième pour éteindre les becs de
gaz de l'escalier. Il était donc dix heures
du soir, pas une minute de plus ni de moins, car la
maison dont M. et Mme Chamusot étaient
depuis trente ans les concierges redoutés
était, en fait de ponctualité, le
modèle des maisons du quartier.