Contes du
Dimanche
Récits
allégoriques
 La marque rouge.
La marque rouge.
Histoire vraie, par le
Général 0. 0. Howard, ex-gouverneur
de l'État dit Connecticut
(États-Unis).
 ' ÉTAIS un matin dans une gare, attendant
un train qui était en retard. Un homme
singulier m'accosta d'une étrange
manière : ' ÉTAIS un matin dans une gare, attendant
un train qui était en retard. Un homme
singulier m'accosta d'une étrange
manière :
« Adam, où
es-tu ? » me dit-il.
En me retournant vers celui qui me
parlait, je vis un homme âgé, aux
vêtements négligés, avec une
longue barbe grise. Mais, malgré sa mauvaise
apparence, son oeil bleu fixé sur moi
semblait me percer de part en part.
L'évidente sincérité du pauvre
homme me toucha.
- Adam, où es-tu ?
- Je ne m'appelle pas Adam,
répondis-je avec douceur.
Avec un demi-sourire, l'homme, ayant
baissé la voix, murmura :
- Dieu dit à Adam :
« Où es-tu ? » Tu
n'es pas Adam et je ne suis pas Dieu, mais Dieu
peut te parler par mon moyen.
Puis, d'un ton solennel, il me
demanda :
- Buvez-vous ?
- Boire, moi ! Est-ce que j'ai
l'air d'un homme qui a besoin qu'on lui fasse une
leçon de tempérance ? Pourquoi
me posez-vous cette question, à moi qui vous
suis complètement
étranger ?
- Pardonnez-moi, monsieur, dit-il, et me
fixant encore avec une expression de doute, il
ajouta : je suis bien aise que vous ne buviez
pas !
- Eh bien, dis-je pour le mettre
à l'épreuve, en supposant que je
boive de temps en temps un verre de vin ou de
bière, où est le mal ?
Cette question l'excita :
- Ah ! dit-il, écoutez mon
histoire. Si vous ne buvez pas, ce récit
pourra vous servir pour sauver quelque pauvre
buveur.
- Peut-être que votre histoire est
trop longue, lui dis-je ; vous savez, je pars
par le train qui va arriver.
Mais, malgré ces paroles, mon
homme commença le récit de sa
vie.
Retraité du service des
États-Unis, il habitait avec sa fille veuve
à peu de distance de là. Voici
d'ailleurs son histoire, à laquelle il
manque cependant l'originalité de style du
narrateur.
« Vingt ans avant la guerre,
j'épousai la plus jolie fille d'un petit
village de la Nouvelle-Angleterre. Ma femme
était charmante ; elle avait de beaux
cheveux bruns et des yeux admirables. Elle
était aimée de tous dans le pays, car
elle était aussi bonne que belle. Nous nous
établîmes sur une ferme des environs,
et nous eûmes deux filles, qui devinrent
toutes deux aussi jolies que leur mère, et
aussi aimables, ce qui est le plus grand
éloge que l'on puisse faire d'elles.
L'aînée était brune
et l'autre blonde ; c'étaient,
monsieur, je vous l'assure, des enfants à
rendre fier un roi. Elles s'appelaient Alma et
Jeanne ; elles s'aimaient tendrement, jamais
la moindre dispute ne s'éleva entre elles.
C'est moi, hélas ! qui fis naître
les premiers orages dans notre paradis terrestre.
Je commençai à boire, d'abord du vin
le jour de ma noce, puis du whisky (eau-de-vie de
grain). Cette passion absorba mes ressources
à ce point qu'il fallut que mon Alma.
essayât de soutenir la maison par son
travail ; elle devint la maîtresse
d'école du village. Le sénateur de
l'État, Hiram Brown, habitait le
voisinage ; son fils Henri revint du
collège pour aider son père dans son
commerce. Ce jeune homme et ma fille Alma devinrent
amoureux l'un de l'autre et nous les
mariâmes. Tout le village approuva cette
union - quelques personnes, cependant,
disaient : « C'est
malheureux que le père
soit buveur à ce point, bien qu'on ne puisse
blâmer la pauvre fille à cause des
vices de son père ! »
Ah ! monsieur, quel beau couple ! Le
jeune homme était grand, fort, instruit et
cultivé ; sa jeune femme était
digne de lui. Ma femme fit son possible pour
l'honneur de la famille à l'occasion de ce
mariage. Mais le repas de noces fut pour moi un
nouveau prétexte pour m'enivrer
copieusement. »
Le train approchait, et j'essayai de
quitter le vieux bonhomme ; mais il se
cramponna à moi, me montrant une cicatrice
rouge, affreuse, en forme de fer à cheval,
qui se cachait sous sa barbe.
- Monsieur, me dit-il, voyez-vous cette
cicatrice ?
- Oui, oui, mais il faut que je
parte.
- Eh bien, laissez-moi monter à
côté de vous, et je vous raconterai la
suite.
- Soit, montez.
Cette cicatrice mystérieuse et ce
nez déformé excitaient ma
curiosité. C'étaient ces deux
choses-là qui, malgré les yeux bleus
et assez beaux du vieillard, lui donnaient si
mauvaise apparence. Quand nous fûmes assis
dans le wagon, je lui dis en
plaisantant :
- Je suppose que vous avez là des
marques d'une noce plus soignée que les
autres ?
Il me répondit :
« Mon histoire ne ressemble
à aucune autre. Généralement
on sait comment se terminent les histoires
d'ivrogne, mais attendez un peu. Je n'ai pas bu une
goutte de boisson fermentée depuis plus de
trente ans. Je sais que je ne suis pas beau. Les
gamins courent après moi en criant :
« Voilà le vieux
toqué ! » Ils ont raison,
peut-être, mais cela ne m'arrête pas.
Mon temps se passe à avertir les jeunes
gens ; je suis moi-même un avertissement
vivant.
Cette cicatrice m'a été
imprimée parle coup de pied d'un
cheval ; mais ni cela, ni la difformité
de mon nez, résultat d'un pugilat
après boire, n'étaient très
perceptibles avant que l'eau-de-vie eût fait
son oeuvre. Quand je rentrais ivre à la
maison ces marques devenaient enflammées,
oui, toutes rouges et hideuses. Quand ma femme et
mes filles les voyaient, elles fondaient souvent en
larmes. Ah ! que de fois, en voyant leur
douleur, en sentant que je perdais peu à peu
l'estime de ma famille et de mes concitoyens, j'ai
essayé de me corriger !
« Enfin, un jour, ma petite
Jeannette vint en sautant de joie m'annoncer qu'il
y avait, chez Henri et Alma, un bébé
nouveau-né, et qu'il me ressemblait.
C'était mon premier petit-fils.
« Naturellement, dès
qu'il me fut possible d'aller
voir ma fille et son
nouveau
trésor, je me rendis chez les Brown.
Malheureusement je rencontrai un camarade de
boisson aux confins du village. « Le
premier petit-fils ! me dit-il ; il faut
célébrer sa
naissance ! » Nous allâmes
boire un coup ; je ne me souviens plus de ce
qui se passa pendant les quelques jours
suivants ; je revins chez moi, à jeun
et tout honteux, et ma pauvre chère femme
voulut bien me recevoir encore. Quelques jours
après, je rendis visite à
Alma.
« Ma fille était
entourée de bien-être et de luxe tout
ce qu'un mari riche et passionné peut offrir
à une femme, elle l'avait. Henri
n'était pas là ; Alma
était assise sur sa chaise à
bascule ; le bébé endormi
reposait sur son sein. Elle me vit à
peine ; elle regardait au loin d'un air
égaré, et ses yeux étaient
rougis par des pleurs qu'elle avait essuyés.
« Pourquoi ces larmes ?
demandai-je ; qu'arrive-t-il, chère
enfant ? » je lui parlai de ma voix
la plus enjouée ; mais à mon
grand effroi Alma ne me répondit pas un mot,
ne m'adressa pas un regard. À la fin, comme
par une impulsion soudaine, comme en un rêve,
elle se leva et, tenant l'enfant sur un bras, elle
souleva la petite couverture et me montra le visage
de son bébé âgé de
quinze jours. Puis elle recouvrit l'enfant, le
remit dans son berceau et, voilant sa face de ses
deux mains, elle s'écria :
« Mon Dieu, pardonne-moi....
Tu sais que je ne suis pas impie, et qu'il n'y a
personne qui puisse me délivrer de ta
main ! »
(Job
X, 7.)
L'homme toussa un peu, puis il
reprit :
« Je ne connaissais pas la
Bible alors, mais je compris le sens de cette
exclamation. L'enfant portait une marque horrible
et changeante ; c'était le
fac-similé de cette cicatrice ! Le
petit innocent, sans que ses honnêtes parents
y fussent pour rien, portait sur sa face la double
empreinte de mon vice ! À chaque regard
jeté sur son enfant, ma fille était
devenue de plus en plus
désespérée, et ma visite la
mit hors d'elle-même. Sa tristesse prit une
forme étrange ; elle s'imagina que son
mari ne lui pardonnerait pas, à elle, la
fille du buveur, d'avoir mis au monde un enfant
portant des stigmates de honte. À partir de
ce jour-là, je n'ai plus jamais
bu. »
Le singulier vieillard me laissa
à la station suivante, mais il avait eu le
temps de m'apprendre que la pauvre Alma dut
être internée dans un asile
d'aliénés ; quant à
Henri, parti pour la guerre, il ne revint jamais.
« Le petit enfant fut laissé
à mes soins ; je le gardai
jusqu'à quinze ans. Les marques rouges
devinrent de plus en plus apparentes, et le pauvre
enfant marchait et parlait comme s'il avait
été pris de vin. Il était
à moitié idiot. Il m'a quitté
sans rien dire, et il est maintenant quelque part,
luttant pour la vie parmi
les
hommes. Peut-être rencontrerez-vous mon
petit-fils dans vos voyages. Dites-lui que son
pauvre vieux grand-père l'attend depuis
seize ans. Mon occupation ? C'est d'avertir
les jeunes gens de peur que, comme moi et les
miens, ils ne tombent sous l'horrible
malédiction de la boisson. Au revoir !
Dieu vous bénisse, cher
monsieur ! »

Les étrennes de
Bobèche.
I
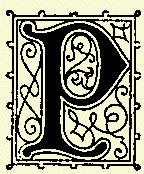 OURQUOI l'appelait-on Bobèche ? Il
n'aurait pas su le dire lui-même, mais
personne ne lui donnait d'autre nom, excepté
sa mère. Dans toute la rue Mongrand
où demeuraient ses parents, dans la rue
Grignan où se trouve la Grande Poste, ainsi
que dans les rues avoisinantes, tous les
garçons de bureau et les petits
employés connaissaient Bobèche, le
jeune saute-ruisseau de la maison Reynardon et
Cie. OURQUOI l'appelait-on Bobèche ? Il
n'aurait pas su le dire lui-même, mais
personne ne lui donnait d'autre nom, excepté
sa mère. Dans toute la rue Mongrand
où demeuraient ses parents, dans la rue
Grignan où se trouve la Grande Poste, ainsi
que dans les rues avoisinantes, tous les
garçons de bureau et les petits
employés connaissaient Bobèche, le
jeune saute-ruisseau de la maison Reynardon et
Cie.
Il passait dans ce monde-là pour
un bon enfant, et quand il se rendait à la
poste pour y chercher le courrier de la maison, il
ne manquait pas d'échanger un bonjour amical
avec deux ou trois douzaines d'autres gamins,
lesquels étaient tous ses intimes.
- Bobèche ! As-tu des
timbres nouveaux ? lui criait l'un.
Bobèche ! Le courrier est en
retard ; faisons une partie de barres, criait
un autre.
Bobèche ne savait à qui
entendre. Sa popularité le gênait,
surtout quand les camarades impatientés
commençaient à le houspiller.
- Laissez-moi tranquille, disait-il sans
se fâcher.
Oh ! les bonnes parties dont
Bobèche était le héros dans la
cour de la poste ! C'était là,
à cette époque, que se tenait la
petite bourse des timbres oblitérés,
là que se rencontrait deux fois par jour la
fleur des bureaux environnants, l'espoir naissant
du commerce marseillais.
Il s'agissait bien du courrier !
Rien ne réjouissait plus cette jeunesse que
lorsque le chef des facteurs venait lui apprendre
qu'il y avait « une demi-heure de
retard ». Une demi-heure ! Autant de
pris sur l'ennemi, c'est-à-dire le
patron ; autant de gagné pour le jeu.
En hiver, quand il pleuvait ou qu'il faisait trop
froid, on descendait dans les caves de la poste
auprès du calorifère et l'on s'y
racontait des « histoires ». En
été, les deux maigres platanes
offraient un abri suffisant pour jouer aux billes
et à mille autres amusements.
Quelquefois le patron, surpris de ne pas
voir arriver ses lettres, venait les chercher
lui-même. Grand émoi au camp des
jeunes employés, qui tous
prenaient alors une mine de circonstance et
s'empressaient au-devant du personnage pour lui
annoncer avec l'air d'en avoir mille regrets - les
hypocrites ! - que le courrier était en
retard.
II
Ce soir-là, - c'était le 31
décembre, - Bobèche était
revenu de la poste où il ne s'était
pas trop longtemps attardé. Il était
occupé à copier à la presse
les lettres que le patron plaçait devant lui
après les avoir écrites.
Tout était silencieux dans le
bureau quand M. Reynardon était
là ; l'on n'entendait que le grincement
des plumes sur le papier et de temps en temps
quelques mots échangés à voix
basse par les commis à propos de leur
travail. Aujourd'hui, le silence semblait plus
religieux encore que de coutume :
c'était le 31 décembre, le jour des
augmentations ; et chacun se demandait si la
« maison » serait plus
libérale à son égard que
l'année précédente. Le teneur
de livres, un homme chauve à la vue
affaiblie par trente ans de labeur sous un bec de
gaz, se prenait à espérer que le
patron ajouterait quelques centaines de francs
à son maigre traitement
en considération de sa nombreuse famille. Le
même rêve semblait bercer dans son coin
le garçon de recettes ; quant au
caissier, il ne semblait point nourrir
d'espérance, peut-être savait-il
déjà à quoi s'en
tenir ?
Et Bobèche ? -
Bobèche était entré dans la
maison depuis six mois ; il était
parvenu à l'âge de douze ans et ne
touchait encore qu'un traitement de quinze francs
par mois. Il lui semblait en bonne conscience que
cette rétribution n'était point
proportionnée à ses importantes
fonctions. Outre le courrier qu'il fallait aller
chercher tous les jours et la copie des lettres,
n'avait-il pas encore le classement, le
répertoire de toutes les
pièces ? Ne faisait-il pas les courses
en ville ? Tout cela valait certainement
vingt-cinq francs par mois au bas mot. C'est ce
qu'on lui avait dit aujourd'hui à la poste
où tous les camarades lui avaient
exprimé leur espoir d'être
augmentés eux-mêmes.
Et Bobèche se représentait
la joie de sa mère quand, arrivé
à la maison, il lui dirait :
« Devine : - Vingt-cinq
francs ! presque vingt sous par
jour ! » Bobèche se prenait
à espérer qu'en considération
de cette augmentation considérable sa
mère voudrait bien, quoique pauvre, lui
laisser quarante sous par mois pour ses menus
plaisirs.
III
L'heure du paiement a sonné ; le
patron a déjà appelé le teneur
de livres dans son cabinet. Bobèche rougit
et tremble à sa place. L'espoir, la crainte
se balancent en son esprit. Enfin il n'y tient
plus.
- Croyez-vous qu'il
m'augmentera ?
souffle-t-il au garçon de bureau.
- Peut-être, répond
celui-ci laconiquement. Mais pour des
étrennes, n'y compte pas. Ce n'est pas
l'habitude de la maison.
Enfin le tour de Bobèche
arrive.
- Monsieur ! répond-il
à l'appel de son nom, et son émotion
est telle qu'il a failli se jeter à bas du
tabouret sur lequel il était
perché.
- Jeune homme, dit le patron d'un air
sévère, je ne suis pas très
content de vous. Vous restez longtemps en course,
particulièrement quand vous allez à
la poste. Les lettres ne sont pas très bien
copiées....
- Monsieur....
- Ne m'interrompez pas. Enfin vous
êtes encore bien jeune.
- J'ai douze ans passé, monsieur.
- Ne m'interrompez pas, vous dis-je. Les
affaires n'ont pas été brillantes
cette année ; nous ne pouvons pas
encore vous augmenter ; dans trois ou quatre
mois, peut-être.... Mais il faudra que nous
soyons plus contents de votre travail, Allez....
Ah ! à propos. Vous n'avez pas besoin
de venir nous souhaiter la bonne année
demain. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir nos
employés ce jour-là.
Bobèche rentra dans le bureau,
anéanti. Tous ses rêves avaient
disparu ! Le caissier lui compta ses quinze
francs, les employés partirent. L'enfant
resta seul avec le garçon de bureau. Il
était accroupi à sa place et
sanglotait.
- Pauvre Bobèche ! dit le
garçon de recettes, tu comptais sur une
augmentation. Tu n'es pas assez vieux dans le
métier, mon enfant. Allons, console-toi. Il
t'a dit que les affaires avaient mal marché,
hein ? ou que tu n'as pas assez
travaillé.... Pauvre petit ! À
douze ans.... Allons, il ne sera pas dit que tu
seras parti d'ici sans emporter d'étrennes.
Tiens, Bobèche, et ne pleure
plus !
Et le brave homme mit dans la main du
jeune garçon une pièce de vingt
sous.
- C'est pour acheter des papillotes.
Allons, adieu ! Tu me diras merci, en me
souhaitant la bonne année
après-demain.
Bobèche sortit en essuyant ses
larmes, et le garçon de bureau s'empressa
d'éteindre le gaz avant de regagner à
son tour le cinquième étage où
sa femme l'attendait.
IV
Quelques instants après, les pleurs de
Bobèche étaient
séchés ; il avait presque
oublié sa déconvenue en longeant la
rue St-Ferréol, merveilleuse ce
soir-là.
Quels étalages aux vitrines des
boutiques ! Les vingt sous du pauvre enfant
sautaient d'eux-mêmes hors de sa poche, comme
s'ils étaient mis en fièvre par le
voisinage de tant de belles choses ; mais quel
rapport pouvait-il y avoir entre ces jouets
magnifiques, ces parures, ces trésors de
toute espèce, et la pièce blanche de
Bobèche ?
Aussi regardait-il tout cela d'un oeil
désintéressé. Il y a chez le
pauvre moins d'envie qu'on ne le prétend.
L'habitude de se passer des choses de luxe lui en
ôte le désir. Il jouit de les voir
sans les posséder, tandis que beaucoup de
riches les possèdent sans les voir et n'en
jouissent pas. C'est ainsi que Dieu, dans sa
providence, établit des compensations.
Chemin faisant, Bobèche se
demandait quel usage il ferait de ses vingt sous.
Il n'avait à attendre d'étrennes de
personne ; sa mère, dont il
commençait à être le soutien,
étant trop pauvre pour lui en
offrir.
Soudain il revit en esprit, dans la
petite cour qu'ils habitaient à St-Lazare,
le pâle visage de Marie, sa petite voisine,
son amie d'enfance, Marie que la maladie tenait
clouée au lit depuis plusieurs mois, et dont
les parents étaient plus pauvres encore que
sa mère à lui.
- Tiens se dit-il, c'est une
idée. Si je faisais des étrennes
à Marie ?
- Et qui t'en fera à toi ?
dit une voix intérieure.
- C'est vrai, tout de même. Il est
pourtant bien juste que je m'offre quelque chose
avec mes vingt sous. Mais Marie est malade, un
petit cadeau lui fera plaisir.... Bah ! tant
pis. Je saurai bien m'amuser sans argent. Il faut
que j'offre des étrennes à
Marie.
Cette décision une fois prise, il
restait encore une affaire très
importante : le choix du cadeau.
Bobèche se hâta de quitter la rue
St-Ferréol ; il sentait bien que dans
ces riches boutiques il n'y avait rien pour lui. Il
gagna le cours Belzunce, où se tenait alors
la foire aux santons. La foire aux
santons est à Marseille
ce que la foire au pain d'épices est
à Paris. C'est l'une des vieilles coutumes
locales qu'aucune révolution n'a
renversée. De temps immémorial le
commerce de petites crèches en bois ou en
écorce de liège, garnies d'un petit
Jésus, d'un Saint Joseph, d'une Sainte
Vierge en plâtre, avec des anges suspendus au
plafond par de trop visibles fils de fer, et des
boeufs, des ânes, des chameaux à
profusion, - de temps immémorial, dis-je, ce
commerce s'est fait à Marseille, à
l'époque de Noël. La fabrication de ces
crèches est évidemment une industrie
du pays ; Saint Joseph a l'air d'un vigoureux
paysan provençal, et les bergers que l'on
voit arriver par une échelle et sur les
flancs d'un rocher en carton peint, portent un
costume plus européen qu'oriental. Devant
l'enfant Jésus on place ordinairement un
petit quinquet qui brûle sans cesse, et
toutes ces lumières brillant dans chacune
des boutiques provisoires érigées
dans la foire, produisent l'effet le plus
pittoresque.
Depuis quelques années - faut-il
s'en réjouir ou s'en affliger ? - la
foire aux santons se modernise, se laïcise,
comme nous disons aujourd'hui. On y vend moins de
plâtre et plus de sucre ; les pantins et
les toupies y font une sérieuse concurrence
aux vénérables mages et à
leurs chameaux. On y voit
brûler moins de quinquets
et plus de becs de gaz. Ainsi s'en vont peu
à peu les vieilles institutions.
Évidemment, nous marchons vers
l'effondrement général....
Bobèche ne pensait guère
à tout cela en arrivant sur le Cours. Il
n'avait qu'une idée : trouver quelque
chose qui ne valût qu'un franc et pût
plaire à Marie. Une poupée ?
L'idée paraît bonne tout d'abord, mais
Bobèche ne tarde pas à la rejeter.
Une poupée, c'est si banal ! Ah !
si ces petites crèches n'étaient pas
trop chères !
Tout à coup, il avise un objet
nouveau ; c'est un délicieux
bébé de cire délicatement
posé sur quatre brins de paille, dans
quelque chose qui ressemble à un panier. Un
vrai petit Jésus, tant il est ressemblant.
Ses pieds et ses mains ont l'air de bouger ;
on dirait qu'il gazouille et se trémousse
comme on le voit faire aux petits enfants
accoutumés à rester
éveillés dans leur berceau.
« Voilà mon
affaire, » pensa Bobèche.
- Combien ce petit Jésus ?
demanda-t-il à la marchande.
- Celui-là ? Deux francs,
mon garçon.
- Ah ! c'est trop cher, murmura
Bobèche désappointé.
- Trop cher ! un Jésus tout
en cire et qu'on dirait vivant ! Mais,
regarde-le donc ! Semble-t-il
pas qu'il va
parler ? On
voit bien que tu n'as pas envie de l'avoir, mon
petit.
- Oh ! que si ! soupira
Bobèche.
- Qu'est-ce que tu veux en
faire ?
Tu es trop grand pour t'amuser de ces
choses-là.
- C'est pour une petite qui est malade,
reprit le jeune garçon.
- Pécaïre, est-ce
vrai ? reprit la marchande. Et combien m'en
donnes-tu, de mon petit Jésus ?
- Je n'ai que vingt sous à
dépenser, dit Bobèche.
- Vingt sous ! eh bien,
prends-le,
pichoun ! Nous serons de moitié dans
ton cadeau à la petite.
Et Bobèche, heureux au point
d'oublier tout à fait qu'il n'avait pas eu
d'augmentation, emporta le Jésus de cire en
remerciant la bonne marchande.
Le brave garçon de bureau qui
mangeait sa soupe à ce moment-là, ne
se doutait pas que sa
générosité en avait
engendré une autre, puis une autre encore,
et que sa pièce de vingt sous faisait la
boule de neige en roulant sur le Cours.
 V
V
Bobèche, portant son tout petit
Jésus comme s'il eût été
vivant, tant il avait peur de le casser, remonta la
rue d'Aix et s'enfonça dans le quartier
St-Lazare. Arrivé dans la cour où il
demeurait, son premier soin fut d'entrer chez
Marie.
Celle-ci logeait avec ses parents dans
une misérable chambre, à laquelle on
arrivait par un escalier extérieur vermoulu.
Le père était ivrogne ; la
mère, blanchisseuse, avait à pourvoir
seule aux besoins du ménage. Rien
d'étonnant que la misère eût
élu domicile dans ce logis.
Dans un coin, sur un lit composé
de quelques planches et d'une paillasse, la petite
fille était couchée, Ses yeux noirs
brillaient de fièvre, mais son visage avait
une expression douce et paisible.
- Bonsoir, Marie, dit Bobèche
doucement en entrant dans la chambre. Je t'apporte
tes étrennes ; je n'ai pas voulu
attendre jusqu'à demain matin.
- Des étrennes à
moi ? tu es bien gentil, Bobèche.
(Même ici le petit employé
était connu par son sobriquet.) - Qu'est-ce
que c'est donc ? demanda Marie en se soulevant
à demi sur son lit.
- Regarde, dit le jeune garçon en
découvrant le bébé de cire. Un
petit Jésus !
- Merci, Bobèche, merci !
Comme il est joli ton cadeau ! C'est de la
foire que tu me l'as apporté ?
- Oui.
- Regarde, mère ! dit la
petite malade ; on le dirait vivant. C'est
Bobèche qui me le donne.
La mère venait d'entrer, un seau
à la main. Elle s'extasia comme de juste
devant le cadeau.
- Moun Dieou, quès
béou ! (1)
répétait-elle en
joignant les mains après l'avoir
admiré.
- Toi qui es si pieuse, dit
Bobèche à Marie, j'ai pensé
que tu aimerais ça. Tu pourras y dire tes
prières chaque matin, censément comme
si c'était un Christ suspendu près de
ton lit.
Marie devint grave soudain : je n'ai pas
besoin de ça, dit-elle. Je vois le Seigneur
Jésus sans cela.
Quelquefois je le vois dans sa
crèche, ou bien lorsqu'il prenait des
enfants dans ses bras; ou bien lorsqu'il
guérissait les malades. D'autres fois, je le
vois sur la croix, et même il me regarde.
- Tu as donc un livre
d'images ?
- Non, je n'ai pas d'images.
- Alors c'est quand tu rêves que
tu vois Jésus ainsi ?
- Non, je ne rêve pas.
- Ah ! par exemple ! fit
Bobèche étonné.
- C'est là que ça se
passe, dit-elle en mettant sa main sur son coeur.
J'ai un livre où il n'y a pas d'images, mais
qui raconte toute l'histoire de Jésus ;
et maintenant que je ne puis plus lire, ça
me revient la nuit. Quand je ne dors pas, je ferme
les yeux tout de même, et c'est alors que je
revois toutes ces choses. Par exemple, le Bon
Berger qui porte son agneau sur ses épaules,
eh bien, quelquefois, c'est comme si je voyais son
portrait sur la muraille, mais un portrait vivant,
puisque je l'entends parler.
- Et qu'est-ce qu'il dit ?
- Oh ! des choses que j'ai
apprises
dans le livre qu'on m'a donné à
l'école du dimanche. « je suis le
bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses
brebis.... Je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent ; je les appelle par leur nom et
elles me suivent. » Alors je lui parle et
le lui dis : « Bon berger,
appelle-moi ! » Et il me
répond : « Voici, je viens
bientôt. » C'est encore une parole
qui est dans mon livre.
- Je voudrais bien que tu me le
prêtes, ton livre, dit
Bobèche.
- Oui, je veux bien te le
prêter ; prends-le là sur
l'étagère. Tu le garderas tant que je
serai malade et tu viendras me
le lire quelquefois. Et puis, écoute :
Garde-le tout à fait, ça sera tes
étrennes. Tu m'as donné un petit
Jésus, moi je t'en donne un autre. Tu verras
son histoire dans ce livre.
- Mais toi, tu en auras besoin, dit le
petit garçon.
- Oh ! moi, répondit Marie,
je ne crois pas. Tout à l'heure, avant que
tu viennes, quand j'étais seule dans la
chambre, si tu savais ce que j'ai vu ! je
n'étais plus ici, j'étais dans une
grande salle où se trouvaient beaucoup de
gens. J'étais couchée sur mon lit et
je voyais sur un beau fauteuil de velours
Jésus assis devant moi. J'avais peur - il
était si beau, si bien habillé, si
brillant, mais il me dit :
- Veux-tu être
guérie ?
Alors j'ai répondu : Oui,
Seigneur. Et tout à coup je me suis
trouvée debout, le lit avait disparu et moi
aussi j'étais habillée toute en
blanc, comme ceux qui étaient là,
comme Jésus lui-même.
- Et qu'est-ce que cela veut
dire ?
demanda le petit garçon.
- Je ne sais pas, mais je pense - ici la
petite fille baissa la voix - je pense que cela
veut dire qu'il viendra bientôt me chercher
pour aller au ciel.
- Mais non, puisque tu seras
guérie.
- Oui, mais pas dans cette chambre,
répondit Marie avec un sourire. Adieu,
Bobèche, merci pour ton cadeau ; tiens,
prends tes étrennes.
VI
Bobèche rentra chez lui et remit à
sa mère les quinze francs de son
mois.
- Eh bien, pas d'augmentation ?
demandât-elle.
Le petit garçon secoua la
tête.
- Et pas d'étrennes non
plus ?
- Des étrennes ? Ah
si ! Marie vient de m'en donner.
- Marie ! des étrennes de
Marie ! tu es fou, je pense ! Tu veux
dire ton patron.
- Non, le patron me m'a rien
donné, mais Marie vient de me faire un
cadeau. C'est un livre....
- Nous avons besoin d'autre chose que de
livres, mon pauvre garçon.
Et la mère passa dans la cuisine
sans attendre de nouvelles explications,
vexée de l'insuccès de son fils.
Le lendemain, Marie était
guérie. On la pleura longtemps dans la
vieille cour. Bobèche n'a pas de plus cher
trésor que son livre, son petit Nouveau
Testament, les seules étrennes qu'il ait
reçues ce jour-là, outre les vingt
sous du garçon de bureau.

|
 ' ÉTAIS un matin dans une gare, attendant
un train qui était en retard. Un homme
singulier m'accosta d'une étrange
manière :
' ÉTAIS un matin dans une gare, attendant
un train qui était en retard. Un homme
singulier m'accosta d'une étrange
manière :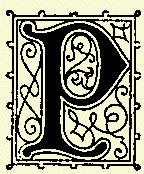 OURQUOI l'appelait-on Bobèche ? Il
n'aurait pas su le dire lui-même, mais
personne ne lui donnait d'autre nom, excepté
sa mère. Dans toute la rue Mongrand
où demeuraient ses parents, dans la rue
Grignan où se trouve la Grande Poste, ainsi
que dans les rues avoisinantes, tous les
garçons de bureau et les petits
employés connaissaient Bobèche, le
jeune saute-ruisseau de la maison Reynardon et
Cie.
OURQUOI l'appelait-on Bobèche ? Il
n'aurait pas su le dire lui-même, mais
personne ne lui donnait d'autre nom, excepté
sa mère. Dans toute la rue Mongrand
où demeuraient ses parents, dans la rue
Grignan où se trouve la Grande Poste, ainsi
que dans les rues avoisinantes, tous les
garçons de bureau et les petits
employés connaissaient Bobèche, le
jeune saute-ruisseau de la maison Reynardon et
Cie.