| Il est
écrit: TA PAROLE EST LA VERITE (Jean 17.17) Cela me suffit... |
REGARD
Bibliothèque chrétienne online EXAMINEZ toutes choses... RETENEZ CE QUI EST BON - 1Thess. 5: 21 - (Notre confession de foi: ici) |
Il est
écrit: TA PAROLE EST LA VERITE (Jean 17.17) Cela me suffit... |
CLAUDE BROUSSONDéfenseur des Eglises opprimées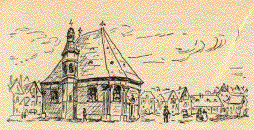
Le soir du 11 septembre 1698, un cavalier monté sur un cheval « à poil rouge », apercevait au loin la jolie ville de Pau, dominée par le château de Henri IV et par les majestueuses montagnes des Pyrénées. Ce cavalier, vêtu en gentilhomme, portait perruque et chapeau galonné. Son portemanteau « de drap sergé brun » contenait du linge, trois perruques diverses, un ample manteau de drap écarlate, une paire de pistolets non chargés, une épée, des papiers couverts d'une écriture menue et des lettres. En approchant, il observait les premières maisons qu'il rencontrait, cherchant des yeux quelque hôtellerie. Il aperçut bientôt, suspendue à son bras de fer forge, l'enseigne du «Chapeau Rouge». Il arrêta sa monture aussitôt devant la porte, mit pied à terre et jeta les guides au valet qui se présentait. C'était l'heure du souper. La grande salle qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger se trouvait pleine de monde. Brouhaha des conversations, cliquetis des verres, rires des servantes qui s'interpellaient entre elles et s'affairaient, appelées de tous côtés, odeur appétissante du potage, des viandes rôties que des marmitons tournaient sur la broche devant un feu d'enfer, du vin du pays qui coulait à flots, des fruits mûrs de cette fin d'été, tout ce bruit, cette animation, ces senteurs mêlées accueillirent Brousson à son entrée dans l'auberge. A l'hôtelier qui s'avançait pour l'accueillir, il demanda un souper et une chambre. L'homme s'empressa de satisfaire ce client important. Il lui trouva une place à la longue table d'hôte, s'assura que le valet s'était occupé de son cheval et fit monter son sac au premier étage. Brousson se trouva donc assis entre un abbé et un gentilhomme et il commença de manger sans mot dire. Mais on liait vite connaissance, autrefois, à la table d'hôte des auberges. Autour du pasteur, les conversations allaient bon train, et force lui fut de répondre aux avances de ses voisins et de causer avec eux. Utile entretien, d'ailleurs, car il apprit par le gentilhomme que, cette même nuit, le baron d'Aroir devait venir coucher au « Chapeau Rouge ». Or, Brousson était justement en possession d'une lettre de recommandation que lui avait remise le sieur Olivier, ancien ministre de Pau, pour M. d'Aroir. Tout en se félicitant de cette heureuse coïncidence, il monta dans sa chambre aussitôt après le repas. C'était une belle chambre meublée de plusieurs lits, comme il était d'usage dans les hôtelleries de jadis. Lourds «cabinets» (armoires) cires et sculptés, fauteuils de tapisserie, couvre-pieds d'indienne à fleurs, baldaquin aux fines colonnettes, le logement du voyageur était bien digne d'un gentilhomme. Brousson avait cru comprendre que le baron d'Aroir devait coucher dans cette même chambre et il s'en réjouissait. Mais le baron n'arrivait pas et ce n'est que, tard dans la soirée que le pasteur déjà couché et à moitié endormi entendit entrer quelqu'un. Le lendemain matin, sitôt levé, il interpella son compagnon de chambre et lui demanda s'il était bien le baron d'Aroir. - je le suis, en effet, Monsieur, répondit le gentilhomme. Prudemment, Brousson répéta sa question une deuxième fois en prononçant le nom tout entier: - Je veux dire Monsieur d'Espalunque, baron d'Aroir ? - Ah ! non Monsieur... Nous sommes deux à porter le même titre, mais je ne suis pas d'Espalunque. Le gentilhomme dont vous parlez se trouve présentement aux Etats de Béarn, assemblés, comme vous le savez, à Lescar, à une lieue de cette ville L'obligeant baron donna l'adresse exacte de son homonyme au ministre, et Brousson s'empressa d'envoyer au « vrai » M. d'Aroir la lettre du pasteur Olivier. Puis, il passa la journée dans l'hôtellerie, à lire et à écrire et ne sortit que le soir, afin de se mettre en rapport avec quelques protestants de la ville. Il quitta le lendemain le « Chapeau Rouge » pour aller loger dans une auberge, tenue par un coreligionnaire, un nomme Bedoras où il pensait être plus en sûreté. Le soir du dimanche 14 septembre, il célébra la Cène et présida le culte chez ce même Bedoras. A cette réunion assistaient l'avocat Abadie, de Pau, des marchands, des artisans et quelques dames et demoiselles qui vinrent « le visage recouvert », de peur d'être reconnues. Le mardi matin, Brousson quitta Pau pour Oloron. Il y arriva sur les six heures du soir et descendit à l'hôtellerie de la Poste. Tout de suite, il se fit conduire par un petit garçon auprès de l'avocat huguenot Guillem. Mais ce dernier s'excusa: il partait justement pour Pau et ne pouvait s'occuper du ministre et organiser des assemblées avant son retour. Brousson, déçu, regagna l'auberge et employa les deux jours suivants à entrer en relation avec quelques réformés de la ville. Mais il était impatient et inquiet. Il avait hâte de pouvoir remplir son ministère à Oloron pour continuer ensuite son voyage. Le lendemain, il se morfondait toujours à l'hôtellerie et son inquiétude grandissait, car il n'était pas prudent pour lui de demeurer trop longtemps en un même lieu. Dans la journée, un protestant nomme Cazemalour lui fait dire de ne pas s'impatienter et d'attendre l'avocat Guillem qui ne tarderait pas la' revenir. Lui-même allait s'occuper de trouver au ministre un logis plus sûr. Mais Brousson, au comble de l'agitation et de l'anxiété, sortit de l'auberge et n'osa pas y revenir dîner. Il roda dans la ville, pressant le pas quand il s'imaginait être suivi, baissant les yeux de peur de rencontrer des regards soupçonneux. Vers le soir, à bout de patience, il décida de quitter la ville et regagna l'hôtellerie de la Poste ou il dit au valet de seller immédiatement son cheval. Puis, il monta dans sa chambre et se hâta de serrer ses hardes dans son portemanteau. Comme il en fermait le cadenas, il se redressa brusquement et prêta l'oreille à une rumeur insolite qui montait de la salle d'en bas: l'hôte parlait haut, d'une voix fâchée... d'autre voix lui répondaient... Soudain, des pas lourds et presses firent gémir l'escalier de bois et, sans qu'on eût frappe, la porte s'ouvrit brusquement. Brousson devint très pâle et comprit tout de suite. Un homme se tenait sur le seuil... derrière lui les soldats de la maréchaussée venaient de s'immobiliser et, dans un silence subit, le pasteur traque et la police royale se trouvèrent face a face. L'inconnu désigna le ministre en disant: - « C'est lui... Saisissez-le ». Dédaignant de chercher à cacher son nom et sa qualité, Brousson tendit les mains aux fers, sans résistance. Le dénonciateur qui avait conduit les soldats au logis de la Poste était un nommé Chaillon, « receveur de la foraine », qui depuis deux jours remarquait en ville cet étranger qui ne fréquentait que des nouveaux convertis. Intrigué et déjà soupçonneux, il s'était souvenu que l'intendant du Béarn venait de faire afficher partout le signalement d'un ministre protestant poursuivi. A tout hasard, il avait prévenu Pinon, qui, des Etats de Lescar ou il se trouvait. avait donne l'ordre d'arrêter immédiatement le suspect. Dès le lendemain, dans la prison de Lescar où on l'avait conduit, Brousson comparaissait devant l'intendant et subissait le premier interrogatoire dont le procès-verbal nous a été conserve. Le pasteur répondit a toutes les questions avec noblesse et sérénité. « Simplement il raconta à son juge toute sa vie, telle qu'elle lui apparaissait à cette heure suprême, dans la continuité de son dévouement à une sainte cause. » Aussitôt après l'interrogatoire, Pinon annonçait l'arrestation du ministre à la Cour et à Bâille. Quel triomphe pour « le roi du Languedoc » ! Son vieil ennemi, l'homme qui l'empêchait de dormir, l'insaisissable fugitif qui semblait narguer les plus fins espions et les plus nombreuses troupes est enfin aux mains des Puissances! Tout de suite, il écrit à Fléchier pour lui faire part de sa jubilation: « C'est seulement, Monsieur, pour vous confirmer la bonne nouvelle que Brousson est pris. je meurs de peur que ce malheureux qui est bien fin n'échappe. Il a fait beaucoup de mal. Il en eût beaucoup fait encore. jamais fanatique ne fut plus dangereux. » Bâville envoya à Pinon le dossier de Brousson, contenant toutes les preuves qu'il gardait en réserve contre le ministre : « de quoi lui faire son procès en deux heures ». Mais, à peine les précieuses pièces arrivées en Béarn, une lettre de M. de Torcy, venant de la Cour, informait Bâville que. par décision royale, c'est lui. même qui jugerait le prédicant. Cette fois, la joie de l'intendant ne connut plus de bornes et il dépêcha sur le champ à Pau un capitaine de M. de Broglie pour réclamer le prisonnier. Lorsque dans la prison du château de Pau où on l'avait transféré, Brousson apprit qu'il allait être ramené à Montpellier et tomber entre les mains de Bâville, il fut au désespoir. Tout au long de son ministère, il avait envisagé avec horreur l'idée de se trouver à la merci de l'implacable intendant. Certes, Pinon l'avait interrogé plusieurs fois sans aucune bienveillance et ne s'était pas fait faute de lui mettre sous les yeux la fameuse lettre a Schomberg, confirmant ainsi que cette pièce accablante se trouvait bien dans le dossier, comme le pasteur le craignait, mais « ce magistrat humain, créature du parti janséniste », lui inspirait moins d'aversion que Bâville. En attendant son départ pour le Languedoc, le malheureux prisonnier passa par une crise d'abattement et de détresse dont la relation nous serre le coeur aujourd'hui encore. Seul, désespérément seul, séparé des siens et de ses amis, non seulement par les murs de sa prison, mais encore par toutes les puissances de ce monde, « il avait pleuré fort souvent », au dire de ses geôliers et les larmes de Claude Brousson, héros et martyr, pèsent pour nous d'un poids écrasant sur la mémoire de ceux qui les ont fait couler. Comme son Maître à Gethsémané, il frémissait d'horreur devant le supplice tout proche et, sans doute, les ténèbres de son cachot entendirent la même prière que le ciel nocturne qui palpitait de toutes ses étoiles, au-dessus du Jardin des Oliviers... « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi... » Mais sans doute aussi, les lèvres tremblantes du prisonnier murmurèrent-elles ensuite les mêmes mots d'obéissance et d'acceptation... « toutefois, que Ta volonté soit faite et non pas la mienne... » 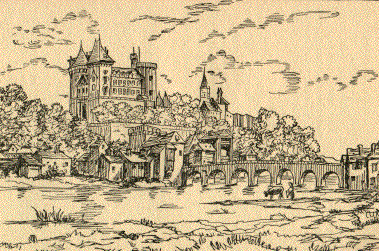
Le jour du départ arriva. Les protestants de Pau, consternés, virent s'éloigner Brousson dans une chaise roulante, entourée de vingt grenadiers. A Narsas, on fit monter le pasteur à cheval jusqu'à Toulouse. Là, il fut remis aux soldats de Broglie qui devaient l'escorter jusqu'à Montpellier. Une relation du temps" nous rapporte tous les détails de ce voyage: « Le comte de Broglie (qui reçut Brousson à Toulouse) le fit embarquer sur le canal (du Midi), escorté de son capitaine des gardes, d'un capitoul et de dix hommes armés, jusqu'à Béziers, OÙ on le fit débarquer et où les deux compagnies du régiment de Moranges l'accompagnèrent jusqu'à une lieue de cette ville (Montpellier). Dès qu'on le sut arrivé en cet endroit, on y fit marcher incessamment deux compagnies de grenadiers du régiment d'Auvergne, avec un détachement de cinquante hommes, deux capitaines et deux lieutenants. L'intendant y envoya aussi sa chaise roulante pour le prendre, aux deux cotes de laquelle marchaient le hoqueton de M. l'intendant et le capitaine des gardes de M. de Broglie qui ne l'avait pas quitté depuis Toulouse. Il y eut plus de six mille âmes qui accoururent au devant de lui pour le voir arriver. Vous l'auriez vu dans sa chaise ou levant les yeux au ciel ou saluant d'un air fort tranquille tous ceux qu'il voyait. Personne ne pouvait retenir ses larmes, voyant mener comme un criminel ce véritable serviteur de Dieu. On le conduisit de cette manière jusqu'à l'Esplanade ou M. de Bâville l'attendait et le fit mettre en même temps dans sa chaise à porteurs et le fit porter à la citadelle. » Brousson connut donc une troisième prison. Il y fut relativement bien traité. On lui ôta ses chaînes. Un seul homme le gardait, mais jour et nuit et sans que la surveillance se relâchât un instant. C'était tantôt le hoqueton de l'intendant, tantôt le capitaine des gardes de Broglie. Tous deux eurent des égards pour lui et montrèrent même de la bonté, surpris sans doute et touches par la noblesse et le rayonnement qui émanaient de ce « criminel ». L'intendant lui-même témoigna d'un certain respect pour le pasteur, le traitant toujours de « Monsieur » et lui envoyant « des viandes de sa table », moins par humanité, d'ailleurs, que par prudence. Dès le lendemain de son arrivée, Brousson comparaît devant Bâville pour subir son interrogatoire. Comme à Pau, il répond simplement aux questions qui le concernent, mais garde obstinément le silence « pour ne pas blesser son honneur, sa conscience et le devoir de son ministère » quand on lui demande de désigner ses hôtes ou ses compagnons d'activité. Brousson, d'ailleurs, plaide sa cause en bon juriste. Lorsque Bâville lui parle de la Déclaration de 1693 qui remet à l'intendant le jugement des ministres rentrés dans le Languedoc, il la déclare juridiquement nulle. « Les réformés, lors dudit arrêt, n'ont été ni ouïs ni défendus, et depuis ils ont continué d'adresser au roi de très humbles remontrances pour lui faire connaître leur innocence et la pureté de leur culte. » L'intendant en vient au principal chef de l'accusation. - « Ne s'est-il point mêlé d'autre chose que de prêcher, comme de faire prêcher pour soulever des peuples et introduire des troupes étrangères dans le royaume ? » Brousson se lance alors dans de longues explications. Il parle, prétend Bâville, « avec une prolixité effroyable ». Fatigue par la longueur de ses discours, l'intendant lui met brusquement sous les yeux la lettre à Schomberg. C'est le coup de massue qu'attendait: et redoutait l'inculpé. Il blêmit et perd un instant, contenance. Mais il n'est pas sans avoir prévu le moment ou il serait mis en face de cette malencontreuse lettre, puisqu'on la lui a déjà présentée a Pau, et sans avoir préparé la déclaration qu'il ferait à son sujet. Reprenant son sang-froid et sans répondre directement à la question répétée par trois fois avec impatience par Bâville « si cet écrit était de sa main ou n'en était pas », il excipe de nouveau de l'amnistie incluse dans la paix de Ryswick, puis il expose ce qu'il a à dire pour la justification de sa conduite. Il atténue - quelque peu au détriment de la vérité, il faut l'avouer - la part qu'il a prise au projet séditieux, dans la première partie de son ministère, avant de changer complètement de vues et de renoncer à toute autre action que l'action spirituelle et il tente d'en rejeter toute la responsabilité sur Vivent. Vivent est mort, et les déclarations de Brousson ne peuvent plus lui nuire. Cependant, nous eussions préféré que notre héros revendiquât hautement la responsabilité de ses actes, et ne reniât pas son ancien compagnon de lutte. C'est la seule fois, qu'au cours de son admirable vie, le pasteur du Désert montre quelque faiblesse... Regrettons-le, mais, avant de le juger, mettons-nous à la place d'un homme aux abois, qui à la torture et la mort devant les yeux... Peut-être aussi faut-il voir dans l'insistance de Brousson à écarter ce chef d'accusation, le désir d'être envoyé au supplice uniquement en tant que ministre de l'Evangile. Et, pour la quatrième fois, Brousson, après avoir consenti à signer plusieurs de ses lettres ou écrits inclus au dossier, refuse de parapher la lettre à Schomberg. A la fin du dernier interrogatoire, l'accusé demande du papier et de l'encre et rédige une requête au roi dans laquelle nous retrouvons son loyalisme impénitent... et sa candeur obstinée. Loyalisme sans espoir... parce que, tout au long de son ministère, Brousson a vainement cherché à concilier « sa fidélité de sujet, qui était le patriotisme d'alors, avec son droit de résistance à l'Eglise romaine, sur lequel sa conscience ne pouvait transiger. La question était insoluble, le roi et l'Eglise, en l'espèce, ne faisant qu'un ». Et candeur... parce que, penser qu'un Bâville voudra transmettre à la Cour une suprême requête, penser qu'un Louis XIV pourra pardonner à un homme dresse contre son absolutisme depuis tant d'années, est d'une naïveté presque inconcevable. D'ailleurs, la supplique au roi eût-elle été envoyée à Paris, qu'elle n'y fut pas parvenue a temps, puisque, dès le 4 novembre, Brousson comparaissait devant le Présidial pour être jugé. La veille, comprenant que son heure approchait, le prisonnier avait demandé de l'encre et du papier pour écrire aux siens, ce qui lui fut refusé. Mais le hoqueton compatissant, lui promit de transmettre à sa famille tout ce qu'il désirait lui écrire. Le jugement eut lieu dans la matinée. « La salle du Présidial était pleine de gens d'église, de robe et d'épée, avides de voir ce jurisconsulte autrefois célèbre, maintenant un pauvre pasteur du Désert, près d'aller à la mort. Brousson dédaigna, comme indigne de la sainteté de sa cause, et comme inutile peut-être d'employer dans sa défense le moindre artifice oratoire. Il parla un quart-d'heure environ avec calme et simplicité, se bornant à dire qu'il était homme de bien craignant Dieu, ministre de l'Evangile et rentre en France pour consoler ses frères malheureux 2. » D'une seule voix, le Présidial condamna le pasteur pour «rébellion, écrits et libelles séditieux et assemblées illicites » à être rompu vif, après avoir subi « la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices ». Bâville fit ajouter à l'arrêt une clause secrète portant que le pasteur serait étranglé avant d'être rompu, ceci, non par humanité « mais afin de finir promptement le spectacle », comme il l'écrivit à Fléchier. 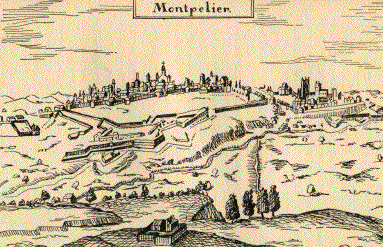
Brousson subit la torture avec courage et ne dénonça personne. - « Messieurs, vous n'avez qu'à faire ce qu'il vous plaira, dit-il en s'étendant sur le « banc de gêne ». Quand vous fracasseriez tous mes os, vous ne m'en feriez pas dire davantage. » Puis, détournant les yeux de ses bourreaux, il regarda plus haut et s'écria: - Seigneur, aie pitié de ta pauvre créature ! Ne m'abandonne pas dans l'état pitoyable où tu me vois, et donne-moi toujours la force et le courage de pouvoir supporter les maux qu'on me va faire souffrir, pour la gloire de ton nom. » Lorsque, meurtri et pantelant, on l'arracha au banc de torture où on l'avait vainement supplicié, ce fut pour l'avertir qu'il n'avait plus que quelques heures a vivre et que l'exécution aurait lieu à la fin du jour... Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est propagée en ville. Les rues de Montpellier grouillent de monde... Plus de dix mille personnes au dire d'une relation, s'écrasent sur le chemin qui va de la Citadelle A l'Esplanade, et sur la place, catholiques et protestants se pressent pour assister au supplice. Mais on aurait tort de croire que la perspective de l'affreux spectacle réjouit les uns comme elle consterne les autres. Notre bon peuple méridional, prompt à la colère et aux disputes, est tendre de coeur et prompt aussi à la pitié. La commisération des catholiques entoure le pasteur aussi bien que celle de ses fidèles. Avant d'écrire les dernières lignes de ce livre, disons bien haut que les gens de chez nous ont toujours vécu en bonne intelligence, même dans les temps les plus troubles, que de nombreux catholiques et même des curés du pays vinrent en aide a leurs voisins huguenots, les aidèrent dans leurs évasions, les nourrirent de leur pain, les avertirent des dangers qui les menaçaient et s'indignèrent des souffrances qu'on leur infligeait. Ce sont le roi, la Cour, les « Puissances » et une partie du clergé qui firent tout le mal. Cependant, le hoqueton vient d'entrer dans le cachot et signifie au prisonnier que l'heure est venue. Brousson est debout, pâle et résolu, raidissant son corps meurtri par la torture. On lui a permis de marcher à l'échafaud « avec ses habits et perruque », c'est-à-dire dans un costume qui lui laisse toute sa dignité extérieure. Avant de suivre le hoqueton et le capitaine des gardes, il les prie d'accepter l'un sa montre, l'autre son manteau d'écarlate, en reconnaissance des égards qu'ils lui ont témoignés. Puis, il pose sa bourse sur le grabat et demande qu'on la fasse parvenir à Madame de Tremoulet, afin qu'elle en distribue le montant aux pauvres. Cependant, sur l'Esplanade, où tant de martyrs huguenots ont déjà été mis à mort, deux bataillons du régiment d'Auvergne, formant une double haie, contiennent avec peine l'énorme foule. « Le menu peuple, dit une relation, s'était mis sur la demi-lune dont les gardes ne purent les déloger. Les gens de distinction se glissèrent entre les rangs des soldats d'où les officiers, par honnêteté, n'osèrent les faire retirer. » Soudain, devant la citadelle, où cinquante mousquetaires attendent le prisonnier, les tambours commencent à battre et Brousson paraît, escorte du hoqueton et de l'abbé de Camarignan, qui, depuis son arrivée à Montpellier, a vainement tenté d'obtenir l'abjuration du pasteur. Le cortège se met en marche. L'impitoyable roulement des tambours, destine à empêcher que le ministre huguenot n'adresse la parole aux fidèles qui se pressent sur son chemin, ne s'arrête pas un instant. Il ne cessera qu'avec le dernier soupir du supplicié. Brousson avance « sans rien voir ni à droite ni à gauche ». Il a tente d'entonner le psaume 346, mais le hoqueton, inquiet, l'a prié de se taire, craignant une sédition. - Hélas, Monsieur, a-t-il répondu, il n'y en a pas la moindre apparence. je discontinuerai, pourtant, et je prierai Dieu. Et, dès lors, il marche en silence, tandis que tout le monde fond en larmes, « en voyant passer cet illustre martyr qui va sceller de son sang la vérité qu'il a prêchée ». Le soleil couchant, le rouge soleil de cette fin d'automne, darde ses derniers rayons lorsque Claude Brousson arrive au pied de l'échafaud. Celui-ci « s'élevait dans un magnifique horizon qui, vers la mer et le soleil s'étendait sans limites comme une voie lumineuse ouverte aux âmes fugitives des martyrs ». Brousson s'agenouille pour une courte prière, puis il monte seul et sans faiblir la fatale échelle. On lui lit alors la clause secrète de l'arrêt, portant qu'il serait étranglé immédiatement. Alors, il tend les bras au bourreau pour être lié et s'abandonne entre ses mains. Un instant encore... puis le lugubre roulement des tambours cesse brusquement... et c'est le silence, un silence solennel, écrasant qui tombe sur la foule frémissante, tandis que l'âme du martyr quitte son corps brisé pour entrer dans l'éternelle paix... Brousson disparu, l'Eglise sous la Croix va connaître bien des vicissitudes encore et de nombreuses années s'écouleront avant qu'elle ne soit restaurée par Antoine Court et surtout, avant qu'électrisée par la grande voix de Rabaut-St-Etienne, député de Nîmes, l'Assemblée Nationale, en 1789, ne proclame la liberté de conscience et l'égalité des Français de toutes confessions. Mais Brousson a été l'ouvrier fidèle qui prépare les moissons futures et se couche dans la tombe avant de les avoir vu mûrir. Par son héroïque ministère, il a soutenu des multitudes d'aines, en leur insufflant la foi, la force, la fidélité qui les aidèrent à braver la persécution et à maintenir, dans la tempête, la flamme vacillante et toujours menacée de l'Eglise huguenote. 0 mort, dont la figure humaine n'est plus qu'une poignée de cendres dispersées au vent des siècles, ton grand souvenir nous est une bénédiction et un exemple. Ta voix qui se tait depuis tant d'années nous parle encore... Chaque fois que nous nous asseyons sur les bancs de nos temples, chaque fois que nous présentons un petit enfant au baptême, chaque fois que nous prenons le pain et le vin de la communion, dans la joie et la paix, nous pouvons bénir ta mémoire et louer Dieu de t'avoir suscité pour restaurer les Eglises dévastées. Car, c'est ton exemple qui apprit à nos pères à rester fermes dans l'épreuve, ce sont tes souffrances qui ont paye notre liberté et c'est ta mort qui, le 4 novembre 1698, « a ouvert une porte que personne ne pouvait désormais fermer ». 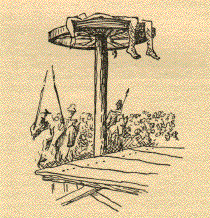 |
| Table des
matières Page précédente:
Page suivante:
|
|
|