| Il est
écrit: TA PAROLE EST LA VERITE (Jean 17.17) Cela me suffit... |
REGARD
Bibliothèque chrétienne online EXAMINEZ toutes choses... RETENEZ CE QUI EST BON - 1Thess. 5: 21 - (Notre confession de foi: ici) |
Il est
écrit: TA PAROLE EST LA VERITE (Jean 17.17) Cela me suffit... |
CLAUDE BROUSSONDéfenseur des Eglises opprimées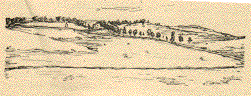
Comment Claude Brousson nous apparaît-il lorsqu'il débarque dans la bonne ville de Castres où il vient exercer son métier d'avocat? Tout jeune encore, il ne ressemble en rien au solennel portrait peint beaucoup plus tard, lors de son séjour en Hollande, par Peter van Bronkhorst, et actuellement au musée de Nîmes. Non, le petit avocat obscur qui donnera, demain, sa première plaidoirie à la Chambre de l'Edit, n'est pas ce prédicateur corpulent et imposant dans sa robe noire au vaste rabat, cet homme fait, calme, puissant, dont les yeux seuls, les yeux sombres et perçants, conservent la vivacité de la jeunesse. C'est un jeune méridional, du type courant, semble-t-il, si nous en croyons les divers signalements que nous possédons de lui : la taille moyenne, le teint « basané », les cheveux noirs, le nez plutôt grand. Mais il a déjà, toujours d'après les descriptions de ses contemporains, ces « belles mains » aux doigts effilés, et surtout, cette « démarche fière » qui le fait remarquer, dès le premier coup d'oeil, parmi les autres jeunes gens de son âge. Lorsqu'il descendit du coche, mêle aux autres voyageurs, et se trouva tout seul, au milieu du joyeux brouhaha de l'arrivée, lorsqu'il eut fait déposer ses bagages à l'hôtellerie, en attendant de trouver un logis, et qu'il s'en fut à la découverte de la ville, celle-ci dut lui paraître assez mesquine, terne, mélancolique même, comparée à Nîmes et à Montpellier, les cités voisines et rivales, toutes deux bruyantes, gaies, ensoleillées. C'était une très petite ville, de sept mille habitants à peine, qui somnolait au confluent de l'Agout et de la Durenque. Elle était faite de pauvres maisons, souvent bâties sur pilotis, qui se miraient dans les eaux lentes de la rivière, et de majestueux hôtels particuliers aux façades orgueilleuses et rébarbatives, dressées le long de rues étroites, pleines d'ombre et de silence. Et, là-dessus, un ciel souvent gris, d'ou descendait trop fréquemment une pluie obstinée, dont le tambourin, monotone, frappait les pavés inégaux et qui s'écoulait en bouillonnant dans la rigole qui passait au milieu de la chaussée... Non, vraiment, Castres, au débotté, n'avait rien d'attirant. Pourquoi donc Brousson la choisit-il pour s'y fixer et y exercer son métier ? C'est sans doute parce que cette ville offrait à un jeune avocat protestant de nombreuses occasions de plaider. Castres était, en effet, le siège de la « Chambre mi-partie » du Languedoc, appelée aussi « Chambre de l'Edit ». Ces Chambres de l'Edit, composées par moitié de juges réformes et de juges catholiques, jugeaient les procès concernant les protestants auxquels on avait voulu donner ainsi des garanties juridiques. La Chambre de Castres comprenait deux présidents, vingt conseillers, un grand nombre de commis, procureurs, greffiers, huissiers et, naturellement, des avocats. Les procès étaient longs, les plaideurs nombreux, aussi, un débutant, comme le jeune Brousson, avait-il bien des chances de trouver tout de suite du travail, au service de ses coreligionnaires. D'ailleurs, si Castres, au premier abord, ne parut pas un séjour enchanteur à Claude Brousson, celui-ci ne tarda pas certainement à lui découvrir des charmes et à s'y organiser une existence « bien faite pour contenter un honnête homme », comme dit l'un de ses biographes. Le chrétien, profondément religieux, trouva dans l'Eglise protestante de Castres que dirigeaient deux hommes de valeur, les pasteurs Gaches et Jaussaud, toute la pâture spirituelle nécessaire à la vie de son âme. Le bourgeois lettré, à l'intelligence vive, à l'esprit ouvert, adhéra avec enthousiasme à l'Académie qui s'était formée à l'instigation des deux pasteurs, aidés par quelques conseillers, tant catholiques que protestants, et qui faisait participer l'élite de la petite ville au mouvement intellectuel et littéraire de l'époque. L'avocat, enfin, ne tarda pas à acquérir à la Chambre de l'Edit, une réputation avantageuse, due aussi bien à ses connaissances qu'à son talent oratoire. L'historien protestant Charles Bost cite à ce sujet le jugement d'un biographe du temps : « Brousson, écrit-il, parlait bien et, sans le flatter, on peut dire : éloquemment, quoique son éloquence eut moins de brillant que de force, moins d'ornements superficiels que de> substance et de moëlle. Son style était simple et, ce semble, sans art, mais net, intelligible et surtout, il était touchant et affectueux par une certaine naïveté qui, souvent, fait plus d'effet et d'impression que les figures les plus magnifiques. » Et Bost ajoute « La naïveté de Brousson, sa franchise d'expression expliquent, en effet, la plupart des circonstances de sa vie agitée et rendent sa personne d'autant plus attachante qu'on l'examine de plus près. « Nature extrêmement sensible, il allait tout entier où sa conscience, son coeur, sa foi le poussaient. Doué d'une piété sérieuse, inébranlable, d'un zèle austère, qu'on trouvait même rigide, il accomplissait méticuleusement ses devoirs de dévotion. La doctrine réformée, sous sa forme la plus stricte, était, pour lui, l'absolue vérité. Mais un mysticisme très personnel, une croyance intime à la puissance féconde de l'Esprit, devait peu à peu pénétrer ses croyances calvinistes d'une douceur à la fois, et d'une hardiesse, qui lui assignent une place à part parmi les protestants de son temps. » Voilà donc Brousson installe à Castres où il mène une vie active, utile, intéressante. Apprécie par l'élite intellectuelle de la ville, reçu dans les vieilles familles bourgeoises ou nobles, aime par les nombreux coreligionnaires dont il prend la défense et particulièrement par les plus déshérités, ce qui l'a fait surnommer « l'avocat des pauvres », il semble définitivement fixé sur les rives de l'Agout. Mais la vie de Brousson ne connut jamais de longues périodes de stabilité. Elle ne fut qu'une succession d'arrivées, de départs, de pérégrinations et de voyages et le jeune avocat devait bientôt quitter Castres. En effet, les ennemis de la Chambre de l'Edit ne tardèrent pas à obtenir un succès appréciable : un édit de 1670 ordonna son transfert à Castelnaudary. « Par là, on ruinait Castres, ville odieuse au clergé à cause de la puissance que les reformes y avaient acquise. On éloignait les conseillers de leurs familles, de leurs biens, de leurs habitations. On les envoyait en un lieu ou il y avait à peine le quart de ce qu'il fallait de maisons pour les loger et où surtout il n'y avait pas d'exercice public de leur religion'. » Dès l'annonce du transfert, les consuls de Castres délibérèrent de la conduite à tenir « pour se garantir d'un si grand malheur » et ils s'empressèrent d'adresser des requêtes à Sa Majesté. Ce fut, bien entendu, peine perdue. Claude Brousson suivit donc la Chambre a Castelnaudary, où il soutint et consolida l'excellente réputation d'avocat acquise à Castres. Mais il ne se borna point à l'exercice de son métier: il continua à se tenir au courant du mouvement intellectuel de son époque et, surtout, il resta, malgré l'absence d'une Eglise réformée à Castelnaudary, un protestant fidèle et fervent. Fait qu'un de ses contemporains souligne quand il écrit : « Quoique sa profession l'obligeât à feuilleter souvent les livres qui traitaient du Droit, ce n'était pas de ceux-là, néanmoins, qu'il faisait son principal attachement. L'Ecriture Sainte constituait sa lecture ordinaire et c'était dans l'intelligence de la loi de Dieu qu'il avait acquis le plus de connaissances des lois humaines. » Quoique résidant à Castres, puis à Castelnaudary, Brousson gardait le contact avec sa ville natale et avec sa famille. Son père était mort, quelques années auparavant, mais il retrouvait A Nîmes sa mère, son oncle et sa tante de Parades, « auxquels je baise très humblement les mains » dit-il, dans une lettre, et beaucoup d'amis, de bons compagnons de jeunesse et d'études. Il retrouvait en même temps les rues familières, pleines de bruit et de gaîté, le bon peuple des ouvriers en soie, des tisseurs de brocards d'or et d'argent, des teinturiers des bords de l'Agau, des maraîchères au verbe haut, des laveuses qui jacassaient, en trempant leur linge dans les eaux limpides de la Fontaine, près du moulin des Dames de Beaucaire, dont le tic-tac couvrait la rumeur de leurs voix mêlées. Il retrouvait le ciel pur, tendu comme une tente bleue et sans taches, au-dessus des pierres antiques des Arènes et de la Maison Carrée et, aux environs de la ville, le « mas » a l'abri de sa rangée de cyprès, avec son toit de tuiles, ses murs éblouissants au soleil, son jardin plein de souvenirs d'enfance, son « olivette » aux arbres vert-argent, sous lesquels, au printemps, les crêtes écarlates des coquelicots et les ombelles roses des fleurs d'ail sauvage, fleurissaient l'herbe rare. Ces séjours à Nîmes devaient être pour Claude Brousson des haltes délicieuses et bienfaisantes, interrompant pour un temps le cours d'une vie austère, laborieuse, une vie de chicanes, de discussions, de luttes contre les assauts de plus en plus nombreux et violents que subissaient les malheureuses Eglises et les infortunes protestants du Languedoc. Ce fut au cours d'un de ces séjours, que Brousson épousa, le 2 janvier 1678, Marie de Combelles, originaire de Béziers. Nous voudrions connaître, autrement que par un simple nom, cette jeune femme qui partagea, pendant quelques années seulement, l'existence de Claude Brousson et qui lui donna deux enfants : Barthélémy et Claude, avant de mourir, peu après la naissance de son second fils. Mais, hélas, nous ignorons tout de Marie de Combelles. Elle passe, ombre légère et imprécise, dans l'histoire de notre héros sans que rien ne nous permette d'évoquer son jeune visage ou son caractère. Brousson a beaucoup écrit. Il n'a pas consacré une ligne à sa première femme, du moins dans les papiers parvenus jusqu'à nous et nous ne possédons que quelques lettres écrites à Marthe Dolier, sa seconde femme. Quelques lettres seulement: froides, guindées, pleines d'une austérité et d'une rigueur qui nous choquent au premier abord. Quelle différence entre ces lettres et celles de Paul Rabaut, qui sera, un siècle plus tard, à Nîmes, un de nos plus grands pasteurs du Désert ! La plume de Rabaut évoque sans cesse sa femme, Madeleine Gaidan, cette « chère compagne » qui partage sa vie dangereuse et menacée et qui l'accompagne au Désert où ils n'ont souvent tous les deux « que la terre pour lit et le ciel pour couverture ». En lisant les lettres de « Monsieur Paul » nous voyons Madeleine partout: à l'auberge de la « Tête d'Or » que tenait sa tante Madon et où eut lieu leur repas de noces, dans la vaste et sombre maison de la rue Caretterie qu'illuminaient sa grâce et sa jeunesse, et plus tard dans la demeure qu'ils firent bâtir « pour inspirer du courage aux protestants » et malgré le danger encore très réel d'être arrêtés. C'est Madeleine qui veille de loin avec lui sur les trois enfants, mis en sûreté en Suisse chez l'ami Antoine Court et, lorsque les « Mirmidons » mécontentent leur tuteur, Rabaut s'en désole plus encore pour elle que pour lui-même: « je ne suis pas sans inquiétudes et ma femme en a peut-être plus que moi. » Toujours, derrière Paul Rabaut, nous voyons se dresser la gracieuse silhouette de Madeleine Gaidan. Derrière Claude Brousson, nous ne voyons ni Marie de Combelles ni Marthe Dolier. Qu'est-ce à dire ? Brousson, dont les biographes soulignent tous l'extrême sensibilité et le grand coeur, aurait-il été un époux indifférent, voire même dur ? Nous ne le croyons pas. Le silence de Brousson sur sa vie privée et sentimentale n'avait rien que de normal à l'époque ou il vivait. N'oublions pas que le XVIIe siècle était très réservé sur tout ce qui touchait à la vie intime, que les sentiments tendres s'extériorisaient peu et que leur manifestation eut paru déplacée et même inconvenante. Songeons, si nous sommes tentes par des comparaisons trop faciles. que Rabaut vivait cent ans plus tard, qu'il avait lu Jean-Jacques Rousseau et suivi le courant qui introduisait dans les moeurs plus de sensibilité, parfois, d'ailleurs, exagérément étalée. 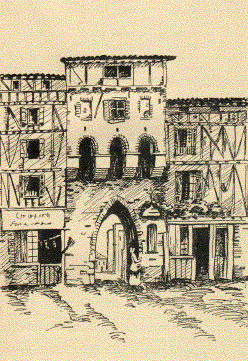
Et quand Brousson, écrivant à sa femme, ne trouve pas d'autres tendresses à lui dire que: « Adieu, ma chère femme et tachez de servir désormais Dieu mieux que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant », peut-être mettait-il dans ce « chère femme », une chaleur que le vieux papier des archives ne nous transmet pas et, dans le rude conseil qui suit, une sollicitude inquiète pour l'âme de son épouse. Une année a peine s'écoule et, déjà, Brousson et sa femme doivent transporter leur foyer ailleurs. Le jeune avocat rapporte un jour au logis la nouvelle redoutée: toutes les Chambres de l'Edit vie, rient d'être supprimées. Pourtant, à sa jeune épouse atterrée, il assure que tout n'est pas perdu, que le pain quotidien ne leur manquera point, mais qu'il faut suivre tout le personnel de la Chambre du Languedoc et accompagner les conseillers incorporés au Parlement de Toulouse. Toulouse... a ce nom Marie dut se rasséréner: Toulouse, la ville rose, la vieille cite de briques, «fille Joyeuse de la plus sombre des mères: la noire Maladetta », Toulouse, étalée dans sa plaine opulente, au bord des eaux rapides de la Garonne... allons ! le séjour y sera plus plaisant sans doute, qu'en cet ennuyeux Castelnaudary et Marie se résoudra sans peine au départ. Pour Claude Brousson, il n'a qu'à s'armer de courage, afin de recommencer là-bas une nouvelle vie et de s'y refaire une situation. Du courage, le jeune avocat n'en manque point. Et, quelques mois plus tard, le voilà déjà acclimaté dans sa nouvelle résidence. A Toulouse, cité hostile à la foi réformée, l'arrivée des conseillers et de tout le personnel de la Chambre de l'Edit amène un afflux de protestants, qui ne tardent pas à se constituer en Eglise. Leur culte n'étant pas admis à l'intérieur de la ville, les fidèles s'assemblent dans le petit bourg voisin du Portet. Ils nomment un Consistoire et Brousson en en est élu membre. A ce titre, il représentera son Eglise au Synode du Haut-Languedoc, réuni en 1682 à St-Antonin, et dont il sera le secrétaire laïque. Des ce moment il sera directement intéressé au sort des Eglises reformées. Ce moment, déjà, est tragique. Les protestants vivent les dernières années qui les séparent de la Révocation de l'Edit de Nantes. Les « Puissances » : Parlement, Conseil du Roi, intendants, profitent du moindre prétexte pour interdire l'exercice du culte, ou pour ordonner la destruction de quelque temple... Bien place pour connaître le sort qui attend le protestantisme, Brousson sent venir l'orage. Tourmenté par une inquiétude croissante, révolte par les injustices dont il est témoin, bouleverse par la vision des souffrances et des malheurs qu'il prévoit il est prêt, avec son esprit passionne, sa foi brûlante, son inébranlable courage, a se mettre au premier rang des résistants. Et pourtant, ce n'est pas sans douleur que le jeune avocat envisage la désobéissance aux lois établies et la lutte contre son roi. Nous avons quelque peine, aujourd'hui, à concevoir l'intensité du drame qui s'est joué, à cette époque, dans le coeur des protestants français. Constamment préoccupés d'accorder leur loyalisme à l'égard du souverain avec les exigences de leur conscience, ils sont déchirés par la nécessité de choisir entre la fidélité au « Roi soleil », au monarque éblouissant dont le prestige rayonne sur la France et sur l'Europe entière, et la fidélité à leur foi, à leur Eglise, à leur Dieu. Cruelle alternative ! La résistance ou la soumission. Et comme se soumettre, c'est trahir la conscience, une seule issue reste à ceux qui ne veulent point entrer en lutte ouverte : l'exil. Brousson, plus qu'aucun autre de ses contemporains, a vécu ce drame. Malgré la candeur qu'il montra en diverses Circonstances, il était avocat habile et subtil. « La complexité des affaires judiciaires où les protestants étaient impliqués, avait aiguisé en lui, dit Ch. Bost, ses qualités professionnelles. Toute sa vie militante fuit dominée par le souci de concilier, avec les lois du royaume et le respect dû à un prince absolu, les impulsions irrésistibles de sa conscience religieuse. » Hélas! Il n'était point de compromis possible et Brousson devait en faire la tragique expérience. Plus que les vexations et que les injustices, « l'avertissement pastoral » adressé à tous les Consistoires par l'assemblée du clergé, réunie en 1682 et désireuse d'abattre définitivement l'hérésie, ouvrit les yeux à beaucoup de reformés et les jeta dans la consternation. Cet avertissement contenait de graves menaces, dissimulées, il est vrai, sous une forme modérée. Le ton de la conclusion était même habilement sentimental : « Hé ! quoi donc, très chers frères, disait-on en terminant, empêcherez-vous plus longtemps que votre roi, après avoir vaincu de si redoutables puissances, emporté de si fortes places, assujetti de si grandes provinces et entassé triomphes sur triomphes, ne cueille maintenant cette dernière palme, qu'il estime plus que toutes les autres ? » Que cela était donc bien dit, touchant, flatteur ! Peut-on demander aux gens, avec une plus exquise politesse de renier leur conscience et de trahir leur foi ? Peut-on rêver gant de velours plus moelleux sur la main de fer prête a étrangler toute rébellion ? Pourtant, les protestants de France ne s'y trompèrent point. Ils firent la sourde oreille et attendirent - non sans angoisse - la suite des événements. La répression de leur résistance passive ne tarda point: le temple de Montpellier fut rasé, ceux d'Uzes, de Nîmes, de Montauban menacés et de nombreux ministres condamnés. Les réformés de plusieurs provinces méridionales « voyant, dit Brousson, qu'on avait juré leur perte », présentèrent au duc de Noailles, gouverneur du Languedoc, une requête où ils représentaient les maux dont on les accablait et, « comme ils n'y voyaient d'autres raisons que la haine que l'on avait pour leur religion », ils en faisaient voir l'innocence et la pureté par un résume des doctrines réformées. La requête, comme ses candides auteurs eussent dû s'y attendre, resta sans réponse et n'eut aucun résultat. C'est alors, au printemps 1683, que Brousson se jette résolument et ouvertement au secours de ses coreligionnaires. Une heure décisive a sonné, une scène spectaculaire va se jouer, scène que nous pouvons évoquer aisément, dans ses moindres détails, puisque nous en tenons le récit de l'avocat lui-même'. Brousson est assis à sa table, dans la paix studieuse de son cabinet de travail. Peut-être entend-il, lointaines, derrière des portes fermées, les voix enfantines et joyeuses de ses deux petits garçons, ou la mélodie de quelque psaume qu'une servante fredonne en tirant l'aiguille. Mais, ici, le silence règne, à peine troublé par le va-et-vient du balancier dans la gaine de l'horloge, ou Par le froissement léger des feuilles d'une lettre dont il vient de briser les cachets. La lettre arrive de Montauban. Elle demande à Brousson de prendre devant le Parlement la défense des protestants de cette ville et elle énumère les maux dont ils sont accablés, maux que l'avocat, hélas, ne connaît que trop. Il n'a qu'à tendre la main, et voici, sur la table, d'autres lettres venant d'autres Eglises, qui contiennent exactement les mêmes doléances et toutes réclament ses services. Brousson soupire, réfléchit un moment, les yeux fixes sur la fenêtre ouverte que le ciel printanier emplit d'azur. Puis il taille lentement sa plume tout en poursuivant sa méditation. Enfin, de sa petite écriture ronde et nette, il dresse une liste sur laquelle il inscrit le nom de quatorze Eglises voisines; il va faire adjoindre à la cause particulière de Montauban celle de ces paroisses, ce qui lui permettra de recourir dans sa plaidoirie a une argumentation générale. Il n'est plus maintenant qu'à préparer les paroles décisives qu'il veut dire et a attendre la mémorable séance du Parlement où il prononcera « avec une sainte intrépidité », le plus courageux plaidoyer de sa carrière. Le grand jour est arrivé. Pâle et résolu comme un soldat qui va livrer bataille, Brousson quitte son logis et se dirige vers la salle des séances du Parlement. Il a dû beaucoup prier pour que lui soient inspirés les mots qui touchent et qui persuadent; il porte en lui un mélange d'angoisse et d'espoir, il lutte - ce violent, ce passionné - pour rester calme et maître de lui, et c'est d'un pas assuré et la « démarche fière » qu'il fait son entrée dans la salle et gagne sa place. La plupart des juges sont déjà là, entourés de toute une foule élégante : grands bourgeois, nobles ou prélats. Il court dans les rangs pressés un murmure léger de bonne compagnie. De cérémonieux et profonds saluts s'échangent, les têtes aux grandes perruques bouclées s'inclinent, tandis que, çà et là, le pommeau d'une épée, les boutons d'argent d'un habit, les pierreries d'un bijou, scintillent au soleil. Brousson adresse quelques signes de politesse à des amis qu'il reconnaît dans l'assistance. Un Père jésuite se glisse dans la foule et vient s'asseoir derrière lui. Soudain le murmure de voix se tait et, dans un profond silence, le Président déclare que la séance est ouverte. Peut-être d'autres affaires sont-elles jugées avant celle de Montauban, peut-être d'autres avocats parlent-ils avant Brousson, qui doit alors contenir son impatience, tandis que son coeur bat de plus en plus fort et que l'angoisse lui serre la gorge. Mais enfin voici le moment de prendre la parole. L'avocat se lève... Le silence lui semble terrible et tous ces visages tournes vers lui, innombrables. Avant même d'avoir ouvert la bouche, il croit percevoir déjà une réserve... une hostilité... n'est-ce point folie que de prétendre convaincre ces gens ? Qu'importe ! Il faut parler. Et Brousson parle, avec une audace inouïe. Dépassant le sujet des paroisses incriminées, il s'élève jusqu'à des considérations générales et « fait voir sommairement à ces juges prévenus, parmi lesquels il y avait de grands prélats romains, la pureté et la sainteté de la religion qu'ils voulaient abolir. » L'auditoire paraît extrêmement attentif. Est-il intéressé, touche, gagné? Ou, dissimulant sa malveillance, écoute-t-il, au contraire, les paroles de l'avocat pour le prendre en défaut ? Quelles seront ses réactions tout à l'heure ? Brousson ne le sait pas, mais cette attention l'encourage et il continue avec plus d'assurance et plus d'ardeur encore. « J'eus la consolation - écrira-t-il plus tard - de voir que cette confession remplit d'étonnement tout ce grand sénat, aussi bien qu'un fort grand nombre d'ecclésiastiques catholiques romains et d'autres personnes distinguées qui étaient présentes. Comme tout le monde était dans un silence extraordinaire pendant que je parlais de notre religion, un des plus célèbres avocats romains dit à l'un de ses confrères: Hé ! Qu'entendons-nous là ? Le Parlement fait tous ses efforts pour abolir la religion prétendue réformée, et, dans le même temps, on la lui vient prêcher en face ! ... » Les derniers mots du discours de Brousson tombent dans ce « silence extraordinaire ». Il se tait et se rassied. Alors naît et grandit un grand brouhaha parmi la foule, alors les sentiments se montrent, chacun à la parole et exprime sa pensée. Or, il faut le dire, la première réaction n'est pas une réaction de haine ou même d'hostilité. Non, cette plaidoirie courageuse et sincère, a étonné, a touché, a troublé l'auditoire. Le Procureur Général parait décontenancé. Il balbutie quelques phrases que personne n'entend, puis, sa voix s'élève, dominant les murmures de l'assistance, pour déclarer: - « Il faut avouer, Messieurs - et dans son trouble, il répète plusieurs fois : il faut avouer, Messieurs, que ce sont là de belles idées de religion. » A ces mots, Brousson est de nouveau debout : - « Ce que vous appelez de belles idées de religion, réplique-t-il très haut, c'est la religion même que les réformés professent ? Vous convenez donc que cette religion est pure et conforme à la Parole de Dieu ? » La rumeur de la foule couvre encore une fois la réponse du Procureur. Mais Brousson n'est pas au bout de ses étonnements. Quand il se lève pour partir, le jésuite, assis derrière lui, s'approche, les mains tendues, « l'embrasse fortement » en répétant les larmes aux yeux: - Vous m'avez fort édifié... Oui, Monsieur, vous m'avez fort édifié... Mais le premier moment d'émotion passe, les juges se retrouvent assez embarrassés. Maintenant que s'est tue la voix persuasive de l'avocat et dissipée l'atmosphère de sympathie qu'il avait réussi à créer dans la salle, maintenant que les voilà seuls entre eux pour rendre une sentence, ils sont repris par leurs vieilles méfiances, leurs vieux parti pris, leurs vieilles craintes. Cet homme, ce Brousson est une force, on n'en peut douter... mais une force dangereuse... Ne serait-ce pas prudent de le faire arrêter ? C'est l'avis de plusieurs conseillers, mais non celui du président Fieubet. Il est plus prudent encore, et se croit plus habile: Non ! non !... pas d'arrestation spectaculaire qui parerait Brousson d'une auréole aux yeux de ses coreligionnaires. Pourquoi ne pas tenter de le gagner par des promesses alléchantes... Que dirait-il, par exemple, d'une place de conseiller au Parlement en échange de sa conversion ? ... Il y aurait là, sans doute, de quoi le tenter... Eh bien, non !. Brousson ne se laisse pas tenter. Les offres et les promesses le laissent froid et méprisant. Ces Messieurs du Parlement n'ont pas encore compris à quelle sorte d'homme ils s'adressent ! Au soir d'une journée dont il espérait tant, l'avocat, épuisé de fatigue et d'émotion, peut faire un mélancolique bilan : il n'a obtenu qu'un succès éphémère et superficiel; le résultat quant à sa plaidoirie pour les paroisses de Montauban et autres lieux est négatif, puisque la décision concernant ces Eglises a été ajournée « pour ne pas mettre trop de bois au feu à la fois », selon l'expression du duc de Noailles. Enfin, un affront personnel l'a profondément blessé: on a tente de l'acheter... On l'a cru capable de renier sa foi et de trahir sa conscience pour de misérables avantages matériels ! Le jour radieux de printemps peut finir, Toulouse, la ville rose, peut resplendir et chanter dans la gloire du soleil couchant, et les hirondelles se croiser comme des flèches noires, devant la fenêtre ouverte, avec de longs cris joyeux, Brousson reste insensible à tant de lumière et de joie. Il fait sombre en lui. Une immense déception l'accable : le découragement le guette. Mais il n'y succombera pas. Il n'est pas seul. Il sait qu'il a un Dieu vers lequel il peut aller comme un enfant confiant, en disant avec le psalmiste : « Prends pitié de moi, car la détresse assaille mon coeur. » Et, demain, il repartira plein d'un nouveau courage.  |
| Table des
matières Page précédente:
|
|
|