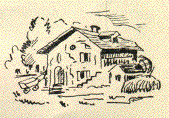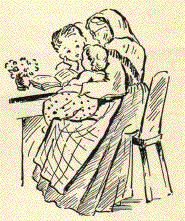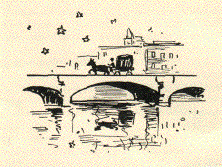Le passeport
CHAPITRE PREMIER
C'était une triste
maison que celle du fermier Martin. Triste, dans
plus d'un sens. L'habitation délabrée
menaçait ruine, car les réparations
les plus urgentes n'avaient pas été
faites depuis longtemps. Les portes fermaient mal,
le vent s'engouffrait à travers les
fenêtres auxquelles manquaient bien des
carreaux, les clôtures du jardin
étaient renversées et la cour
était encombrée d'outils et
d'instruments aratoires en mauvais état.
Hélas ! si la ferme et ses abords
n'étaient guère engageants, que dire
de la condition de ceux qui
l'habitaient ?
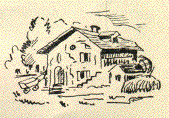
Le fermier était un
homme jeune encore, fort et robuste en apparence,
mais faible de caractère et se laissant
entraîner par le premier venu. Martin n'avait
jamais compris qu'il était un pécheur
perdu et que le chemin dans lequel il
s'était engagé lie conduisait
infailliblement à la perdition
éternelle. Pourtant les avertissements ne
lui avaient pas manqué. Dieu lui avait
parlé de bien des manières, par la
maladie, par le moyen d'amis chrétiens
aussi, mais il refusait d'écouter, accusant
sa « mauvaise chance », et ne
voyant pas que son orgueil, sa paresse et son
incurie étaient la cause de tous les maux
qui s'abattaient sur lui et sur les
siens.
Sa femme souffrait
bien plus que lui de la misère dans laquelle
ils se trouvaient. Elle avait été
élevée par une mère pieuse,
qui s'était opposée
de toutes ses forces à son mariage avec un
incrédule, et maintenant elle reconnaissait
trop tard combien elle avait manqué. Mme
Martin aurait dû chercher aide et secours
auprès du Seigneur, mais si on est
resté oublieux et indifférent pendant
des années, le chemin du retour est souvent
long et douloureux. Cependant Dieu, dans sa
grâce infinie, devait se servir des
circonstances pénibles que traversait Mme
Martin pour la ramener à Lui.
Au moment où
commence notre récit, le mari et la femme
discutent vivement entre eux. Dans la cuisine
sombre et triste, il fait froid. Dans l'âtre,
le feu s'est éteint ; sur la table, les
restes d'un maigre repas. L'homme, assis sur un
escabeau branlant, parle avec
animation.
- Ça ne peut
pas continuer ainsi, déclare-t-il. Se tuer
de travail sans arriver à gagner son pain,
c'est par trop dur. La semence gèle, la
grêle détruit les récoltes, les
pommes de terre pourrissent. Dans de pareilles
conditions, un homme n'aurait pas de quoi vivre
seul, alors je t'en prie, comment entretenir femme
et enfants ?
Avec douceur et
patience, Mme Martin cherche à encourager
son mari, plus elle essaye et plus il s'irrite.
Enfin, il déclare qu'il ne leur reste plus
qu'une ressource : laisser la ferme à
leurs créanciers qui en tireront ce qu'ils
pourront et partir tous deux pour
l'Amérique.
Jusque-là, la
femme avait écouté sans protester,
mais maintenant, elle élève la
voix.
- Tous deux !
s'écrie-t-elle, et les
enfants ?
- Nous les laisserons
ici chez ta mère. Nous n'avons pas le moyen
de les emmener avec nous maintenant. Du reste, pour
arriver à quelque chose, nous devons
être libres de nos mouvements. Plus tard,
nous les ferons venir.
- Tu ne parles pas
sérieusement, Louis. Jamais je ne pourrai me
séparer de mes petits et puis, quelle charge
pour ma mère, à son
âge
- Je parle
très sérieusement, au contraire. Ma
décision est prise et tu ne
m'en feras pas revenir. Quant à ta
mère, à quoi lui sert sa
piété, si elle ne peut nous rendre ce
petit service ?
La pauvre femme se
tut. Elle savait trop bien à quoi aboutirait
la discussion si elle cherchait à maintenir
sa manière de voir. Elle ne songea pas un
instant à abandonner son mari qui, elle le
savait bien, serait un homme absolument perdu si
elle le laissait à lui-même. Mais ses
enfants ! Son aîné Jacques,
âgé déjà de sept ans, la
petite Lise qui venait d'en avoir quatre, et Marie,
son bébé, son petit
trésor ! Sans doute, ils seraient bien
chez leur grand'mère qui veillerait sur eux
avec tendresse, mais ne plus les voir, ne plus
entendre le son de leur voix, ne plus partager
leurs joies et leurs chagrins... C'était
presque plus qu'elle n'en pouvait supporter. Mme
Martin baissa la tête et une parole entendue
autrefois et trop oubliée depuis, lui revint
à la mémoire : Ce qu'un homme
sème, cela aussi il le moissonne. Ah !
pour elle le jour de la moisson était
arrivé et que recueillait-elle ?
L'amertume et la douleur.
À quelques
jours de là, nous retrouvons les
époux chez la mère de Mme Martin, la
veuve Vernier. Martin éprouvait un respect
mêlé de crainte en présence de
sa belle-mère. Celle-ci les avait toujours
aidés de ses conseils et de son
activité, et il savait qu'à l'heure
actuelle, ils pouvaient compter sur l'affection
dévouée qui lui ferait recueillir
lies enfants, dans sa pauvre maisonnette, tout
près de son coeur aimant. Mais ce que Martin
redoutait, c'était le regard perspicace de
la vieille dame, qui semblait lire jusqu'au fond de
son coeur et mettre à nu son
égoïsme et son impiété.
C'est que la veuve Vernier était une enfant
de Dieu qui, depuis de longues années,
marchait à la suite du Seigneur
Jésus ; elle avait appris à le
connaître comme son Sauveur, puis comme son
Maître. Ayant beaucoup à faire avec
Lui par la prière, toute sa manière
d'être en avait acquis un sérieux et
une dignité qui en imposait à l'homme
bassement asservi à ses propres
passions.
Nous n'entrerons pas
dans le détail de l'entrevue. Qu'il nous
suffise de savoir que Mme Vernier ne s'opposa pas
au projet de son gendre. Elle se borna à
l'avertir que, sans la bénédiction de
Dieu, il ne serait pas plus
heureux en Amérique que dans la vieille
Europe.
- C'est la
bénédiction de l'Éternel qui
enrichit, ajouta-t-elle, et Il n'y ajoute aucune
peine.
Martin, ne se
souciant pas d'en entendre davantage, prit
congé et la mère et la fille
restèrent seules.
- La décision
de ton mari me chagrine, dit la vieille dame, mais
surtout en pensant à toi. Cependant tu dois
le suivre, et que le Seigneur, dans sa grâce
infinie, veuille vous attirer tous deux à
Lui. Toi, ma fille, tu as été
instruite dans ces choses dès ton
enfance ; ta responsabilité est grande.
Tu le sens, je crois, mais combien je désire
que tu trouves en Christ ton Sauveur personnel. Une
fois cette question réglée entre toi
et Dieu, tout le reste deviendra
clair.
Mme Martin pleurait.
Sa mère pria encore avec elle, puis elles se
séparèrent. Quelle
bénédiction d'avoir une telle
mère et de pouvoir lui confier ses
enfants ! Et pour la première fois
depuis bien des années, une prière
s'éleva du coeur de la jeune femme vers ce
Dieu qu'elle avait oublié. Prière
d'humiliation, mais aussi d'actions de
grâces. Il ne l'avait pas laissée
seule dans la détresse et elle avait fait
l'expérience de son puissant
secours.
L'affaire ayant
été conclue, maison et terre vendues,
on avait emballé les effets indispensables
pour le voyage. Martin, insouciant comme toujours,
ne voyait que la nouveauté de la situation,
mais sa pauvre femme, le coeur serré,
comptait avec angoisse les heures qui la
séparaient du départ. Le moment
fixé arriva trop vite à son
gré. Une charrette conduisit Les
émigrants à la gare voisine avec leur
petit bagage. Les enfants les regardaient
s'éloigner sans bien comprendre ce qui se
passait. La grand'mère, elle, le savait trop
bien. « Que Dieu les garde,
pensait-elle ; ici-bas, nous ne nous reverrons
plus, mais Dieu veuille que je les retrouve
là-haut ! »
Elle fut
rappelée au sentiment de la
réalité par les cris de la petite
Marie qui réclamait sa maman. Il fallut la
prendre et la calmer.
C'était bien pour les enfants qu'il
s'agissait de vivre maintenant et le Seigneur
donnerait les forces nécessaires pour faire
face à cette grande tâche.
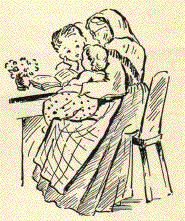
Les voisins plaignaient la
veuve Vernier. À leur avis, elle eût
mérité un peu plus de bon temps dans
ses vieux jours. La présence des enfants
dans la maisonnette diminuait les portions,
abrégeait les nuits et quadruplait la
besogne. Mais tout cela inquiétait peu la
brave vieille qui accomplissait vaillamment le
devoir que le Seigneur lui avait
confié.
Elle exigeait des
enfants une obéissance prompte et joyeuse et
leur demandait de petits services
proportionnés à leurs forces, et
qu'ils étaient tout heureux de rendre, car
ils aimaient tendrement leur bonne
grand'mère. Mais, avant toute autre chose,
la vieillie dame cherchait à conduire ses
petits-enfants au Seigneur Jésus. Elle leur
parlait de sa vie sainte ici-bas, de sa mort sur la
croix, où Il s'est laissé clouer par
amour pour des coupables. Elle leur disait aussi
que ce bon Sauveur est maintenant vivant dans le
ciel et elle leur apprit qu'Il va bientôt
revenir pour chercher les siens. Les enfants
écoutaient avec avidité et leurs
coeurs étaient remplis d'amour pour le
Seigneur Jésus. Mais Jacques comprenait
mieux que ses soeurs et souvent, quand les
fillettes étaient endormies, et que la
grand'mère reprisait les vêtements
endommagés, le petit homme ouvrait la grosse
Bible et en lisait un chapitre à haute voix.
Puis l'aïeule et l'enfant priaient en
semble et se couchaient, pleins
d'une heureuse confiance. « Il a promis
de prendre soin de nous, disait quelquefois Jacques
avec un sérieux au-dessus de son âge,
ainsi tout ira bien. »
De loin en loin
arrivait une lettre d'Amérique ; la
distance était longue et ces missives
n'apportaient ni joie ni argent. Martin et sa femme
n'avaient pas rencontré la fortune de
l'autre côté de l'Atlantique et ils
faisaient la dure expérience que le chemin
de la propre volonté n'est jamais celui du
vrai bonheur.
CHAPITRE
II
Dix-huit mois
s'écoulèrent ainsi ; les enfants
prospéraient, leur santé se
fortifiait, et leur intelligence et leur coeur se
développaient dans cette atmosphère
d'affection. Mais Dieu, dans sa sagesse que nous ne
pouvons souvent comprendre, mais que nous savons
être parfaite, allait leur envoyer une
nouvelle épreuve.
Un matin, au premier
printemps, Jacques, en se réveillant
à l'heure accoutumée, fut tout
surpris de ne voir aucune lumière dans la
chambre, aucune apparence de feu dans le
poêle. Sa grand'mère aurait-elle dormi
plus longtemps que d'habitude ? Il se leva et
vit que la vieille femme reposait en effet sur son
lit. Alors il s'habilla à la hâte et
se mit à préparer le déjeuner,
comme il l'avait fait maintes fois
déjà. Il s'attendait à
l'entendre dire cette fois encore :
« Merci, mon
garçon ! » Mais elle ne
s'éveillait pas ! Quel profond
sommeil !
Oui, bien profond, en
vérité ! Cette nuit-là,
Dieu avait repris à Lui la bonne
grand'mère et ses yeux ne devaient plus
s'ouvrir aux choses de ce monde. Elle était
avec Christ, ce qui est beaucoup meilleur. Jacques,
après avoir longuement examiné ce
visage chéri, comprit enfin ce qui
s'était passé et, tout
effrayé, il alla appeler une voisine. En
quelques minutes la chambre fut remplie de curieux,
mais parmi toutes ces bonnes âmes
compatissantes, il ne s'en trouva aucune qui sut
rendre grâces à Dieu pour la fin si
paisible qu'Il avait accordée à la
veuve Vernier. Tous se lamentaient et plaignaient
les pauvres enfants laissés ainsi, selon
toute apparence, absolument seuls au monde. Mais
personne ne se rappela que Dieu, dans sa demeure
sainte, veille sur les petits enfants et qu'ils
sont très précieux à ses yeux.
Le Seigneur Jésus n'est-il pas venu donner
sa vie pour eux ?
Jacques avait
tendrement aimé sa grand'mère ;
des larmes coulaient sur ses joues, mais il ne
pouvait parler. Il était bien petit encore
et il ne comprenait pas la vraie portée du
malheur qui le frappait.
C'était Dieu qui avait rappelé
à Lui la bonne grand'maman ; elle se
trouvait maintenant dans ce beau ciel dont elle lui
avait si souvent parlé, mais alors pourquoi
était-elle encore là, immobile et
glacée ? Le petit garçon
eût trouvé tout naturel que son
aïeule disparaisse complètement, mais
ainsi, il restait un peu perplexe, quoique toujours
confiant que ce que Dieu faisait était
bien.
Dans la chambre
mortuaire, les voisines bavardaient entre elles,
sans s'inquiéter de la présence des
enfants.
- Que vont-ils
devenir maintenant ? Ils ne peuvent pas rester
ici.
Lorsque Jacques
eût entendu cette question
répétée, sous une forme ou
l'autre, par vingt bouches différentes, il
s'écria enfin :
- Je veux aller en
Amérique, trouver mon papa et ma
maman.
- Et tes soeurs,
où iront-elles ?
- Avec moi, bien
sûr !
Ce projet,
insensé à première vue,
était peut-être le plus raisonnable
après tout. Il s'agissait seulement de
savoir comment on s'y prendrait pour opérer
le transport des trois enfants. Pour le moment, ils
furent placés, par les soins de la commune,
chez une vieille femme (hélas ! ce
n'était pas une grand'maman,
celle-ci !) et le maire du village
écrivit à Martin pour lui faire part
des événements et le sommer de faire
chercher ses enfants ou d'envoyer, avec la somme
nécessaire à la traversée, des
indications précises quant à la route
à suivre, la personne qui devait les
accompagner, etc.
La réponse
arriva aussi vite que possible, bien que
l'intervalle parût fort long à la
commune et aux pauvres enfants aussi. La maman
écrivait quelques pages très tendres
à son petit Jacques, exprimant une profonde
anxiété au sujet du long voyage que
lui et ses soeurs allaient entreprendre tout seuls.
« Je prie le Seigneur Jésus de
vous garder de tout mal », disait-elle en
terminant et, pour le petit garçon
solitaire, cette simple parole fut un
encouragement et un
réconfort. Maman pensait donc comme
grand'mère ! Quel bonheur de le
savoir !
Martin, de son
côté, écrivait au maire ce que
personne ne voulut croire d'abord : les trois
enfants devaient faire le long voyage de France en
Amérique sans être accompagnés.
Il envoyait la somme nécessaire, y joignant
des indications précises et traçant
l'itinéraire de ces trois petits colis
vivants. Le maire devait s'occuper de leur bagage,
bien léger sans doute, puis les conduire
à la gare du, chemin de fer et prendre leurs
billets pour Paris. Là, au numéro 36
d'une certaine rue, ils trouveraient leur tante, sa
soeur, qui les mènerait à la gare de
St-Lazare, et les mettrait dans le train se rendant
au Hâvre. Dans cette ville, ils devaient
chercher un bureau dont l'adresse leur était
donnée et où les attendraient leurs
billets de bord ; le premier du mois suivant
ils s'embarqueraient sur la France. À
New-York, les enfants devaient voir un pasteur, qui
les mettrait sur la voie pour rejoindre leurs
parents. De Dakota, un trajet de peu de jours les
amènerait à Kotteros, où ils
les retrouveraient.
Martin
écrivait en finissant :
« Selon toute probabilité, ce
voyage vous paraîtra extraordinaire. Mais
dans ce pays, on apprend que l'homme ne vaut que
par ce qu'il ose entreprendre, et c'est une
vérité que les enfants ne sauraient
apprendre trop
tôt ».
Bien des gens
s'indignèrent à l'idée de
faire entreprendre un pareil voyage par des enfants
seuls. Mais personne ne se présentait pour
les accompagner. D'ailleurs le père avait
parlé et il portait la responsabilité
de la décision qu'il avait prise. Les choses
en étant là, le plus tôt serait
le mieux. Ce serait une charge de moins pour la
commune. Quant aux enfants, ignorant tout du voyage
qu'ils allaient entreprendre, des dangers
possibles, des difficultés
inévitables, ils étaient
enchantés à l'idée d'aller
retrouver leurs parents. Jacques était tout
à fait persuadé que le Seigneur
prendrait soin d'eux et les fillettes avaient
l'habitude de suivre leur grand frère, que
ce fût dans la maison voisine, dans la
forêt, à Paris ou au-delà des
mers.
On vendit tout ce qui
avait appartenu à Mme Vernier ; on put
ainsi procurer aux jeunes voyageurs un coffre de
bois, un grand sac en cuir et une forte enveloppe
de toile dans laquelle on emballa trois coussins.
Tels étaient les trésors que les
enfants emportaient de leur terre natale. Des
voisins compatissants avaient rempli leurs poches
de provisions de bouche plus que suffisantes pour
atteindre Paris. À peine étaient-ils
assis ; dans le wagon que des mains amies
chargeaient leurs bras de toutes sortes de
friandises. Les recommandations les plus diverses
pleuvaient sur leurs têtes. Mais personne
pourtant n'aurait eu le dévouement
nécessaire pour les accompagner. Jacques
était assis sur son coffre avec Marie sur
ses genoux, Lise était confortablement
installée sur le ballot de coussins et tous
étaient fort étonnés de se
voir les objets de tant d'intérêt.
Tandis que le train s'éloignait, les
voisins, le village et la tombe de la
grand'mère disparurent à leurs
regards.
CHAPITRE
III
Un soir de juillet, vers neuf
heures, un fiacre à l'allure un peu
étrange, venant de la gare de Lyon, excitait
l'étonnement les Parisiens qui le
remarquaient.
« Émigrants ! » se
disaient-ils à la vue du bagage ; puis
ils se ravisaient. « Trois enfants
seuls ! Pauvres
petits ! »
Jacques et ses soeurs
avaient donc franchi sains et saufs cette
première étape de leur long voyage.
Dieu avait incliné le coeur d'un
employé de la grande gare, père de
famille lui-même sans doute. Voyant les
enfants seuls au milieu de la cohue, il leur avait
trouvé un fiacre, avait aidé à
transporter le bagage et, les enfants
installés dans le véhicule, il avait
donné au cocher l'adresse indiquée
par Jacques. La voiture roulait toujours sur des
pavés parfois unis, parfois
inégaux ; elle passait d'une rue dans
l'autre, traversant de vastes places, puis d'autres
rues encore. Il semblait que cette course ne devait
jamais finir. Était-ce donc toujours
Paris ? Jacques se sentait oppressé par
tant de maisons et tant de monde. Les fillettes
pensaient à tout autre chose. Lise caressait
avec admiration l'étoffe râpée
de la banquette sur laquelle elle était
assise. Marie poussait des cris de joie à
chaque réverbère qu'ils
croisaient.
Soudain les maisons
s'éloignèrent. Ils passèrent
sur un pont et virent se refléter dans l'eau
qui coulait au-dessous mille lumières
tremblotantes.
- Que
d'étoiles là-bas !
s'écria l'enfant ravie : regarde,
Jacques, regarde ! Et le petit garçon
regardait, plus impressionné encore par la
foule grouillante qui l'entourait et au milieu de
laquelle il se sentait si seul.
- Encore des
étoiles, s'écria de nouveau la petite
Marie. Et cette fois, il vit de vraies
étoiles scintillant dans le ciel. Alors
Jacques pensa qu'il avait
là-haut un bon et tendre Père dont
l'amour reste toujours le même. Sa
grand'mère lui avait souvent dit :
« Dieu est toujours près de toi.
Il sera partout où tu iras ». Dieu
se trouvait donc à Paris comme ailleurs, et
son oeil veillait sur les trois petits
pèlerins.
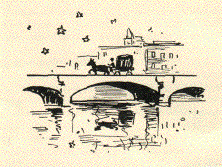
Et la voiture roulait
toujours... Les enfants se sentaient bien
fatigués lorsqu'après plus d'une
heure elle s'arrêta devant une grande maison
ouvrière.
- C'est ici, dit le
cocher.
La bonne tante Ida
fut passablement effrayée en voyant ces
trois petits hôtes inattendus faire irruption
dans son appartement. Elle vivait là depuis
nombre d'années, gagnant son pain quotidien
par son travail de couture. Une seule chambre et
une petite cuisine lui suffisaient. Et maintenant
que faire ? Mais tante Ida cachait un grand
coeur sous des dehors très
modestes.
Elle eut beaucoup de
peine à admettre que ces trois petits
enfants fussent en route pour l'Amérique. Il
fallut, pour la convaincre, que Jacques lui
montrât la lettre de son père. Tante
Ida la lut avec une indignation qu'elle chercha
pourtant à dissimuler devant ses neveux et
nièces. Cela ne l'empêcha pas de
préparer un repas pour les
voyageurs et de les installer pour la nuit dans son
unique chambre. Une fois les fillettes
couchées et endormies dans le grand lit de
la tante, celle-ci put échanger quelques
mots avec Jacques.
- Mon cher enfant, je
ne savais absolument rien de votre arrivée.
Que seriez-vous devenus si j'avais
été absente ? Il m'arrive
quelquefois de passer deux ou trois jours chez des
clientes qui habitent hors de Paris.
Le petit homme leva
vers sa tante ses yeux candides, lourds ce
soir-là de fatigue et de
sommeil.
- Je suis sûr
que le Seigneur a tout arrangé, tante. Lui
savait que nous arrivions
aujourd'hui.
- Tu as raison, mon
chéri, dit tante Ida, en l'embrassant. C'est
Lui qui a tout arrangé.
Ida Martin
était une femme pieuse et tranquille, qui
savait ce que c'est que d'avoir à faire avec
le Seigneur Jésus à chaque instant de
la journée. Elle Lui parlait tout en cousant
ou en vaquant aux soins de son petit ménage.
Il était pour elle l'Ami fidèle,
auquel elle apportait joie et soucis. Il
était aussi son Seigneur, Celui qu'elle
cherchait à honorer et à glorifier
dans tous les détails de son humble
existence. La Parole de Dieu lui était
chère et les pages usées du vieux
livre disaient assez où tante Ida puisait la
nourriture dont son âme avait
besoin.
Les petits eurent
vite fait de s'emparer de son coeur, où un
violent combat se livra au sujet du voyage qu'ils
allaient entreprendre. Elle savait que Dieu
veillerait sur eux et pourtant elle
hésitait. Qui d'entre nous la
blâmerait ? Cependant elle ne pouvait ni
ne devait les retenir. Son travail n'eût pu
suffire à les élever d'ailleurs les
billets étaient pris d'avance au,
Hâvre.
- Si seulement
j'avais quelqu'un à qui je puisse vous
recommander ! dit-elle un soir à
Jacques.
- Mais le Seigneur ne
peut-Il pas le faire ? répondit le
petit garçon, avec sa confiance
habituelle.
Comme un trait de
lumière, ces paroles
pénétrèrent dans le
coeur de la pieuse femme. Elle
vit sa route clairement tracée devant elle
et son âme s'éleva vers Dieu dans une
prière silencieuse. Elle s'humiliait d'avoir
manqué de confiance et rendait grâce
pour l'issue qu'Il lui faisait
entrevoir.
Elle avait fait tout
ce qui était en son pouvoir en
écrivant à une connaissance qui
habitait au Hâvre, pour la prier de s'occuper
des enfants à l'arrivée du train et
de les conduire au bateau. Mais après ?
« Là où s'arrête la
puissance des hommes, celle d'en haut commence
à agir, se dit tante Ida ce soir-là.
Ce que je ne peux pas faire pour ces chers enfants
qui dorment là, si paisibles, insouciants de
tous les périls au-devant desquels ils vont,
le Seigneur le fera
lui-même. »
Cette nuit-là,
unie inspiration lui vint. Le Seigneur du ciel et
de la terre pouvait faire respecter les petits
voyageurs par une seule parole qui était en
même temps une promesse riche de
récompense. Tante Ida se leva, alla prendre
dans une armoire un petit Nouveau Testament et
inscrivit à la première page les noms
des trois enfants en ajoutant
au-dessous :
« Allant de
S. (Jura) à Kotteros, Dakota
(Amérique du Nord), rejoindre leurs
parents. » Puis, plus bas, elle
écrivit d'une main ferme :
« Christ a dit : Ce que vous ferez
à l'un de ces petits, vous l'aurez fait
à moi-même ».
Le lendemain matin,
tout était prêt pour le départ.
Caroline et Marie auraient bien
préféré rester auprès
de leur bonne tante, au grand déplaisir de
Jacques qui répétait d'un air
indigné :
- Mais puisque papa
et maman ont écrit que nous devions aller en
Amérique, nous ne pouvons rester à
Paris. Argument sans
réplique.
Au dernier moment,
tante Ida prit à part son petit Jacques et
lui donna le Nouveau Testament.
- Écoute-moi
bien, mon chéri, dit-elle avec tendresse.
Mets ce livre dans ta poche. C'est le Livre de
Dieu. Lis-en chaque jour quelques versets et
demande au Seigneur de t'expliquer ce que tu ne
comprendras pas. Si tu te trouves dans l'embarras,
dans une gare ou ailleurs, si
quelqu'un te questionne sur le bateau ou en
Amérique, montre chaque fois ce que j'ai
écrit sur la première feuille. Dieu
mettra toujours sur votre chemin quelque bonne
âme qui prendra garde à ces paroles et
vous viendra en aide pour l'amour de Celui qui les
a dites. Souviens-toi de ce que je te recommande
ici. Me le promets-tu ?
Jacques avait
levé vers sa tante ses grands yeux
honnêtes.
- Oui, tante, je le
ferai. Mais, dis-moi, qu'as-tu donc
écrit ?
- Un passeport au nom
de Dieu, répondit solennellement tante Ida.
|