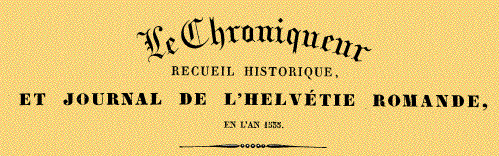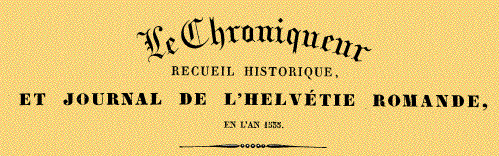
 PROMENADE A
NYON ET AU CHAMP DE BATAILLE DE GINGINS.
(Premier article.)
I
PROMENADE A
NYON ET AU CHAMP DE BATAILLE DE GINGINS.
(Premier article.)
I
Nous abordâmes à Promentou. C'est
un village où se font les échanges
entre les deux rives du lac ; il cessera
probablement d'exister si, comme Monseigneur de
Savoie l'a déjà souvent
ordonné, le marché se transporte
à Nyon.
La noble résidence que le
château de Prangins ! Je ne suis pas
surpris que les Ducs y aient souvent fait demeure.
Les Challand, les Compois l'ont
possédé les derniers ; les
Compois l'ont vendu en 1503 à M. de Rive et
de Grandcour, aujourd'hui Gouverneur de
Neuchâtel.
Voilà Nyon qui se dessine
avec ses clochers : il ne lui manque pour
être la mieux située des petites
villes que d'être assise sur un sol moins
léger et que couvrent de plus beaux
ombrages ; mais à défaut de
feuillages verts elle se couronne à mes yeux
de l'illustration de ses souvenirs. À vrai
dire ce n'est point elle, ce n'est pas la ville que
je vois, dont le nom, depuis quinze cents ans,
reparaît dans nos histoires ; les
cités meurent comme nous, et des villes qui
se ressemblaient peu ont habité l'une
après l'autre la colline dont mon oeil suit
les contours.
D'abord la ville celte, dont il ne
nous est resté que le non, (Noiodonum,
ville-neuve), un nom qui peut-être signifiait
que déjà elle s'était
élevée sur les ruines de demeures
plus anciennes. Cette ville plus ancienne, la
Chronique du Pays de Vaud n'hésite pas
à la caractériser et à lui
donner un nom ; c'est celui de Benevis ;
mais je m'arrête, et pour cause, sur les
confins de la fable ; je n'aspire pas à
voir le Chroniqueur partager la renommée de
la Chronique du Pars-de-Vaud.
À la ville celte a
succédé la cité romaine, la
fille du grand César. Guerrière, elle
se ceignit de remparts et de murailles. Ses portes
furent construites de pierres longues de dix pieds
sur quatre à cinq pieds de largeur. Des
chevaliers romains vinrent l'habiter, et la Colonie
Équestre reçut la mission de couvrir,
de civiliser l'Helvétie, et de l'accoutumer
peu à peu aux moeurs et au joug des Romains.
On n'a pas observé un
fait qui eût
mérité l'attention ; tandis que
les pierres milliaires du reste de
l'Helvétie portent la distance d'Avenches,
celles qui rayonnaient autour de Nyon portent la
distance de la Colonie Équestre ; c'est
que la ville de César doit avoir
été le premier établissement
romain dans nos montagnes, et qu'elle fut chef-lieu
avant qu'Avenches le devint. Ne vous l'imaginez pas
semblable à la ville actuelle ; elle
s'étendait sur la hauteur et se prolongeait
sur le côteau de Prangins, jusques à
Promentou, où elle avait son port. Elle
envoyait au midi les grands arbres du Jura. Le luxe
y habitait et les arts y faisaient leur demeure. La
grande voie commerciale et militaire (via strata)
passait sous ses murailles. Consultez les monumens
.
Mais que dis-je ? ces monumens
sont dispersés ; Genève en a
recueilli quelques-uns ; d'autres gisent
mutilés sur le sol. Bientôt la
cité romaine avec sa gloire n'aura pas
laissé plus de traces que la ville des
Celtes.
Une vérité demeure
pourtant encore gravée sur ce qui nous en
reste ; les noms que portent ces débris
sont ceux de l'empereur, comme d'un dieu, et
d'hommes puissans et redoutés ; et le
style de tous, peu s'en faut, est celui de
l'adulation ; la gloire y est donnée a
Héliogabale, l'amitié même y
est servile ; ils nous apprennent à
n'envier pas le sort de l'Helvétie sous les
Romains.
Notre patrie s'enrichit, mais pour
se corrompre. Elle acquit les arts, mais sans
l'inspiration ; les lois, mais sans le droit
de les appliquer ; la paix, mais une paix
désarmée, qui la laissa molle,
énervée, et la livra sans
défense en proie aux barbares. Quelques
palais s'élevaient auprès des cabanes
nombreuses ; quelques riches vivaient
mollement au milieu de beaucoup d'esclaves.
Vainement les routes, artères
fécondes, unissaient l'Helvétie au
vaste corps de l'empire ; ces veines
renfermaient un sang altéré.
La religion, corrompue comme le
reste, n'apportait ni relèvement, ni vertu,
ni consolation. Pourtant le christianisme vint
tardivement visiter l'Helvétie ; Nyon
eut une église chrétienne ; elle
fut un moment le chef-lieu d'un
évêché ; mais vers la fin
du cinquième siècle,
l'évêque avait transporté son
siège à Belley. Au lieu qu'occupait
la Colonie Équestre nous ne distinguons plus
que des ruines.
Un siècle ne s'était
pas écoulé que naissait une ville
nouvelle ; j'appelle de ce nom les demeures
fortifiées de quelques chefs ou
propriétaires de terre, entourées des
cabanes des serfs qui cultivaient le sol. Tout est
obscur, confus, incertain ; quelques ombres
apparaissent néanmoins dans cette
obscurité. On rencontre quelque temps
après Charlemagne les noms de comtes de
Nyon. Le cartulaire de Lausanne nommé
Verlande, comte des Équestres, avec
Vodelgise, comte de Vaud et Manassé, comte
de Genève. Airbert succède à
Verlande ; c'est lui qui a fondé le
prieuré de Satigny. En 926, Anselme
était comte du Val-d'Aoste et des
Équestres. Selon de bons auteurs il eut pour
successeur Manassé, et Manassé eut
pour fils cet Humbert aux blanches mains, lequel
fonda la puissance de la maison de nos Ducs. La
veuve de Manassé, la mère de Humbert
aurait épousé Rodolphe III, le
dernier des rois de la Bourgogne et Humbert se
serait enrichi des libéralités du
faible prince. Ainsi Nyon se trouverait avoir
été la plus ancienne
propriété des comtes de Savoie sur la
rive septentrionale du lac.
Sous cette domination, Nyon s'est
accrue, a acquis de belles libertés, et est
devenue ce que nous la voyons. Une rue, celle de
Rive, s'est élevée au bord du lac, au
pied de la ville ancienne. Dans le haut, vont et
viennent les prêtres et les seigneurs. Le bas
est la ville de commerce ; la route passe au
travers ; les barques y arrivent de Savoie, et
le chemin qui s'ouvre peu à peu dans les
gorges du Jura, y amène de jour en jour des
marchandises. Le péage de Nyon forme
aujourd'hui un des plus riches revenus des Ducs
dans le Pays-de-Vaud. Le prince compte cette
cité parmi ses bonnes villes ; il
l'aime d'une affection particulière. Nous ne
parlons point ici de ses franchises ; le jour
viendra que nous chercherons à pourtraire
dans son ensemble l'état social du pays et
à caractériser la civilisation des
villes, leurs lois et leurs
libertés.
Allons arriver chez Jean Munier
*, à la
Croix-Blanche. À l'hôtellerie, dans
les rues, aux foyers, tout est encore plein des
événemens dont le pays vient
d'être le théâtre. On ne parle
que de Genève, des Suisses et de la bataille
de Gingins. Le lac se couvre de bateaux, que le Duc
rassemble pour fermer aux Genevois la seule voie
qui leur reste pour se procurer des vivres. Les
moines sont dans la joie d'avoir vu les
Neuchâtelois contraints à se retirer
dans leurs foyers. Ils habitent à Nyon trois
maisons ; l'une, celle des Frères
Mineurs termine la rue de Rive du côté
de Genève ; les deux autres, avec leurs
deux églises, sont dans le haut de la ville
et en occupent les extrémités. D'un
côté est le vieux
monastère de St-Jean,
tourné vers Lausanne et vers le soleil
levant ; St-Jean est le patron de la
contrée, et les sermens les plus
sacrés sont ceux qui se prononcent en son
nom. De l'autre côté est le couvent
des soeurs de Notre Dame ; il regarde
Genève et le midi ; l'église est
de l'an 1471
**. Une route
souterraine, haute de six pieds et large de quatre,
court d'une de ces maisons à l'autre, et de
l'une à l'autre des portes de la
ville ; la malignité l'attribue aux
moines ; je la crois l'ouvrage des Romains.
Peut-être aussi appartenait-elle aux moyens
de défense de la ville dans le
moyen-âge. Des voies latérales s'en
détachent et ont leurs issues dans la
campagne et loin des murs.
II
La distance est d'une lieue de Nyon à
Gingins, La route est celle que faisaient il y a
huit jours M. de LuIlin et les ambassadeurs de
Berne ; derrière eux s'avançait
le Genevois auquel le Gouverneur avait fait trouver
bon d'échanger contre un âne son beau
cheval d'Espagne. Nous approchons du lieu de la
bataille. Ici l'on a rencontré les premiers
fuyards. Les Savoyards occupaient tout le pied de
la montagne. Voilà le taillis, voilà
le ravin desquels sont sortis les
Neuchâtelois. Troupe de braves, honneur
à vous ! vous n'aviez pris les armes
que pour le salut de vos frères, et le pays
qui vous a vus à l'oeuvre rend
témoignage à votre
vaillance.
Descendons. De beaux villages se
succèdent de proche en proche le long du
pied de la montagne, mais aucun de ces villages ne
mérite d'être comparé à
Gingins, le siège de l'illustre maison de ce
nom. L'origine de cette famille se perd dans la
nuit des temps. Les de Gingins se comptaient parmi
les grands vassaux des rois Rodolphiens. Au pied de
la Dole, sur un renflement de la montagne, qui
semblait inviter un édifice à s'y
asseoir, les barons ont d'ancienneté
érigé l'abbaye de Bonmont (1124). En
ce vieil âge, il n'était pas de
seigneur puissant qui n'eut son couvent de
religieux, chargés de prier pour sa
maison ; ce fut aussi dans ce but que les de
Gingins, avec les comtes de Genève,
construisirent le grand édifice qui se
dessine aujourd'hui au loin et domine toute la
contrée. Ils y appelèrent des moines
de l'ordre de Citeaux. Ils les dotèrent
richement. On ne mourrait pas sans faire un legs
aux bons pères, qui
payaient tant de libéralité en messes
pour les vivans et en messes pour les morts. Il est
d'ordinaire que le puîné de la noble
famille soit abbé des religieux de
Bonmont.
Lorsque les princes de Savoie
étendirent leur domination sur le pays, les
barons de Gingins traitèrent avec eux, et
ils les reconnurent pour chefs, à condition
qu'ils en recevraient protection contre leurs
ennemis. Ce fut dès lors que leur maison
s'accrut en biens, en gloire et en
puissance.
En 1374, Jaques de Gingins
épousa Aymonette de Joinville, et devint par
ce mariage seigneur de Divonne et d'une partie du
pays de Gex ; dès lors il prit les
armoiries des Joinville sur son écusson. De
ses fils, Guibert fut abbé de Bonmont ;
l'aîné, Jean, fut un des meilleurs
capitaines du roi Charles VI de France et des plus
redoutés des Anglais. il épousa, en
1415, Marguerite de La Sarraz qui lui donna les
seigneuries de Chàtelard et de Montreux, et
la coseigneurie de Vevey. Il bâtit les
châteaux de Gingins et de Chàtelard.
Le sage Amé VIII le nomma son conseiller. Le
duc Louis l'employa dans plus d'une affaire. Il
mourut en 1461, laissant quatre fils, les seigneurs
Jaques, Jean. Amédée et
Pierre ;
1. Jaques, seigneur de Divonne, a
été chambellan du Duc de Savoie et
son premier maître d'hôtel. De ses
fils, Antoine s'est acquis le plus grand
renom ; il est mort en 1518, président
du conseil du prince.
2. Jean de Gingins,
l'héritier du nom de son père, a
été grand écuyer de Savoie. Le
roi Charles VIII l'a créé chevalier
de sa main, à la bataille de Fornoue. Il est
mort il y a deux ans.
3. Amé est des seigneurs de
la maison de Gingins le mieux connu dans la
contrée. Pronotaire apostolique, chanoine de
Genève, abbé de Bonmont depuis 1484,
nommé en 1513 évêque de
Genève en concurrence avec Jean de Savoie,
de qui il s'est contenté d'être le
grand vicaire et de recevoir une pension, bourgeois
de la ville de Fribourg, l'ami des Suisses et des
libertés de Genève jusqu'aux jours de
la réformation, naguères le compagnon
de table de Bonnivard, bouffon, luxurieux,
libertin, malgré sa robe et son vieil
âge, Amé de Gingins a
déjà paru plusieurs fois dans nos
histoires. Appelée à choisir entre
Farel et lui, Genève a donné gloire
à Dieu, et dès lors M. de Bonmont
s'est condamné à un exil
nécessaire. Nous venons de le voir dans son
abbaye, las, en proie à l'ennui et le pied
déjà dans la tombe.
4. Un quatrième fils de
l'illustre Jean de Gingins était ce
Pierre du Châtelard qui,
en 1476, lors de la guerre de Bourgogne rassembla
de nombreux soldats et se fit tuer à leur
tête, en combattant contre les Suisses, sous
les murs de son château. il laissait deux
fils.
L'un, le seigneur François, a
hérité du Chàtelard et est
revêtu, depuis l'an 1498, de l'office de
châtelain de Chillon et de la Tour de Peils.
Le second, le seigneur Jaques, est
conseiller ordinaire et chambellan de Monseigneur
de Savoie. Peu s'en est fallu que les deux
frères ne soient devenus, en 1515, les
successeurs des grands biens et du château
des sires de La Sarraz. Le dernier mâle de la
maison de La Sarraz venait de mourir,
établissant par son testament sa veuve,
Huguette de St-Trivier, usufruitière de ses
biens. Charles III cependant inféoda comme
suzerain la baronnie aux seigneurs du
Châtelard ; Lucerne, dont ils
étaient bourgeois, Zoug et Schwytz leur
fournirent les troupes et ils s'emparèrent
de La Sarraz, d'où ils chassèrent
Madame Huguette. Que faire ? La fugitive se
rendit à Berne, intéressa à sa
cause l'avoyer de Scharnachthal, et elle obtint que
600 Bernois et 500 hommes de Soleure, marcheraient
à la défense de ses droits.
La guerre devenait sérieuse,
lorsque Lucerne et Fribourg envoyèrent des
médiateurs pour empêcher les
hostilités. Le Duc de Savoie était
à Genève ; on lui fit signer un
arrangement par lequel la baronne fut
rétablie dans ses droits, les Gingins furent
indemnisés, et lui-même il demeura
chargé des frais de l'armement.
La guerre avait duré six
ans ; elle se termina dans les fêtes et
la bonne chère ; les Suisses n'en
parlent encore que sous le nom de la guerre des
chapons. Le seigneur François du
Châtelard, trompé dans son
espérance, s'est distrait de son chagrin en
s'occupant à rebâtir son
château. Son fils a été page du
roi François III ; il s'est dès
l'an 1522 allié à la ville de Berne;
héritier des regrets et de l'ambition de son
père, il ne négligera point, si
l'occasion s'en présente, de chercher
à rentrer en possession de la baronnie de La
Sarraz. ***
III
La route est rapide qui de Gingins conduit au
col du Jura et au village
d'où les Suisses sont descendus. Les
troupeaux des moines de Bonmont paissent
çà et là dans les
pâturages. Le plus souvent on gravit entre
deux rangs rapprochés de sapins.
Tout-à-coup on se trouve sous le
château et en présence des maisons de
Saint-Cergues (Sancti Sergii, S.
Cyriri).
Un temps a été
où la propriété de ces
montagnes était incertaine. Aucune
frontière. Aucune limite dans les
forêts. Le jour vint que les moines de
St-Claude (alors St-Oyen ), qui possédaient
un petit empire au sein des noires Joux,
trouvèrent bon de s'en faire donner la
propriété ; je ne sais si ce fut
par l'archevêque de Besançon ou par
l'empereur. Le titre, authentique ou non, est de
l'an 1184. Le pays se peuplait cependant ;
quelque industrie se faisait jour; le passage
était de plus en plus
fréquenté; les seigneurs voisins et
les moines de Bonmont faisaient reculer les
religieux de St-Oyen, quand un abbé de ce
monastère jugea utile de conférer la
garde du passage et la défense des droits de
son couvent à un seigneur puissant et
valeureux. Il choisit dans ce but le sire de
Thoyre-Villars, son parent, et lui donna (1299) les
vallées de St-Cergues, sous la condition
qu'il y élèverait un château
fort, qu'il reconnaîtrait la
médiateté du couvent, et que les
hommes qui viendraient s'établir dans ces
vallées seraient les serfs des religieux.
Humbert de Villars bâtit le
château. Une charte assura la condition des
habitans. Semblable à toutes celles de
l'époque, elle faisait passer les serfs
à un commencement de propriété
et de sécurité (1557) ;
c'était un faible et premier pas dans la
voie de l'affranchissement *1. Le
nouveau seigneur ne tarda pas d'oublier la
médiateté des moines de St-Oyen. Il
prêtait hommage au duc de Savoie, et les
frontières du Pays-de-Vaud se sont ainsi
trouvées écrites aux lieux où
s'arrêtaient les nouvelles
propriétés des barons de Villars (qui
bientôt après devinrent les barons
d'Aubonne).
Gravissons jusques au château.
À peine avons-nous fait vingt pas que se
déroule à nos yeux le vallon de
St-Cergues. La route qui court vers Arzier a
été une fois la grande route
du pays ; elle a
cessé de l'être depuis qu' on voyage
en sûreté sur les bords du lac.
À moitié chemin des deux villages,
elle passe près du vallon solitaire dont les
sapins ombragent le couvent d'Oujon
*3. Plus loin
se déploient les villages qui faisaient
partie de la grande baronnie d'Aubonne ; ils
appartiennent encore à des membres de la
famille des barons ; Aubonne même est la
propriété des comtes de
Gruyère.
Du côté de France ce ne
sont que noires forêts. Une fontaine, qui se
trouve sur ce chemin, à droite, à 500
pas du village, attire en ces lieux de nombreux
malades de Genève et de tous les
alentours ; on attribue à cette
fontaine une vertu miraculeuse ; elle
guérit la lèpre, la goutte, la gale,
les ulcères ; il suffit de couvrir la
plaie avec la terre limoneuse que les eaux
charrient. C'est St-Claude, disent les moines, qui
guérit les malades par ce moyen
**3.
Cent pas encore et l'on arrive
devant le château de St-Cergues. Quel
spectacle se présente alors aux
regards ! C'est Genève, c'est le lac,
c'est tout le bassin du Léman. Nous suivons
de l'oeil la route que nos pas viennent de
parcourir. À nos pieds se déploie le
fertile pays qui s'étend de la Versoix
à l'Allamane, et que l'on désignait,
il y a peu encore, sous le nom de terre des
Équestres. Le peuple qui l'habite est plus
vif et plus mobile que celui du reste du
Pays-de-Vaud. Ses relations les plus ordinaires
sont avec Genève. Il en dépend pour
le spirituel. Dans l'état de
relâchement où sont tombés tous
les liens politiques, il va quelquefois
jusqu'à oublier qu'il appartient à la
patrie de Vaud et l'on a vu Nyon négliger
d'envoyer ses députés à la
congrégation des villes. Ce peuple est
jusques ici demeuré simple spectateur de la
lutte de son prince avec Genève.

|