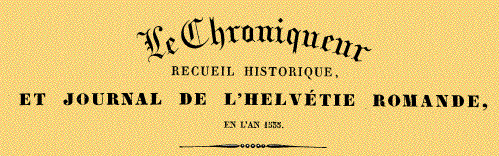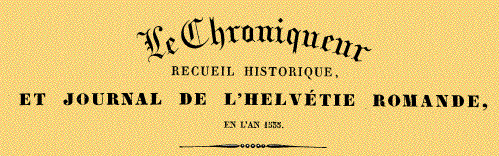
 PROMENADE A
NYON ET AU CHAMP DE BATAILLE DE GINGINS.
(Second article.)
PROMENADE A
NYON ET AU CHAMP DE BATAILLE DE GINGINS.
(Second article.)
Retour par la Savoie,
« Je n'ai point
rencontré la richesse sans les bonnes lois,
l'économie et le
travail. »
Combien ces barques nombreuses, avec
leurs grandes voiles, allant, venant, sillonnant le
lac en tous sens, ajoutent à tout ce qu'a le
Léman de vie et de magnificence ! Ainsi
nous disions, en saluant Nyon, Prangins et la rive
vaudoise, pour naviguer vers la pointe d'Ivoire et
vers Ripaille, la retraite d'Amédée.
Nous ajoutâmes : C'est un bienfait pour
ces rivages que d'appartenir à un même
prince. Les provinces versent librement l'une
à l'autre le superflu de leurs
produits ; vin, blé, fruits,
bétail, elles font sans difficulté
l'échange de leurs richesses ; il en
serait autrement, si jamais elles venaient à
appartenir à des états rivaux, et
divisés d'intérêts. Les
prohibitions, avec tout le cortège de
mesures qui les accompagnent, viendraient se mettre
entre les deux pays. Le commerce souffrirait. Les
liaisons entre les habitans des deux rives
perdraient leur intimité. On ne traverserait
plus le lac aussi fréquemment qu'on le fait
aujourd'hui pour les affaires ou pour le
plaisir ; et le Léman, sur le miroir
duquel l'oeil ne verrait plus à toute heure
courir ces barques légères,
paraîtrait en deuil de jours meilleurs,
triste de ne point remplir une destination amie et
déshérité de quelque chose de
sa beauté.
Un jour a été, selon
le récit de nos pères, où la
navigation était plus animée encore
qu'elle ne l'est aujourd'hui ; c'était,
il y a cent ans, lorsque le sage
Amédée VIII régnait sur la
Savoie. Amédée était
nommé le Salomon de son siècle, et je
ne sais pourquoi la merveille de sa retraite
à Ripaille et de son exaltation au souverain
pontificat nous a fait oublier les bienfaits de son
gouvernement. Je ne dirai rien ici de la haute
estime dont il jouissait, de l'amitié que
lui portaient les républiques et les rois,
des grandes querelles qu'il sut apaiser, des
agrandissemens qu'il fit sans conquêtes, de
l'art qu'il eut d'entretenir de puissantes
armées, en les mettant au service et
à la solde de ses voisins. Je ne veux
à cette heure parler de lui que sous un seul
rapport, c'est celui de la bonne justice qu'il fit
régner dans la Savoie.
Ses lois méritent
d'être étudiées. Elles
substituaient insensiblement à la loi
militaire de la féodalité un ordre de
choses plus équitable. Elles posaient des
limites aux privilèges du clergé.
Elles réglaient l'état des notaires.
Elles protégeaient les orphelins. les
mineurs ; elles donnaient au pauvre un
avocat ; elles voulaient que la cause de
l'indigent fût plaidée la
première et qu'elle le fût
gratuitement. On y rencontre une ébauche de
code criminel. Les appels y sont établis
avec sagesse. Des juges-mages sont élus pour
prononcer sur les différends entre la
féodalité et les communes. Il restait
à donner vie à cette organisation, en
conférant les charges de judicature à
des hommes prudens et habiles, et ce fut en ceci
que se montra bien particulièrement le tact
du prince. Il ne nomma aux places de juges que des
hommes qui avaient été
licenciés en droit.
Sans avoir égard à la
naissance, il choisit ses conseillers parmi les
hommes les plus intelligens et les meilleurs. Les
provinces, grâces à une administration
si sage, connurent les bienfaits de la
sécurité, de la paix sous les lois et
de la confiance dans le gouvernement. Les fruits de
ce nouvel ordre de choses ne tardèrent pas
à se montrer. La terre fut cultivée
avec plus de soin. La Savoie, chose remarquable, se
montra au bout de peu d'années l'un des pays
de l'Europe les plus riches et les plus plantureux.
Elle versa en abondance le blé, le vin, les
châtaignes aux contrées voisines. Le
Pays-de-Vaud qui, se faisant un bouclier de ses
privilèges, n'avait pas reçu la
législation d'Amédée et ne
participait qu'indirectement à ses
bienfaits, le Pays-de-Vaud se trouva bientôt
loin de la prospérité du
duché. Mais cette fleur devait être
passagère ; cette
prospérité était l'ouvrage
d'un homme ; elle a disparu en grande partie
sous la faiblesse orageuse des princes successeurs
d'Amédée.
Nous arrivâmes, en causant
ainsi, devant Thonon. la ville principale du
Chablais. Voilà le château
qu'Amé VlII a agrandi et qu'il habitait une
partie de l'année. Son fils, Louis 1er,
préférait ce séjour à
celui de toutes les autres villes de ses
états. Combien la vue de ce château
doit être belle sur
l'amphithéâtre que forme le
Pays-de-Vaud.
Voici le couvent des
Bénédictins. Voici l'église de
la Ste-Vierge. Cette maison est celle de
Monseigneur Aymon de Genève, baron de
Lullin, gouverneur du Pays-de-Vaud. Sa famille, qui
descend de celle des anciens comtes du Genevois,
est la plus ancienne, la plus illustre et la plus
riche du Chablais. Notre gouverneur Aymon, chose
rare parmi nos gentils-hommes, honore son rang par
son savoir dans les langues, dans l'histoire et
dans les mathématiques. Le Duc l'a
créé, en 1526, chevalier de
l'annonciade. Il lui a commis la charge aujourd'hui
difficile de bailli du Pays-de-Vaud. Son dessein,
si nous sommes bien informés, est de lui
confier bientôt l'éducation de son
fils le jeune prince Emmanuel Philibert.
Prenons terre à Ripaille et
courons chercher les traces d'Amédée.
Ripaille était un couvent d'Augustins.
Auprès du monastère, Amé a
fait construire un château, composé de
sept appartemens et de sept tours, ayant chacune
leurs dépendances et un jardin. Les jardins
communiquent à un grand parc planté
de chênes dont les sept allées,
distribuées en étoiles ont chacune
pour perspective la vue d'une des villes ou d'un
des bourgs du Pays-de-Vaud. Ici notre sage a
vécu cinq ans, la barbe longue, sous la robe
grise et le capuche des hermites,
Il n'avait renoncé ni
à la dignité des formes, ni aux
délices de la table, ni à une
société choisie. Jamais il n'avait eu
en main les fils de plus d'affaires que depuis
qu'il avait fait ses adieux au monde ; jamais
il n'avait été plus
nécessaire. Un beau jour il se
réveilla pour être salué le
père de la chrétienté. Thonon,
Ripaille ne purent contenir le nombre des
ambassadeurs et des prélats, qui de toutes
parts venaient lui prêter obédience,
Le duc Louis son fils et trois cents gentils-hommes
piémontais, Savoisiens, vaudois se
trouvèrent bientôt réunis, et
suivi de ce brillant cortège, il alla
à Bâle recevoir les ordres saints et
les habits pontificaux. Il était
nommé pape pour la réforme de
l'Eglise. Les bulles qu'il a publiées ont
été rassemblées à
Genève en huit volumes in-folio ;
(*) il serait
curieux d'y chercher ce que, il y a un
siècle, ou appelait du nom de
réformation. Amé, raconte-t-on, versa
un torrent de larmes en laissant poser la tiare sur
sa tête, et quand il la déposa neuf
ans après, il dit le faire avec une grande
joie. L'acte de sa renonciation se fit à
Lausanne, dans la grande cathédrale, devant
les Pères assemblés. Amé
rentra dans Ripaille, et ce fut dans la
chrétienté à qui lui donnerait
le plus d'éloges. Pour dire jusqu'à
quel point ces louanges étaient
méritées, il faudrait avoir
étudié ses actes et son
caractère avec plus de soin qu'on ne l'a
fait jusqu'à ce jour. N'est-il personne
à qui sa biographie parût un sujet
intéressant d'étude ?
Derrière Ripaille
s'élèvent entre les montagnes les
pastorales vallées de St-Jean d'Aulps et
d'Abondance ; celle d'Abondance où,
selon la tradition, Colomban fonda le
monastère le plus ancien du pays ;
celle d'Aulps, qui conserve fidèlement le
corps de St-Guérin. La Dranse apporte au
Léman les eaux de ces deux vallées.
On passe la rivière sur un pont de
vingt-quatre arches, construit dans le
siècle dernier ; puis on se trouve dans
le pays de Gavot. Évian en est le chef-lieu.
Elle s'élève en face de Lausanne,
couronnée d'un vert
amphithéâtre sous le château que
Pierre de Savoie fit bâtir en même
temps qu'il déclara Évian cité
franche et libre, comme toutes les villes
murées de ses pays. Les habitans de la
petite ville sont en possession de naviguer sans
payer aucun droit dans tous les ports du
Pays-de-Vaud et du Chablais. Ils jouissent, pour
leurs foires et leurs marchés, de
privilèges étendus. On les dit
industrieux. Les soeurs de Ste-Claire fugitives de
la ville d'Orbe depuis l'an 1528, viennent de
trouver un asile dans leurs murs et de fonder un
couvent nouveau.
Avant de traverser le lac, jetons
encore un coup-d'oeil sur la Savoie. Pourquoi
n'offre-t-elle plus le spectacle de
prospérité qu'elle déployait
aux jours d'Amé VIII ? Pourquoi, non
moins fertile que le Pays-de-Vaud, lui
cède-t-elle en richesse, en culture, en
activité ? Parmi les faits qui
l'expliquent il en est un qui me paraît se
présenter en premier lieu. Comparez quant
à l'étendue les
propriétés situées sur l'une
et l'autre rives ; comme elles sont dans le
Pays-de-Vaud divisées, morcelées et
renfermées dans des limites étroites,
et combien il est en Savoie de grandes
propriétés. Dans les deux pays le
clergé possède de vastes domaines.
Mais les seigneurs ... ils sont pour la plupart
grands propriétaires en Savoie, petits
propriétaires dans le Pays-de-Vaud. J'ai
lieu de croire que cette différence
n'existait pas anciennement et qu'il n'en est ainsi
que depuis que, sur l'une des deux rives, on a
reçu de France l'usage des majorats, qui n'a
point prévalu sur l'autre bord. L'usage a
commencé par la famille du prince ; le
principe de la succession par l'âge et de
mâle en mâle l'emporta à la cour
sur l'ancien système des partages ;
puis les grands propriétaires de fiefs,
voulant assurer la gloire de leur maison,
léguèrent pareillement leur fortune
à leurs aînés, laissant aux
puînés des familles la ressource de
l'Eglise ou de médiocres apanages. Ce
principe cependant ne passa pas le lac et n'envahit
pas le Pays-de-Vaud. Je ne sais quelle jalousie
républicaine et quel besoin
d'égalité se trouvent parmi les
traits caractéristiques du peuple de notre
pays. J'y ai vu des fils héritiers de terres
sises en trente lieux divers, et les partager
encore en trente parts nouvelles. Je ne sais s'il
est aucune terre qui soit plus
fractionnée ; elle l'est
assurément trop en plus d'un lieu. Mais ou
ne saurait méconnaître qu'en
général et partout où le
principe n'a pas été porté
jusqu'à la déraison, il a
été favorable à la meilleure
culture du sol.
Nous n'en saurions douter lorsque
nous portons tour à tour nos regards sur le
Pays-de-Vaud, avec sa noblesse plus nombreuse et
plus rapprochée de la bourgeoisie que nulle
part ailleurs, avec ses petites
propriétés en grand nombre, avec son
aisance ; puis sur la Savoie, sur ses grands
domaines, sur leur culture négligée.
Nous ne voulons pas généraliser
au-delà du fait. Il est, nous voulons le
croire, des conditions dans lesquelles la grande
culture porte de meilleurs fruits ; il en est
dans lesquelles elle est la plus favorable à
la production de la richesse ; mais dans les
conditions données où se trouvent les
deux provinces, elle n'a pas produit ces effets. Il
est entr'autres une circonstance qui n'a pu de
moins que d'être malheureuse pour la Savoie.
Les comtes y faisaient jadis leur
séjour ; ils avaient à
Chambéry leur résidence la plus
ordinaire ; et c'est à Turin que se
trouve aujourd'hui la cour. Les états des
Ducs en Italie sont aujourd'hui la partie la plus
riche et la plus importante de leur
domination ; c'est en Italie qu'ils cherchent
à s'agrandir encore ; c'est en Italie
aussi que les nobles savoisiens vont chercher la
cour, dépenser le meilleur de leurs revenus,
et que quelques-uns ont été fixer
leur demeure auprès du prince. Les
Savoisiens propriétaires de fiefs ont
dès lors habité moins leurs
châteaux, donné moins de soins
à leurs domaines, et leur or, ils le
prêtent plutôt aux marchands de
Lombardie, qui savent le faire valoir et en paient
le 20, le 30 et jusqu'au 40 pour cent
d'intérêt, qu'aux Savoyards agricoles,
pauvres, ignorans du commerce, qui ne leur
offriraient que le cinq pour cent du capital. Ainsi
s'enrichit le Piémont et va s'appauvrissant
la Savoie.
SOURCES.
Grillet,
Dictionnaire historique de Savoie. - Costa de
Beauregard, Histoire de Savoie. - Les Statuta
Sabauditoe de l'an 1430 ; je ne sais s'ils se
trouvent sans interpolations. - Quelques mots
d'Olivier de la Marche sur la
fécondité de la Savoie sous
Amé VIII. - L'Amedoeus Pacificus du
Père Monod. - Guichelion, Tom. IV. - Nos
observations sont les déductions les plus
naturelles d'un petit nombre de faits cités
par tous les anciens historiens de la Savoie et
reproduits par MM. Grillet, Dal Pozzo et de Costa.
- Sur le taux élevé de
l'intérêt en Lombardie, voyez Muratori
en plus d'un lieu ; et sur le taux de
l'argent, la gène du commerce et la mauvaise
justice en Savoie, consultez les plaintes
formulées dans les États de 1429 et
1528.

|