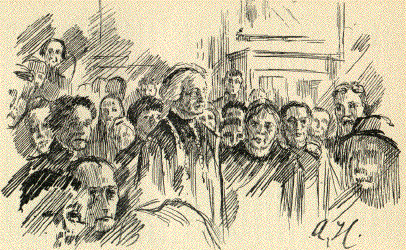Ténèbres et
Lumières
NOUVEAUX SOUVENIRS
DE MATHILDA WREDE
Parmi les fugitifs.
En automne de l'année 1922, Mathilda
Wrede commença une oeuvre parmi les
malheureux qui, fuyant la Russie, avaient
cherché un refuge en Finlande. Ces fugitifs
appartenaient aux nationalités, aux
conditions de vie et aux conceptions politiques les
plus variées. Elle s'intéressa d'une
façon plus particulière aux onze
cents sans-patrie qui avaient trouvé, au
petit bonheur, un asile à la
frontière sud-orientale de la Finlande, dans
l'isthme de Carélie. À peine
avait-elle commencé son travail qu'un jour,
en société, elle rencontra une dame
d'un certain âge, appartenant au meilleur
monde d'Helsingfors.
- Est-il vrai que Mathilda Wrede
consacre toutes ses forces, toute son
énergie, tout son amour chrétien,
oui, tout ! à nos ennemis
héréditaires ? interrogea la dame
épouvantée.
- Quoi donc ? Je n'ai point
d'ennemis et, certes, il ne me viendrait jamais
à l'idée d'avoir des ennemis
héréditaires, telle fut la
réponse de Mathilda.
- Je veux parler des Russes,
expliqua la dame.
- Ah ! Oui, c'est vrai. Mon temps,
mes forces, mon énergie, mon amour
appartiennent, à l'heure présente,
aux Russes fugitifs.
- Pauvres Finlandais !
L'humour éclaira le regard
plein de vivacité de Mathilda.
- Pendant quatre ans je n'ai
vécu que pour les pauvres gens de Finlande.
Comme, à ma grande surprise, J'apprends
l'intérêt qui s'est
éveillé pour les Finlandais dans le
coeur d'une dame aussi riche que vous, je vous les
abandonne désormais volontiers et je m'en
tiens aux Russes.
Bouleversée et silencieuse,
la dame regarda fixement Mathilda ; aucune des
personnes présentes n'articula la moindre
parole, mais avec beaucoup de sérieux
Mathilda continua :
- Il y a bien des années -
c'était au commencement de mon travail dans
les prisons - J'étais à court
d'argent et mes pauvres amis avaient le plus urgent
besoin de secours. Eh ! bien, dans mon pays, je ne
pouvais compter que sur trois seules personnes.
À ce moment-là m'arriva un
télégramme de
Saint-Pétersbourg. Les héros de la
foi, exilés pour leur religion, le colonel
Paschkoff et le comte Korff, avaient reçu
l'autorisation de séjourner dans leur patrie
pendant deux semaines, afin de surveiller leurs
propriétés et pour mettre en ordre
leurs affaires personnelles ; ils exprimaient le
désir de me voir.
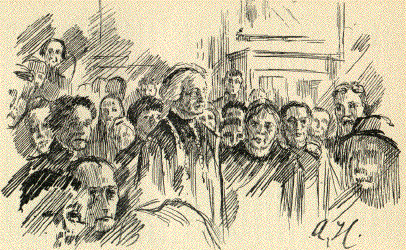 Mathilda
Wrede avec des fugitifs russes.
Mathilda
Wrede avec des fugitifs russes.
D'une part, J'avais une vraie répugnance
à faire ce voyage, parce qu'à cette
époque-là, dans notre pays, on
n'aimait pas les Russes, d'autre part, je
désirais vivement apprendre à
connaître ces hommes qui avaient tout
sacrifié à Dieu et
à leurs convictions religieuses. C'est ce
dernier sentiment qui fut le plus fort. je partis
pour Saint-Pétersbourg où je gagnai
des amis pour la vie. Deux d'entre eux, en
particulier, commencèrent à m'envoyer
régulièrement de l'argent, si bien
que je pus donner des secours matériels aux
prisonniers et à leurs familles. Maintenant
Dieu me fournit l'occasion de payer à une
autre génération la grande dette
d'amour chrétien avec la grande dette
d'argent que j' ai contractée envers les
Russes, pour moi-même et pour les pauvres de
mon pays ; et je veux m'acquitter de cette dette de
confiance et d'honneur en m'intéressant
à la destinée tragique de ces
malheureux ; je continuerai à le faire,
aussi longtemps que Dieu me donnera les forces
nécessaires pour remplir cette
tâche.
Dès lors plus de deux
années se sont écoulées et
Mathilda Wrede, sans se lasser, tient sa
promesse.
Mathilda Wrede, se retrouvant un
jour dans le pays frontière de
Carélie, fut accueillie à la station
de Teriyjokei par des amis connus et inconnus. Il y
avait parmi eux une vieille, très vieille
petite mère, au visage tout ridé et
dont les yeux cernés disaient les larmes
abondantes qu'elle avait répandues. L'un de
ses pieds était chaussé d'une
pantoufle, l'autre d'une galoche ; le reste de son
accoutrement était à l'avenant : ses
vêtements fripés et
rapiécés ne la protégeaient
que très insuffisamment contre les rigueurs
de l'hiver. On racontait l'avoir trouvée, en
compagnie d'une nièce malade d'esprit, dans
un coin d'une chambre de bain
où un coffre leur servait
de chaise et de lit. C'était une de ces
bonnes d'enfants, comme il en arrivait beaucoup en
Finlande et qui, de génération en
génération, remplissent leurs devoirs
envers leurs maîtres avec un entier
dévouement, donnant l'affection tout
entière de leur coeur aimant aux enfants
confiés à leurs soins. Quand la
révolution éclata en Russie, les
familles qui purent le faire, s'enfuirent et
gagnèrent pour la plupart l'Europe
occidentale. Mais les vieilles bonnes furent
laissées au pays, les plus heureuses, du
côté finlandais de la
frontière, les autres, sur terre russe, mais
toutes, abandonnées dans la pauvreté
et le malheur.
Lorsque Mathilda Wrede entendit
parler de cette pauvre vieille, elle accourut
auprès d'elle, lui montra le ciel, lui
disant, dans un russe étrangement incorrect
: « Dieu aime Pelageja !» Cette
compassion, cette affection confondirent la vieille
Pelageja. En gémissant, elle rendit
l'étreinte reçue et, suivant la
coutume russe, elle donna baiser sur baiser
à sa nouvelle amie, au grand
étonnement de toutes les personnes
présentes.
Le jour suivant, on organisa une
fête pour les plus malheureux de ces pauvres
fugitifs, hommes, femmes et enfants de toutes les
classes de la société qui arrivaient
de très loin, par une neige épaisse.
La joie fut à son comble, quand,
après un copieux repas, les enfants
commencèrent à sauter et à
gambader dans la grande salle. La plupart d'entre
eux avait des bottes de feutre et des habits trop
exigus. Des privations de tous genres avaient
marqué leurs pâles visages
d'ineffaçables empreintes. Plusieurs
étaient atteints de tuberculose. Mais en ce
moment, tous les soucis
étaient oubliés ; ce n'était
plus qu'une joyeuse cohorte qui se pressa autour de
Mathilda Wrede à la fin de la fête,
pour recevoir d'elle, en guise d'adieu, encore une
caresse ou un dernier baiser, avant de s'en
retourner dans ses foyers, où l'attendaient
la faim et la détresse.
À la table des plus
âgés, au cours de l'excellent repas
qui fut servi, les représentants des
vieilles familles de la Russie étaient
assis, à côté des plus modestes
ouvriers. Tous étaient réduits
à la même pauvreté ; une
même détresse en avait fait des
égaux et les unissait les uns aux autres.
Ici l'on voyait un chambellan impérial, aux
traits nobles et majestueux, qui avait
été plusieurs fois millionnaire et
avait tout perdu lors de la révolution
russe; il vivait maintenant dans la chambre d'un
domestique, recevant ici et là
l'hospitalité de personnes charitables.
À l'autre extrémité de la
longue table se trouvaient deux dames de la
noblesse de Saint-Pétersbourg, dont les
vêtements usés avaient
été autrefois élégants,
et qui parlaient un français
distingué. Plus loin, le prêtre
orthodoxe et l'évêque catholique
romain voisinaient dans leurs vêtements
sacerdotaux.
Mathilda Wrede ne portait d'habitude
jamais aucune parure quelconque ; elle avait mis,
ce jour-là, un collier de perles
confectionné par des moines et béni
par un « igumen »
(1) et que des
fugitifs lui avaient donné. À son
entrée dans la grande salle toute
l'assistance se leva ; un tzigane de
quatre-vingt-quatre ans, aux cheveux blancs comme
la neige et aux yeux noirs
clignotants, répéta à
plusieurs reprises :
- Dieu vous bénisse et vous
accorde une Iongue vie ! Dieu vous bénisse
toujours davantage et vous fasse vivre toujours
plus longtemps ! Dieu vous bénisse toujours
plus ! toujours plus ! et prolonge encore
longtemps, toujours plus longtemps votre vie
!
Ces bénédictions
répétées attirèrent
l'attention particulière de Mathilda qui
l'interrompit en lui disant
- Nous nous sommes
déjà rencontrés.
- Oui, assurément,
murmura-t-il. je vous ai tout de suite reconnue,
mais ne racontez pas aux autres que j'ai
été en prison.
Non, certes, elle ne le dirait pas :
il n'avait rien à craindre.
Elle prit place sur le siège
voisin resté inoccupé, personne
n'ayant voulu s'asseoir à côté
de lui.
Puis, le repas du milieu du jour fut
servi avec une certaine solennité et dans
l'abandon des conversations particulières ;
on entendit plusieurs discours en russe et l'on
remit à Mathilda Wrede une adresse. Elle ne
comprenait pas grand chose à ce que l'on
disait, mais tous versaient d'abondantes larmes et
la regardaient, et ces larmes, ces regards
étaient, en quelque sorte, la traduction des
paroles pour elle inintelligibles.
La journée était
déjà fort avancée, lorsque
sonna l'heure du départ. Mathilda Wrede
avait encore plusieurs familles à visiter
avant la tombée de la nuit. Avec une grande
amabilité, le commandant de la
frontière avait mis un cheval à sa
disposition pour tout le temps
de son séjour, et l'évêque de
l'église catholique-romaine avait
demandé de pouvoir l'accompagner. Le
traîneau les attendait à la porte,
prêt pour le départ.
Le prêtre russe avait
raconté que sa fille, âgée de
dix-sept ans, était alitée, gravement
atteinte de phtisie. Elle brûlait du
désir de voir « l'amie des Russes
» dont elle avait beaucoup entendu parler,
aussi Mathilda se décida-t-elle
immédiatement à aller la voir. Le
prêtre la remercia, les larmes aux yeux, puis
s'éloigna rapidement pour devancer les
visiteurs et préparer les siens à
l'arrivée de ces amis.
Mathilda Wrede et son compagnon
n'avaient pas encore fait une grande partie du
chemin que le prêtre venait
déjà à leur rencontre et les
rejoignait ; dans ses longs vêtements, il
luttait péniblement contre l'ouragan et
contre le froid, sur une route couverte de neige.
On fit arrêter le traîneau et Mathilda
lui dit avec amabilité :
- Batjuschka (petit père,
c'est ainsi que d'habitude on interpelle le
prêtre russe) montez donc, vous aurez
meilleur temps. Je ne puis pas vous offrir une
bonne place, mais vous pouvez vous asseoir à
côté du cocher.
Il accepta cette offre avec
reconnaissance et se mit près du conducteur,
un garde-frontières.
Tandis que les voyageurs
poursuivaient leur route, une pensée vint
subitement à l'esprit de Mathilda
Wrede:
« Notre Père. »
jamais encore elle n'avait senti, jusqu'alors,
aussi fortement la grandeur de cette
réalité: « Notre Père.
Mon Père, le Père du prêtre
orthodoxe, le Père de
l'évêque catholique romain, le
Père du soldat qui nous conduit et qui n'a
peut-être aucune conviction religieuse
quelconque. Le Père sûrement aussi du
maigre cheval qui les faisait avancer. Admirable,
cet amour qui embrasse, qui réunit tout et
tous ! »
Voici le traîneau
arrêté à l'entrée d'une
villa, sur le rivage du golfe de Finlande et
d'où l'on aperçoit vaguement, dans le
lointain, les tours des églises de
Cronstadt. Le prêtre invita Mathilda à
entrer auprès de la jeune malade qui, un peu
confuse, mais très joyeuse, salua
l'étrangère. Mathilda avait peine
à s'adresser à quelqu'un en
présence de tant de monde ; elle finit par
prendre dans sa poche un billet de banque et
à le cacher sous l'oreiller de la jeune
fille à laquelle elle dit :
- Prie ta maman de t'acheter avec ce
que je te donne, des oeufs, du beurre et quelques
autres aliments fortifiants.
La jeune fille souleva son oreiller
et considéra le billet de cent marcs qui
venait de lui être remis. Il y avait bien
longtemps qu'elle n'avait vu et encore moins
possédé une aussi forte somme
d'argent. Et des larmes de joie couvraient ses
joues.
Mais le plus remarquable c'est que,
lorsque Mathilda parcourut la même
contrée quelques mois plus tard, la jeune
fille était complètement
guérie et personne ne put lui ôter de
l'idée que Dieu lui avait rendu la
santé par l'entremise de Mathilda
Wrede.
De là, le voyage continua
ensuite de ville en ville et de village en
village.
Dans une école populaire,
c'est la femme d'un
général et une
baronne qui remplissaient les fonctions de
domestiques. L'une de ces deux dames était
malade et alitée. Elle avait voulu porter un
seau d'eau au second étage de la maison,
avait glissé sur les marches gelées
et s'était fait très mal au dos.
C'est pourquoi tout l'ouvrage incombait à
l'autre dame seule : fendre le bois, porter l'eau,
balayer la neige, etc.
Dans une hutte en ruines vivait un
ancien officier, qui, bien que malade
lui-même, soignait sa femme atteinte de
paralysie. Il leur avait fallu vendre leur literie
et tout ce dont ils pouvaient se passer, n'ayant
plus d'autres ressources que les quelques francs
gagnés par le mari à couper les
cheveux et à raser la barbe des amis qui ne
pouvaient, du reste, que s'accorder rarement un tel
luxe.
Quand Mathilda Wrede rentra enfin
à la maison, après cette grande
tournée, plusieurs personnes l'y attendaient
déjà pour lui demander de l'aide en
diverses affaires.
L'une des visiteuses était la
femme d'un ingénieur ; elle possédait
encore un manchon, c'est-à-dire qu'elle
n'était pas parmi les plus pauvres. Elle
avait le plus urgent besoin d'un appui, elle avait
six enfants et son mari était sans moyens
d'existence. Une autre femme lui exposa l'angoisse
de son âme: elle s'accusait d'être
mauvaise, ce qui lui faisait beaucoup de peine.
Mathilda Wrede commença par la regarder
très sérieusement, puis elle lui dit
avec amabilité :
- Ces yeux me semblent confirmer la
vérité de vos propos. Mais le plus
pervers de tous les enfants des
hommes peut revenir à des sentiments
meilleurs, notre Dieu possédant le pouvoir
et la volonté de secourir ceux qui
s'adressent à Lui.
Enfin le dernier solliciteur
s'éloigna, et Mathilda Wrede put aller se
livrer au repos, sans pouvoir dormir, du reste,
tant son coeur était brisé de douleur
et de compassion pour ses amis
éprouvés et persécutés.

|