MÉMOIRES D'UN PROTESTANT
CONDAMNÉ AUX GALÈRES DE FRANCE
POUR CAUSE DE
RELIGION.
Suite (p 512)
Les seigneurs et dames, ayant parcouru la
galère d'un bout à l'autre sur le
coursier, reviennent à la poupe, s'asseyent
sur des fauteuils; et le comite, ayant reçu
l'ordre du capitaine, commande l'exercice à
la chiourme au son du sifflet. Au premier temps, ou
coup de sifflet, chacun ôte son bonnet de
dessus la tête ; au second, la casaque; au
troisième, la chemise. On ne voit alors que
des corps nus. Ensuite on leur fait faire ce qu'on
appelle en provençal la monine ou les
singes. On les fait coucher tout à coup dans
leurs bancs. Alors tous ces hommes se perdent
à la vue. Après on leur fait lever le
doigt indice ; on ne voit que des doigts ; puis le
bras; puis la tête; puis une jambe; puis les
deux jambes ; ensuite tout droits sur leurs pieds :
puis on leur fait à tous ouvrir la bouche;
puis tousser tous ensemble, s'embrasser, se jeter
l'un l'autre à bas, et encore diverses
postures indécentes et ridicules, et qui, au
lieu de divertir les spectateurs, font concevoir
aux honnêtes gens de l'horreur pour cet
exercice, où l'on traite des hommes, et qui
plus est, des hommes chrétiens, comme s'ils
étaient des bêtes
brutes.
Ces sortes d'exercices, comme j'ai dit, arrivent
très fréquemment dans l'hiver comme
dans l'été. Voilà donc
l'occupation de la chiourme pendant le cours de
l'hiver. Lorsque le mois de mars vient, ces
occupations se multiplient chaque jour, par de
nouvelles fatigues. On ôte du fonds de cale
toute la saure; c'est le lest ou ballast de
la galère, qui est tout de petits cailloux
gros comme des oeufs de pigeon. Tous ces cailloux
se montent du fond de cale en haut par les
écoutilles, dans des mannequins d'osier,
lesquels on passe de main en main remplis de ces
cailloux jusque sur le quai devant la
galère, où deux hommes sont
commandés par banc, avec des seaux pour
puiser de l'eau de la mer à force, pour
laver cet affreux monceau de cailloux , et les
rendre nets comme des perles. Quand ils sont secs,
on les rentre dans la galère. Cette fatigue
dure sept à huit jours, y compris le temps
qu'on emploie, pendant que la saure est à
terre, à caréner la galère,
pour la radouber et calfater ; ce qui occasionne
aussi une grande fatigue aux galériens. La
galère étant redressée, chaque
jour jusques à ce qu'on l'arme,
produit nouvelle occupation.
Premièrement, on visite les câbles des
ancres dans la galère ; ensuite tout le
cordage neuf s'approprie, et on le passe ou
tiraille autour de la galère à force
de bras pour le rendre souple et plus maniable.
Cette occupation dure plusieurs jours. Vient
ensuite la visite des voiles; et, s'il en faut
faire de neuves, c'est le maître comite qui
les coupe, et les forçats les cousent ; car
il n'y a point de voilier sur les galères.
Il faut aussi coudre les tentes neuves, raccommoder
les vieilles, de même que les pavillons de
rambade, et ceux qui servent aux lits des
officiers, et enfin tant d'autres ouvrages, qu'il
m'est impossible de les tous particulariser. Cela
dure jusqu'au commencement d'avril, qui est
d'ordinaire le temps, où la cour envoie ses
ordres pour armer les galères.
Cet armement commence par espalmer les
galères. Pour cet effet on renverse une
galère sur une autre qui la soutient, tant
que la quille ou carène de cette
galère renversée se découvre
hors de l'eau. Alors on frotte tout ce
côté de la galère depuis la
quille jusqu'en haut, de suif fondu; après
quoi on la renverse de l'autre
côté, et on la frotte de même.
Voilà ce qu'on appelle l'espalmage, qui est
la plus rude de toutes les fatigues à la
vogue près. Ensuite on arme la galère
de son artillerie, mâts, ancres, cordages,
vivres et munitions; et tout ce rude ouvrage se
fait par la chiourme, qui s'en trouve si
harassée, qu'on est obligé souvent
d'attendre quelques jours pour mettre en mer, afin
de lui donner le temps de se refaire.
De quelle utilité sont les galères
pour un État par opposition aux navires de
guerre.
Il est avéré que les galères
sont d'une grande charge à un État,
soit républicain ou monarchique, par
l'excessive dépense requise à leur
entretien. Il est facile de le comprendre, si l'on
se rappelle que les galères sont toujours
entretenues soit en paix soit en guerre, en hiver
désarmées comme en été
armées. Leurs nombreux équipages,
tant officiers, soldats que mariniers,
reçoivent toujours la même paye, qui
est beaucoup plus forte que celle des
équipages des navires de guerre ; au lieu
que ces derniers, en temps de paix, ou lorsqu'ils
sont désarmés, ne
demandent d'autre entretien, que celui des
officiers majors.
Je reconnais, que les galères des
républiques d'Italie ne coûtent pas
à beaucoup près autant que les
galères de France, par le ménagement
que ces républiques y apportent. Tout le
monde sait, que diverses galères de ces
républiques appartiennent à de
puissants particuliers, sous la protection de leurs
États; et que,lorsque ces mêmes
États en ont besoin, ils payent un subside
à ces particuliers ; ce qui occasionne un
grand ménagement. D'ailleurs ces
États d'Italie retirent de l'utilité
des galères, soit en ce qu'elles gardent
leurs côtes des irruptions des barbares,
à quoi elles sont toujours exposées,
soit en ce qu'elles vont en course continuellement
contre ces barbares, dont elles retirent même
du profit par les esclaves qu'elles font; ce qui
compense en quelque manière les
dépenses qu'elles coûtent. Il n'en est
pas ainsi des galères de France. Elles ne
sont point occupées à garder les
côtes de l'irruption des infidèles.
Ces côtes y sont beaucoup moins
exposées par leur situation; et la France
par sa puissance, sait bien réprimer
l'insolence et la piraterie des
écumeurs de mer, sans être
obligée de mettre ses galères
à leurs trousses. De quelle utilité
sont donc les galères de France par rapport
à l'État ?
Je réponds suivant mes petites
lumières, et par l'expérience que
j'en ai eue, pendant douze ans que j'ai
été sur ces bâtiments dans la
mer Océane. Les galères y ont eu plus
de succès dans ce temps-là, qu'elles
n'en ont eu durant un siècle dans la
Méditerranée; et tous ces
succès pourtant aboutissent à deux ou
trois vaisseaux de guerre ennemis, qu'elles y ont
pris, et pas un navire marchand, quoique la mer en
fût couverte. Je ne parle pas ici des alarmes
continuelles qu'elles donnaient aux côtes
d'Angleterre, mais dans un bien petit espace dans
la Manche, et sans aucun autre effet que de tirer
des volées de canons dans le sable des
dunes, sans jamais y avoir fait ni tenté
aucune descente, excepté celle de Harwich,
qui fut manquée.
On me demandera, quelle vue pouvait donc avoir la
France, d'entretenir sous le règne de Louis
XIV quarante galères, avec des
dépenses si immenses? Je n'y en vois que
celles-ci. Premièrement, pour faire voir
sa grande puissance ; en second
lieu, pour entretenir un grand nombre de
gentilshommes, la plupart cadets de famille, qui
n'ont guère tiré de leur patrimoine
que l'éducation. La plus grande partie
étant chevaliers de Malte, ce qui ne leur
procure que peu ou point de revenu, sont
réduits, pour soutenir leur état et
leur noblesse, aux bienfaits du Roi, qui les avance
suivant leur mérite et leur naissance : et
l'entretien d'un si grand nombre de galères
en fournit l'occasion; car presque tous les
officiers majors des galères sont chevaliers
de Malte.
Troisième raison: Le royaume de France
étant fort grand et fort peuplé, il
ne se peut qu'il ne s'y trouve beaucoup de
malfaiteurs de toute espèce ; et pour les
réprimer et punir leurs crimes, un si grand
nombre de galères étaient
nécessaires. Outre que dans ce temps
là on condamnait aux galères les
déserteurs des troupes., ce qui peuplait
abondamment les chiourmes.
Pour ce qui regarde l'utilité, que
l'État en retire, elle est de peu de
conséquence. En temps de paix, les
galères ne servent qu'à transporter
quelquefois, des personnes de distinction
à Rome ou autres
États de l'Italie, comme cardinaux,
ambassadeurs, et autres, par ordre du Roi. En ce
cas, une ou deux galères sont
commandées. Hors de là, les
galères restent dans le port de Marseille
sans rien faire; ou si on en arme une escadre de
cinq ou six, ce n'est que pour aller sur les
côtes d'Italie pour se faire voir et faire
respecter le pavillon, ou pour exercer les
chiourmes et les équipages.
Reste donc à demander, à quoi les
galères sont utiles en temps de guerre? Je
réponds comme ci-dessus, qu'elles sont de
très peu d'utilité, principalement
dans la mer Océane, où les
galères ne peuvent naviguer qu'avec beaucoup
de peine, à cause du flux et du reflux, qui
se fait sentir plus violemment aux côtes
qu'en pleine mer. Or la construction des
galères ne leur permet pas de s'y
engouffrer, ni d'abandonner la côte de vue;
et lorsqu'elles se trouvent dans la
nécessité de le faire, pour faire
route d'un port à un autre un peu
éloigné, elles prennent de grandes
précautions, et observent de prendre pour
cela un temps fort calme, et où la mer soit
fort unie; ce qui arrivant peu
souvent dans l'Océan,
elles se morfondent des temps infinis dans le port
pour attendre quelque occasion pareille. Par les
mêmes raisons, les galères ne sont pas
propres à aller en course contre l'ennemi ;
et il leur est très rare de trouver
l'occasion de le combattre ; puisqu'elles ne
peuvent s'éloigner que de fort peu de
distance de la côte pour aller chercher les
vaisseaux ennemis soit de guerre ou marchands, qui
ne naviguent jamais mieux qu'en haute mer.
D'ailleurs elles ont une autre très grande
difficulté pour le combat ; c'est que les
galères ne peuvent absolument en livrer
aucun, qu'en temps calme. C'est là leur fort
; car pour lors elles ont le choix d'attaquer les
plus formidables navires, ou de les éviter;
et elles peuvent se retirer impunément,
après avoir attaqué et
maltraité de tels navires; mais s'il fait
assez de vent pour que les navires puissent faire
servir leur voiles, dix galères n'oseraient
attaquer la moindre frégate: mais elles se
retirent incessamment dans leur port; car si le
vent est assez fort, une telle frégate,
faisant force de voile sur les galères, leur
passerait facilement sur le corps, et
les coulerait à fond,
à cause de la construction basse et
légère de cette sorte de
bâtiments.
Il reste à voir, si les galères sont
utiles à seconder une armée navale
dans un combat ? Elles le seraient effectivement,
si le temps et le lieu du combat se trouvaient leur
être favorables ? En ce cas, les
galères peuvent servir très utilement
pour remorquer et retirer hors du combat les
navires démâtés et
endommagés, et en remorquer quelque autre
à la place. Mais pour cela il leur faut un
temps calme, et tout à fait sans vent, pour
les raisons dites ci-dessus. Mais la grande
difficulté pour les galères, c'est de
se trouver en pareil combat naval ; parce qu'une
armée, qui cherche l'ennemi, n'a pas le
choix du lieu pour l'attaquer, et qu'il faut
presque toujours le chercher en haute mer; et les
galères n'osent pas se trouver vingt-quatre
heures hors de la vue de terre.
Outre cela les vaisseaux de guerre ne peuvent
naviguer qu'avec un vent assez fort, pour chercher
à combattre l'ennemi, et les galères
ne peuvent supporter un tel vent; si bien qu'il est
comme impossible, que les galères se
trouvent à un combat naval. Tout
ce que les galères
peuvent faire de plus utile, ce serait de faire
quelque descente en terre d'ennemi, pour piller et
brûler quelque village; et ces descentes ne
peuvent être que de peu de
conséquence, parce que les galères ne
peuvent prendre à leur bord que fort peu de
troupes de renfort, n'y ayant pas de place; car les
cinq cents hommes, qui forment l'équipage et
la chiourme d'une galère, la remplissent
totalement: et de ces cinq cents hommes on ne peut
mettre à terre qu'environ cinquante ou
soixante hommes par galère; le reste devant
n'en pas bouger pour y garder trois cents hommes de
chiourme, qui sont plus à craindre pour eux
que l'ennemi de dehors. Aussi les galères de
Dunkerque, pendant douze ans qu'elles y furent,
n'entreprirent jamais de descentes, soit à
la côte de Hollande, ou à celles
d'Angleterre. De tout ceci on peut aisément
conclure, que les galères dans la mer
Océane ne sont que de peu
d'utilité.
Dans la mer Méditerranée, les
galères y naviguent avec plus de
facilité, tant à cause que dans cette
mer là, il n'y a point de flux et
reflux, que parce que la bonace
ou calme y règne incomparablement plus que
dans l'Océan. Mais les mêmes
difficultés se trouvent pour que les
galères puissent s'y joindre à une
armée navale, qui cherche l'ennemi pour le
combattre; car les navires de guerre ont besoin
d'un vent fort, pour naviguer; et les
galères, par leur construction, ne peuvent y
tenir sans s'exposer à périr.
Tout l'avantage donc qu'on peut espérer des
galères dans la Méditerranée,
c'est que, comme le calme y règne souvent,
il peut s'y trouver des navires ennemis, soit de
guerre ou marchands, qui soient surpris par la
bonace. Pour lors les galères, qui
rencontrent quelque navire dans cet état,
l'ont belle pour s'en rendre maîtres, ou le
couler à fond, s'il est trop fort pour le
pouvoir prendre à l'abordage. C'est presque
l'unique utilité qu'on peut se proposer des
galères dans la Méditerranée;
car pour des descentes à la côte, soit
de l'Italie ou de Catalogne, qui se trouvent dans
ces mers là, elles ne l'entreprennent jamais
par la raison que j'ai dite plus haut.
Il peut aussi arriver un combat d'une escadre de
galères contre une autre
des ennemis. Mais ces rencontres ont rarement lieu;
parce que de tels combats ne décident de
rien de conséquence, et qu'en un mot il n'y
a que des coups à gagner: car quand l'ennemi
s'est engagé au combat, s'il voit qu'il a du
dessous, il a le même avantage pour fuir que
son ennemi trouve à le poursuivre. Comme il
ne s'agit que de ramer, et non de faire voile, que
des galères ayant le dessus ou le dessous du
vent, cela leur est tout un. Et ce que je dis est
tellement vrai, qu'on n'a jamais vu prendre des
galères sur l'ennemi par d'autres
galères. On n'a même de mémoire
de tels combats donnés de galère
contre galère, que dans la guerre, qui
précéda la paix des
Pyrénées. Alors une escadre des
galères de France en rencontra une des
galères d'Espagne dans la mer
Méditerranée; et l'action fut fort
sanglante.
J'ai connu un vieux turc, esclave sur notre
galère, qui s'était trouvé
à ce combat. Il disait, que les
galères d'Espagne s'accrochèrent aux
galères de France à l'abordage, et
que ces dernières auraient eu du dessous,
n'eût été qu'on s'avisa de
donner dans chaque banc aux galériens une
corbeille pleine de cailloux pour repousser les
Espagnols, promettant aux dits galériens
leur liberté, si les Espagnols
étaient repoussés; à quoi ils
réussirent; car par cette grêle de
cailloux les Espagnols furent dans l'obligation de
lâcher prise ; mais pas une galère de
part et d'autre n'y périt. Cependant on ne
tint pas parole aux galériens
français, et ce fut comme dit le proverbe
italien : passala la festa, gabato il santo;
qui veut dire, la fête passée
on trompe le saint. Depuis ce temps-là,
on n'a plus vu de tel combat; car comme il est
facile au parti le plus faible d'éviter d'en
venir aux mains, cela ne manque jamais d'arriver
dans les occasions.
Les galères ont une autre grande
incommodité, lorsqu'il se présente
quelque occasion de se battre contre les navires de
guerre. Car trois cents hommes, qui composent la
chiourme, sont autant d'ennemis, qui veillent
continuellement à se procurer leur
liberté, soit à force ouverte, ou
autrement; et pour empêcher leur
révolte, on est obligé de prendre
contre eux autant et plus de précautions que
contre l'ennemi même qu'on va attaquer. Aussi
l'on met les menottes aux mains
des forçats; on braque deux pièces de
canon à la poupe, chargées à
mitraille, l'une pointée sur la droite, et
l'autre sur la gauche de la galère, pour les
décharger sur la chiourme en cas du moindre
mouvement. Outre cela, de cent soldats qu'il y a
sur une galère, cinquante sont
ordonnés pour la garde de la chiourme, et
ont toujours sur elle le fusil bandé et
couché en joue en cas de révolte. Et
malgré toutes ces précautions, les
officiers ne sont pas peu intrigués, et ont
toujours plus de peur des chiourmes que de l'ennemi
: car s'il arrivait, que les chiourmes fissent le
moindre mouvement, il en faudrait venir au
remède extrême, qui est d'en tuer la
plus grande partie; ce qui serait pire que le mal;
car la chiourme étant les jambes de la
galère, sa perte par là se trouverait
inévitable.
Voilà ce que j'ai pu remarquer des
galères en général, par
rapport à leur fort et à leur faible,
par opposition aux navires de guerre, qui n'ont pas
à beaucoup près tant de
difficultés ni d'incommodités pour
combattre les galères, comme ces
dernières en ont pour
combattre les navires. De tout
ceci on peut conclure, que la dépense pour
l'entretien des galères est très
grande, et leur utilité très petite.
Aussi la France en a-t-elle bien connu la
conséquence, par la réforme des trois
quarts de ses galères, qu'elle fit pendant
la régence et la minorité de Louis
XV, qui règne si glorieusement
aujourd'hui.
Après avoir fini ces mémoires, je me
suis aperçu, que j'avais oublié de
marquer à sa place, à la suite de
l'histoire du combat et de la prise de la
frégate anglaise, le Rossignol, la
destinée du capitaine Smit de
détestable mémoire. Il reçut
peu de temps après le digne loyer de sa
trahison par l'événement que
voici.
On a vu plus haut, que la Reine Anne d'Angleterre
avait confié en l'année mil sept cent
huit le commandement d'un navire de haut- bord,
garde-côte, au capitaine Smit, bon soldat et
bon homme de mer; mais papiste caché, et qui
nourrissait dans son coeur une haine implacable
contre sa patrie, comme il le fit bientôt
paraître. Car ayant, comme je l'ai dit, vendu
son navire à Gottenburg en
Suède, et
congédié l'équipage, il fut
présenter ses services militaires au Roi de
France contre l'Angleterre sa patrie. J'ai dit
aussi, que ce monarque le reçut bien, et
qu'il lui promit de lui donner la première
place vacante de capitaine de haut-bord, et qu'en
attendant il fut servir comme volontaire sur la
galère du chevalier de Langeron, à
Dunkerque.
On n'a jamais vu un homme si animé contre
les Anglais, que cet infâme traître
l'était. Sitôt que quelque corsaire de
Dunkerque faisait quelque prise sur les Anglais,
comme il arrivait souvent, cet ennemi
irréconciliable de ses compatriotes ne
manquait jamais d'aller aux prisons, où on
tenait les équipages de ces prises: il les
injuriait, et leur aurait arraché les yeux,
s'il lui eût été permis. Il
donnait de l'argent au geôlier, et aux
sentinelles, qui gardaient ces pauvres prisonniers,
afin qu'ils les empêchassent de recevoir les
charités des bonnes âmes; et si nous
autres cinq protestants, qui étions sur la
galère du chevalier de Langeron, où
il était aussi, n'avions pas eu ce chevalier
pour ami, il n'aurait pas manqué chaque jour
de nous faire rosser à
coups de corde, comme il le conseillait à
tout moment à ce commandant, parce que nous
étions de la religion des Anglais ses
ennemis. Ce traître était si
acharné contre sa patrie, qu'il ne faisait
que former projet sur projet pour nuire à
l'Angleterre. Et comme il en connaissait
parfaitement toutes les côtes, et qu'outre
cela il avait de l'esprit et de l'expérience
dans la guerre, ces projets plaisaient beaucoup aux
bons Français, qui n'estimaient cependant
guère sa personne. Enfin il fit celui
d'aller piller et brûler la petite ville
d'Harwich, sur les côtes de la Tamise; projet
qu'il envoya en cour de France, et qui fut
approuvé, comme je l'ai dit; et
manqué, comme on l'a vu, par le combat que
nous eûmes à l'embouchure de cette
rivière.
De retour de cette expédition dans le port
de Dunkerque, Smit voulait à cor et à
cri, que nous allassions avec les six
galères recommencer la même
entreprise. Mais notre commandant n'y voulait pas
consentir, alléguant qu'outre la saison, qui
n'était plus propre pour la navigation des
galères, elles se trouvaient par
ce dernier combat hors
d'état de mettre en mer, non seulement par
la ruine des équipages, dont une grande
partie avait été tuée ou
blessée; mais aussi par la perte et la
destruction des mâtures et des agrès,
dont les magasins du Roi étaient alors fort
dépourvus. Tout cela n'empêchait pas
le capitaine Smit de blâmer la nonchalance du
commandant et des officiers des galères. Il
en écrivit en cour. Notre commandant y
envoya de son côté un
procès-verbal, où il alléguait
les raisons susdites, qui le mettaient hors
d'état de rien entreprendre. Tout cela
attira la jalousie ou plutôt la haine de nos
officiers au susdit Smit, et lui causa sa perte,
comme on le va voir.
Le capitaine Smit ne se rebutant pas du refus que
la cour lui faisait de lui confier les six
galères pour son expédition, fit un
autre projet, et demanda qu'on lui accordât
deux navires de guerre à ses ordres. Ces
deux navires étaient armés, et dans
le port de Dunkerque; l'un de quarante
pièces de canon, et l'autre, une petite
frégate, fabrique anglaise, de vingt-quatre
pièces. Il prétendait, qu'avec ces
deux navires il brûlerait
Harwich, comme il aurait pu faire avec les six
galères. La cour accepta son projet avec
ordre de l'exécuter incessamment; mais ne
lui laissa que le commandement de l'entreprise, et
non celui des deux navires. Un capitaine de
galère monta le plus gros comme amiral, et
un lieutenant, aussi des galères, comme
capitaine de la frégate; et Smit comme
commandant à la descente de Harwich.
Les deux navires mirent en mer au mois d'octobre
mil sept cent huit et firent route pour la Tamise.
Mais à la vue de cette côte, ils
aperçurent un navire de guerre anglais,
garde-côte, de septante pièces de
canon. Cette vue les intrigua, et l'amiral ayant
tenu conseil avec le capitaine Smit, il fut conclu
d'aller croiser quelques jours au Nord pour
distraire le garde-côte de leur dessein, et
de revenir lorsqu'il n'y serait plus; ce qu'ils
firent en effet. Mais au bout de deux ou trois
jours, étant revenus, ils aperçurent
soit le même garde-côte, ou un autre de
la même force. Inquiets de ce contre-temps,
ils tinrent de nouveau conseil de guerre. Smit
soutenait fort et ferme que leurs deux navires
étant extraordinairement
bien armés, ils étaient capables
d'aborder et de prendre le garde-côte, tout
formidable qu'il était. L'amiral et le
capitaine de la frégate n'étaient pas
de ce sentiment; mais Smit s'opiniâtra si
fort à tenter cette fortune, qu'il fit
pencher la balance de son côté. On
stipula seulement qu'il monterait sur la petite
frégate, comme étant un navire
léger, et qu'il irait reconnaître le
garde-côte; qu'après en avoir
examiné le fort et le faible, il ferait
signal au navire amiral pour se joindre à
lui et tenter l'entreprise; mais qu'il ne
s'approcherait pas trop près du
garde-côte et qu'il éviterait sa
bordée, de peur d'être coulé
à fond.
Suivant cette résolution, l'amiral se tint
en panne, et Smit à force de voile fut, avec
sa petite frégate, reconnaître le
navire anglais qui, par mépris d'un objet si
peu capable de l'émouvoir, se tenait en
panne. Smit, contre l'avis des officiers de sa
frégate, avança si proche du
garde-côte, et eut l'imprudence de se mettre
si fort à portée de recevoir sa
bordée, que l'Anglais, en effet, la lui
lâcha toute de la manière la plus
furieuse. Cette bordée fit l'effet de
démâter la
frégate de tous ses mâts et la mit
hors d'état de se sauver du péril
inévitable d'être prise ou
coulée à fond. L'amiral
français voyant ce désastre, bien
loin de venir secourir sa conserve, comme il
l'avait promis, en cas d'accident, fit force de
voile vers Dunkerque, où il arriva pour
porter la nouvelle de la perte du capitaine Smit et
de la frégate.
D'abord que le garde-côte vit le vaisseau
ennemi démâté et hors
d'état de lui échapper, il lui cria
de son bord d'amener le pavillon et de se rendre ;
sans quoi il allait couler à fond. Smit n'en
voulait rien faire, aimant mieux périr les
armes à la main que par celles du bourreau
de Londres. Mais il n'était pas le plus fort
sur son bord : car officiers, soldats et matelots
le menacèrent de le jeter à la mer,
s'il ne consentait à se rendre. Il fut donc
obligé à y consentir: mais il imagina
un moyen de se soustraire à la main du
bourreau. Il prend une mèche allumée,
qu'il cachait dans sa manche, et voulut descendre
à la soute à poudre pour y mettre le
feu et faire par là sauter la frégate
en l'air.
La sentinelle de la soute à poudre
l'arrêta, et ayant crié
à ses camarades que Smit
voulait mettre le feu à la frégate,
on se jeta sur ce misérable; et l'ayant
attaché bras et jambes au tronçon du
grand mât, ils amenèrent le pavillon
et crièrent au garde-côte qu'ils se
rendaient à discrétion. L'Anglais
envoya ses chaloupes bien armées et
commandées par un officier de son bord, pour
prendre possession de sa prise. Y étant
entrés sans la moindre opposition, car tout
l'équipage criait: quartier; les
Anglais aperçurent d'abord le capitaine Smit
lié et garrotté au pied du mât.
Il fut aussitôt reconnu et conduit à
bord du garde-côte, qui fit une
décharge de tous ses canons en
réjouissance, bien plutôt de ce qu'ils
tenaient cet insigne traître, que du gain de
la prime de mille livres sterling, qui était
sur sa tête. Il fut d'abord conduit à
Londres, où son procès lui fut
bientôt fait: et quoiqu'il offrît
lâchement de se faire protestant pour obtenir
sa grâce, il fut condamné à
être écartelé tout vif, ce qui
s'exécuta de la manière qu'on fait
aux traîtres en Angleterre, en leur frappant
le visage de leur cœur palpitant. Et j'ai vu
l'année mil sept cent
treize, que je fus à Londres, les quartiers
de son corps exposés le long de la Tamise.
Grande leçon pour ceux qui, comme lui,
s'abandonnent à leur passion jusqu'à
cet excès, que de trahir leur propre patrie!
FIN.
PIÈGES JUSTIFICATIVES.
I. Les Caumont-Laforce.
La famille des Caumont-Laforce, de la plus illustre
noblesse de Guyenne, a dû sa
célébrité et sa grandeur aux
guerres de religion qui déchirèrent
la France au seizième siècle. Elle
nous offre le dramatique tableau des
destinées les plus glorieuses et les plus
lamentables, d'une piété fervente et
d'une triste apostasie, d'une fortune, dont la
grandeur ne fut dépassée que par la
profondeur de la chute.
Un de ses membres, par ses romanesques aventures, a
fourni à un peintre célèbre sa
plus touchante inspiration; son chef
vénérable a légué
à la postérité des
mémoires qui ne sont pas indignes de figurer
à côté de ceux d'Agrippa
d'Aubigné; une femme a jeté sur son
écusson militaire le lustre délicat
de la grâce et de l'esprit. La France lui
doit quelques-uns de ses plus excellents officiers,
l'Église réformée quelques-uns
de ses plus dévoués
défenseurs.
Charles II de Caumont, seigneur de Castelnaut et de
Montpouillant, et qui vivait dans les
premières années du seizième
siècle, eut six fils; tous
embrassèrent la Réforme. L'un d'eux,
Geoffroy, abbé de
Clairac, se convertit, en 1562, à la foi
évangélique; son fils mourut quelques
années après lui.
François, l'aîné, joua un
certain rôle dans les guerres de
religion.
François de Castelnaut, né en 1524,
marié, en 1554, à la veuve de la
Châtaigneraye, suivit à contre-coeur
Jeanne d'Albret à Paris pour le mariage de
Henri de Navarre, et périt quelques heures
après l'amiral, le 24 août 1572, ainsi
que son fils aîné. Son jeune fils,
Jacques Nonpar (né le 30 octobre 1558), par
une soudaine inspiration du ciel, s'étendit
à côté de son père, en
s'écriant: «Je suis mort!» bien
qu'il n'eût reçu aucune blessure, et,
par cette ruse, sauva sa vie. A la chute du jour,
quand tout fut rentré dans un sinistre
silence, il se fit connaître à un
pauvre marqueur du jeu de paume, et put, enfin,
après huit jours d'angoisses mortelles,
traqué de près, et menacé par
la rage aveugle des persécuteurs, trouver un
sûr asile auprès d'un de ses oncles,
à Castelnaut des Mirandes. Sa vie
héroïque et aventureuse mérite
d'être résumée en quelques
mots.
Le proscrit de la Saint-Barthélemy entra
bientôt au service du roi de Navarre, et
occupa rapidement une place importante dans
l'affection de son maître. Nommé au
gouvernement de Sainte-Foy, il contribua, par ses
sages avis, à une réconciliation
sincère du Béarnais et de Henri III,
et prit part à toutes les guerres de la
Ligue. Nous le voyons faire
lever, en 1586, le siège de Castex,
défendre Marans avec succès, se
distinguer, en 1587, à Anthogny, avoir, en
1589, deux chevaux tués sous lui à
Arques.
Accouru du fond de la Guyenne, pour prendre part
à la bataille d'Ivry, il dirigea
successivement les opérations des
sièges de Paris, 1590, Noyon, 1591, Rouen,
1592.
Pendant deux années, il se concilia, par son
administration sage et modérée,
l'affection des Béarnais. L'ouverture des
hostilités contre l'Espagne le trouva
prêt à reprendre les armes.
L'un des héros du combat de
Fontaine-Française, en 1595, il sut unir la
sagesse de l'homme d'État aux talents de
l'homme de guerre, et prit part aux travaux de
l'assemblée des notables de Rouen, 1597.
Fidèle à la foi, que son père
martyr avait scellée de son sang, il refusa
toutes les offres séduisantes d'un roi
apostat, et sut concilier sa loyauté envers
son roi à sa fidélité envers
son Dieu. Aussi Henri IV, rendant hommage à
sa loyauté et à sa droiture, ne
craignit pas de lui confier, en 1599, l'oeuvre
difficile de la pacification du Béarn. Il
eut, en 1600, l'honneur de présenter
à la cour le vénérable
Théodore de Bèze, et lors de
l'assassinat du roi par les jésuites, 1610,
la reine régente jeta les yeux sur lui, pour
calmer les justes alarmes des protestants, et le
délégua à l'assemblée
de Saumur.
Laforce, aussi modéré que brave,
refusa de prendre part au premier
soulèvement de
Condé; éclairé par
Duplessis-Mornay, il ne voulut pas compromettre la
cause de l'Évangile au service de brouillons
et d'ambitieux, qui ne reculaient pas devant
l'intervention étrangère, et
tendaient à former un État dans
l'État. Mais il fut lui-même
entraîné dans le mouvement, qui devait
se terminer par la prise de La Rochelle, fruit
déplorable de cette funeste alliance en
France du calvinisme et de la noblesse, et qui a
tant contribué à rendre notre noble
cause si peu populaire.
Député de la Basse-Guyenne
auprès de l'assemblée de Grenoble,
Caumont-Laforce tenta le projet hardi de s'emparer
du roi dans sa marche sur Bordeaux ; trahi par un
subalterne, il reçut bientôt sa
grâce, et se retira dans le Béarn,
l'un des centres de la révolte, et qui se
vit contraint de rétablir le catholicisme,
et de rendre aux prêtres leurs
propriétés confisquées pour le
bien public, malgré la protestation
solennelle des États, qui
revendiquèrent leurs franchises. Louis XIII
entra en conquérant dans la ville de Pau, le
15 octobre 1620, et la dépouilla de ses
priviléges.
L'assemblée de La Rochelle, indignée
des tendances catholiques du gouvernement, divisa
l'Église de France en huit circonscriptions,
et se réserva le droit de lever, sous
l'assentiment du roi, des impôts et des
troupes. La guerre devenait inévitable;
signalé aux vengeances des catholiques,
Laforce se réfugia en Guyenne; mais de
toutes ses places fortes,
Clairac et Nérac seules opposèrent
quelque résistance aux royalistes, et,
pendant que ses fils cherchaient un asile à
La Rochelle, Laforce gagna Montauban, et
réussit, grâce au concours loyal du
ministre Charnier, à surmonter les
préjugés populaires.
Assiégée par le maréchal de
Thémines, à la tête de 20,000
hommes, Montauban opposa, du 27 août au 20
novembre, une résistance
héroïque; 8,000 royaux et le duc de
Mayenne, frappé par Castelnaut-Laforce,
succombèrent, et le siège fut
levé.
La marquise de Laforce, digne d'être
comparée aux héroïnes des
premiers temps de la Réforme, sut, par son
héroïsme et sa beauté, soutenir
l'enthousiasme des huguenots. Laforce fit lever le
siège des places de Gensac et Laforce,
s'empara de Tonneins, et se vit condamné
à mort par le parlement de Bordeaux (15
novembre 1621).
Le protestantisme français allait
bientôt expier cruellement la faute
impardonnable d'avoir associé les intrigues
politiques et les brigues aristocratiques à
la cause de l'Évangile; d'avoir, en un mot,
foulé aux pieds la grande parole du Christ :
Mon royaume n'est pas de ce monde.
Tous ces seigneurs, qui avaient vu dans la
Réforme un moyen de parvenir,
l'abandonnèrent pour ces misérables
faveurs temporelles, qu'elle n'avait pu leur
donner; Lesdiguières fut
récompensé de son apostasie par le
bâton de connétable ; Châtillon,
petit-fils de Coligny, se vendit
pour quelques écus; Laforce fit sa paix,
sans renier sa foi, et reçut le bâton
de maréchal de France. Seul, Rohan, ferme et
incorruptible, se montra digne des Coligny et des
Duplessis- Mornay.
La carrière du héros protestant est
terminée; la victime échappée
au 24 août 1572, l'illustre compagnon de
Henri IV, le défenseur de la foi rentre dans
la foule des courtisans et le train du monde,
toujours vivant dans les camps; et comptant ses
années par ses services.
En 1625, il couvre la Picardie contre les efforts
des Espagnols, ne prend aucune part aux
opérations de La Rochelle, et oublie la
honte de sa chute dans les dangers de la guerre
d'Italie.
En 1630, il force Pignerol, prend Saluces,
débloque Casai. Un ennemi peu formidable, le
faible et imbécile Gaston d'Orléans,
vient de tenter une nouvelle révolte ;
Laforce le défait à Florenville
(Champagne), investit Nancy, et réduit le
duc de Lorraine à capituler, poursuit Gaston
en Languedoc, le défait à
Pont-Saint-Esprit, et s'empare de Nîmes, dans
laquelle les protestants étaient pour le
roi. Deux mois après la prise de Lunel, il
reparaît en Lorraine, assiège Nancy,
et force les ennemis à repasser le Rhin. Il
occupe Coblentz, Haguenau (31 janvier 1634),
Saverne, investit Lunéville, Philippsbourg,
et fait lever le siège de Heidelberg.
En 1635, il force Jean de Werth à
repasser le Rhin, et
délivre la Lorraine. Nommé duc et
pair en 1637, il signale sa dernière
campagne par la défaite de Piccolomini, et
consacre ses dernières années
à la rédaction de ses
mémoires. Il mourut, le 10 mai 1652,
à l'âge de quatre-vingt- quatorze
ans.
Peu de vies ont été aussi bien
remplies et aussi accidentées. De la
Saint-Barthélemy à la Fronde, il
assista aux événements de tout un
siècle, guerres civiles et religieuses,
intrigues et cabales, chute du protestantisme
politique, affermissement de l'unité royale,
gloire extérieure de la France.
Ce serait un des grands noms de la seconde
génération protestante, s'il
n'était effacé par Duplessis-Mornay
et Rohan. Il eut huit fils et deux filles; il vit
servir sous ses ordres trois de ses fils et deux de
ses petits-fils, dont quelques-uns atteignirent une
haute fortune militaire.
Son fils, Henri Nonpar (né en 1582), devint
maréchal de camp en 1638; les fils de son
fils, Pierre, marquis de Cugnac, et Armand, marquis
de Montpouillant, obtinrent le même grade, le
premier, en 1648, le second, en 1651.
Un autre de ses fils, Jean de Montpouillant,
mourut, en 1620, d'une blessure reçue au
siège de Tonneins. Armand, marquis de
Montpouillant, resté fidèle à
la foi de ses pères, émigra de
France, en 1686, se retira en Hollande, et mourut,
en 1701, lieutenant général, et
comblé des faveurs du
prince d'Orange.
Sa plus jeune soeur, Henriette de Caumont-Laforce,
fut enfermée dans un couvent en 1686;
à sa mort, le clergé fit courir le
bruit qu'elle avait abjuré
l'hérésie calviniste; mais la noble
et malheureuse jeune fille, qui avait su, par sa
douceur et sa résignation, se concilier la
faveur de sa supérieure, lui avait remis une
cassette de prix, dans laquelle on retrouva plus
tard une confession vivante et touchante de sa pure
foi évangélique.
Sa cousine germaine, Charlotte-Rose de Castelmoron
(1650-1724), que l'on croit être morte
catholique, se distingua par ses talents
littéraires et par plusieurs romans
historiques assez goûtés des
contemporains.
L'arrière-petit-fils de Jacques Nonpar de
Caumont-Laforce, le héros de la
Réforme, et qui portait le même nom,
fut l'une des victimes de la révocation de
l'édit de Nantes et de l'infâme
despotisme de celui que la postérité
a appelé le Grand. Il avait à
l'origine joué dans l'Église
réformée le même rôle que
ses ancêtres, et fut nommé, en 1660,
député de la Basse-Guyenne au synode
de Loudun.
Son Église se vit privée du droit de
fief, en 1682, et lui-même fut conduit comme
hérétique à la Bastille, le 29
juin 1689. Le Mercure galant rapporta
bientôt sa conversion, celle de ses quatre
fils, et ajouta que Sa Majesté avait
daigné parler au duc sur sa conversion. Le
Mercure, journal
officiel, ment, puisqu'il raconte la conversion du
duc en mai 1686, et que nous voyons le duc à
la Bastille pour cause de religion en 1689.
La persécution remontait plus loin; le roi
écrit lui-même au duc le 80 juin 1686
(Bulletin de l'histoire du protestantisme
français, 1.1, 67); le 23
février, il lui dépêche le
coadjuteur de Rouen pour triompher de son
hérésie; tous les moyens lui sont
bons dans l'intérêt de la sainte cause
: rapt des enfants confiés aux
jésuites, modeste pension assignée
dans les couvents aux demoiselles de Caumont, et
«qu'il faut régler au plus juste
prix.»
Le jour où l'on conduisait le duc à
la Bastille, un exempt conduisait la duchesse
à Angers. Le 16 juillet, tous les papiers de
la famille sont livrés à la police ;
on prive le duc de ses domestiques enfermés
dans la prison de Pont-de-l'Arche, et on les
remplace par des catholiques. Le 14 septembre, le
roi accorde comme une grande faveur à Mme de
Caumont la permission de se promener pendant une
heure sur la terrasse du château, et au duc,
la grâce de voir, en présence de
témoins, son médecin, s'il tombe
malade.
Le 28 avril 1691, le duc fut
transporté au couvent de Saint-Magloire ;
les mauvais traitements finirent par
ébranler sa constance. Ses domestiques,
humbles serviteurs de Christ, restèrent
fidèles jusqu'à la fin; mais le duc
et pair succomba. Sa conversion ne fut pas bien
profonde, puisqu'on crut devoir
le garder à vue jusqu'à sa mort,
arrivée le 16 avril 1699.
Sa fille aînée du premier lit, Jeanne,
qui avait épousé, en 1682, le marquis
de Courtaumer, apostasia la première, et
entraîna, par son mauvais exemple, sa soeur
Louise, que le roi lui avait personnellement
confiée. Ses quatre soeurs du second lit
furent religieuses.
Des fils, deux restèrent dans l'ombre ;
l'aîné, Henri, duc de Laforce,
né en 1675, et, qui fut converti à la
foi catholique à l'âge de treize ans
se montra le digne élève des
jésuites, et se signala par sa rage aveugle
contre ses anciens coreligionnaires. Il
s'était marié, en 1697, à
l'âge de vingt-deux ans ; mais à cette
époque, sa foi était assez
tiède, puisque le roi dut lui envoyer, pour
la raffermir, un plus habile jésuite. Sans
doute que les illustres souvenirs de sa famille,
les portraits de ses aïeux tous morts au
service de la bonne cause, les souvenirs religieux
de l'enfance avaient sur lui quelque pouvoir. Mais
que ne peuvent la cour, ses plaisirs, ses
promesses, sur une âme vaine et
ambitieuse!
En 1700, nous le voyons, pour faire sa cour au
grand roi, et faire oublier un glorieux
passé, gagner à prix d'argent ses
paysans à la messe, et recevoir une
gratification de 100,000 livres de rentes.
En 1701, il parcourt la Guyenne, à la
tête de ses dragons et suivi de quatre
jésuites; la force brutale, l'astuce et
l'apostasie firent en quelques
mois une ample moisson de victimes et de
martyrs.
Nous empruntons à l'excellent recueil
publié par M. Ch. Read, à ce
Bulletin du Protestantisme qui sauve tous
les jours de l'oubli quelques-uns des souvenirs du
passé de notre Église, une des
lettres que le noble élève des
jésuites écrivait à M. de
Pontchartrain, chancelier et garde des sceaux de
France, pour se faire honneur auprès du roi
Louis XIV des conversions au catholicisme qu'il
s'efforçait d'opérer dans toute
l'étendue de ses domaines. Cette lettre
confirme pleinement le récit de Jean
Marteilhe, et sert à montrer les moyens
qu'on employait alors pour convertir.
A la Force, 15 octobre 1699.
« Monsieur,
«Les révérends pères
jésuites commencèrent dimanche
dernier à faire leur instruction dans l'une
des chambres du château de la Force. La
chapelle, comme j'ai eu l'honneur de vous le
mander, n'étant pas encore en état,
il s'y trouva environ trois ou quatre cents
nouveaux convertis; mais, à la
réserve de deux ou trois des principaux, il
n'y avait que des paysans, quoique j'eusse
régulièrement fait avertir tout le
monde, comme vous avez vu,
Monsieur, par la lettre que j'ai écrite aux
curés.
Et voyant que les plus aisés des paroisses
négligeaient de s'y trouver, je leur
envoyai, lundi dernier, à chacun un billet
pour leur dire de me venir parler: ils y sont venus
presque tous; et lorsque je leur ai
représenté que l'intention du roi
était qu'ils s'instruisissent, et que Sa
Majesté voulait qu'ils assistassent aux
explications qui se font ici, j'en ai trouvé
très peu de dociles, et quoique le nombre de
ces principaux monte à plus de cent, il ne
s'y en est trouvé mardi que dix ou
douze.
Je ne compte point les paysans: car si cette
centaine faisait son devoir, il est certain que
tous les autres suivraient leur exemple, et que les
églises, qui sont présentement
désertes, se trouveraient remplies. J'ai
déjà eu l'honneur de vous dire,
Monsieur, dans une de mes lettres, que le voisinage
de Bergerac et de Sainte-Foy est d'un grand
obstacle pour les conversions ; je l'ai
expérimenté dans cette
dernière rencontre; car plusieurs, qui se
disent bourgeois de Bergerac, et qui sont pourtant
établis depuis longtemps dans le
duché, quand on les presse de se faire
instruire, vont y demeurer et se croient là,
comme dans une ville de sûreté,
à l'abri de toutes les instructions contre
lesquelles ils sont fort en garde.
Mardi même, en ayant envoyé chercher
sept ou huit devant que la conférence
commençât, et leur
ayant dit que le roi voulait qu'ils y assistassent,
il y en eut quelques-uns qui balancèrent sur
ce qu'ils avaient à faire; mais un d'entre
eux, nommé Cheissac, sieur de Fongrave, qui
demeure depuis douze ans dans le duché de la
Force, prit la parole pour tous, en disant:
«Nous sommes bourgeois de Bergerac, et quand
le roi nous donnera ses ordres à Bergerac,
nous verrons ce que nous aurons à faire.
»
Cette parole, dite d'un air de mutinerie, acheva de
déterminer tous les autres. Il s'en alla et
ils le suivirent, quoiqu'un père
jésuite fit tout ce qu'il put pour les faire
entrer. La conférence commença
ensuite, et, après une lecture de
l'Écriture sainte et une prière en
français, le père Dubois expliqua un
point de controverse qui était celui de la
perpétuité de l'Église, et
demanda ensuite à tous les nouveaux
catholiques, chacun en particulier, s'ils avaient
quelques difficultés à proposer, et
de ceux qui avouèrent être convaincus
on en fit un état en forme de
procès-verbal dont je vous envoie la
copie.
Faites-moi l'honneur, Monsieur, de me mander ce que
je ferai de l'original. Je fis ensuite appeler par
mon secrétaire tous ceux à qui
j'avais écrit de s'y rendre, pour savoir
ceux qui ne s'y étaient pas trouvés,
et j'ai ordonné au juge d'ici d'aller chez
ceux-là et de leur demander s'ils refusent
d'aller aux conférences, la raison pourquoi,
et de dresser un
procès-verbal de leurs réponses, dont
j'aurai l'honneur de vous envoyer copie par le
premier ordinaire. Mais je vous supplie, Monsieur,
de me faire savoir comment le roi veut qu'on en use
à l'égard de ceux qui refuseront
absolument de s'y trouver, et encore à
l'égard de ceux qui, ne se contentant pas de
n'y pas venir, empêchent les autres de s'y
rendre ou les raillent et leur disent des injures
quand ils y ont été, les traitant de
papistes et de renégats; car il est certain
que l'exemple de ceux-là, qui sont les
principaux et les chefs, attirera toute la
populace, et qu'aussi, s'ils ne viennent pas, ceux
même qui y assistent présentement
discontinueront de le faire.
J'avais déjà eu l'honneur de vous
proposer, Monsieur, deux moyens pour cela: l'un que
le roi leur imposât quelque amende
pécuniaire qui allât toujours en
augmentant, applicable au rétablissement des
églises détruites; l'autre, que Sa
Majesté leur envoyât quelques
cavaliers en garnison de ceux qui sont à
Bergerac; car je puis vous assurer, Monsieur,
qu'aussitôt qu'on aura réduit ces
principaux, il ne restera plus ici de vestiges de
l'hérésie.
De plus, si le roi voulait avoir la bonté de
me donner dans chaque paroisse 200 ou 300 fr. de
taille pour pouvoir soulager ceux qui font bien
leur devoir, et la rejeter sur ceux qui ne le font
point du tout, cela serait d'une grande efficace et
le roi n'y perdrait rien; car,
comme ils sont presque tous ici de la religion, les
syndics et les collecteurs se soulagent les uns et
les autres par l'espérance de la
représaille.
J'attends sur tout cela les ordres du roi.
Cependant, Monsieur, je continuerai trois fois la
semaine à faire faire des instructions, y
ferai venir ceux que je pourrai, ferai signer
chaque point de controverse qu'on aura
traité, à ceux qui assisteront et
n'auront rien à dire contre, et, enfin
généralement tout ce que je croirai
pouvoir contribuer à les fortifier dans la
religion catholique, apostolique et romaine.
Je suis toujours très sincèrement,
Monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur,
«Le duc De La Force.»
(Bulletin de la Société de
l'histoire du protestantisme français,
VIIIe année, page
144.)
II. Les Galériens protestants.
Nos filles dans les
monastères,
Nos prisonniers dans les cachots,
Nos martyrs dont le sang se répand à
grands flots,
Nos confesseurs sur les galères,
Nos malades persécutés,
Nos mourants exposés à plus d'une
furie,
Nos morts traînés à la
voirie,
Te disent (ô Dieu!) nos calamités.
Ton courroux veut-il nous éteindre,
Nous nous retirons dans ton sein,
De nous exterminer formes-tu le dessein,
Nous formons celui de te craindre,
Malgré nos maux, malgré la mort,
Nous bénirons les traits, que ta main sous
appreste,
Ce sont les coups d'une tempête,
Mais ils ramènent dans le port.
Ces vers admirables de profondeur
héroïque et de conviction
chrétienne, que M. le pasteur Melon a
retrouvés dans une vieille bible de famille,
et qui datent de 1698, résument en quelques
traits éloquents et l'inébranlable
constance de nos martyrs, et la rage aveugle de
leurs persécuteurs. Les livres
d'écrou des galères du roi
très chrétien renferment les plus
beaux titres de noblesse de nos églises,
l'immortel et glorieux héritage, que nous
devons transmettre avec un soin
religieux à nos enfants comme un
modèle et un exemple. Élie
Benoît a résumé en une phrase
éloquente le caractère de la
piété de nos ancêtres! La
simplicité même des moins
éclairés, nous dit-il, avait quelque
chose de noble, et comme la plupart n'avaient rien
appris que dans l'école de la
piété, il était aisé de
voir qu'elle l'emporte sur tous les maîtres
de l'éloquence.
Quel tableau douloureux nous présente
l'Eglise sous la croix pendant ces années de
deuil et d'opprobre, qui resteront comme une
flétrissure ineffaçable sur le blason
du grand roi.
Les assemblées surprises et
dispersées, la parole inspirée de
Dieu foulée aux pieds, les confesseurs de la
foi exposés aux plus affreux supplices, les
femmes victimes des outrages d'une soldatesque
effrénée, les tendres vierges
enfermées dans les couvents, ou ensevelies
toutes vivantes dans les affreux cachots de la tour
de Constance, les ministres du Seigneur
chargés de fers et livrés aux flammes
des bûchers, les vieillards, les enfants, les
nobles, les humbles confesseurs de la
vérité confondus et attachés
sur le banc d'infamie des galères, tout ce
sang innocent répandu au nom de Dieu,
s'élève aujourd'hui encore en
témoignage contre une église
dégradée et avilie, un souverain
voluptueux et adultère qui cachaient sous
les plus belles apparences tant de corruptions et
d'ignominies.
Les troupes exilées de la
patrie, dont leur coeur conserva un si vivant et si
profond souvenir, accueillies avec amour par les
cités évangéliques de la
Suisse et de la Hollande, pleurant au souvenir de
leur Église désolée, se
plaisaient à répéter avec le
prophète : Si je t'oublie, Jérusalem,
que ma droite s'oublie, et s'appliquaient ces beaux
vers de l'Esther de Racine:
Sacrés monts, fertiles
vallées,
Par nos ancêtres habitées,
Du doux pays de nos aïeux
Serons-nous toujours exilées!
Mais, tout en conservant au fond du coeur un
sentiment généreux et instructif de
dégoût et de mépris pour une
église, pour un monarque capables d'aussi
grands forfaits, inspirons-nous des pieux
sentiments de nos martyrs, qui avaient placé
en Dieu leur espoir et leur consolation, qui ne
voyaient dans les épreuves que Dieu jugeait
bon de.leur envoyer qu'une nouvelle marque de son
amour, et répétaient à
l'exemple du Sauveur du monde, aussi longtemps que
la rage des bourreaux leur laissait un souffle de
vie: Mon Père, pardonne- leur, car ils ne
savent ce qu'ils font. (Lettre de Baptiste
Blanchard, galérien, du 10 décembre
1700.)
Qu'il nous suffise, pour résumer l'esprit du
système, et les sentiments d'une
époque réputée la plus
civilisée de notre histoire, de reproduire
cette lettre de Seignelay au directeur
général des
galères en date du 18
avril 1668:
«Comme rien ne peut tant contribuer
à rendre traictables les forçats qui
sont encore huguenots, et n'ont pas voulu se faire
instruire, que la fatigue qu'ils auraient pendant
une campagne, ne manquez pas de les mettre sur les
galères, qui iront à
Alger!»
Des amis dévoués de la
vérité ont dressé le glorieux
martyrologe de nos églises. Les chiffres
sont éloquents, et ces pages muettes
justifient la pensée du psalmiste que la
mémoire de l'homme de bien est
immortelle.
Nous voyons dans l'espace de soixante années
(1686-1746) plus de trois cents assemblées
du désert dispersées et surprises par
les armées du roi, quarante-huit ministres
de Jésus-Christ livrés au dernier
supplice, de 1685 à 1752, 7,370 protestants
envoyés aux galères.
L'année de la révocation de
l'édit de Nantes, les dernières et
sinistres années du vieux roi frappé
de la main de Dieu, les plus déplorables
années du règne honteux de Louis XV
sont par la logique même des faits les plus
fécondes en martyrs. Tous les rangs, toutes
les conditions, tous les âges sont confondus
devant le supplice comme ils sont égaux
devant Dieu.
Le vieillard, qui a blanchi au service de Dieu, le
fidèle ministre arrêté au
moment où il
annonçait à des âmes
altérées de sainteté et de
justice la bonne nouvelle du salut, voient assis
à leurs côtés, et
attachés à la même chaîne
d'infamie de pauvres paysans, de jeunes hommes dans
la fleur de l'âge, qui n'ont commis d'autre
crime, comme le déclarait avec une constance
héroïque une jeune femme
déportée en Amérique, que de
ne point avoir voulu adorer la beste, et se
prosterner devant les images.
Sur les registres des galères, que la
générosité du pieux amiral
Baudin a légués à la
Société de l'histoire du
protestantisme français, nous trouvons parmi
les galériens à vie quatre jeunes
gens de quinze, seize, dix-huit et dix-neuf ans.
(Sur l'une des colonnes, on lit cette remarque
à la marge : Galérien condamné
pour avoir, étant âgé de plus
de douze ans, accompagné son père et
sa mère au prêche.)
L'imagination recule épouvantée
à la seule pensée de ces héros
de la foi associés aux plus vils criminels,
exposés sans défense aux
intempéries des saisons, aux fatigues d'une
rude traversée, au feu des flottes ennemies,
privés de nourriture, de sommeil, meurtris
par le fouet, des bourreaux, accablés
d'injures, expirant de douleur et d'angoisse.
Et quelle céleste résignation, quelle
inébranlable assurance, quelle douceur
divine dans ces âmes, qui ont tout
quitté pour le service de Dieu, et qui
veulent lui demeurer fidèles jusqu'à
la mort. «M. René Barraud (sieur de la
Cantonière, natif de
Talmond en Bas-Poitou, condamné en 1686 aux
galères), écrit un témoin
oculaire, a supporté tous ses maux, avec une
patience et une douceur, qui a frappé tous
ses ennemis, et qui sert d'exemple à ceux
qui sont appelés à suivre le chemin
étroit, qu'il a tenu. Sa maladie fut
pressante et le troubla, (mais) ces vives
élévations qu'il fit à Dieu
son protecteur et son Sauveur faisaient bien voir
que l'esprit de vie était en lui. Le 13 juin
1693 son esprit fut mis en la liberté des
enfants de Dieu. »
Dans une lettre collective que les malheureux
galériens de Marseille adressèrent
dans leur détresse le 10 décembre
1700 à l'église de Bâle, qui
leur envoya ses généreux secours et
ses ferventes prières en leur faveur, nous
les voyons parler avec joie de la fermeté
que leurs compagnons de martyre, qui les ont
précédés dans la gloire, ont
déployée jusqu'à la fin.
« Ils ont été fermes et
constants, écrivent-ils, de sorte que la
douceur ni la rigueur n'ont pas été
capables de les ébranler dans la
résolution qu'ils avaient prise d'être
fidèles à leur Dieu et de mourir pour
son service. Il y a des motifs de joie et de
consolation dans leur magnanimité
chrétienne.»
Les femmes de la Réforme se montraient les
dignes compagnes de ces héroïques
témoins de la vérité, et
justifiaient cette belle pensée du livre des
Proverbes: La grâce trompe, et la
beauté s'évanouit, mais la femme, qui
craint l'Éternel sera celle qui
recevra la louange.
Un des proscrits, victimes des fureurs de Louis
XIV, rencontra sur un navire, qui les transportait
en Amérique, des femmes
déportées pour avoir confessé
Jésus-Christ. Plus de quatre-vingts femmes
étaient là couchées sur des
grabats infects, en proie aux horreurs de la
maladie et ,de la misère. «Au lieu de
les consoler, écrit-il à sa
mère, elles me consolaient, et ne pouvant
parler, elles me disaient d'une commune voix: Nous
mettons le doigt sur nos lèvres, et nous
disons que toutes choses viennent de celui qui est
le Roi des rois ; c'est en celui-là que nous
mettons notre espérance.»
Ces glorieux disciples de
Jésus-Christ, parmi lesquels on comptait les
hommes les plus distingués du royaume, un
Isaac Lefèvre, avocat de Chastelchinon, un
Louis de Marolles, avocat de
Saint-Ménehould, et dont les souffrances
nous ont été racontées dans un
récit touchant, ne se contentaient pas de
prêcher l'Évangile par leur exemple,
leur constance, leur héroïsme, ils
fortifiaient et consolaient ceux qui n'avaient pas
encore passé par l'épreuve.
«N'oubliez jamais, leur
répétaient-ils (lettre datée
de la tour de Constance, 12 février 1687),
n'oubliez jamais de si grands bienfaits, si vous
voulez que Dieu continue ses
bénédictions et ses grâces sur
vous et sur les vôtres. Priez continuellement
pour la liberté de Sion, pour les
prisonniers de Jésus-Christ. Vous avez
glorieusement commencé,
mais
tout cela,
n'est rien, si vous ne persévérez
jusqu'à la fin. »
Ainsi parlaient et agissaient au sein de
l'affliction nos pères en la foi, justifiant
la belle pensée de Tertullien que le sang
des martyrs est une semence féconde de
chrétiens.
Nous voyons se succéder sur les bancs des
galères plusieurs générations
de la même famille: en 1687 Pierre Albert, en
1688 Louis Albert, en 1689 Jacob Albert,
âgé de vingt-neuf ans.
En 1745 quatre Bérard de Chateaudouble. Si
le Languedoc, le Dauphiné et la Provence
occupent une place d'honneur dans ce triste et
glorieux tableau, la Normandie, la Champagne, la
Picardie, le Poitou, la Bretagne elle-même
comptent de nombreux représentants.
Telle est la puissance de la vérité
et du dévouement sur les âmes les
moins bien disposées que nous voyons les
galériens huguenots faire des
prosélytes jusque sur les bancs des
galères. «Nicolas Daubigny,
écrit un martyr, un papiste, a
embrassé notre religion en galère,
et l'évêque de Marseille,
répétant, par un élan
irrésistible de conviction, la parole du
centurion : «Assurément cet homme
était «juste,» ému,
touché, en présence de tant de
courage, d'héroïsme, disait, par une
impulsion soudaine de son coeur, à un
galérien, M. Ducros : «Monsieur, si
votre religion est bonne, il faut que «j'avoue
que vous êtes un
saint.»
Le 4 août 1775, il y a quatre-vingt-neuf ans,
et quelques-uns de ceux qui vivent au milieu de
nous auraient pu en être les témoins,
il y a quatre-vingt- neuf ans, la seconde
année du règne réparateur de
Louis XVI, gémissaient sur les pontons de
Marseille deux galériens, derniers et
glorieux témoins de l'Église sous la
croix, Antoine Riaille et Paul Achard, tous les
deux du diocèse de Die, condamnés,
les 9 et 26 février 1745, par le parlement
de Grenoble, aux galères à vie. Court
de Gébelin ne put obtenir leur grâce
qu'après une année de
démarches infructueuses, et bientôt il
ne resta plus des iniquités d'un autre
âge que le souvenir.
Parmi ces martyrs ont figuré bien des
ancêtres de nos familles protestantes;
à ceux qui nous demanderaient : «Vos
pères, où sont-ils?» rappelons,
en ce siècle de tiédeur et
d'engourdissement moral, le souvenir de leurs
mâles vertus; retrempons dans ces glorieuses
annales, trop longtemps restées dans
l'oubli, notre foi, qu'une longue
sécurité et le dangereux contact du
siècle ont allanguie, notre mémoire
trop ingrate, notre piété vacillante;
ne craignons pas surtout de rappeler, dans un
siècle de tolérance, quel esprit
animait, il y a quatre-vingt- neuf ans à
peine, une Église redoutable, qui nous
supporte par impuissance bien moins qu'elle ne nous
accueille comme des frères, et conservons
fidèlement un dépôt
scellé d'un sang si
précieux, et que nous
devons transmettre à nos enfants pur, sans
souillure et sans tache; à nos concitoyens,
comme la source intarissable, à laquelle
seule ils pourront puiser la conscience du devoir,
le respect des lois, l'intelligence de la
liberté, le sens exquis des grandes
choses.
Albert Paumier.
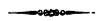
|