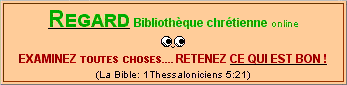
18. Scot Érigène.
Jean Scot Érigène, qui vient d'être nommé parmi les adversaires de Gottschalk, était un Irlandais, vivant depuis 840 environ à la cour de Charles le Chauve (57). Il est le seul des savants du neuvième siècle qui soit indépendant de la tradition orthodoxe; il se rattache à la tradition alexandrine. Penseur original, sachant le grec, nourri d'Origène et surtout des ouvrages de Pseudo-Denis, dont il fit une traduction latine, il est plus philosophe que théologien; il présente le spectacle d'un métaphysicien panthéiste, égaré au milieu d'une époque incapable de le comprendre.
Son ouvrage principal, intitulé de divisione naturoe, se compose de cinq livres de dialogues entre un disciple et un maître (58). Scot Érigène pose en principe l'unité de la philosophie et de la religion; l'une et l'autre ont le même objet, qui est Dieu, cause première de toutes choses; la philosophie le cherche par la réflexion, la religion l'adore avec humilité la première suit la raison, la seconde l'autorité de l'Écriture. La raison et l'autorité ne peuvent pas se contredire, car elles dérivent également de Dieu; si l'une semble contraire à l'autre, le conflit n'existe qu'en apparence.
En envisageant la nature, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers, on reconnaît tout d'abord qu'elle se divise en deux grandes catégories, les choses qui sont et celles qui ne sont pas, l'être et le non-être, Dieu et les phénomènes. On arrive ensuite à une nouvelle division, celle de la fixité et du mouvement, de l'immuable et du variable. En combinant ces diverses catégories, on trouve qu'il y a quatre formes générales, que Scot appelle autant de natures : 1° la nature qui crée sans être créée elle-même, Dieu; 2° la nature qui crée et qui est créée, les causes primordiales, les prototypes idéaux; 3° la nature qui est créée et qui ne crée pas, l'univers visible; ho la nature qui n'est pas créée et qui ne crée pas non plus, Dieu comme fin de tout, vers qui tout retourne. C'est un cycle d'évolutions partant de Dieu et revenant à lui, il est principium, medium et finis de tout l'univers.
En disant de Dieu qu'il est l'être, la bonté, la sagesse, la puissance, on lui applique des attributs limités, puisque à chacun de ces termes on peut opposer un terme contraire; Dieu est supérieur à tous les attributs, dans son essence absolue il n'y a plus ni relation ni différence; comme il est au-dessus de l'être, il n'est pas l'être, il est nihil, «il est exalté superessentiellement au delà de tout ce qui est ». Incompréhensible en soi, il apparaît, il se manifeste dans les créatures, qui sont ainsi des théophanies; la plus haute en est l'intelligence humaine; plus celle-ci se reconnaît, plus elle reconnaît Dieu ; les deux connaissances se fondent en une seule, l'intelligence vertitur in deum. Elle est capable de cette transformation, parce qu'elle porte en elle une empreinte de la trinité. La conception que se fait Scot de cette dernière est fort éloignée du dogme orthodoxe : le Père est la première cause créatrice; le Fils ou le Verbe est l'organe de la création, laquelle existe en lui à l'état d'idée; le Saint-Esprit en est l'ordonnateur, celui qui diversifie les effets et les phénomènes. Mais les trois personnes ne sont pas des réalités, elles ne sont que des noms donnés à des relations divines; « Dieu est plus qu'unité et plus que trinité ».
L'évolution divine, processio ex, deo, s'explique par les causes primordiales, qui sont contenues dans le Verbe et qui en sortent comme théophanies. Rien n'a une existence réelle en dehors de Dieu, et rien n'est en dedans de lui qui ne soit lui-même; il est donc tout en tout. La religion enseigne que le monde a été tiré du néant, ex nihilo factum est; ce nihil est Dieu; en créant, Dieu sort du néant de son absoluité, il apparaît; le monde fini est la forme de l'infini. Scot a donc pu dire que Dieu et la création sont «une et la même nature, que Dieu est tout et que tout est Dieu». Comme l'intelligence humaine porte en elle l'image de la trinité, elle devient le théâtre de la même évolution ; elle crée les choses en les concevant ; en les rapportant à Dieu, elle rentre elle-même en lui. Dieu est Dieu par l'excellence de sa nature; l'homme devient Dieu par un effet de la grâce, et celle-ci est nécessaire à cause de la chute.
C'est par ces termes de grâce et de chute que reparaît chez Scot l'élément religieux, pour être absorbé aussitôt de nouveau par l'élément métaphysique. Adam est tombé parce qu'il a voulu être quelque chose en dehors de Dieu; il s'est distingué de Dieu au lieu de rester un avec lui, il s'est privé ainsi du seul bien véritable. Le mal n'est pas une réalité, il n'est que la privation du bien; pour «la spéculation supérieure» il n'existe pas, il n'existe pas non plus pour Dieu. C'est là ce que Scot oppose à la doctrine de Gottschalk. L'homme déchu n'a pas cessé d'être un résumé de la création, seulement il n'en a plus conscience, il ne peut plus remplir son rôle de tout rapporter à Dieu. Pour le ramener au bien, le Verbe est apparu sous une forme humaine; il est l'homme idéal et éternel, l'homme-Dieu. En lui on contemple l'unité du fini et de l'infini; cette contemplation nous délivre du mal, elle nous apprend à supprimer les différences, nous devenons un avec Dieu, « par l'efficacité de la contemplation ». Le terme final de l'univers sera une absorption de tout en Dieu; le mal se consumera dans le bien éternel, la misère dans la béatitude, la mort dans la vie.
Cette philosophie, dont on n'a pu donner ici qu'un résumé très court, est bien éloignée du christianisme. En la comparant avec celle des alexandrins et de Pseudo-Denis, on découvre, malgré les analogies, une différence considérable; Scot Érigène trouve la manifestation de l'infini, moins dans les phénomènes du monde visible, que dans l'intelligence de l'homme. Fondée sur le principe que l'essence universelle est l'être unique, sa spéculation est un réalisme, dont le dernier mot est le panthéisme. Le neuvième siècle n'était pas préparé à ces hardiesses; il ne put ni les suivre ni les réfuter, il ne les comprit pas; il condamna Gottschalk, mais n'inquiéta pas Scot.
19. La science théologique.
Après la période animée des Carolingiens, le dixième siècle parait si inerte et si barbare, que le cardinal Baronius l'a qualifié, dans ses annales, de siècle de plomb, soeculum plumbeum. Dans les écoles des monastères et des chapitres les études
******** n'étaient pas interrompues, mais en général elles n'allaient pas au delà du savoir clérical le plus indispensable. On continuait aussi de faire des compilations, on traitait quelques sujets de morale, on recueillait des sermons et des lois, on écrivait des légendes ou des chroniques monastiques, mais on ne traitait aucune question d'un ordre supérieur. Depuis la fin du siècle il se manifeste un réveil, grâce aux relations établies par les Ottons avec l'empire byzantin, au retour progressif de l'ordre dans l'église par les efforts des papes, et à l'exemple donné par les Arabes d'Espagne, qui depuis 980 possédaient à Cordoue une école célèbre, fréquentée aussi par des chrétiens.
En Angleterre Alfred le Grand, roi depuis 871, avait essayé de relever les études autrefois si florissantes en ce pays; il avait traduit lui-même en anglo-saxon des ouvrages historiques et philosophiques ainsi que le Pastoral de Grégoire le Grand. Après lui avaient recommencé les ténèbres, jusqu'à ce que vers la fin du dixième siècle son oeuvre fût reprise par l'abbé Aelfric et l'archevêque Dunstan; Aelfric fit pour les écoles une grammaire et un glossaire latins-saxons, et des traductions de quelques livres historiques de l'Ancien Testament, des dialogues du pape Grégoire et d'un recueil d'homélies. Dès lors on travailla dans les monastères anglais avec une nouvelle activité.
En Italie le savoir théologique n'est représenté au dixième siècle que par un étranger,Rathérius de Liège,évêque de Vérone, mort en 974, esprit bizarre, dont la vie ressemble à un roman. Il écrivit dans une prison des Proeloquia sur les devoirs des hommes de toutes les classes, avec de fréquents retours sur sa destinée personnelle et de vives sorties contre la corruption et l'ignorance du clergé italien (59).
*****Dans le couvent de Saint-Gall, qui avait une riche bibliothèque et une célèbre école de calligraphes, et où se formaient, sous des abbés très instruits, des disciples dont plusieurs devinrent illustres, le moine Notker, dit le Bègue (balbulus), mort en 913, composa des hymnes et introduisit quelques améliorations dans le chant liturgique. L'Allemagne nous offre une femme lettrée,Roswitha, une des nonnes du couvent de Gandersheim dans le Harzgebirg, vers 980. Outre un poème en hexamètres latins rimés sur les faits et gestes d'Otton le Grand, elle a composé des comédies religieuses ; comme celles de Térence étaient au nombre des rares ouvrages classiques qu'on expliquait dans les écoles, Roswitha a voulu les remplacer par des pièces sur le même modèle, mais opposant l'amour céleste à l'amour mondain, et le martyre chrétien à la passion païenne (60). Elle prouve qu'à cette époque il y avait souvent plus d'instruction dans les monastères de femmes que dans ceux des moines.
Le Français Gerbert, qui devint le papeSylvestre Il, avait visité l'école arabe de Cordoue, où il avait appris les mathématiques et l'astronomie. Il dirigea pendant quelque temps l'école de Reims, où il donna aux études une impulsion nouvelle. Ses nombreux ouvrages s'occupent de presque toutes les parties du savoir d'alors (61). Eu France, outre l'école de Reims, les plus renommées étaient celles de Chartres et de Tours et, depuis l'arrivée de l'Italien Lanfranc, celle du couvent du Bec en Normandie.
Un des effets du réveil intellectuel fut de ramener les esprits à Aristote. Celui-ci n'avait jamais été oublié complètement dans les écoles occidentales; on s'était servi de quelques-uns de ses traités dialectiques traduits par Boëce; le moine Notker labeo de Saint-Gall fit même une version allemande des catégories et du livre de l'interprétation ; mais on ne connaissait pas les grands ouvrages du philosophe; il n'influa encore sur la théologie que par sa logique. Cette influence se fit sentir d'abord dans la nouvelle controverse sur l'eucharistie.
20. Controverse sur la sainte-cène. Bérenger.
La doctrine exposée par Radbert n'était pas encore reçue comme dogme de l'église. Les théologiens flottaient, indécis, entre des opinions diverses; celle toutefois de Radbert fit du chemin, elle était conforme à la tendance générale de l'époque. Elle fut combattue de nouveau parBérenger, depuis 1.031 écolâtre à Tours, et depuis 1040 archidiacre à Angers (62).
S'appuyant sur quelques Pères et s'aidant d'arguments dialectiques, Bérenger enseigna que la messe consiste en deux choses, dont l'une est visible, les espèces du sacrement, et l'autre invisible, la res sacramenti, c'est-à-dire le corps et le sang de Christ; par la consécration le pain et le vin deviennent sacrement sans perdre leurs propriétés, ils n'acquièrent qu'une dignité nouvelle. Si l'on dit que le pain est alors le corps, c'est une manière de parler figurée, locutio tropica. La manducation du corps n'est donc pas matérielle, elle se fait intellectualiter, Jésus-Christ n'est présent que pour l'intelligence du croyant. Il n'y a de réel que ce qui est substance, et on ne peut appeler substance que ce qui est perçu par les sens; or dans la cène les sens ne perçoivent que du pain et du vin, donc le pain et le vin sont les seules substances réelles du sacrement. On ne, peut ni parler de la présence du corps de Christ, puisqu'on ne voit pas ce corps, ni dire que le pain n'est plus pain, puisqu'on ne cesse pas de le voir sous cette forme. Bérenger dit, il est vrai, que les éléments sont le corps et le sang, mais il pense que par cette affirmation même on exclut toute idée de transmutation; toute proposition se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un attribut ; dans celle dont il s'agit, le pain et le vin sont le sujet, le corps et le sang forment l'attribut; si donc le pain cessait d'être ce qu'il est, le sujet serait changé et l'attribut ne s'y appliquerait plus; quand un sujet est remplacé par un autre, les propriétés du premier ne passent pas au second.
Cette démonstration par le moyen de la logique se heurta contre l'opinion qui réclamait un miracle. Soupçonné d'hérésie, Bérenger écrivit à son amiLanfranc, alors écolâtre du couvent du Bec, pour lui proposer une tractation publique de la question. Sa lettre, ouverte par d'autres mains, devint la cause d'une dénonciation auprès de Léon IX; celui-ci fit condamner Bérenger, sans l'entendre, par deux conciles tenus en 4050 à Rome et à Verceil. En France il avait quelques défenseurs; Hildebrand lui-même, venu comme légat et qui présida en 1054 un concile à Tours, lui semblait favorable; devant cette assemblée Bérenger déclara qu'après la consécration le pain et le vin sont le corps et le sang. Le légat et le concile en furent satisfaits. Mais la déclaration était ambiguë quelque temps après on en voulut une plus claire; en 1059 Bérenger, cité devant un concile romain, eut la faiblesse de signer une formule, disant que dans la messe « le corps et le sang du Christ sont touchés sensualiter par la main du prêtre et mâché et bu par les fidèles ».
Délivré de ses persécuteurs, il rétracta une doctrine qui lui semblait trop matérialiste pour qu'il pût se l'approprier. Ce fut alors que commença une controverse littéraire, qui dura plusieurs années. L'emploi que Bérenger faisait de la dialectique obligea ses adversaires, dont le principal était Lanfranc, à s'en servir à leur tour pour donner à leur système un aspect en quelque sorte plus scientifique. Ils persistèrent à soutenir le caractère miraculeux de l'eucharistie, mais prétendirent l'expliquer par des raisonnements : la substance peut changer, sans que les attributs ou les accidents changent, et réciproquement, les attributs ne sont pas inhérents à la substance, ils ne sont que des accidents, que la volonté divine peut faire passer d'une substance à une autre; c'est ainsi que dans la cène la substance du pain est remplacée miraculeusement par celle du corps du Christ, il n'en reste que la forme accidentelle. Cette substitution de la substance du corps et du sang à celles du pain et du vin reçut le nom de transsubstantiation, terme qui fut employé pour la première fois dans un sermon par un ancien élève de Bérenger, l'archevêqueHildebert de Tours.
Les partisans de ce dogme montrèrent une telle exaspération, qu'au concile de Poitiers de 1075 Bérenger eut de la peine à se soustraire à leurs violences. Devant un concile romain de 1078 il répéta ce qu'il avait dit à Tours; Grégoire VII voulait qu'on se contentât de sa formule générale, mais, obsédé par les fanatiques, il dut lui imposer, au concile de Latran de 1079, une profession de foi plus explicite : le pain et le vin deviennent le corps et le sang dans la vérité de la substance. Regrettant ce désaveu de ses principes, il essaya de s'expliquer, mais on ne lui laissa pas de repos avant qu'il eût convenu qu'il s'était trompé. Dès lors, protégé par le pape, il put se retirer dans l'île de Saint-Côme près de Tours et y passer en paix le reste de sa vie; il mourut en 1.088, presque vénéré comme un saint; Hildebert de Tours, ne se souvenant plus que du savant théologien, son ancien maître, composa en son honneur une longue épitaphe en vers latins; chaque année les chanoines de Saint-Martin se rendaient à sa tombe pour y célébrer son anniversaire.
Cette controverse, qui assura le triomphe de la transsubstantiation, marque l'avènement de la théologie scolastique; désormais on se servira de la dialectique d'Aristote pour démontrer la conformité des dogmes avec la raison.
Précédent:17. Controverse sur la prédestination. Gottschalk
Suivant:21. Les Saxons. Les pays scandinaves
57 Hjort, Scotus Erigena oder von dem Ursprung einer christlichen Philosophie, Copenhague 1823. - Staudenmaier, Scotus Erigena und die Wissenschaft seiner Ait, Francfort 1834, T. 1, unique. - Saint-René Taillandier. Scot Érigène et la philosophie scolastique. Strasbourg 1843. - Christlieb, Leben und Lehre des Se. Er. Gotha 1860. - Huber, Se. Er. Munich 1861. - Hauréau, Histoire de la philosophie scolastique. T. 1, p. 148. - Fronmüller, Die Lehre des Se. Er. vom Wesen des Büsen. Tübinger Zeitschr. für Theol. 1830. 1re et 3e livr. - Möller, Se. Er. und seine Irrthümer. Mayence 1844. - Hoffmann, Gottes-und Schüpfungsbegriff des Se. Er. Iéna 1876.
58 1ere éd. par Gale, Oxford 1681, in-f° réimpr. par Schlüter, Münster 1838. La meilleure édition est celle de Floss, dans la Patrologie de Migne, T. 122.
59 Ratherii opera, edd. Ballerini. Vérone 1765, in-f°. - Vogler, Ratherius und das zehnte Jahrhundert. Iéna 1854.
60 Théâtre de Roswitha, traduit en français, avec le latin, par Ch. Magnin. Paris 1845. Die Werke der Hrotsvitha, herausgegeben von Barak. Nüreinberg. 1858.
62 Berengarii liber de S. coena, edd. A. et F. Vischer. Berlin 1834. - Sudenhof, Berengarius Turonensis, Sammlung ihn betreffender Briefe. Hambourg 1850.