
V
Martyr (Février-Avril 1732)
-------
« ... Ils
moururent tués par l'épée, ils
'allèrent çà et là...
dénués de tout,
persécutés, maltraités - eux
dont le monde n'était pas digne, -
errants... Tous ceux-là, à la foi
desquels il a été rendu
témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur
était promis, Dieu ayant en vue quelque
chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne
parvinssent pas sans nous à la perfection...
»
HÉBREUX XI: 37-40.
Il faisait froid le mardi 12
février 1732. La neige recouvrait de ses
plaques épaisses les prés et les
bois.
Ce matin-là Pierre Durand
s'était arrêté chez son ami
Fumant; et ce fut sans doute de ce logis
hospitalier qu'il écrivit à sa femme.
Les deux enfants allaient bien et leur père
voyait s'approcher le moment où ils seraient
en état d'aller rejoindre en Suisse leur
mère impatiente. Seulement,
préoccupé avant tout de rendre
à Dieu la place qui lui était due
jusque dans le règlement
de cette affaire, le pasteur ne manqua pas de
recommander à sa compagne de s'appuyer sur
la Providence et de ne compter que sur
elle.
Il n'en restait cependant pas
moins
soucieux de l'attitude de Court, toujours
indifférent au sort difficile de
l'exilée, bien qu'il se fût alors
ouvert à lui de ses préoccupations;
et il était en droit de penser que le
réorganisateur des Églises
comprendrait son angoisse, pour l'avoir
lui-même connue jusqu'à son
départ de France en 1729. Il n'en fut rien.
Sa femme Étiennette fut plus insensible
encore. Durand, désolé,
écrivit au pasteur Vial, comptant trouver
auprès de lui plus de sollicitude. Il
espérait que ses démarches
aboutiraient à l'octroi d'une pension en
faveur de la jeune mère dans la
détresse.
La seconde partie de sa lettre
était adressée à Jacques
Boyer. Il l'entretenait de ces soucis : « Anne
n'était pas femme à faire
connaître ses besoins », et « son
chagrin était de la sentir là-bas
avec si peu d'argent »... En même temps,
il lui faisait part de ses projets : il allait se
rendre en Dauphiné pour conférer avec
Roger sur l'affaire de l'autre Boyer, le
schismatique.
Différents témoignages
laissent penser que le programme du pasteur ne se
bornait pas là. Après ce voyage il
retournerait en Languedoc, puis il
s'évaderait quelque temps de France pour
aller loin du danger se reposer
de ses fatigues auprès de sa compagne. Il
irait également à Berne ou à
Zurich pour y solliciter lui-même les secours
qui assureraient enfin le pain du lendemain
à sa famille sans ressources.
Le jeune pasteur fit seulement
de
discrètes allusions à ces projets, et
garda sur eux les plus grandes réserves, car
sa lettre pouvait être
interceptée.
Après avoir écrit il
se rendit au hameau de Gamarre où il
s'apprêtait à passer la soirée
avant d'aller de nuit à Vernoux. Il
s'arrêta chez le religionnaire
Reboul.
Mais tandis qu'il parcourait la
route de Chalencon à Gamarre il fut reconnu
par la femme et les enfants du cardeur de laine
Jean Brun. Ce dernier, dont la petite maison
était proche du chemin, avait souvent vu
passer le pasteur et l'avait désigné
aux membres de sa famille. Il n'était pas
alors chez lui, mais chez un voisin qu'il aidait
à faire de l'huile.
Sa femme, âpre au gain, fut
assez avisée pour comprendre que si elle
allait avertir son compagnon, elle et lui ne
manqueraient pas d'être rendus responsables
de la capture par les populations huguenotes
exaspérées. Elle renonça donc
à courir jusqu'à la grange où
il travaillait, mais elle envoya son fils à
Chalencon. Là résidait un apostat,
Jacques Astier, « chirurgien de son
métier, capable de se donner cent fois au
diable pour avoir du bien, car il était fort pauvre
». La relation de
Fauriel qui nous donne ces détails prend
soin d'ajouter « que cela n'était pas
une hyperbole, car plusieurs personnes dignes de
foi l'avaient entendu dire qu'il ne se souciait pas
d'être damné, pourvu qu'il
laissât du bien à ses enfants; et
qu'il voulait faire du mal autant qu'il en pourrait
faire, car ni plus ni moins il serait damné
».
Ces enfants, tous deux «
chirurgiens » comme leur père,
habitaient avec lui. Dès que le fils de Brun
les eût avertis de la présence du
proscrit dans leur quartier, ils se rendirent
à Vernoux et firent part de ces
événements au capitaine de la
Chambardière, commandant la
garnison.
Or le même jour, à
l'insu de Durand, le prédicant Lapra fit
convoquer une assemblée qui devait se tenir
au Chevalar, près de Vernoux. La nouvelle en
fut donnée à la femme du tisserand
Jacques Boury : Cette « religionnaire »
avertit son mari, resté « papiste
», de son dessein d'assister à la
réunion clandestine, contribuant ainsi sans
le savoir à l'arrestation du ministre. Boury
fit en effet ce dont sa compagne ne l'aurait pas
cru capable : il avertit Desbots, le curé de
Saint-Félix-de-Châteauneuf. Celui-ci,
jeune, cupide et ambitieux, avait remplacé
depuis peu le vénérable prieur
Desmosins, qui, on s'en souvient, avait, en
septembre 1719 refusé de rien faire contre
Pierre Rouvier revenu de Suisse, dont il
connaissait cependant la
présence au Constant. Mais son successeur
était plus entreprenant. Depuis longtemps il
suivait son rival et s'inquiétait de voir
les nouveaux convertis de sa paroisse abandonner
l'Eglise pour les assemblées. Or des
considérations financières
n'étaient pas étrangères
à son zèle : les mariages
célébrés au Désert
diminuaient son casuel. Le rôle odieux qu'il
joua plus tard ne laisse aucun doute sur ses
sentiments.
Un religionnaire, qui se
trouvait au
presbytère de Desbots lorsque Boury s'y fit
recevoir, entendit la soeur du prêtre
déclarer à son frère qu'un
homme voulait lui parler. Soupçonnant le
tisserand d'être venu dénoncer
l'assemblée du Chevalar, il l'observa
discrètement. Mais Desbots devina le
manège et fit sortir Boury par
l'écurie après l'avoir gardé'
près d'une heure dans sa chambre. Le
traître n'en fut pas moins reconnu par le
huguenot qui s'empressa de mettre les «
anciens » en garde contre ses menées.
Après avoir hésité ceux-ci ne
jugèrent pas à propos de renvoyer
l'assemblée, mais ils firent placer des
sentinelles. Le soir venu, l' « exercice
» eut lieu sans incident.
À Saint-Félix le
prieur dîna rapidement, puis il courut
à Vernoux. M. de la Chambardière
venait déjà de recevoir les fils
d'Astier. Il lui fut aisé de rapprocher les
divers faits dont il était saisi. D'une
part, une assemblée devait avoir lieu sans
que Desbots pût en
désigner l'emplacement exact que Boury
ignorait; et d'autre part Durand avait
été signalé vers Gamarre. Le
capitaine, avec les trois délateurs,
prêtre et apostats, établit son plan.
Sans doute la réunion se tiendrait à
la grange de Vernat, près de Gamarre. Elle
serait nombreuse, car on savait assez la
renommée de Durand qui, à les en
croire, devait certainement la
présider.
M. de la Chambardière
disposait d'une centaine d'hommes, mais il
était impossible de les faire tous partir en
détachement, et dans de telles conditions il
devenait imprudent de se porter directement contre
l'assemblée. On n'oubliait pas que des
protestants surpris s'étaient parfois
vigoureusement défendus; et il ne fallait
pas courir le risque d'attaquer un attroupement,
important peut-être, avec des forces
inférieures en nombre. On se contenterait
donc de partir assez tard et de surveiller les
routes pour saisir les fidèles qui
rentreraient en petits groupes au village ou
à la ville, à l'issue de la
réunion.
De ces calculs, établis sur
un rapprochement inexact des faits, un malheur
allait résulter.
Vers dix heures et demie du
soir, ce
même mardi 12 février 1732,
trente-cinq hommes du régiment de Bourbon
quittèrent leur caserne, sous les ordres de
M. de la Chambardière. Ils parcoururent deux
kilomètres environ, puis ils se
séparèrent en deux groupes. Tandis que le
premier
poursuivait sa marche sur le vieux chemin de
Saint-Agrève, l'autre bifurquait et
s'engageait vers le hameau de Vernat, sur
l'ancienne route de Vernoux à
Saint-Jean-Chambre. Celle-ci, coupée
maintenant par endroits, est abandonnée
depuis une cinquantaine d'années. Les
vieillards se souviennent encore de l'avoir suivie,
et son relief demeure net sous les fougères
et les broussailles qui la recouvrent. Mais si le
pèlerin veut se rendre sur les lieux exacts
de l'arrestation, il lui sera plus facile de partir
de Vernoux que de Gamarre, car la piste se perd
à la sortie du hameau.
L'auteur a parcouru ces anciens
chemins. Il a vu le carrefour où se divisa
le détachement de M. de la
Chambardière. Il a continué sa course
vers le bois, en passant devant le château de
Vaussèche pour s'engager plus loin sous les
taillis et descendre dans un vallon obscur
longé par un ruisseau que l'on traverse sur
un pont de planches assez rustique. Autrefois on
allait à gué. La courbe du chemin est
encore visible. Mais bientôt il se
relève pour monter en lacets au travers
d'une futaie de bouleaux et de frênes
parsemée ici et là de
châtaigniers, qui recouvraient jadis seuls
cette croupe assez abrupte.
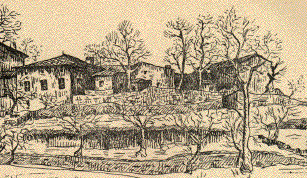
Hameau de Gamarre, près de Vernoux
Siège du Synode National de 1730. Lieu où dîna Pierre Durand le soir de son arrestation (12 février 1732)
Retrouvons donc Durand à Gamarre.
Ignorant du piège qui lui était
tendu, il dîna là-bas avec son
collègue Fauriel et quelques amis.
Bientôt une trentaine
d'autres personnes arrivèrent et se mirent
à émonder des noix. La soirée
passa. Vers dix heures, au moment où les
soldats quittaient Vernoux, le pasteur se
prépara pour le départ. Il se
disposait à aller non loin de là dans
une maison appartenant à M. de Montreynaud
et louée par le religionnaire Brunel, dont
il devait marier la fille. Après quoi il
suivrait son plan et s'en irait vers Valence et le
Dauphiné.
On voulait l'accompagner. Il
refusa
et s'en, alla seul sur son cheval noir sans
même avoir chargé ses pistolets
d'arçon, bien que les routes fussent rendues
peu sûres par les loups et les
bandits.
La nuit se prolongeait, froide
et
pleine d'étoiles. Durand, pressé,
poussa sa monture dont les pas sonnaient sur le sol
glacé. Il s'avança bientôt vers
le bois de Vaussèche. Mais de l'autre
côté du ruisseau les soldats
l'entendirent. À ce bruit suspect ils
détachèrent en avant-garde le sergent
Chapelle et deux autres hommes. Le sous-officier
fit quelques pas au delà du gué, et
se blottit derrière l'un des coudes du
chemin.
Il est onze heures du
soir.
Durand s'engage dans les lacets,
prêt à franchir le gué qu'il
devine bientôt dans l'obscurité. Au
dernier tournant, Jean-Baptiste Chapelle se dresse.
Le voyageur tressaille. Instinctivement il porte la
main sur un petit pistolet de poche, chargé
celui-là. Mais il se reprend. Il ne tirera pas.
Le
sergent saisit le cheval à la bride : le
pasteur est prisonnier !
Les deux soldats retrouvent leur chef et tous
les trois mènent le cavalier vers le
capitaine de la Chambardière. Ce dernier
questionne le voyageur mystérieux.
D'où vient-il et où va-t-il ? La
relation protestante de l'arrestation coïncide
absolument avec les dépositions des divers
témoins : Durand, sans dire tout, affirma
qu'il allait de Saint-Jean-Chambre à
Vernoux, « pour une communauté ».
À ce moment, il fut rejoint par le
curé Desbots. Le prêtre avait
guidé l'un, des deux détachements
pendant que le fils d'Astier dirigeait l'autre sur
la route de Saint-Agrève.
L'obscurité empêchait
que l'on visitât la valise suspendue sur la
croupe du cheval. On fit donc rappeler toute la
troupe qui regagna le hameau de Vernat; on
supposait à tort que l'on y capturerait
quelques membres de l'assemblée
déjà dispersée; mais on ne
trouva rien de suspect. Alors des lumignons furent
apportés, et, dans la demi-obscurité
d'une salle mal éclairée,
l'abbé Desbots acheva de reconnaître
le voyageur. Vainqueur et vaincu étaient en
présence, dans la plus dramatique des
confrontations.
Les sacoches du pasteur furent
ouvertes : aucun, doute ne pouvait subsister. On
venait enfin de se saisir du séditieux, du
proscrit depuis longtemps recherché. L'affaire
était magnifique. Il ne restait plus
qu'à prendre les précautions
nécessaires contre les tentatives
d'évasion du prisonnier ou les entreprises
des religionnaires désespérés
par la nouvelle de la capture de leur
ministre.
Durand silencieux assistait aux
fouilles qui livraient successivement aux soldats
et au prêtre ses ouvrages religieux
préférés et quelques volumes
de Malebranche et de Boileau; les lettres et la
menue somme d'argent qu'il portait sur lui : quinze
livres en tout. C'était peu! Ses registres
n'étaient pas là. Homme prudent, il
ne les gardait pas dans ses bagages, car sa capture
toujours possible en aurait fait les plus
redoutables pièces à conviction
contre les protestants dont il avait béni
les mariages ou baptisé les enfants. On ne
saisit en tout et pour tout qu'un certificat de
mariage.
Quand on eut fini de retourner
et de
vider sa valise, on l'interrogea de nouveau. -
« Êtes-vous Monsieur Durand? » -
« Oui, Monsieur, je le suis, et je connais que
mon heure est venue de passer de ce monde au
Père des Esprits ». Le captif ne se
faisait aucune illusion sur le sort qui
l'attendait. On lui demanda s'il ne venait pas de
convoquer une assemblée. Il le nia. Puis il
refusa de dire où il avait
dîné.
Vers une heure du matin on le
conduisit à Vernoux, lié sur son
cheval. Triste cortège qui, dans la nuit, menait
le vagabond pour la
foi
vers la première étape de la course
à la mort. Le prisonnier voyait comme dans
un rêve ses amis qui l'attendaient, et qui,
lassés allaient renoncer enfin 'à
l'interminable veillée. Inquiets, ils
s'abandonneraient au repos troublé et
incertain, jusqu'à ce qu'ils
connûssent la raison de l'absence de
l'hôte désiré. C'était
là le sort des religionnaires, la
rançon de leur héroïque
obstination.
Il songeait à sa
carrière brisée, à
l'inéluctable destin qui le mènerait
bientôt devant le juge et devant le bourreau.
Mais il savait aussi que son Dieu restait
fidèle. Toutes ces affirmations qu'il avait
si souvent répétées, il les
revivait à présent, ne voulant plus
garder que la seule volonté de se soumettre
à l'ordre d'En Haut.
On parvint à Vernoux vers
trois heures du matin. Le pasteur ne fut pas mis en
prison. On voulait en effet le traduire à
Tournon dès le lever du jour, par crainte
d'un soulèvement des populations
consternées.
Il fut conduit aux casernes
où M. de la Chambardière lui fit
apporter un fauteuil et lui permit de manger en sa
présence, avant d'aller donner ses ordres
non sans laisser son lieutenant auprès du
détenu.
À l'aube, les soldats
n'étaient pas encore prêts. Mais
déjà le bruit de la capture du
ministre s'était répandu dans la
bourgade. Plusieurs personnes vinrent le voir,
auxquelles il répondit avec calme et
politesse. Le curé Meunier lui demanda « de
lui rendre une partie de l'argent tiré des
mariages qu'il aurait dû bénir
lui-même ». Durand resta calme et digne
: « Monsieur, fit-il, le tribut que j'en ai
tiré vous serait bientôt rendu,
puisque vous savez bien, si vous voulez le savoir,
que je n'ai pris des mariages que le montant du
papier timbré pour le certificat et le
registre ». Puis il déclara n'avoir
accompli là que la volonté de Dieu et
suivi les ordres de sa conscience : on ne pouvait
laisser des conjoints vivre en concubinage. Ils
devaient donc se marier; mais puisqu'ils ne
consentaient pas à le faire au prix de leur
abjuration, l'intervention du pasteur devenait
nécessaire. Quant aux ordres du Roi, le
prisonnier croyait pouvoir les enfreindre sans
remords; car il valait mieux servir Dieu en leur
désobéissant, que de les suivre en
offensant Dieu.
Une vieille demoiselle de
Vernoux,
dont l'inconduite était notoire, crut bon
d'insulter le malheureux. Mais il sut la reprendre
vigoureusement et lui faire sentir dans le langage
de l'homme sûr de son droit toute
l'indignité de son attitude. Elle s'en alla,
pleine de honte et de rancoeur.
D'autres visiteurs vinrent
encore,
poussés par la curiosité ou la
sympathie ; et ils s'en retournèrent fort
émus par le calme et la
sérénité du
ministre.
Le moment de partir arriva. Le
détachement était prêt.
C'était le mercredi 13 février,
à 7 heures et demie du
matin. On fit monter Durand sur son cheval. Le
lieutenant l'accompagnait.
Au sortir de la ville la petite
troupe était attendue par des groupes
importants de curieux ou de religionnaires venus
pour revoir une dernière fois leur
conducteur dont ils déploraient le sort
tragique. Lorsque celui-ci' parut, escorté
par les soldats en armes. l'émotion fut
intense. Le martyr entonna, de toute sa voix, la
première « pause » du psaume 25
- À toi mon Dieu mon coeur monte,
En Toi mon espoir j'ai mis.
Puis bientôt il s'éloigna, allant
vers son destin.
Il chanta plusieurs fois encore
en
cours de route, et s'entretint le reste du temps
avec l'officier. Celui-ci le traita fort
humainement et prit même son repas avec lui
quand le moment en fut venu.
Vers cinq heures on arriva à
Tournon. L'étape avait été
longue et fatigante. La nuit tombait. On jugea
inutile de faire comparaître dès le
soir le ministre devant M. de La Devèze,
commandant militaire en Vivarais, et on l'enferma
dans une prison du château de Rohan. Le
gouverneur, craignant sans doute que quelqu'un ne
tentât d'empoisonner l'infortuné, fit
apporter dans la geôle des aliments
préparés chez lui.
Le lendemain jeudi 14
février, La Devèze procéda, vers le début de
l'après-midi, au premier interrogatoire.
Durand, se référant aux
décisions des synodes, ne voulut pas
répondre jusqu'à ce que son juge lui
eût montré la copie d'une
déclaration royale aux termes de laquelle
les affaires concernant la religion relevaient de
la juridiction de l'Intendance. Selon Fauriel,
à qui nous devons cette relation, le
prévenu reconnut alors qu'il avait
prêché, marié, et
baptisé. Mais il refusa de donner aucun
détail qui pût compromettre ses
amis.
On avait trouvé sur lui
plusieurs clefs. Il répondit que l'une
d'elles était celle d'un petit coffret. On
le pressa de questions afin de savoir où se
trouvait cette boite qui ne contenait pourtant que
quelques livres et quelques lettres, et on alla
même jusqu'à le menacer de la torture.
Il écrivit alors à son
collègue Fauriel, après avoir obtenu
du commandant la promesse, donnée sur
l'honneur, que l'on n'inquiéterait pas
l'homme venu pour retirer la missive au bureau de
Privas.
Celle-ci eut son histoire, mais
avant d'y faire allusion, nous en résumerons
quelques passages. Durand signalait sa propre
capture, et demandait que l'on fit porter le fameux
coffret à Marcoles, devant la porte de M.
Descours, protestant, et juge des quatre mandements
des Boutières. Ce notable ne devait pas
manquer, dans la pensée du prisonnier, de
remettre à La Devèze l'objet tant
désiré. Le malheureux terminait ensuite par des
recommandations et des adieux :
« Il ne me souvient pas
s'il
y a dans le coffret une copie de nos
règlements, écrivit-il. S'il se
pouvait, je souhaiterais que M. de La Devèze
en vit une ; de sorte que si vous entendez dire
qu'il n'y en ait point, vous me ferez plaisir de
lui en envoyer une copie, afin qu'on voit par
là que nous n'enseignons ni ne pratiquons
rien contre le bien de l'État. Au reste, mon
cher frère, ma course sera bientôt
finie. Dieu aidant, dans peu de temps je scellerai
l'Évangile que j'ai prêché. je
vous prie de prier le Seigneur en ma faveur, qu'il
me pardonne mes péchés, qu'il me
sanctifie par son Saint-Esprit et qu'il me
soutienne dans toutes mes épreuves.
Grâces à Dieu, j'ai rendu
témoignage de ce que je crois ; Dieu m'a
donné la force de confesser librement qui je
suis. le prie le Seigneur de me faire la
grâce de finir mes jours dans son amour et
dans sa crainte. je vous recommande à sa
divine protection. Il n'est pas nécessaire
de vous dire que vous avez à vous conduire
sagement et avec beaucoup de circonspection. je
vous recommande, de même qu'à toutes
les bonnes âmes, ma pauvre femme et mes chers
enfants qui vont être bientôt sans
père... Adieu, mon cher enfant nous nous
reverrons au ciel. Amen. »
Cette lettre, qui figure aux
Archives départementales de
l'Hérault, fut connue des religionnaires
dans les circonstances suivantes. Elle portait une
fausse adresse. La Devèze, ayant
donné sa parole, écrivit à M.
de la Fare pour lui demander des instructions. Sur
ces entrefaites les protestants apprirent la
catastrophe qui les frappait et nul d'entre eux ne
voulut courir le risque d'aller « à la
poste » de Privas. Bien leur en prit, car, au
reçu de la réponse de La Fare, le
commandant, oublieux de sa promesse, fit surveiller
le bureau et signifia à la directrice
qu'elle eût à avertir
immédiatement « le brigadier des
cavaliers de la maréchaussée
logeant dans la ville », si quelqu'un se
présentait pour réclamer le
pli.
La Devèze se rendit
lui-même à Privas vers le 10 mars. La
lettre y était toujours. Le commandant
militaire n'aurait pas demandé mieux que
d'arrêter Fauriel venu là-bas pour la
chercher; mais le prédicant se sentant en
danger avait fui à Genève. Quand La
Devèze l'apprit, il fit quérir, dans
son dépit, deux hommes de la paroisse de
Vernoux. Croyant sans doute que le fameux coffret
se trouvait chez eux, il les menaça, mais
sans résultats : les malheureux ignoraient
toute cette affaire. En désespoir de cause,
leur tyran les autorisa à recevoir la lettre
et leur remit un sauf-conduit à cet effet.
Les deux coreligionnaires prirent la missive, en
firent une copie qui fut transmise plus tard
à Fauriel, et renvoyèrent l'original
à Tournon.
On conçoit que les retards
entraînés par ces incidents aient
empêché le coffret d'arriver assez
tôt pour que La Devèze pût
l'ouvrir avant le départ du prisonnier pour
Montpellier. Il ne se mit pas moins en devoir
d'avertir l'Intendant de la capture enfin
réalisée. « Voici Durand, le
fameux ministre, le faiseur de mariages,
arrêté... » Et l'officier
ajoutait qu'il le faisait garder à vue
jusqu'à ce qu'il reçût des
ordres. En même temps, il donnait ses
suggestions à propos de l'attribution de la
prime de 4.000 livres promise pour la tête du
pasteur,
et dont la plus grande partie devait être
remise, selon lui, au capitaine de la
Chambardière.
Quelques jours
s'écoulèrent. Une petite
polémique mit aux prises le
subdélégué Dupuy, de Privas,
et M. de la Fare. Le premier voulait que
l'exécution du coupable - qui ne faisait
aucun doute selon lui - eût lieu dans cette
ville. L'autre ne partageait pas son avis. Les
ordres arrivèrent bientôt. Le 18
février M. de Bernage, très
rapidement averti par un courrier spécial,
demandait à Versailles l'autorisation
d'instruire le procès du pasteur en
même temps qu'il rendait compte de sa capture
au garde des sceaux, au chancelier Saint-Florentin,
au cardinal Fleury lui-même et au duc de
Maine. Puis il répondait à La
Devèze. M. de la Fare donnerait le jour
même les ordres nécessaires pour le
transfert de Durand à Montpellier. Et comme
l'autorisation. de verser une partie au moins de la
prime ne manquerait pas d'être
accordée par la cour, il convenait que le
commandant, dont le zèle serait certainement
reconnu, établît lui-même un
projet de répartition.
On avertit M. du Bois de la
Ville,
commandant une compagnie de grenadiers du
régiment de Bourbon, d'avoir à se
préparer pour accompagner le ministre
jusqu'en Languedoc, avec deux compagnies en armes.
On craignait toujours les entreprises des religionnaires
désespérés
par la capture de
leur pasteur, « le patriarche du Vivarais
», dont on connaissait toute l'influence et la
popularité. On remit à l'officier un
mémoire concernant les lieux et les gens que
le prisonnier était soupçonné
d'avoir fréquentés et à propos
desquels il conviendrait de l'interroger.
L'itinéraire fut établi avec ses
diverses étapes, et d'autres prescriptions
terminèrent cette longue note de service :
« Ordonnons aux consuls (les maires) des lieux
de passage de faire fournir au capitaine commandant
une maison sûre et telle qu'il choisira
lui-même, pour la sécurité du
prisonnier dont il est chargé, avec soixante
et quinze livres de bois, et chandelle pour le
corps de garde qu'il lui est ordonné de
poser... Au surplus ordonnons aux consuls de
fournir les chevaux nécessaires aux
officiers, en payant conformément à
l'ordonnance du Roi ».
Les soldats furent
prélevés sur les garnisons d'Annonay,
de Privas et de Chomérac. Le 21 ils
étaient groupés à Tournon. Le
lendemain le cortège se mettait en marche.
Sans doute avait-on prêté un cheval
à Durand, car le prix de location de la
bête fut porté sur la liste des frais
de voyage « Il avait été
nécessaire de la fournir au ministre ».
On devait arriver le soir à Charmes,
après une courte étape de vingt-cinq
kilomètres. Que dut penser le voyageur en
traversant Soyons, jadis illustré par le
ministère de son devancier dans le service
et
l'épreuve, le vieux martyr Isaac Homel
?
Le matin, il avait pris congé
de M. et de Mme La Devèze, dans un langage
ferme et digne, rendant témoignage de sa foi
sans omettre d'appeler la bénédiction
du ciel sur le commandant et sa femme. Pendant la
journée, selon la chronique de Fauriel, il
conserva la même attitude en face de ses
gardiens qu'il émut par son stoïcisme
et sa sérénité. Partout, sur
son passage, les habitants sortaient en grand
nombre pour le voir une dernière fois.
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
