
Pasteur et homme de douleur (suite)
-------
On se réunit le 11 octobre 1727 ainsi que
Roger l'avait prévu. Il y avait là
trois pasteurs, cinq proposants
et trente-cinq anciens. Ni Court ni Corteiz ne
purent assister à ce synode national. Le
second avait à ce moment les plus
sérieuses inquiétudes sur le sort de
sa femme. Elle venait de faire un séjour
secret dans les Cévennes, mais après
un an d'alarmes perpétuelles elle avait
dû regagner Zurich où elle vivait
d'expédients.
Boyer représentait les
Églises du Languedoc. Nous verrons
bientôt quel rôle néfaste il
allait jouer là-bas, moins de trois
années après ces
événements.
On confirma certains arrêts
ordonnant de se rendre sans armes aux exercices
publics de piété, puis on
décréta que le « Conseil
extraordinaire » - manière de
Comité dont l'existence avait
été décidée quelques
mois auparavant - resterait toujours sous le
contrôle des synodes. L'assemblée
nationale gardait donc seule le pouvoir absolu.
Cette disposition fut bientôt
confirmée à propos d'une discussion
portant sur la députation
générale de Du Plan. Celui-ci,
fortement discuté, avait reçu des
instructions et même des blâmes de la
part de certains synodes provinciaux qui, sur les
instigations de Corteiz, l'accusaient de
compromissions avec des inspirés
réfugiés à Genève. Une
décision rappelant que l'ancien gentilhomme
d'Alès relevait seulement de la juridiction
générale des Églises marqua le
triomphe de Court et termina cette irritante
controverse. Du Plan rendait alors d'incontestables
services.
Ne
venait-il pas précisément d'obtenir
des pouvoirs de Lausanne qu'ils prissent à
leur charge l'entretien de quelques
prédicants venus là-bas pour
compléter leurs études ? On ne
demandait en échange que la
discrétion la plus absolue, par crainte des
représentations de l'ambassadeur
français.
Après avoir rendu aux
Églises leurs anciennes et fortes
traditions, les pionniers s'assuraient à
présent du concours d'amis étrangers
et prenaient toutes les mesures nécessaires
pour la formation d'une élite de conducteurs
instruits et capables.
Durand présida trois semaines
plus tard un synode provincial, puis il dut
s'occuper avec Roger de régler - encore -
des comptes difficiles, concernant la vente de
livres dont quelques-uns, ceux de Genolhac -
n'étaient toujours pas soldés. Le
colporteur Mercier, du hameau de Gamarre, refusait
maintenant de céder le moindre volume avant
d'avoir été payé. En outre ses
ballots partaient toujours directement pour le
Languedoc et. il fallait que les Ardéchois
envoyassent là-bas un
délégué pour pouvoir y
retrouver ce qui leur était dû. Il
était plus simple de procéder au
partage sitôt le passage des colporteurs en
Vivarais. Ceux-ci n'auraient plus qu'à
descendre ensuite vers le sud, avec une charge
diminuée.
Vers la fin de l'année le
nouveau ministre fut victime d'une machination dont
plusieurs lettres successives
laissent voir qu'elle le mit sérieusement en
souci. Un homme avait autrefois
épousé l'une de ses parentes, morte
bientôt après. Or il venait de
séduire une veuve, et de cette union
irrégulière était né un
enfant que le père fit baptiser sous le nom
de Durand. Le pasteur comprit immédiatement
quel parti les catholiques pouvaient tirer de
l'incident. Bien qu'il se sentît à
l'abri de tout soupçon de la part de ses
coreligionnaires, il s'efforça de faire
supprimer ce nom sur le registre, en faisant
intervenir à cet effet un notaire de sa
parenté, et celui aussi de l'imposteur; mais
il n'aboutit pas.
Il demeura perplexe. Se
défendre quand même était
donner à l'aventure une publicité
bien inutile et dangereuse. S'en
désintéresser équivalait
à laisser les soupçons sans
réponse. Ces problèmes paraissaient
lourds à l'âme délicate du
jeune homme, et par malheur ils se doublaient
d'autres soucis. Il avait craint un instant que sa
femme n'eût été
dénoncée. Il respirait maintenant,
mais non sans avoir connu pour la première
fois les terribles angoisses qui allaient
l'atteindre lui-même dans la personne des
siens.
Le froid ralentit bientôt ses
efforts. Il apprit avec joie la libération
de Genolhac, puis attendit l'année nouvelle.
Le 3 janvier 1728 il bénissait son
quatre-vingtième mariage près de
Desaignes. L'hiver rigoureux avait fait sortir les
loups de leurs repaires, et ces
animaux commettaient de sérieux ravages,
allant jusqu'à s'attaquer aux hommes. L'un
d'eux, sans doute enragé, étrangla
près d'une vingtaine de personnes. Il
fallait du courage pour braver ces périls
imprévus qui s'ajoutaient à tant
d'autres. Pourtant des assemblées fort
importantes eurent lieu vers la fin du mois
près de Saint-Sauveur et d'Issamoulenc; puis
un peu plus tard aux environs d'Ajoux, avant que
Durand ne revînt vers le nord de l'actuel
département de l'Ardèche où il
n'était pas passé depuis fort
longtemps. Il n'y séjourna pas et descendit
à Vals. Là, il reçut un mot de
Court lui recommandant de s'appliquer avec la
dernière énergie à faire
retirer son nom du registre des baptêmes
où l'imposture d'un débauché
le faisait ainsi figurer. Le réorganisateur
des Églises priait en outre son,
collègue de se rendre le 4 avril à
Uzès pour une « affaire
générale ».
Il y eut à peu près
vers ce moment une nouvelle alerte - on saisit des
lettres chez la veuve Fuzier, à Beaumont, et
la malheureuse se vit sérieusement
inquiétée. Il ne semble pas
heureusement que les choses aient été
plus loin et qu'un jugement quelconque ait
été rendu contre elle. Mais
c'était une indication. Les temps
n'étaient pas sûrs et plus que jamais
il importait d'agir avec beaucoup de
prudence.
L'un des meilleurs moyens
d'améliorer cette situation délicate
n'était-il pas d'obtenir de tous
l'observation des règlements ? Au milieu de
mars, Durand put joindre Monteil. Après une
conversation qui dura toute la nuit, il le
convainquit de sa faute et de la vanité de
son attitude. L'autre promit de se corriger et
consentit même à reconnaître ses
torts devant toute l'Eglise. Après quoi,
« il accepta de réparer son crime de
paillardise, de rébellion et de schisme de
la manière que le synode lui ordonnerait
». Mais en revanche « il souhaitait
d'être remis à son emploi de
prédicant après la suspension qu'on
jugerait à propos de lui infliger
».
Ce n'était pas un mince
succès pour les partisans de l'ordre.
Monteil l'indiscipliné venait à
résipiscence ! Ce résultat si
difficilement acquis avait une importance
considérable pour les Églises qui
allaient enfin, retrouver la paix
intérieure. Le pasteur écrivit en
hâte à Court et à Roger pour
leur annoncer l'heureuse nouvelle et demander que
l'autorisation de prêcher fût rendue le
plus rapidement possible au rebelle enfin repenti,
car le nombre des prédicateurs était
encore très réduit. Il ajoutait
« qu'il fallait appréhender des suites
fâcheuses si la suspension venait à
être trop longue ». On ne pouvait
être plus perspicace.
Dortial venait alors de
constituer
à Saint-Fortunat une secte
d'inspirés, en s'adjoignant deux
prophétesses, Claire et Veyrenche. Ce petit
groupe avait repris à son
compte les extraordinaires pratiques religieuses
jadis adoptées par Vesson à
Montpellier, lors de l'affaire des Multipliants, en
1723. Chacun prêchait en langage extatique,
revêtu d'oripeaux multicolores ou de longues
robes. Des rites étranges ou grotesques
unissaient entre eux les initiés de cette
singulière compagnie. Mais les
attroupés de Dortial, à demi-fous,
avaient failli brûler une Église et
des arrestations eurent lieu vers la fin du mois de
février. Le vieux fanatique échappa
seul aux recherches.
Lassagne était parti pour la
Suisse où il devait reprendre à
Lausanne la place d'étudiant laissée
libre par Betrine, jadis compagnon de Court et
revenu depuis peu auprès de son
maître. L'avenir s'annonçait donc
malgré tout, sous d'heureuses
auspices.
Pourquoi faut-il que, peu de
temps
après, Durand bénît le mariage
d'un religionnaire qui, devenu plus tard victime de
sa courageuse décision, perdit toute
bravoure et voulut se disculper en accusant le
pasteur ?
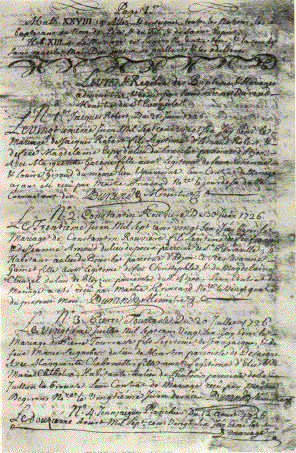
Première page du « Livre et Registre des Baptêmes, et mariages administrés et bénis par Pierre Durand ».
Le registre du jeune ministre nous
déclare expressément que Simon-Pierre
Aulagnet, habitant du Guâ, près de
Chomérac, avait fait établir par
devant notaire le 4 janvier
précédent, un contrat l'unissant
à Suzanne Benoît, de la Gréze.
Les deux conjoints vivaient déjà
depuis plusieurs mois ensemble et la jeune femme
était devenue mère d'une fillette que
ses parents refusaient, par
motif de conscience de faire baptiser à
l'Eglise catholique, gardant en face de celle-ci
l'attitude déjà prise lorsque le
moment était venu de commencer leur vie
commune. Le 1er mai ils rencontrèrent Durand
et lui demandèrent de consacrer par la
bénédiction religieuse la situation
depuis longtemps existante.
Nous citons le témoignage de
l'accusé :
« Aulagnet dépose le
2 avril 1732, devant le juge, à Montpellier,
que lui étant à labourer une terre a
un kilomètre de Chomérac où il
habite, a vu un homme à lui inconnu qui lui
a représenté s'il y avait des
nouveaux convertis à Chomérac, et si
le curé faisait difficulté de les
marier ; à quoi le répondant lui dit
qu'il y avait des nouveaux convertis à
Chomérac, dont il était du nombre ;
qu'il était même fiancé (sic)
et que le curé ne voulait pas
l'épouser ; à quoi le dit homme
répondit qu'il l'épouserait et qu'il
en avait le pouvoir ; en effet le dit homme lui
avant envoyé sur le soir à
Chomérac un homme a lui inconnu pour lui
dire de le venir trouver avec sa fiancée,
accompagnés dudit homme qui l'amena dans une
campagne à une demi-iieue de
Chomérac, où, étant
arrivé, il trouva celui qui lui avait dit
qu'il l'épouserait, accompagné de
deux inconnus ; et ledit homme ayant lu des
prières dans quelque livre, il lui donna la
bénédiction nuptiale de même
qu'à sa fiancée ; et lui remit un
papier en demi-feuille écrite de sa main, et
lui dit qu'il pouvait montrer ce papier à
son curé en l'assurant qu'il était
marié par un homme qui en avait marié
beaucoup d'autres ; et en effet le déposant
était de si bonne foi qu'il dit à sa
fiancée d'aller remettre à leur
curé l'écrit ; ce qui fut fait ; et
quelque temps après lui qui dépose
fut arrêté à ce sujet dans les
prisons de Beauregard dont il sortit dans la suite
sur ce qu'on reconnut son innocence ; affirmant
qu'il ne connaissait pas alors Durand, mais qu'il
le reconnaîtra s'il lui est
représenté ... »
Nos lecteurs auront compris
d'eux-mêmes l'invraisemblance des propos
prêtés au pasteur, et les raisons qui
portaient Aulagnet à déformer ainsi
les faits pour affirmer son
innocence. Le juge eût été
naïf de se laisser prendre aux
déclarations du religionnaire apeuré.
Telles quelles, elles nous donnent cependant de
très intéressants détails sur
la manière dont Durand se mettait en,
rapports avec les « nouveaux convertis »
qu'il désirait atteindre.
Un autre interrogatoire avait,
deux
années auparavant,
précédé celui-ci : lorsque, le
10 mai 1729, Aulagnet comparut à Beauregard
devant le subdélégué, il
convient que le ministre lui avait donné
rendez-vous au bois de Bressac, près de
Chomérac, où les «
fiancés » étaient allés
d'eux-mêmes et sans guide. Les autres
détails touchant l'entrée en
relations des conjoints avec le pasteur sont
identiques et furent ultérieurement reconnus
par lui comme exacts.
Un synode eut encore lieu le 8 mai. Selon la
coutume Durand en fut élu modérateur.
Ces conférences avaient lieu maintenant avec
une parfaite régularité. On eut
à traiter des conditions auxquelles «
on recevrait à la paix de l'Eglise »
Monteil et Dortial lui-même qui, pour la plus
grande joie de tous, venait de suivre depuis peu
l'exemple de son compagnon.
Le zèle des prédicants
s'accrut. Bientôt le pays reçut la
visite de Corteiz qui revenait de Zurich et de
Neuchâtel. Accablé de fatigue, il
s'arrêta à Araules, sur le plateau, chez son
ami
« le pieux Bonnet », où
bientôt il retrouva ses frères d'armes
avec les « anciens » des Églises
voisines. Guilhot était des leurs. Il put
donner au vigoureux Cévenol « des
nouvelles satisfaisantes ». « Diverses
paroisses s'étaient entièrement
départies (séparées) de
l'Église romaine, tant à
l'égard des mariages que des baptêmes
». La piété se
développait en même temps que cette
courageuse attitude se généralisait
davantage.
« Par prudence », Corteiz
ne resta pas longtemps dans le pays. Il rentra
rapidement dans ses quartiers. Durand ne l'avait
sans doute pas rencontré lorsque des devoirs
de famille le rappelèrent auprès de
sa jeune femme. Celle-ci était sur le point
d'être mère. Le 14 août le
pasteur bénissait encore un mariage à
Saint-Cierze, le dernier avant la naissance d'une
petite Jeanne qui vint au monde dix jours plus
tard.
Anne Durand était
probablement encore à Craux. Mais les
lettres de son mari ne donnent pas la moindre
indication là-dessus. Elles firent seulement
allusion, longtemps après, à certains
changements de résidence effectués
sous la menace de poursuites devenues de plus en
plus redoutables, mais auxquelles on ne songerait
pas à ce moment.
Le clergé commençait
en effet à s'émouvoir de la
résurrection du protestantisme. Ces
succès répétés se traduisaient pour lui par
la
désertion de ses Églises et la
diminution de ses revenus. Au moment où les
prédicants se préoccupaient de faire
rembourser à Genolhac maintenant à
Genève les volumes perdus, exactement 12
psautiers et 4 bibles sans doute emportés
par quelque huguenot impatient, le curé de
Silhac, lui, prenait ses dispositions pour faire
arrêter son rival dont l'activité
devenait terriblement gênante.
Ce fut le début d'une
série d'embûches et de traquenards
auxquels le malheureux pasteur ne devait finalement
pas échapper. L'abbé Chambon signala
donc à Dumolard que les « choses
étaient dans un pitoyable état
», puis il déplora « qu'un nombre
bien grand de pauvres âmes allassent boire en
foulée dans une bourbe la plus infecte
». Quand à la raison pour laquelle
Durand, l'imposteur, n'était pas pris,
« c'est qu'on ne comptait pas bien sur la
promesse de 1.000 livres faite à qui
arrêterait un prédicant ». Mais
il y avait « un moyen, comme infaillible;
savoir, de prendre deux concubinaires qui ne soient
pas encore été épousés
de Durand, et qui, fissent semblant de vouloir le
faire, sans cependant blesser la
vérité; ce qui n'est jamais permis !
». On ne pouvait pas mieux sauvegarder les
apparences de la loyauté. Mais
malheureusement la casuistique du curé ne
resta pas sans effet.
Durand avait béni onze
mariages à l'issue d'une assemblée
tenue sans doute près de
Saint-Agrève; puis, deux
jours après, neuf autres au même lieu
et dans les mêmes conditions. Le lendemain,
encore huit. La nouvelle en parvint sans doute au
subdélégué. Il fallait
à tout prix se débarrasser du «
séditieux » ! Mais celui-ci restait
insaisissable. Dumolard n'hésita pas. Le 18
septembre il envoya Duroux, de Privas, et douze
soldats au Bouchet de Pranles. À
défaut du fils on arrêterait le
père, soupçonné d'être
« de toutes les parties » du
proscrit.
Le vieil Étienne Durand avait
alors soixante et onze ans. Il était «
chez lui, tranquille », quand le
détachement partit à l'aube, de
Privas. Comment et par qui fut-il brusquement
averti de ce qui se tramait contre lui ? Le
subdélégué lui-même nous
l'explique. « Il ne sortait jamais les troupes
d'un quartier (d'une caserne) sans que les gens qui
avaient quelque chose sur leur conscience ne
prissent le large ».
Les visiteurs se consolèrent
de la fuite du vieillard en se saisissant de tous
ses papiers, de sa bible, de deux psautiers et d'un
certain nombre d'ouvrages de piété.
Parmi les pièces ainsi confisquées se
trouve l'intéressant « livre de raison
» de la famille, auquel nous avons
emprunté, dans un précédent
chapitre, des détails sur l'histoire du
protestantisme vivarois avant 1719.
Du Monteil fit part à de
Bernage de l'échec de sa tentative et crut
devoir conclure, en s'appuyant sur la désignation
des
volumes trouvés dans la maison du Bouchet,
que « le père n'était
guère moins coupable que le fils » ;
mais il en exagéra sans doute les torts en
l'accusant de faire le commerce de ces livres.
L'aïeul les avait acquis pour son propre
usage. Une seule indication touchant le pasteur
lui-même fut relevée sur une vieille
bible incomplète, sous la forme d'une note
priant quiconque trouverait le volume « de le
rendre à son maître qui est
nommé en grosses lettres Pierre Durand
».
Ce n'était pas assez pour
étayer une accusation de complicité;
mais le vieillard ne s'en tint pas moins sur ses
gardes. Il s'était réfugié
chez M. de Saint-Quintin, au château de
Bavas. Il y resta, ne venant guère qu'une
fois ou deux chez lui pour se rendre compte de
l'importance de la saisie effectuée par les
soldats de Duroux.
Le jeune pasteur n'apprit
probablement pas tout de suite le, malheur que son
père venait d'éviter au moins
provisoirement. Il était parti pour le
Languedoc afin de représenter les
Églises du Vivarais au synode du 8 octobre.
Il retrouva là, au château de
Montvaillant, entre Lassalle et Saint-Jean-du-Gard,
ses amis Corteiz et Court complètement
réconciliés après leurs
discussions sur la députation
générale de Du Plan. Roger
n'était pas venu, malgré l'invitation
qui lui en avait été faite, Il en
avait été empêché, au
dire de Corteiz, par des pluies
récentes et violentes qui l'avaient
gêné dans sa course ou même
arrêté devant quelque torrent
subitement grossi. Aucune décision
importante ne fut prise et l'on se contenta de
passer en revue les différents
événements survenus pendant les
derniers mois.
Au lendemain, de cette
assemblée Alexandre Roussel, jeune proposant
de 26 ans, fut arrêté près du
Vigan. Le péril demeurait donc continuel et
la preuve la plus dramatique venait d'en être
rendue. Lés prédicants, malgré
tout, surmontèrent leur émotion. Rien
n'est plus simplement beau que leurs lettres de
cette époque. Avec une grandeur d'âme
qui fait assez voir le fond de leur pensée
et la valeur de leurs convictions ils poursuivirent
leur tâche et refusèrent de tenter le
moindre effort violent pour délivrer leur
infortuné collègue. Puis ils
s'efforcèrent d'apaiser les religionnaires
et se firent communiquer par des fidèles
montpelliérains nombre de détails sur
la captivité et le procès de leur
ami. Celui-ci marcha le 30 novembre à la
potence, avec une admirable
sérénité. Sa mère eut
la force d'écrire une lettre sublime,
inspirée des plus beaux sentiments de
confiance en Dieu, par laquelle elle louait dans
ses larmes la Providence qui avait aidé son
fils à rester ferme jusqu'au
bout.
La persécution
commençait. Pierre Durand était
à Nîmes le 12 octobre, lorsqu'une note
signée du Cardinal Fleury
enjoignit à La Devèze, commandant
militaire en Vivarais, de prendre toutes les
mesures nécessaires pour s'assurer de la
personne du trop hardi prédicant dont la
réputation était allée
jusqu'à Versailles.
Le clergé ne se privait pas
de harceler l'ancien évêque de
Fréjus, devenu premier ministre. Le
vieillard au caractère prudent et pacifique
ne recourut jamais aux méthodes de violence
de ses prédécesseurs envers les
protestants qu'il croyait réduits à
une poignée. Mais l'abbé Robert,
prévôt de la cathédrale de
Nîmes, avait l'oreille du prélat et
sut parfois obtenir de lui quelques
sévérités propres à
montrer que l'ère de la tolérance
n'était pas encore venue.
Durand allait avoir affaire à
forte partie. Il rentra vers le milieu d'octobre en
Vivarais. À ce moment, des
événements nouveaux étaient
survenus.
Du Monteil, représentant de
Dumolard à Privas, connaissait depuis peu la
retraite d'Étienne Durand. Il voulut se
rendre à Bavas. Le greffier l'apprît
et « fit proposer à M. de Saint-Quintin
s'il pouvait voir cet homme et lui parler sans
être arrêté ». Le
fonctionnaire, jugeant qu'il pouvait tirer parti
d'une telle entrevue, y consentit. Le greffier
affirma formellement n'avoir jamais eu de relations
avec son fils depuis que celui-ci avait pris le
désert. Mais cela ne l'empêcha pas de
recevoir, selon ses propres termes, « une
telle mercuriale à son
égard, qu'il aurait voulu être
à un autre endroit ». Du Monteil lui
déclara que le pasteur faisait plus de mal
dans le Vivarais que « Calvin n'en avait fait
en France, en Angleterre, ni ailleurs à
cause des mariages »; puis il menaça le
vieux père « d'une prison où il
serait resserré lui-même incessamment
pour le reste de ses jours », et l'engagea
finalement à promettre « qu'il
travaillerait de toutes ses forces à faire
sortir son fils du royaume ».
Étienne Durand, pris de peur,
eut un moment de faiblesse bien excusable. Il vit
sa vieillesse s'achever dans la captivité,
ses biens confisqués et sa vie paisible
compromise pour toujours. Il rédigea quatre
lettres :
À La Devèze, il se dit
« innocent de toutes les affaires et de la
conduite de son fils, quoique le monde en
murmurât contre lui; car il n'a jamais
été dans sa maison depuis le mois de
février 1719 qu'une seule fois qui
était en 1721, et il n'y resta qu'un jour,
et que depuis il a été toujours
absent; qu'il ne s'est plus approché de sa
maison, ni (le greffier) n'a jamais eu aucun
commerce avec lui, dont il se charge de le prouver
par enquête de voisins anciens catholiques
». « Le suppliant était dans un
âge avancé de 72 ans, accablé
de dettes à plusieurs créanciers;
pour autant que son bien pouvait valoir, il ne
pouvait pas agir pour s'entretenir, à cause
qu'il n'osait point paraître (en public) ». Il
avait
donc recours à « la charité
ordinaire » du commandant militaire et le
priait de lui faire rendre ses papiers non,
suspects afin qu'il pût être
remboursé de toutes les sommes dues par ses
divers créanciers. Il demandait en outre sa
liberté, dont il ne pouvait se passer pour
gérer ses affaires.
Nos précédents
chapitres ont montré ce qui, dans la lettre
du vieillard, était vrai. &Le reste
avait té imaginé pour les besoins de
sa défense.
Mais ce n'était pas assez
d'intercéder auprès de La
Devèze, Il fallait encore avertir le pasteur
des mesures prises contre les siens. Ne sachant
où s'était réfugié son
fils, Étienne Durand écrivit trois
autres messages identiques, adressés
à des religionnaires de Vals, des
Boutières et du plateau de la Haute-Loire.
L'un au moins parviendrait bien au
destinataire!
Il y faisait part à son
enfant des menaces de Du Monteil : « On avait
délibéré, dit-il, mille livres
à celui qui vous mettrait entre les mains de
la, justice, et à présent on donne
mille écus ». Il ajoutait qu'il courait
lui-même le risque d'être mis en prison
jusqu'à ce qu'on eût la preuve du
départ de son fils pour l'étranger.
« Ayez une fois compassion, de votre pauvre
père, concluait-il, considérez ma
vieillesse et les chagrins que je reçois,
comme aussi prenez garde à vous, et suis,
votre père Étienne Durand
».
Le ministre qui venait
d'apprendre
la machination du
subdélégué avait ralenti ses
courses, et s'astreignait avec impatience à
une demi-retraite. Pourtant, le 8 novembre, il
présidait un synode. Veut-on savoir quelles
décisions y furent prises ? Un jeûne
solennel fut prescrit pour le premier dimanche du
mois de janvier suivant, afin que « le
courroux de Dieu qui semblait s'être
allumé contre ses enfants » fût
apaisé. En outre des prières devaient
être dites pour la prospérité
du pays et de la maison royale. À la
persécution les huguenots répondaient
par plus de zèle religieux et de loyalisme
envers le souverain.
Monteil le schismatique fut
réintégré dans l'Eglise. Son
homonyme, le fonctionnaire de Privas, se
réjouissait de ce que « l'on n'entendit
plus parler de Durand », et proposa même
vers cette époque de laisser enfin le vieux
père en repos. Il ne se doutait pas des
véritables intentions du pasteur, auquel le
curé de Chomérac s'efforçait
à son tour de tendre des pièges.
Mais, disait celui-ci, « il y fallait de
l'argent ». L'apôtre n'en avait pas
besoin, lui, pour continuer son ministère de
souffrances et de dangers incessants.
Au milieu de février 1729,
dix ans après le début de sa
carrière, une épreuve cruelle
l'atteignit dans ses affections les plus vives. Son
père fut, cette fois, effectivement
arrêté, en compagnie du religionnaire
Aulagnet, déjà cité et
coupable de s'être marié au
désert.
Tous deux furent
transférés au château de
Beauregard, en face de Valence, où ils
retrouvèrent le fidèle colporteur
Mercier, « Petit Louis », capturé
depuis peu.
Alors le futur martyr limitait
ses
courses aux environs de Gluiras; et il ne
convoquait sans doute qu'assez rarement des
assemblées. Les procès-verbaux de
mariages sont peu nombreux sur son registre
à cette époque, et l'on doit en
inférer qu'il redoublait de
précautions, les temps s'avérant
décidément difficiles.
Cependant Anne Durand, souvent
malade, était toujours à Craux. Elle
ne devait plus y demeurer longtemps.
Deux mois plus tard une
conférence se tint pour préparer le
synode national qu'on se proposait de tenir
l'année suivante en Vivarais, en
dépit des circonstances. Un modeste
traitement fut alloué aux jeunes Ladreyt et
Fauriel, bien qu'ils n'eussent pas encore
été admis au rang des proposants. Le
second était toujours en Suisse, où
il poursuivait quelques études sommaires et
d'où il écrivit une fort belle lettre
pastorale à ses frères sous la Croix
les assurant de ses voeux et de ses prières,
et de son vif désir de reprendre
bientôt sa place à leurs
côtés. « Il ne faut pas nous
lasser, Dieu secondera nos efforts, Il ne permettra
pas que nous travaillions en vain; nous devons attendre
de Sa bonté
qu'Il fera réussir tous nos efforts à
la gloire de Son Saint-Nom... ».
L'enthousiaste étudiant
était alors dans la gêne, et avait
dû emprunter treize écus pour vivre.
Il rappelait les églises à leur
devoir. Elles devaient subvenir à son
nécessaire; « car s'il n'était
pas dans un état convenable, il ne ferait
pas bonheur (sic) au corps des proposants »...
Les communautés protestantes, si riches de
courage, avaient, hélas, leurs faiblesses
humaines dont l'avarice n'était pas la
moindre. Durand lui-même ne parvenait pas
à toucher son salaire malgré les
engagements pris par les synodes.
Il n'en gardait pas moins son
énergie et sa vaillance. Cependant le souci
déchirant de la captivité de son
père s'ajoutait aux autres. Il s'en savait
la cause indirecte et réfléchissait
à la question. Il l'envisageait sous tous
ses aspects, tantôt hésitant et
tantôt sentant ses scrupules dominés
par l'appel des Églises auxquelles il avait
consacré sa vie.
Un drame se jouait dans sa
conscience. Le devoir du fils l'emporterait-il sur
celui du, pasteur d'un troupeau menacé par
l'orage ? Quelles pouvaient être les
dispositions réelles du vieillard ?
Accepterait-il de sacrifier sa liberté
à la cause de Dieu ? Ou reprocherait-il
à son enfant de poursuivre son
ministère ?
Pierre Durand prit une
décision héroïque. Il resta.
Mais il tint à justifier son attitude
auprès de ses persécuteurs, et sa
longue lettre du 22 avril à La Devèze
est celle d'un juge plutôt que d'un suppliant
:
« Monsieur, j'ai voulu
plusieurs fois me donner l'honneur de vous
écrire, pour vous apprendre ce que je suis,
ce que je fais, et les raisons qui me font agir ;
mais certaines raisons m'ont tenu jusqu'ici dans le
silence. je ne saurais cependant aujourd'hui
m'empêcher de vous adresser la
présente pour vous parler d'une affaire qui
me touche de fort près et qui, si je ne me
trompe, ne vous doit pas être tout à
fait indifférente. Il s'agit que, comme j'ai
appris, mon père est détenu par vos
ordres dans le château de Beauregard, non
pour avoir commis aucun crime, car son innocence et
sa probité sont reconnues de tout le monde,
mais parce que son fils est ministre, et qu'en
France les ministres y sont regardés comme
dignes de mort. je dis que cela me regarde de
-près; en effet personne ne doit me, croire
insensible à ce que souffre à cause
de moi celui de qui je tiens la vie. je n'ai jamais
oublié les devoirs de chrétien et de
fils ; mais, dans la situation où je me
trouve, il me faut opter entre ces deux sortes de
devoirs, puisqu'il m'est impossible de m'acquitter
des uns sans négliger les
autres.
« ... Me sera-t-il
permis,
Monsieur, de vous demander si le Roi vous ordonne
de punir un père pour les prétendus
crimes de son fils ? Agira-t-on en France avec plus
de vigueur contre des ministres dont tout le crime
consiste à servir Dieu selon leur
conscience, que contre des voleurs, des assassins
et de semblables monstres de nature ? Quoi !
infliger des peines, retenir en prison un pauvre
vieillard parce qu'il a un fils ministre, un fils
qui est chrétien mais qui refuse de croire
les dogmes qu'il ne croit pas véritables, et
laisser en repos le père d'un Cartouche, le
plus insigne des scélérats' 'Vit-on
jamais une plus noire injustice ? Se peut-il croire
que cela se pratique dans les états d'un
prince qui fait sa plus grande gloire de porter le
titre auguste de Très-Chrétien ? Un
événement de cette nature
étonnera la postérité et si je
n'attendais pas un effet de votre justice, je
dirais hardiment qu'il a été
réservé pour faire la honte de notre
siècle, puisqu'on ne lit pas qu'il soit
jamais arrivé rien de semblable parmi les
chrétiens. Cela ne vous est donc pas
indifférent à vous, Monsieur, qui ne
cherchez qu'à élever la gloire de la
nation française et qu'à faire
pratiquer ses lois ?
« L'on m'assure qu'en
détenant mon père, vous croyez de
m'obliger à sortir du royaume... Le
caractère duquel je suis revêtu ne me
permet pas d'abandonner le troupeau que le Seigneur
m'a confié, et du salut duquel je dois
rendre compte...
Il suffit de vous dire
que je me
croirais criminel devant Dieu si, pour garantir ma
vie, j'abandonnais ceux à l'instruction
salutaire desquels je me suis consacré. Vous
pouvez bien conclure de là que je ne suis
pas déterminé à sortir du
royaume, excepté que tout mon troupeau ne
fut déterminé à en sortir avec
moi.
« ... On en veut
absolument
à ma vie. Les démarches qu'on a
faites et qu'on fait actuellement ne me laissent
pas lieu d'en douter. On offre des sommes
considérables à mon délateur.
Ne pouvant réussir de ce côté,
on prend une autre voie ; on jette mon père
dans une prison, on fait courir le bruit qu'il ne
sortira de là que je ne sois sorti du
royaume. Mais, Monsieur, me croyez-vous si peu de
jugement peur ne pas prévoir que tandis que
mon père est en prison, peut-être tous
les passages sont munis de gardes, avec mon
portrait. (signalement) en main, pour
m'arrêter, au cas que je passe ? Ce n'est pas
sans raison que je crains de ce
côté-là ; je vois le
Rhône bordé d'une manière que
je serais bien imprudent si j'entreprenais de le
passer. Ainsi, il ne faut pas attendre que je m'y
hasarde.
Si mon Sauveur veut
m'appeler
à signer de mon sang son Saint
Évangile, sa volonté soit faite !
Mais je sais qu'il nous commande la prudence du
serpent, aussi bien que la simplicité de la
colombe, et qu'autant il est glorieux de mourir
pour la vérité, autant il serait
honteux d'être la victime d'une
témérité imprudente. Vous
voyez donc, Monsieur, que tant que les affaires
seront dans l'état où je les vois, je
me résoudrai jamais à sortir du
royaume ; et, par conséquent, que c'est une
injustice de détenir ce bon vieillard dans
la captivité.
« ... J'ose donc
attendre de
votre équité, Monsieur, que vous
laisserez libre celui qui est injustement
détenu, puisque vous apprenez son innocence.
Au moins, ne vous attendez pas de m'intimider en le
détenant. je sais qu'il souffre pour une
juste cause, et que quand il serait conduit
à la mort pour soutenir la sainte religion,
je n'aurais pas lieu de le prendre à honte ;
au contraire je croirais devoir m'en glorifier.
Mais je sais aussi que vous ne devez pas oublier
qu'il y a un Juge souverain, devant lequel vous
serez obligé de comparaître, aussi
bien que nous ; et que toutes les absolutions,
jubilés et indulgences du clergé
romain ne seraient pas capables de vous justifier
devant ce juge, aussi redoutable que juste, si vous
faites souffrir ce bon vieillard mal à
propos, et si vous répandez son sang
innocent de propos délibéré.
Or c'est à vous à y faire attention.
Un homme qui approche de quatre-vingts ans pourrait
bien vous rester entre les mains, si vous le
traitez d'une manière trop rude. Ce n'est
pas à cet âge qu'un homme est en
état de supporter les horreurs de la
prison... »
La lettre parvint à La
Devèze, qui n'en tint aucun compte, comme le
prouvera la suite du récit,
Depuis longtemps Pierre Durand
n'avait pas écrit à Court. Il se
sentait surveillé, et lorsqu'il reprit avec
son maître une correspondance qui lui tenait
à coeur, son premier mot fut pour l'aviser
de ces malheurs et recommander qu'on
n'envoyât pas à Craux de lettres
faisant mention de son nom. Betrine venait de
commettre cette faute qui aurait pu coûter
cher aux hôtes de la vieille maison d'Isabeau
Sautel. Il fallait tout adresser à Anne, qui
remettrait les plis à leur véritable
destinataire. Celui-ci parlait aussi du prochain
synode national et soumettait à
l'approbation de son illustre ami certains articles
concernant le recrutement des prédicants.
Enfin il l'entretenait d'un envoi de livres et lui
demandait de lui faire passer « une
étoffe de camelot de Bruxelles,
mélangée, et dont la trame
était comme argentine », tissu
semblable à celui du vêtement
porté par son correspondant lors de sa
visite de 1724, et introuvable en Vivarais. Les
lettres des hommes du désert restaient
parfaitement vivantes et simples.
Au début de mai, Roux et
Boyer, tous deux étudiants en Suisse, se
firent consacrer à Zurich. Ce fut parmi les
prédicants de France une indignation
générale. On alla jusqu'à
vouloir leur interdire l'exercice du
ministère. Durand intervint dans cette affaire qui
lui fit engager
avec
ses collègues un échange de
correspondance. On admirera d'autant plus la
manière dont les uns et les autres savaient
faire abstraction du danger qu'on connaîtra
leur situation particulièrement critique.
Court, aux environs de Nîmes,
échappait à un piège pour
tomber dans un autre. Sa femme avait dû
s'exiler et passer à Lausanne pour ne pas
courir, elle aussi, le risque de se voir
arrêter. Trois fois en moins d'un mois on
fouilla, la nuit, les maisons dans lequel le
pasteur avait été signalé
très peu de temps auparavant. Sa tête
était mise à prix. On en offrait
10.000 livres, 250.000 francs au moins
d'aujourd'hui. Il lui devenait impossible de se
reposer ailleurs qu'en pleine campagne. Et c'est
à ce moment qu'il s'inquiétait de ce
qu'une « ordination » eût
été conférée par une
académie étrangère,
plutôt que par' un synode français
!
Les nouvelles du Vivarais
n'étaient guère plus favorables. Le
greffier du Bouchet venait d'être
interrogé par Dumolard, et, dans la prison,
Aulagnet n'avait pu lui donner, sur le pasteur,
aucun renseignement postérieur au moment
où celui-ci avait béni à
Chomérac son mariage avec Suzanne
Benoît. L'horizon restait sombre, et le
vieillard, n'ignorant rien des dangers courus par
son enfant, redoutait à bon droit les pires
éventualités.
Devant le
subdélégué il reprit ses
affirmations précédentes et
déclara que le fait d'avoir écrit
à trois adresses différentes
était la meilleure preuve de son ignorance
des démarches de son fils. Puis il se
défendit d'avoir jamais eu de rapports avec
lui depuis 1719 et le décret de prise de
corps rendu contre les fugitifs du
Navalet.
Dumolard dut avouer son échec
: « Il ne m'a pas été possible
de rien faire avouer, au dit Étienne
Durand... qui m'a paru très
expérimenté et préparé
à toutes les demandes qu'on pourrait lui
faire. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il est
très obstiné dans sa religion, et je
ne doute pas, quoiqu'il le nie, qu'il soit
d'intelligence avec son fils ».
L'intendant de Bernage, en
recevant
ce rapport, n'hésita pas. Bien qu'il n'y
eût aucune preuve à la charge du
vieillard, il jugea dangereux de le renvoyer chez
lui, « crainte qu'il ne tînt un commerce
avec son fils qui ne pourrait être que de
très mauvais effet pour la religion dans le
pays ». ci je crois donc, conclut-il, qu'il
est à propos de le faire enfermer le reste
de ses jours dans Ici fort de Brescou ».
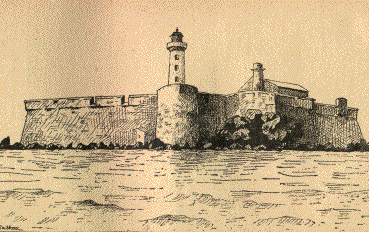
Le Fort de Brescou
On gardait dans cet îlot basaltique, au,
large d'Agde, les prisonniers internés hors
de toute procédure régulière,
par seule « raison d'état ». Il
suffisait, pour qu'Étienne Durand les
rejoignît, d'une lettre de
cachet aussitôt demandée à
Versailles, et que La Devèze compléta
lui-même.
Entre temps, le malheureux
greffier
essayait encore d'attendrir Dumolard par une
supplique. Tout resta vain. Le 8 juillet des ordres
étaient donnés. Aulagnet devait
être relâché, faute de preuves,
mais sa femme rejoindrait ses parents et ne lui
serait rendue que s'il consentait à faire
bénir son mariage par le prêtre. Quant
à Durand, quatre fusiliers et un sergent le
conduiraient jusqu'au fort. L'iniquité
allait se poursuivre jusqu'au bout.
Il nous plaît de penser que le
vieux père, ayant tout perdu, n'en garda
nulle rancune à son fils. Ce dernier avait
bien jugé lorsqu'il écrivait sa
fière réponse à La
Devèze. Veut-on savoir les sentiments exacts
du greffier ? Vers la fin de septembre 1730, alors
que sa fille Marie qu'il avait laissée seule
au Bouchet était à son tour
enfermée dans les geôles
d'Aigues-Mortes, et que son époux Mathieu
Serres était venu le rejoindre à
Brescou, il eut le courage d'envoyer à la
prisonnière une lettre qui en dit long sur
sa pensée, et sa foi vigoureuse. Nous nous
permettons de la reproduire sans en modifier
l'orthographe :
« Monsieur le
lieutenant du
Roy d'Aygues Mortes, pour rendre s'il lui
plaît à Marie Durand,
prisonnière à la tour de
Constance.
« Ma fille, l'auteur de
la
nature a permis que depuis mon âge de
congnoissance je
suis ésté toujours dans des
épreuves dans de souffrances et de
perssecutions de toutes part et je voy quelles
aumentent (augmentent) de degré en
degré, mais remerciant à Dieu je me
suis toujour conssollé et met ma confiance
en Luy, en nonobstant tous mes malheurs jamais rien
ne m'a manqué pour mon entretien et de ma
famille, ainsy mon enfant je vous écrit que
de (quelques) mes pour vous prié de ne vous
chagriné pas en rien que ce soit au
contraire de vous réjouir au Seigneur par
des prières par des psaumes et des cantiques
à toute heure et à tous moment et par
ce moyant (moyen) le Seigneur vous donnera la force
et le courage de supporter toutes les afflictions
qui peuvent vous arriver et dire comme David «
Tant plus de mal il me vient tamplus de Dieu il me
souvient ».
Il ne faut pas
regretter la
bienséance que vous avez car vous voyez que
votre frère a tout quitté pour
travaillé à leuvre du Seigneur et qui
nauze (qu'il n'ose) point paraître en publy
(public) et pourtam je croit quil ne pert point
courage, faites vous en (le même. Dieu vous
fait une grande grâce de ce que vous avez
pour compagnie nos soeurs de Latraverse et des
Boutières s'ils sont en vie sam oublier les
autres qui som du même coingt auxquelles
votre fiancé et moy nous recommandons
à leurs saintes prières nous en
faisons pour tous de même tam pour nos
ennemis que pour nos amis. Que Dieu leur face La
grâce de reconnaître le tort quil nous
font et se font à eux-mêmes. je vous
fit réponce sur celle que m'avez
écrit du mois de Mars pour aprover vostre
mariage mals elle ses (s'est) perdue au buraud de
même sur celle de juilliet. Et pour lors vous
étiez arrettée et suite jen'ay (j'en
ai) envoyé une à beauregard mais vous
avez dut partir, jay envoyé au couzin
Boursarié davoir soint de mes afaires et de
mais meubles. Vostre fiancé ce porte bien il
couche avec moy dans un bon lit et jespére
avec layde de Dieu il aura la liberté dans
le fort comme moy pour veut (pourvu) qu'il soit
passiant et sage comme je croix, je vous recommande
encore une fois de prandre passiance et suis votre
père. »
Cette lettre, dont les
caractères indécis disent qu'ils
furent tracés par un vieillard à la
main tremblante, nous donne des détails
intéressants sur le régime des
prisonniers retenus à Brescou. Mais elle ne
parvint jamais à la Tour de Constance.
Interceptée, elle retira aux juges toute illusion
sur les
sentiments du captif, et lorsqu'il fit parvenir au
garde des sceaux lui-même un placet par
lequel il tentait de s'innocenter et de disculper
son fils « parti seulement par libertinage et
non par motif de religion », l'Intendant,
averti, répondit qu'il serait de trop
mauvais exemple de rendre la liberté
à ce huguenot obstiné, «
très estimé des gens de sa secte
». Le greffier resta au fort. Il y
était encore en 1739. Une liste des
prisonniers pour la. foi, imprimée sur les
instigations d'un synode de Nimègue, le
signale expressément; et l'ordre de
libération donné par Saint-Florentin
le 15 septembre 1743 en faveur « d'un
nommé Durand », concernait sans doute
le vieillard, bien que l'omission faite du
prénom dans la missive du chancelier rende
la chose incertaine. Le père du martyr
aurait eu alors plus de 86 ans. Une note des
archives de l'Hérault laisse voir enfin
qu'en avril 1745 il n'était plus avec les
relégués de Brescou.
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
