
CHAPITRE V
-------
Le succès de son Mémoire avait valu à Vinet une amitié nouvelle, celle de M. Stapfer, un de ses juges parisiens. A cette aubaine il avait été d'autant plus sensible que les écrits de Stapfer étaient, avec ceux de l'Ecossais Erskine, une de ses lectures de prédilection. Mais entrer en rapports personnels avec l'auteur, voilà une chance qu'il n'avait pas espérée. Dans une réponse à une lettre que lui écrivait Stapfer peu après la publication du Mémoire, Vinet s'écrie dans un besoin de sincérité que sa modestie rend plus impérieux :
Quand je pense que vous aimez en moi l'amour que vous me supposez pour la cause que j'ai défendue, et quand, après cela, je rentre en moi-même, quel sentiment profondément pénible me faites-vous éprouver à votre insu ! Savez-vous, en effet, que cet apôtre de la tolérance n'a pas encore pu l'implanter dans son coeur, que cet avocat de la liberté a souvent lésé celle des autres, que je vois le bien et que je fais le mal ? Je ne puis souffrir, monsieur, qu'après avoir jugé trop favorablement le livre, vous vous abusiez sur l'auteur. Le soin de ma propre Indépendance, l'intérêt de ma liberté ont donné de l'accent à mes paroles : témoin de l'oppression qui s'exerçait sur des amis de ma jeunesse, j'ai facilement pris feu pour eux ; une conviction profonde, ineffaçable, dont je rends grâce à Dieu, s'est enracinée dans mon âme; mais j'y cherche encore cette charité pleine de support (1), seul vrai principe de la tolérance.
Cependant Dieu a permis que ce travail, dont je n'étals pas digne me fît un bien. Il m'a pénétré d'un grand respect pour les droits de la conscience, et tout dépourvu que je suis de l'amour qui doit être l'esprit de la vraie tolérance, je ne puis plus désormais, sciemment et de propos délibéré, violer les droits que j'ai défendus.
Reprenez donc, Monsieur, l'opinion trop favorable que vous avez peut-être de mon coeur. En revanche accordez-moi vos prières. Demandez à Dieu qu'il me donne d'aimer et de supporter ; qu'il achève en moi la grande oeuvre qu'il y a commencée. Qui a tant de peine à aimer et à tolérer peut-il se réclamer de Jésus-Christ ? Qui se réclame de lui devrait-il avoir un sentiment qui ne fiât comme pénétré d'abnégation et d'amour ? Quand nous le contemplons dans sa vie et dans sa mort, nous reste-t-il un bien, un souffle, une prétention, un désir, dont nous ne lui devions le sacrifice, et le sacrifice joyeux ? Que cette perfection est haute, et qu'il serait absurde d'y vouloir atteindre sans son aide ! (2)
S'il avait valu à son auteur des éloges et des amis, le Mémoire allait lui apporter aussi, indirectement, des soucis et le labeur d'une ardente polémique. Le professeur Monnard dirigeait à Lausanne le Nouvelliste, organe libéral assez gênant pour le parti conservateur, alors au pouvoir, et dont la Gazette représentait les tendances politiques. Les conservateurs, inquiets des progrès que faisaient dans le pays les idées libérales, saisirent avec empressement le prétexte d'une échauffourée provoquée à Payerne par le prêche d'un évangéliste dissident pour attaquer leurs adversaires sur le sujet de la liberté religieuse, comptant bien, et non sans raison, sur l'appui que leur fournirait l'intolérance populaire. Par cette tactique, ils pensaient réussir à se débarrasser de M. Monnard, champion de la liberté en général et de la liberté religieuse en particulier. Vinet était, au Nouvelliste, le plus solide et le plus brillant collaborateur de Monnard. Si pleines que fussent ses journées, son patriotisme vaudois lui faisait trouver le temps d'envoyer régulièrement au journal des articles aussi soignés quant à la forme que nourris de pensée, grandement prisés du public cultivé.
Depuis un certain temps, au canton de Vaud, les luttes politiques et religieuses devenaient moins ardentes. La loi du 20 mai 1824 n'était guère appliquée. Un peu fatigués, les partis faisaient trêve, et la bonhomie, la placidité vaudoises reprenaient tout doucement le dessus. Mais voici qu'on lit un beau matin dans la Gazette, sous la signature d'un homme distingué, le landamann Muret, partisan de la manière forte en politique, un article contre les sectaires qui inaugura entre ce journal et le Nouvelliste une polémique passionnée. Vinet, l'apôtre de la liberté de conscience, pouvait-il se taire ? La question, pour lui, ne se posa même pas. Son sang bouillonnait comme s'il avait été dans l'arène. Quelques pages ardentes, vengeresses, partirent aussitôt pour Lausanne, pages que le comité du Nouvelliste, pris de frayeur, ne crut pas pouvoir accueillir. Mais M. Monnard, à la prière de l'auteur, se chargea d'en faire faire un tirage à part. Un millier d'exemplaires s'enleva du jour au lendemain La brochure, sans nom d'auteur ni d'éditeur, était intitulée : Observations sur l'article sur les Sectaires inséré dans la Gazette de Lausanne du 13 mars 1829. Peu après, la Gazette ayant riposté, cette brochure était suivie de Nouvelles Observations.
Le titre long et embarrassé de ces pages répond mal à leur contenu. Il y a dans ces deux écrits un emportement, une verve sacrée qui rappellent le Pascal des Provinciales. Maître de ses idées, Vinet, maintenant, l'est aussi de sa plume. C'est avec une sorte de joie passionnée qu'il la manie comme une épée dont l'acier étincelle à chaque coup :
Une loi immorale, une loi irréligieuse, une loi qui m'oblige à faire ce que ma conscience et la loi de Dieu condamnent, si l'on ne peut la révoquer, il faut la braver. Ce principe, loin d'être subversif, est le principe de vie des sociétés. C'est la lutte du bien contre le mal. Supprimez cette lutte : qu'est-ce qui retiendra l'humanité sur cette pente du vice et de la misère où tant de causes réunies la poussent à l'envi ? C'est de révolte en révolte, si l'on veut employer ce mot, que les sociétés se perfectionnent, que la civilisation s'établit, que la justice règne, que la Liberté fleurit.
... Liberté de la presse, liberté de l'industrie, liberté du commerce, liberté de l'enseignement, toutes ces libertés, comme les pluies fécondes de l'été, arrivent sur les ailes de la tempête... Vouloir empêcher qu'une idée n'arrive chez un peuple, et n'y excite les esprits, c'est aussi insensé que de vouloir retenir les vents à la frontière ou de vouloir soumettre les oiseaux de l'air au péage des douanes (3)...
Pour le coup, le public vaudois sortit de sa placidité. « - Avez-vous lu les Observations ? » - « Que pensez-vous des Observations ? » se demandait-on en se rencontrant dans la rue, aussi bien à Payerne ou à Morges qu'à Vevey ou à Yverdon. Le nom de Vinet, jusqu'alors connu seulement d'un publicrestreint, volait de bouche en bouche. « Quelle force ! disaient les uns. La vérité seule trouve de tels accents. » Et les autres de s'écrier, après avoir répété avec indignation la phrase désormais fameuse: « C'est de révolte en révolte, etc.» prononçaient : « Ce Vinet est un fou dangereux... De telles paroles sont une attaque criminelle contre l'ordre social. Espérons que nos autorités sauront sévir. »
Certes, les autorités y songeaient. L'occasion était belle, en frappant l'auteur des Observations, de frapper en même temps l'éditeur, qu'on supposait être M. Monnard : et le fâcheux Nouvelliste serait décapité. Vinet et Monnard sont donc déférés aux tribunaux. Vinet, bouleversé du tort que sans le vouloir il a fait à son ami, dont il voit la situation compromise et peut-être perdue, part aussitôt pour Lausanne, afin de revendiquer, tant comme éditeur que comme auteur, l'entière responsabilité de ses brochures. Et l'affaire suit son cours. Par bonheur, s'il y a des juges à Berlin, il y en a aussi à Lausanne : sur le chef de provocation à la révolte, Vinet est acquitté par le tribunal, qui juge que la doctrine des brochures, pour hardie et même dangereuse qu'elle soit, ne constitue pas une provocation directe au délit et au crime.
Quant à Monnard, ne sachant plus trop comment l'atteindre, le Conseil d'Etat s'accorda la satisfaction de lui infliger une peine disciplinaire en le suspendant pour un an de ses fonctions de professeur, tandis que Vinet lui-même se voyait suspendu pour deux ans des fonctions de pasteur qu'il n'exerçait pas, mais qu'il aurait pu exercer dans le canton de Vaud. Cet abus de pouvoir lui fermait pratiquement la porte de ce pays vaudois où il avait tant espéré revenir bientôt avec les siens. « Je suis banni de fait, écrit-il à Leresche, mais le monde est grand, et Dieu est un asile pour tous... De cette haute retraite, qu'ils sont misérables, ces débats ! »
Si, du point de vue de son intérêt personnel, Vinet prenait assez philosophiquement son parti de sa mésaventure, il était en revanche fort tourmenté des difficultés où il avait entraîné son ami Monnard, qui parlait de démission, et songeait sérieusement à quitter un pays où la liberté de pensée n'existait pas. Monnard se ravisa cependant, jugeant en somme plus digne de lui de rester sur la brèche pour continuer le bon combat. Enfin les choses se tassèrent, comme on dit, et Vinet lui-même, gagné par le calme qu'avait retrouvé son ami lausannois, se tranquillisa.
Le Conseil d'Etat, entre temps, pour justifier ses mesures de rigueur, avait élaboré un copieux rapport qui accusait Vinet d'outrage à la religion, d'insulte aux autorités supérieures du canton, et d'excitation à la révolte. A peine de retour à Bâle, le jeune professeur écrivait une réponse intitulée Essai sur la conscience et sur la liberté religieuse. A la question : Qu'est-ce que cette conscience dont chacun parle sans songer à se demander quelle est sa nature ? Il répond :
Ce sentiment inexplicable qui, échappant à toute analyse, doit être considéré comme un fait primitif de notre nature, est celui de la nécessité de mettre nos actions en harmonie avec notre persuasion... Jusque dans ses aberrations les plus étranges, la conscience se rend sensible à nos regards, elle rend témoignage d'elle-même : la persuasion peut être erronée ; mais le sentiment de la nécessité de suivre sa persuasion, le sentiment du devoir, se montre toujours... Et s'il arrivait qu'une loi fût cri opposition avec ce que la conscience nous fait accepter comme devoir, il faudrait, de toute nécessité, que nous obéissions à la conscience plutôt qu'aux lois, parce que la conscience est au-dessus des lois : il arriverait alors que le même principe moral en vertu duquel nous obéissons à l'autorité humaine nous porterait invinciblement à résister à cette autorité... (4)
Mais on s'alarme et s'indigne de cette prééminence donnée à la conscience. C'est, dit-on, légitimer l'anarchie, l'indiscipline et le règne du bon plaisir, puisque chaque individu a sa conscience. Cependant Vinet avait dit dans ses Observations :
Donnez-moi seulement des hommes qui aient de la conscience, et je vous ferai un peuple où il y aura de l'unité et de la subordination. Je vous le demande, d'où viennent les maladies sourdes des États, leurs fièvres violentes et leurs affreux désordres ? Est-ce peut-être de ce que les citoyens suivent trop leur conscience ? N'est-ce pas plutôt qu'ils ne l'écoutent point assez ?
... Quand tous les périls seraient dans la liberté, toute la tranquillité dans la servitude, je préférerais encore la liberté ; car la liberté c'est la vie, et la servitude c'est la mort. Mais si l'histoire atteste que l'enfantement de la liberté est ordinairement laborieux et plein d'angoisses, elle atteste également que la liberté, une fois établie, est le seul gage du repos des nations .
Vinet, dans sa Réponse, se fait plus incisif et plus énergique encore en s'adressant à ceux qui veulent établir une confusion entre la conscience et la volonté propre, la fantaisie, le bon plaisir :
J'aurais dit qu'on doit suivre son bon plaisir, ce qui présente une contradiction clans les termes, l'idée de devoir excluant celle de bon plaisir. Que vient-on nous parler d'un libre arbitre de la conscience ? J'avoue que cette expression m'est nouvelle. Rien n'est moins libre que l'homme en présence de la conscience : il ne choisit pas, il accepte ; il ne commande pas, il sert.
Je n'ai point prétendu, continue-t-il, qu'un délit commis en conscience ne soit pas un délit. Je n'ai pas dit qu'il ne faille pas le punir.. Je dis bien, eu égard à la conscience, qu'il faut désobéir à la loi immorale ; mais je ne dis point que le magistrat, qui ne croit pas sa loi immorale, ne doive pas punir cette désobéissance.
La liberté de conscience entraîne celle des cultes :
Tenons-nous à la liberté d'association ; elle est reconnue pour les arts, pour les lettres, pour la politique même et pour un objet dont je n'ai qu'une idée confuse, et qui, seul entre tous, a le privilège du secret, je veux dire la franc-maçonnerie. Et c'est pour la religion seule qu'elle n'existerait pas !
... Comment peut-on se dire protestant et refuser la liberté des cultes ? Nous nous sommes séparés de l'Eglise romaine pour n'avoir plus à recevoir nos croyances toutes faites de la main d'un pape, et nous les recevrions aujourd'hui de la main d'un prince ou d'un sénat !... Prenons-y garde : être protestant, c'est protester sans cesse contre toute contrainte en matière de religion ; être protestant et gêner les consciences, c'est la plus choquante des contradictions.
On dit, pour excuser les abus du pouvoir, que les dissidents, étant exclusifs et intolérants, méritent la réciprocité. Quelques mots suffisent à Vinet pour déceler le sophisme :
Leur intolérance est spirituelle, celle dont on les accable est civile. Leur intolérance consiste à prononcer que nous ne sommes pas dans la vérité, notre intolérance consiste à leur interdire ! exercice de leur culte ; ils nous jugent, nous les frappons. Je ne vois pas là une réciprocité bien exacte... Et j'ajoute que quand bien même ils seraient dans l'opinion qu'on doit refuser aux errants même la tolérance civile, ce qu'ils n'ont jamais (lit, ce ne serait pas encore une raison pour la leur refuser à eux-mêmes. Car, tant que leur opinion n'est pas transformée en acte, ce n'est qu'une spéculation qui échappe à toute poursuite ; et si jamais la tolérance peut trouver une belle occasion de s'exercer, c'est envers les intolérants.
Pour faire marcher les événements, pour hâter la venue de cette victoire que la foi de Vinet saluait d'avance, rien ne fut plus efficace que ces accents frémissants d'une passion toute sainte, la passion de la vérité. Mais on pense bien que ces coups reçus, rendus, toute cette bataille, avec sa fièvre, les discussions privées qui faisaient écho aux discussions publiques, les lettres à écrire et à répondre, les voyages, n'allèrent pas, pour le lutteur, sans beaucoup de fatigue physique et mentale. D'autre part la vie suivait son cours. Les leçons, les corrections de devoirs, les préparations allaient leur train coutumier ; les malaises de santé en faisaient autant. Et puis, en même temps que professeur et publiciste, il fallait être un conseiller et un guide pour de nombreux jeunes gens qui ne se bornaient pas à consulter à propos de leurs études ce maître dont ils sentaient si bien la sollicitude profonde, mais lui demandaient souvent une direction de conscience et de vie. Enfin il fallait être fils, mari et père.
Depuis quelque temps, une menace planait sur la famille. Le petit Auguste, d'une santé florissante les premières années de sa vie, donnait de l'inquiétude à ses parents; son ouïe devenait de moins en moins bonne. L'appelait-on ? Il ne répondait pas. Un coup de sonnette à la porte d'entrée, que tout le monde avait entendu et auquel sa soeur courait répondre, ne le faisait pas broncher. Distraction ? Mais l'enfant, jusque là très actif, n'était ni distrait ni rêveur. La crainte d'une infirmité redoutable, peut-être incurable, s'insinue dans le coeur des parents, qui évitent de se faire part l'un à l'autre de ce gros souci. Parler à l'avance d'un malheur possible, n'est-ce pas l'inviter à sortir de l'ombre ou il est embusqué ? Les époux sont arrivés à ce moment de la vie et de l'amour où, dans une commune souffrance, la part de l'autre est celle que l'on a le plus de peine à porter. Alexandre a peur pour Sophie, et Sophie tremble pour Alexandre.
Et presque en même temps, voici une autre douleur. Mme Vinet la mère tombe dangereusement malade. Pendant quelques jours on essaie de se faire illusion, mais bientôt son fils, sa fille, et cette autre fille qu'est pour elle Sophie sont forcés d'abandonner tout espoir. La mère, la grand'mère qui par sa tendresse tenait une si grande place dans la vie de tous, ne se relèvera pas. Et la famille entre dans cette période d'angoisse qui précède les deuils : larmes refoulées ou répandues en secret, voix assourdies, prières qui voudraient monter vers Dieu et retombent douloureusement, luttes entre la foi qui veut se soumettre et la nature que fait crier l'arrachement de ses libres les plus intimes...
La malade souffre pendant sept longues semaines, cruellement, mais avec cette résignation que pendant soixante années, elle n'a pas cessé de montrer à la vie. Elle est paisible, elle est même contente, et sur le seuil d'un autre monde, elle se souvient des petites fêtes de celui-ci. Le 17 juin est le jour de naissance d'Alexandre ; elle met, ce matin-là, plus de tendresse dans son baiser, et lui désigne un cadeau qu'elle lui destine, et dont Sophie se chargera aujourd'hui même de faire l'emplette. Le fils, qui se sent déjà orphelin, remercie dans un sanglot.
Prie pour elle et pour nous, écrit-il à Leresche ; pour nous qui approchons d'un moment douloureux qu'à cette heure même nous avons peine à envisager. Tu sais ce qu'étaient pour nous nos parents, dans quelle intimité nous avons vécu avec ma mère. Tu sais donc ce que nous allons souffrir...
Il reprenait le soir du même jour
J'allais t'envoyer l'incluse lorsqu'il a plu à Dieu de terminer les souffrances de notre chère mère et de recueillir son âme dans la paix. Elle est morte ce matin à 9 h. 1 /4, après une agonie fort douloureuse suivie de quelques moments de repos... Elle est morte dans la paix et la joie ; et ce dernier sentiment s'est tellement communiqué à notre âme qu'il a comme absorbé la douleur (5).
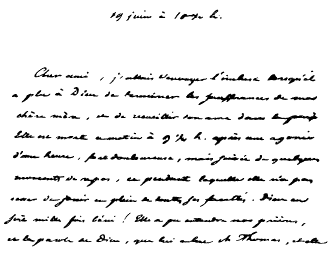
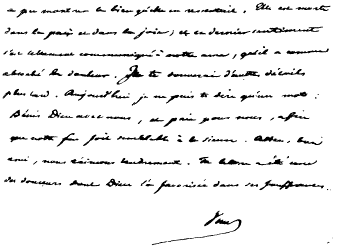
Pour quelques instants seulement ; et puis la blessure se remet à saigner. Un peu plus tard, Vinet écrit à M. Alexis Forel :
J'ai perdu ma mère... C'est la chair et le sang qui disent : j'ai perdu ; l'esprit devrait parler autrement. On n'a pas perdu ce qu'on a déposé entre des mains sûres et bienveillantes... Aussi loin que peuvent remonter mes souvenirs, nous retrouvons les soins et la tendresse désintéressée de notre mère bien-aimée, son dévouement tranquille et modeste, son abnégation continuelle, tant de vertus que le monde n'a point vues, mais qui ont fait le bonheur de son mari et de ses enfants... (6)
Et à Leresche quelques semaines après:
Dans le recueillement de la solitude et du loisir les Images effacées se ravivent, on se retrouve au lendemain du jour douloureux ; on a devant soi les yeux de cette mère dévouée, si humble, si patiente, qui pendant une vie entière a fait son lot de supporter et de céder, qui, à l'exemple de son Sauveur, est venue dans le monde pour servir et non pour être servie, que la plus petite marque d'attention pénétrait de reconnaissance, âme si compatissante, si facile à attendrir, si prête à faire des sacrifices au malheur et au besoin, coeur si simple qu'elle a cru sans effort, espéré sans jamais douter, enfin qui a été « douce envers la mort comme elle l'était envers tout le monde », et dont les derniers moments ont été le plus précieux souvenir qu'elle nous ait légué... Voilà les deux auteurs de mes jours dans le repos éternel. Ma faiblesse s'appuyait sur eux... avec eux, cette vie si redoutable à mon inexpérience ne m'effrayait pas... (7)
Ah ! oui, comme il se sent faible à présent, le pauvre Vinet, devant cet avenir gros d'un mystère hostile ! Quelles blessures nouvelles, quelles angoisses pour lui et pour ceux qu'il aime recèle dans ses profondeurs cet inconnu où il n'ose pas plonger son regard ? Mais Dieu y sera, dans cet avenir, comme il est dans le présent cruel que le fils orphelin porte cependant sans ployer sous le fardeau. Dans de tels moments il prend souvent sa Bible, l'ouvre au livre des Psaumes, et, seul ou avec sa femme, il relit les mains jointes le cantique du roi prophète fuyant devant son fils rebelle :
- L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
- Il me fait reposer dans de verts pâturages,
- Il me dirige près des eaux paisibles.
- Il restaure mon âme.
- Quand je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort
- Je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi...
A mesure qu'il lit, une paix surnaturelle inonde son âme blessée d'où toute frayeur s'est enfuie.
(1) Le mot support dans le sens de patience, en usage en France jusqu'au XVIe siècle, est courant dans la Suisse romande.
(2) Lettres, I, 133.
(3) Liberté des Cultes, p. 364, 365.
(4) Liberté des Cultes, p. 435, 436, 437.
(5) Inédit.
(6) RAMBERT, P. 150.
) Lettres, I, 182.| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
