
CHAPITRE III
CONVERSION ET VOCATION MISSIONNAIRE
GLAY 1851-1852
-------
Henri Jaquet. - Arrivée à Glay. - La vie à Glay. - Fondation de l'institut - Mme Jaquet. - Tante Catherine et tante Frêne. - Mort de tante Frêne. - « Es-tu du froment ou de la paille? » - Conversion. - Le réveil dans le pays de Montbéliard. - Les darbystes. - Vocation missionnaire.
Le directeur de l'institut de Glay (1) (Doubs) était, à cette époque, son fondateur, Abraham-Samuel-Henri Jaquet. Né en 788, à Vevey, il y fit ses premières études. S'étant rendu à Isny (Wurtemberg) pour faire un apprentissage de commerce, il se convertit (1809). D'Isny il vint à Bille, où il se décida à commencer ses études de théologie. Il était en pension chez M. Spittler, un des fondateurs de la Société des Missions de Bâle. Sous l'influence de ce zélé serviteur de Dieu, la foi du jeune Jaquet se développa d'une façon remarquable.
En 1813, il fut consacré à Bâle, puis il fut nommé pasteur allemand à Guebwiller. En octobre 1819, il accepta le poste de Glay; ce ne fut cependant que dix-huit mois après sa nomination qu'il alla s'y installer; le consistoire de Blamont ne voyait pas d'un oeil favorable l'arrivée de cet étranger, précédé de la réputation de piétiste. En 1815, il avait épousé Mlle Élise Schneider, liée en 1787, élevée chez les Frères Moraves à Montmirail, institutrice à Vevey pendant cinq ans, puis, pendant deux ans, directrice d'un pensionnat à Liestal.
En 1822, M. Jaquet fonda l'institut de Glay.
Glay ! C'était en effet ma destination. Ce seul
nom de Glay, qui me fait tressaillir maintenant de joie en évoquant
tant de si doux souvenirs, me faisait alors palpiter le coeur
d'émotion. En passant, pour la première fois, parmi ces
ramifications du Jura dédale de collines boisées et de vallons
verdoyants où fourmillent des villages populeux et prospères, à demi
cachés sous les vergers, il y avait beaucoup de choses qui étaient
de nature à exciter ma curiosité : les maisons massives des paysans
accusant un bien-être très supérieur à tout ce que j'avais vu dans
le Berry, les hommes en vestons courts et en pantalons de toile
verte, les femmes, non plus en coiffes blanches et en manches
courtes, mais avec des manches à gigot et de petits bonnets de soie
noire ornés de verroterie de couleur et de larges rubans, noirs
aussi, le tout ne garnissant que le sommet de la tête... mais tout
cela, je le vis plus tard. Pour le moment, j'étais oppressé, trop
préoccupé, trop absorbé par mes propres pensées pour m'occuper de
quoi que ce fût. Je traversai toute une chaîne à peine interrompue
de villages : Audincourt , Seloncourt, Hérimoncourt, Meslières.

Enfin Glay parut à mes yeux, un petit village qui n'avait rien du clinquant industriel de ceux que je venais de dépasser. Il était là, posé comme un nid, au fond d'un vallon tranquille et ravissant de fraîcheur. Lorsque je l'eus traversé dans toute sa longueur, on m'indiqua une maison qui ne se distinguait guère des autres que par sa grandeur et quelques dépendances.
Elle était au fond d'une petite cour et entourée
d'un jardin potager. Je ralentis le pas, mon coeur battait fort. Je
ne sais pourquoi, mais j'aurais voulu être bien loin, en Berry, ou
pouvoir retourner sur mes pas. Ce n'était pas possible. Donc
j'entrai timidement dans la cour (20 septembre 1851) (2).
De grands jeunes gens, à droite, qui faisaient
bruyamment de la gymnastique, s'arrêtèrent tout court, se turent
comme d'un commun accord. Pendant que l'un d'eux courait m'annoncer,
ne sachant où mettre les yeux, je les fixai sur la porte d'entrée,
et je lus et répétai je ne sais combien de fois cette parole qui y
était peinte, dont certainement je ne comprenais guère encore la
portée, mais qui me frappa néanmoins : « L'Éternel y pourvoira! »
Enfin un monsieur parut, âgé, de grande taille, à la figure
vénérable sous ses cheveux blancs. Avec un bon sourire, il me
demanda mon nom, me tendit la main, me donna un baiser affectueux et
m'introduisit dans le vestibule où une dame âgée aussi, petite, au
regard pénétrant, me reçut avec non moins de bonté. Elle me
conduisit au dortoir où je devais occuper un des lits et me désigna
l'armoire dont un des rayons m'était alloué. Au culte de famille, le
vénérable directeur me présenta aux sous-maîtres et aux élèves : «
Une nouvelle addition à notre famille, » remarqua-t-il, et il pria
avec ferveur pour que Dieu bénit mon entrée dans l'établissement.
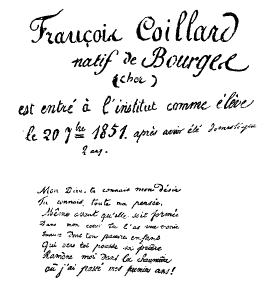
Tout cela me fit une impression si profonde que j'ai peine à croire que quarante et quelques années se sont passées depuis lors. Je ne comprenais rien à cette réception si affectueuse, moi qui avais toujours été tenu à distance par des supérieurs, depuis que j'avais quitté la chaumière maternelle. Je me demandais s'il n'y avait pas quelque erreur ou quelque malentendu. J'étais de nature extrêmement timide et réservé. Je ne m'étais encore réellement lié avec aucun ami, et j'étais tout à fait étranger aux jeux de la jeunesse. Cependant je me mis vite au pas de la maison.
Tout le service et la discipline se faisaient par les élèves eux-mêmes, à tour de rôle. A 5 heures en été, à 6 heures en hiver, l'élève de service sonnait le réveil; un quart d'heure nous était accordé pour notre toilette, pour laquelle nous devions descendre au rez-de-chaussée dans une grande pièce dallée qui servait de buanderie et où se trouvait une pompe. C'est là que nous nous lavions. Nous remontions ensuite pour finir notre toilette et, au quart très précis, le pion fermait les dortoirs à clef. Les paresseux et les retardataires y restaient enfermés jusqu'au moment où, après avoir déjeuné, nous montions pour faire nos lits avant d'entrer en classe. Le même pion était l'économe de semaine et mettait la table des élèves dont le nombre variait de trente à cinquante environ. Les heures de récréation étaient employées à diverses corvées : les uns s'occupaient de jardinage, d'autres coupaient et fendaient le bois, les plus jeunes balayaient les dortoirs et ciraient les souliers, un autre montait matin et soir à la ferme, tout au haut de la montagne au pied de laquelle se trouvait l'institut, portant sur le dos, comme une hotte, un énorme pot à lait en fer; c'était la corvée la plus rude, en hiver surtout où il arrivait assez souvent que, malgré son bâton armé d'une pique" un novice glissait et roulait en bas un peu plus vite qu'il ne le voulait.
Je fus, dès mon arrivée, complètement exempté de toutes ces corvées. Ma tache à moi, c'était la table de nos directeurs et de leur famille, qui, du reste, prenaient leurs repas dans la même salle et en même temps que nous. Cela m'amena en plus fréquent contact que mes condisciples avec eux, surtout avec Mme Jaquet qui me voua bientôt une affection toute maternelle et avec deux vieilles domestiques qui avaient été dans l'institut dès sa fondation. Notre ordinaire était des plus simples : c'était la nourriture du pays, mais abondante. Tout se faisait eu famille.
Le déjeuner terminé, le vénérable Jaquet présidait le culte que les élèves, à tour de rôle, terminaient par une courte lecture, une prière et l'oraison dominicale. C'était pour les commençants une terrible épreuve. Quand je vis mon tour arriver, je n'en dormis pas de peur. De déjeuner, ce. jour-là, il n'en pouvait être question : la nourriture me restait dans la gorge. Enfin le moment critique arriva; les cantiques, je ne les entendis pas. Je pus rassembler assez de courage pour la lecture; mais, quand tout le monde se fut agenouillé et qu'un silence profond régna dans la salle, toutes les idées que j'avais préparées d'avance s'envolèrent et je restai bouche close. Au bout de quelques minutes, qui me parurent des heures, de cet épouvantable silence, je commençai à répéter l'oraison dominicale. Hélas 1 je dallai pas loin et je commençai à m'embrouiller, à balbutier, puis je m'arrêtai tout court. M. Jaquet vint à mon aide et adressa au Seigneur une de ces prières dont la ferveur vous transporte droit au pied du trône de la grâce et, dans cette puissante intercession, le nouveau venu ne fut pas oublié. Cet incident m'a tellement impressionné que, pendant longtemps, je n'ai pu répéter l'oraison dominicale en public qu'avec un livre devant moi, ce dont je n'ai réussi à m'affranchir que dans le courant des années. Je ne voudrais pas, même à l'heure qu'il est, m'aventurer à le faire, soit en anglais, soit même en français. M. et Mme Jaquet ne perdirent pas une si belle occasion de me parler de mon âme. Le dimanche matin, M. Jaquet distribuait généralement des livres à lire à ceux qui en demandaient. Il en profitait pour leur dire quelques paroles pleines d'à-propos. Il me demanda alors si j'étais converti, me rappela que l'institut n'était que pour des jeunes gens qui désiraient servir le Seigneur, après lui avoir donné leur coeur. J'étais trop embarrassé pour répondre; mais M. Jaquet crut que c'était timidité et émotion simplement. Il avait raison, mais en partie seulement.
Le samedi soir était un moment que nous attendions tous avec une impatience et un intérêt très vifs. Quand le souper était fini, la semaine était close. Le culte se transformait en une causerie de famille qui certes n'était pas oiseuse. A tour de rôle, un des élèves avait charge du Journal de l'institut. Suivant ses dons d'observation et de rédaction, il nous présentait le tableau de la semaine écoulée avec ses incidents généraux et particuliers, visites d'étrangers, promenades, occupations, punitions, lectures en commun, et tout y était mentionné, apprécié selon la tournure d'esprit et les talents de l'auteur. La conduite des maîtres et sous-maîtres n'échappait pas au scalpel du journaliste, et parfois on pouvait bien y découvrir une petite pointe, un grain de sarcasme, une fine critique que tout le monde saisissait avec plaisir au vol. Une fois la lecture terminée, le débat était ouvert, et, en en faisant la clôture, le vénéré directeur le résumait, tenant compte des censures, des regrets exprimés, des promesses faites, des progrès accomplis, relevant et caractérisant la note de l'esprit qui avait régné dans la famille. C'était une soirée piquante d'intérêt et bienfaisante pour tout le monde. Le journal était passé à un autre. Malheur à lui s'il n'était pas fidèle et vrai !
Le dimanche, outre le culte de famille habituel, nous nous réunissions, à 10 ou 11 heures, dans la chapelle de l'établissement, pour le culte public, présidé presque toujours par M. Jaquet lui-même, et auquel assistaient un grand nombre de personnes pieuses qui venaient des environs : « nos amis », disait M. Jaquet. Le reste du jour se passait pour les uns en courses d'évangélisation, pour les autres en lectures ou en chants. Et le soir, après souper, nous avions encore une soirée de famille d'un nouveau genre. M. Jaquet nous faisait la lecture de quelques récits missionnaires, biographies, etc., qu'il avait soigneusement choisis, et, après cela, nous invitait à exprimer chacun notre opinion. Le plus souvent, quand un nouvel ouvrage avait paru, comme La Case de l'Oncle Tom, il accordait à ceux qui lisaient le mieux l'honneur, très apprécié et très envié, de faire la lecture pendant les repas.
De temps en temps, il nous disait : « Mes enfants, appliquez-vous et faites lestement vos corvées et, tel jour, nous irons faire une promenade. » Quelle joie alors! Nous mettions nos habits de dimanche et partions, et, sous l'oeil de ce patriarche qui ne nous quittait jamais, nous gravissions des montagnes escarpées, sautions des ruisseaux avec de longues perches, explorions des cavernes, admirions le Saut-du-Doubs ou d'autres curiosités du pays. Souvent nous visitions quelque ferme où on nous permettait de dévaliser quelques arbres du verger; c'était chez des amis; nous avions un culte avec eux et, si nous partions joyeux, nous laissions toujours une bénédiction derrière nous. Quelquefois, sur une des sommités du Jura, nous admirions un panorama grandiose et puis nous chantions des cantiques en choeur. Et, de retour à la maison, chacun en faisait un récit par écrit, et les meilleures des compositions étaient lues en famille. Et quand je dis en famille, les vieilles domestiques de la maison y avaient leur place. C'étaient de simples femmes du pays, des femmes de peine, dans toute l'acception du mot, mais des femmes pieuses et que nous entourions tous de respect. Quelquefois aussi, M. Jaquet avait une course, une visite, un petit voyage à faire dans les environs. Oh! comme nous estimions heureux celui qu'il choisissait pour l'accompagner ! Ce fut souvent mon privilège à moi, surtout après ma conversion. Et avec quelle joie et quelle vénération il était reçu partout comme un ange de Dieu ! Il était impossible de se trouver en contact avec cet homme de Dieu, toujours digne, d'une grande humilité et d'une insurpassable bonté, sans en recevoir du bien. Dans ses visites, je pensais toujours qu'il était comme les apôtres à qui le Maître avait donné cette injonction : « Quand vous entrez dans une maison, que votre paix vienne sur elle (Matth. X, 13) . »
Un trait bien remarquable de ce chrétien, c'est l'amour si vivant qu'il gardait pour ses anciens élèves. Il nous parlait d'eux, nous racontait les incidents qui avaient caractérisé soit leur arrivée, soit leur séjour à la maison. Il conservait d'eux des souvenirs, comme des reliques, qui formaient un curieux petit musée dans sa grande chambre d'étude. Là se trouvait le bâton de M. Pellissier qui était venu à pied du fond du Dauphiné; là aussi, la casquette que M. Rolland (3) portait coquettement sur l'oreille lorsqu'il vint demander admission dans l'institut récemment fondé ; là encore se trouvait quelque autre souvenir de Gobat (4), l'évêque si connu de Jérusalem. Les récits qu'il nous faisait ainsi, récits empreints d'une affection si vraie, si profonde, non seulement nous captivaient et donnaient des ailes aux heures du soir on au temps des promenades, mais nous faisaient aimer « nos aînés » et entouraient leurs noms d'une auréole. Quand il disait : « Mes enfants, j'ai une lettre de l'ami Rolland, » il fallait voir comme nous nous pressions autour de lui. Mais c'était surtout pour le dimanche soir que ce délicieux plaisir nous était réservé. Alors nous étions tout yeux, tout oreilles! On nous associait ainsi à la vie si variée des membres dispersés de la famille. Nous les suivions dans tous les pays du monde : en Russie, en Allemagne, dans les villes et les villages de France et de Suisse, en Angleterre, au Canada, en Amérique, partout. Un puissant lien de famille nous unissait à eux : ils avaient été à Glay, nous y étions. Nous étions fiers d'eux et leurs exemples nous instruisaient et nous stimulaient. Être un Rolland, un Charpiot, un évangéliste de premier ordre, ce n'était pas peu de chose. Mais pourquoi pas?... C'étaient les aînés de la famille de Glay, ils avaient déployé leurs ailes et avaient quitté le nid; nous étions leurs cadets et, à notre tour, nous nous envolerions et fournirions notre carrière.
Cette idée de la famille, c'était la sève de la vie à Glay et cette sève circulait partout, des maîtres aux élèves, des élèves aux maîtres, dans les leçons comme dans les récréations, dans les détails pratiques de la vie. Nous connaissions les difficultés financières, comme aussi les dons généreux qui arrivaient en réponse à la prière de la foi. Nous portions ainsi notre petite part du fardeau de nos bien-aimés directeurs et nous nous réjouissions avec eux à l'occasion. Nous les entourions tous d'une affection pleine de vénération. Je crois que tous, même les plus volages et les plus insouciants, eussent fait tout au monde pour leur plaire. La plus grande punition qui fût infligée, c'était une réprimande de M. Jaquet, le samedi soir, quand toute la maison était assemblée. Cette réprimande en peu de paroles, calmes et lentes, était sanglante. J'ai vu plus d'un jeune homme éclater en sanglots, et il était rare que le même élève la méritât deux fois. On nous envoyait de Suisse, quelquefois, des caractères étranges dont on ne pouvait absolument pas venir à bout. A Glay, ils subissaient l'esprit de la maison et, malgré l'absence de cette discipline qu'on trouve généralement dans les établissements scolaires, ils étaient forcés de devenir traitables, et plusieurs même, se convertissant, illustraient, par le changement radical de leur vie, la puissance de la grâce de Dieu. Mais, qu'on s'en souvienne, tel n'était pas le but de l'établissement. Seulement les amis de Suisse avaient une telle confiance dans l'esprit de la maison qu'ils s'imaginaient que le caractère le plus récalcitrant pouvait y être dompté. Et ils avaient raison. Je cherche en vain dans mes souvenirs une exception, une seule, le cas d'un élève qu'on ait dû renvoyer.
M. Jaquet était un homme de prière et de foi. Il aimait quelquefois à nous dire quelques mots de sa conversion et de la fondation de l'institut. Il avait fait ses études, il était devenu pasteur, mais la grâce de Dieu n'avait pas encore touché son coeur. Il prêchait la morale et laissait paisiblement dormir les consciences de ses ouailles, comme la sienne. Il ne connaissait pas Jésus-Christ par le coeur et ne pouvait pas le prêcher. Mais un jour, j'oublie la circonstance, un rayon de la grâce de Dieu pénétra dans la nuit de son coeur; il sentit sa misère et pleura; il trouva paix et, joie en ce Jésus dont il parlait sans le connaître, et dès lors, réveillé, il travailla à réveiller son troupeau. Tâche difficile et douloureuse, qui lui suscita une opposition acharnée et une haine implacable, tant parmi ses collègues que dans son église. Lui aussi eut à souffrir persécution pour l'Évangile. Toujours la vieille histoire : on l'accusait de mettre tout sens dessus dessous; les autorités ecclésiastiques blâmèrent son zèle, ses paroissiens s'en irritèrent et il n'est pas d'avanies qu'on ne lui fît (5).
En 1821, M. Jaquet assistait, comme toutes les années, aux fêtes religieuses de Bâle. Ces fêtes se terminèrent par celle de l'établissement de Beuggen fondé depuis deux ans par M. Christian-Henri Zeller.
« Le 22 juin, raconte M. Jaquet, notre bien-aimé frère Zeller nous parla de l'amour du bon Samaritain et engagea surtout les pasteurs à aller et à faire de même, c'est-à-dire à ouvrir des hôtelleries pour y recueillir des enfants pauvres et les élever dans la crainte du Seigneur. Il compara la jeunesse indigente et abandonnée au malheureux de la parabole que le Samaritain charitable entourait de ses soins. « Ah ! s'écriait-il, vous qui êtes appelés à conduire vos semblables, efforcez-vous d'ouvrir des hôtelleries, des asiles de la charité chrétienne, pour y recueillir une jeunesse exposée à toutes sortes de dangers et qui gémit sur nos chemins. » Ces paroles et surtout celle-ci souvent répétée : « Va, et toi aussi fais de même, » produisirent une vive impression sur moi, et plus d'une fois je mêlai mes larmes à celles d'une émotion commune. On parla beaucoup de ce discours durant le reste de la journée. MM. H., S. et d'autres exprimèrent le désir de pouvoir ouvrir, sans retard, des « hôtelleries » dans leurs paroisses. Je les encourageai, ne pensant pas que je commencerais longtemps avant eux. Remplis de ces bonnes dispositions, nous nous quittâmes pour reprendre nos travaux.

« Le lendemain, repassant dans mon esprit tout ce que je venais de voir et d'entendre, j'arrivai dans les environs de Porrentruy. C'était vers le soir, j'étais seul en traversant une forêt où régnait un silence qui a déjà son langage. Mais un langage plus direct, plus. pénétrant, allait m'être adressé. Ce fut alors que cette parole, qui avait déjà touché mon coeur, retentit avec une force toute nouvelle : « Va, et toi aussi fais de même. » C'était le Seigneur lui-même qui me l'adressait, en l'accompagnant de la vertu du Saint-Esprit. Aussi, je ne pus que lui répondre avec de douces larmes: « Oui, Seigneur, j'irai; me voici pour faire ta volonté. » Que ne se passa-t-il pas alors entre le Seigneur et moi ! Pourquoi ces moments, qui remplacent en quelque sorte les visions d'autrefois, sont-ils si rares de nos jours?
« Tout ému, je me hâtai d'arriver chez moi et d'épancher mon coeur qui débordait comme les vaisseaux du sanctuaire; mais, comme ma femme n'était point préparée à une communication si extraordinaire, qu'elle n'avait pas assisté à la fête de Beuggen, ni à l'appel du bois solitaire, elle fut loin de sympathiser avec ce qu'elle appelait un abus de mon imagination.
« Cependant le Seigneur avait parlé trop haut et trop clairement pour que je ne revinsse pas à la charge. J'examinai la chose devant Dieu et lui demandai de faire échouer cette entreprise si elle était au-dessus de mes forces ou si elle était contraire à sa volonté. Ma femme et moi, nous tombâmes enfin d'accord pour adresser une circulaire à nos amis de Bâle, afin de découvrir par eux quelle serait la volonté du Maître. L'accueil fait à notre circulaire, les dispositions favorables des autorités nous donnèrent à tous deux l'assurance que le Seigneur travaillerait avec nous et, qu'il bénirait nos efforts. Nous eûmes à lutter contre ceux qui ne voyaient pas de bon oeil cette entreprise, mais enfin nous parvînmes à jeter les premiers fondements de notre oeuvre. »
Le 11 avril 1822, six jeunes gens, âgés de quatorze à trente-deux ans, furent reçus par M. et Mme Jaquet dans une maison louée à cet effet.
Le 1er mai eut lieu l'ouverture officielle de l'institut. On sentit bien vite le besoin d'avoir une maison plus vaste et plus commode. M. Jaquet acheta, avec l'aide de quelques amis, un immeuble dans le village même.
Mais d'où viendraient les ressources? M. Jaquet n'avait rien. Alors lui vînt à l'esprit, comme un message de Dieu, cette parole, devenue dès lors la devise de l'établissement : « L'Éternel y pourvoirai » Un jour se présenta un jeune homme, la casquette sur l'oreille. C'était un joueur de violon qui présidait aux danses des villages environnants. Il désirait s'instruire. M. Jaquet le reçut. C'était Samuel Rolland. Puis d'autres se présentèrent, puis d'autres encore. Les amis des environs, les vrais chrétiens, s'intéressèrent à ces petits commencements et fournirent leurs pites. Peu à peu, leur cercle s'étendit de proche en proche; les ressources augmentèrent avec la croissance de cette oeuvre naissante, et les résultats justifièrent pleinement la devise de ce nouvel Abraham, homme de prière et de foi et le père spirituel d'un grand nombre d'enfants et de serviteur., de Dieu : « L'Éternel y pourvoirai »

Un autre membre de la famille, Mlle Roman, a bien voulu nous prêter une biographie, restée inédite, de M. Jaquet, grâce à laquelle nous avons pu compléter et rectifier, sur quelques points, les souvenirs de Coillard. (Ed. F.)
2. On conserve à l'institut de Glay une vieille table sous laquelle Coillard a écrit :
-
FRANÇOIS COILLARD -
NATIF DE BOURGES -
(CHER) -
EST ENTRE A L'INSTITUT COMME ELEVE -
LE 20 SEPTEMBRE 1851 APRES AVOIR ETE DOMESTIQUE 2 ANS -
-
Mon Dieu tu connais mon désir, -
Tu connais toute ma pensée; -
Même avant qu'elle soit formée, -
Dans mon coeur tu l'as vue venir. -
Exauce donc ton pauvre enfant -
Qui vers toi pousse sa prière. -
Ramène-moi dans la chaumière -
Où j'ai passé mes premiers ans!
3. Samuel Rolland et J.-J. Pellissier furent parmi les premiers missionnaires envoyés dans l'Afrique du Sud par la Société des Missions de Paris, S . Rolland en 1829, Pellissier en 1831. (Ed. F.)
4. Samuel Gobât, né en 1799, mort en 1879, missionnaire en Abyssinie, puis évêque anglican de Jérusalem, (Ed F.)
5. Comme les lignes qui suivaient, relatant la fondation de l'institut, contenaient quelques erreurs, nous avons préféré y substituer le récit même de M. Jaquet, communiqué par Mlle Roman. L'institut fut ouvert en 1822; C'est alors que s'aggravèrent, contre M. Jaquet, les menées qui aboutirent, en 1827, à un blâme du consistoire de Blamont, en 1830 à une suspension, en 1831 à une destitution approuvée par ordonnance royale du 16 janvier 1833. (Ed. F.)
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
