
CHAPITRE II
ENFANCE - « ANNEES D'ESCLAVAGE
ASNIERES, FOECY, LA FERTE 1845-1851
-------
La famille Bost. - Son départ
d'Asnières. -Une mort. - Premières leçons de latin. - Veillées
d'hiver. - La révolution de 1848. - Une étrange bonne. - Il faut des
livres ! - La misère. - En service au château de Foëcy. - Seul ! -
Mésaventures. - Un appel à la conversion. - Première communion. -
Mort d'une soeur. - La Sologne. - En service à La Ferté-Imbault. -
Études à des heures indues. - Retour à Asnières. - « Il sera
missionnaire! » - Départ pour Glay .
Dans cet intérieur de la famille Bost je ne dirai pas qu'on respirât l'esprit missionnaire, non : il s'imposait, il pénétrait par tous les pores et prenait possession de votre être. Un des grands dons de M. Bost, ce n'était pas seulement d'exercer une activité personnelle dévorante pour faire le bien, mais encore de l'inspirer aux autres, à ses enfants tout d'abord. Il les associait, dans la mesure de leur Age sans doute, à tout ce qui l'intéressait; il était l'âme de cette belle famille. Il a raconté lui-même la grande réunion de tous ses enfants (juillet 1845) (1). Ces onze fils qui, comme il le disait en riant, avaient « chacun une soeur », étaient venus de partout; c'était quelque chose de phénoménal. Le dimanche, tous, les uns par de petits discours, les autres par leurs chants, prirent part à un service spécial. L'un montait en chaire s'appuyant sur des béquilles : c'était le négociant Ami qui venait d'Écosse. Un autre, dont la figure est restée bien gravée dans mon souvenir, nous parlait de ses enfants, de ses incurables; il avait touché les coeurs de ces pauvres paysans qui, au sortir du temple, disaient: « Voilà une belle famille ! Et parmi eux tous, celui-là en a du coeur ! Il est comme sa soeur. Ah ! si nous l'avions comme pasteur avec Mademoiselle, c'est alors que l'Église prospérerait ! » Celui-là, vous l'avez deviné, c'était John Bost. Sa figure m'est restée gravée dans la mémoire et dans le coeur, si bien que, sans l'avoir revu, j'ai pu le reconnaître à trente ans de distance. Mais un autre que «'celui-là » me fit une impression non moins profonde; on l'appelait « le Missionnaire » : c'était Samuel Bost. Il nous captiva par ses récits, il nous montra de petites idoles qu'adoraient les païens. Pour moi ce fut un jour mémorable que celui-là. Je disais à ma mère : « Que c'est donc beau d'être un missionnaire ! » Et elle disait - « Oui, mon enfant, c'est bien encore plus beau que d'être pasteur ! »
Depuis lors, l'intérêt missionnaire reprit vie parmi nous. Mlle Bost nous parlait souvent de missions. Dans ces réunions, elle nous lisait et nous racontait ce qu'elle avait lu. Elle me prêtait de petits traités et me disait : « François, lis cela à la mère Bonté! » Et, dans les longues soirées d'hiver, pendant que ma mère travaillait au coin du feu, cousait, tricotait, tillait le chanvre, je lui racontais tout ce que je savais, et je lui lisais l'histoire de Moïse Mousétsé et une foule d'autres récits. Et ma mère disait : « Il faut que les voisins entendent ça. » Et le lendemain - et souvent - les voisines apportaient leur travail et je lisais les récits missionnaires.
Les noms des Casalis, Arbousset, Rolland, Pellissier, Lemue, comme ils nous étaient familiers! Et de quelle vénération nous les entourions ! Pouvait-il, dans ma jeune imagination, se former de plus bel idéal ? Les mêmes récits étaient lus et relus pour la vingtième fois, et ils avaient toujours la même fraîcheur. Ils occupaient une grande place dans notre vie simple et ont souvent, dans les longues soirées d'hiver, donné des ailes au temps et illuminé notre humble chaumière d'un rayon bienfaisant.
Mais un gros nuage s'élevait à l'horizon : on se disait que M. Bost voulait quitter Asnières. Pareil malheur ne paraissait pas possible. Cependant la rumeur prenait de la consistance, et, un beau jour, dans une de ses réunions, Mademoiselle nous communiqua qu'en effet son père avait accepté -l'appel d'une autre église, bien loin, dans une grande ville qu'on appelait Melun, et qu'ils allaient tous nous quitter. Elle éclata en sanglots et nous tous avec elle. Dans l'Eglise, dans le village, même parmi les catholiques, ce fut une désolation générale. M. Bost père, lui, n'était pas et ne pouvait pas-être populaire; il n'était pas compris de ses paroissiens et il ne les comprenait pas. Quant aux catholiques, ils l'eussent volontiers livré aux tendresses de l'inquisition Mais sa famille ! Mais Mademoiselle! C'était une calamité publique. Le conseil presbytéral fit tout ce qu'il put pour amener M. Bost à retirer sa décision. En vain.
Le jour redouté arriva. Des fourgons de la ville s'arrêtèrent devant le presbytère et chargèrent, puis la famille partit, à pied, en voiture, au milieu des lamentations des vieux qui restaient, des jeunes et de tous les autres qui les escortaient. C'était un Bokim (Juges II, 4-5). Jamais on n'avait vu pareil spectacle. C'était pour les catholiques comme les funérailles de Jacob pour les Cananéens. Les déchirements de coeur ne se décrivent pas. On pleurait partout, au travail, dans les chaumières; le deuil était général.
Il n'y avait pas encore de chemin de fer du Centre. Quand le bruit se répandit que la diligence qui emportait ceux qui étaient tant aimés, devait passer tel jour sur la grande route, tout le monde, spontanément, se rendit à une demi-lieue, à un point où il était impossible de la manquer, et là, nous attendîmes de longues heures dans une morne tristesse. Enfin, la grosse diligence apparut dans le lointain. Elle s'approcha, s'arrêta même quelques instants. Ce fut une nouvelle explosion de sanglots. Le conducteur fouetta ses chevaux, au loin des mouchoirs s'agitèrent encore par la portière, et puis la diligence disparut. Nous reprîmes le chemin du village, sanglotant tous comme des orphelins désolés (20 avril 1846) (2). Plus de réunions, plus de chants ! Plus de ces visages qui avaient toujours un sourire) même pour les petits et les humbles. Le presbytère était fermé. Le dimanche, un des anciens ou notre instituteur lisait un sermon, on chantait les psaumes. Mais les coeurs étaient gros. Et pendant que nous autres nous regrettions le passé, on se demandait, non sans anxiété, quel serait notre avenir et qui nous aurions comme, pasteur.
Une personnalité aussi connue et aussi tranchée que, celle de M. Bost avait beaucoup contribué à mettre en vue l'église de Bourges. Plusieurs candidats se présentèrent pour occuper ce poste important et vinrent prêcher. Le choix du conseil, ratifié par le consistoire, tomba sur M. Théophile Guiral, qui, bientôt, vint définitivement s'installer parmi nous. C'était un homme jeune encore, plein de talents et d'un zèle de bon aloi. Sa jeune femme aussi était pleine de vie et d'entrain. Ce n'étaient pas des Bost, mais ils avaient de l'affection pour leur nouveau troupeau; le troupeau le leur rendit bientôt avec intérêt. M. Guiral avait des talents de premier ordre; aussi, après les incartades de M. Bost, les prédications de M. Guiral furent-elles immensément appréciées. Le premier culte officiel avait lieu au temple de Bourges, à 11 heures, et tous ceux qui avaient des chevaux y conduisaient, à tour de rôle, la vieille « patache » du pasteur. A 2 heures, avait lieu le principal service, à Asnières même. Outre cela, une réunion familière avait lieu le matin, a 8 heures. Elle n'était suivie que par les personnes les plus religieuses du troupeau et était des plus intéressantes. Les homélies simples allaient au coeur de ces bonnes gens. Ma mère ne les aurait pas manquées pour beaucoup, bien qu'elles eussent lieu à cette heure matinale. C'est à ces réunions que mon esprit commença à s'ouvrir aux choses de Dieu.
Mais mes premières impressions vraiment sérieuses, et qui remontent à cette époque, se rapportent à un deuil de famille. J'avais une nièce beaucoup plus jeune que moi et pour qui j'avais une très grande affection. Depuis de longues années elle était invalide. Elle aimait le Seigneur. Sa patience, sa douceur, sa sérénité frappaient tout le monde. Je passais de longues heures avec elle, lisant et chantant des cantiques. Elle mourut .(3) Sa mort fut dépouillée de toute terreur. Un de ses cantiques favoris, qu'elle chantait encore au seuil de l'agonie et que je chantais avec elle, était celui-ci:
La dernière nuit que nous la veillâmes, ma pauvre soeur, accablée par la fatigue de nombreuses nuits sans sommeil, et ma mère aussi, s'assoupissaient par moments, se réveillaient en sursaut et remarquaient en pleurant que « la mort endort », comme dit le vieil adage. Je m'étonnais, moi, et je me demandais si c'était bien là mourir. La chère enfant, elle, disait qu'elle allait à Jésus et chantait son cantique. Ses yeux se fermèrent et elle alla à Jésus. M. Guiral saisit cette occasion de faire, à la jeunesse et aux enfants, un pressant appel. J'en fus profondément remué. Je sentais que je ne pourrais pas mourir comme ma nièce Charlotte, j'avais peur de la mort et je tremblais. Mais à qui confier les combats qui se livraient en moi ? Je luttai pendant quelque temps, m'appliquant à bien remplir mes devoirs religieux. Je me donnai le change. Cette religiosité toute extérieure qui, pour un grand nombre, est l'équivalent de la conversion, est meilleur marché et les satisfait. Elle me satisfit aussi.
Élevé religieusement dès ma plus tendre enfance, cette religiosité était devenue chez moi comme une seconde nature. Il doit cependant s'être produit alors, chez moi, un changement extérieur qui frappa ma bonne mère et mes alentours. Ma mère disait : « Ah, mon enfant chéri, si j'étais assez riche, tu deviendrais pasteur ! Et si jamais je te voyais monter en chaire comme le cousin Cadier (de Pau) et prêcher l'Évangile, ce serait le plus beau jour de ma vie ! » Mes deux frères aînés, que je craignais beaucoup, ne partageaient pas ces sentiments-là; ils trouvaient que ma mère me gâtait, que j'avais eu assez d'écolage et qu'il était temps que je commençasse mon apprentissage de vigneron et « mangeasse de la vache enragée! » J'ai été témoin de ces scènes où ma mère plaidait la faiblesse de ma constitution : « Jamais, jamais il ne sera capable de faire un vigneron; ne voyez-vous donc pas comme il est délicat? Et il ne grandit pas, il est petit pour son âge. » - « Et que voulez-vous donc en faire, demandait mon frère aîné, un monsieur? » - « J'en ferai ce que le bon Dieu voudra, mais si je le puis, il ne travaillera pas à la terre. Pourquoi ne deviendrait-il pas un colporteur comme le cousin Peaudecerf? ou pasteur même comme le cousin Cadier, s'il avait quelqu'un qui le protégeât? » Et, quand. elle était seule avec moi, elle pleurait : « 0 mon petit enfant, disait-elle, je ne suis qu'une pauvre veuve, mais Dieu aura pitié de toi. » Et Dieu entendit les prières de la veuve, il vit ses larmes et il eut pitié de moi.
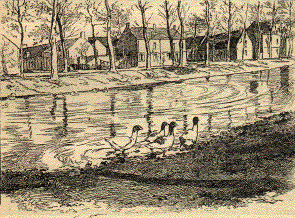
Notre pasteur, M.. Guiral, prenait un grand intérêt à l'école. Il la visitait souvent et y donnait même des leçons. Il remarqua bientôt deux des premiers élèves, le fils du maître d'école (M. Désiré Rivierre) et moi-même, et commença à nous donner chez lui des leçons de latin. Ma pauvre mère ! qu'elle était donc heureuse! J'avais enfin trouvé un protecteur, et déjà elle entrevoyait la réalisation de ses désirs les plus chers. « Non, mon petit, tu ne cultiveras pas la terre, le bon Dieu te fera pasteur. » Le soir, la veillée se passait toujours entre une lecture que je lui faisais à haute voix et la préparation de mes leçons. Et quand je répétais à haute voix : Rosa, rosae, rosae, rosam..., elle travaillait avec un nouveau courage, se disant toujours : « Le bon Dieu fera de lui un pasteur. » Nous pouvions être à court de bien des choses, des nécessités de la vie même, mais n'importe! il y avait toujours une chandelle pour le petit.
Le compagnon d'études de Coillard raconte qu'un jour ils eurent, comme devoir, à mettre en prose une fable de La Fontaine, et il se rappelle encore combien il avait été frappé parla manière dont Coillard avait fait ce devoir. « Coillard avait déjà, ajoute-t-il, ce don d'écrire qui a été une force de son ministère. C'était déjà un garçon travailleur et qui ne pensait pas au jeu comme beaucoup de ses camarades. »
Je ne me souviens pas que ma mère m'ait jamais battu. Ce n'était pas nécessaire pour m'infliger une punition salutaire. Un reproche de sa part et sa tristesse à la rentrée de sa journée de travail suffisaient. Je vivais dé sa vie et de sa joie. Si ma mère était heureuse, j'étais heureux. N'importe le reste. J'écoutais ses instructions avec vénération. A sa suggestion, j'allais tous les jours chez une vieille dame octogénaire qui ne quittait plus sa chambre, pour lui lire des chapitres de la Bible, le Voyage du Chrétien et d'autres livres de piété. La vieille dame appréciait beaucoup mes visites et sa famille aussi, et les heures que je passais dans sa chambre, seul avec elle, ne m'ont jamais paru longues. Cela s'ébruita, et, ici et là, on appelait le petit cousin pour lire un chapitre ou une prière.
De nuit, faisait-il un orage? Ma mère allumait la chandelle et me réveillait : « Mon petit, disait-elle, lève-toi et faisons la prière. » Bientôt tous les voisins, catholiques et protestants, accouraient chez la mère Bonté et je lisais un chapitre et une prière. Puis, l'orage passé, chacun se retirait en remerciant la mère Bonté et le petit cousin (4).
Il n'était pas nécessaire d'un orage pour attirer chez nous les voisins. Dans les longues veillées d'hiver, des femmes apportaient leur travail, l'une filait à la quenouille, l'autre tricotait, une troisième cousait, même des hommes étaient là et le petit cousin faisait la lecture. Au coeur de l'hiver, chacun casse ses noix à tour de rôle dans la journée, et le soir invite ses parents, ses voisins surtout, pour venir passer la veillée. On improvise une grande table, autour de laquelle chacun prend place, on y entasse les noix cassées et chacun de trier, séparant, pour en faire de l'huile, les fruits des coquilles. Ce travail, naturellement peu attrayant, est transformé en une vraie fête qu'égaient, celui-ci par ses contes de revenants à vous faire dresser les cheveux sur la tête, par le récit de ses aventures au service militaire, celui-là par des chansons qu'il exécute d'une voix tremblotante et sentimentale, et que termine généralement le réveillon, un simple repas fait pour de bons estomacs et de bons appétits. Chez ma mère et chez les voisins j'ai souvent chanté des cantiques - car je ne savais d'autre chanson que celle du Juif errant que m'expliquait ma bonne mère - et conté des histoires missionnaires que j'avais lues et qu'on écoutait bouche béante : « Eh, le petit cousin, c'est bien vrai ? » « Je l'ai lu, » répondais-je, et ça suffisait.
Ces veillées étaient des occasions d'or pour faire du bien et je ne m'étonne pas que nos amis les colporteurs y vinssent, et le maître d'école et le pasteur aussi. L'association des idées, la douceur des souvenirs ont entouré pour moi la saison d'hiver d'une auréole de poésie; je rêvais des régions boréales avec leurs neiges et leurs glaces, et, plus tard, j'enviais les missionnaires du Groënland et les Lapons comme si, peut-être chez eux aussi, il y avait des veillées et des noix à trier.
J'avais maintenant à peu près quatorze ans. La révolution de 1848 avait éclaté, temps de surexcitation fiévreuse, même en province. La République fut proclamée; partout dans les écoles on enseignait la Marseillaise. A un jour donné, nous prîmes part à une grande cérémonie civique : on plantait l' « arbre de la liberté ! » Une procession monstre des corporations, des métiers, des écoles, des dignitaires de tous rangs chamarrés des insignes de leurs vocations et de cocardes tricolores, drapeaux, bannières, banderoles tricolores et bandes de musique en tête, défila dans les rues de Bourges, sur la grande place Seraucourt, et, au chant frénétique et enthousiaste de la Marseillaise, on planta le symbole de ce qu'on appelait la liberté. Sur un char fantastique et symbolique, orné des couleurs nationales, trônait la République entourée d'autres figures symboliques. L'arbre périt et les malins disaient : « La liberté est mortel » Ils lisaient aussi, méchamment, sur les édifices publics, ces trois grands mots qu'on y avait peints ou gravés : « Liberté, point; égalité, point; fraternité, point ! »
En tout cas, il y eut un temps de complète anarchie. Des bandes de socialistes parcouraient le pays, pillant les châteaux et les moulins et les livrant aux flammes. Tous les soirs, le tocsin sonnait et on apercevait, dans les environs, quelque nouvel incendie qui éclairait la nuit de ses lueurs livides. La panique s'était emparée de tout le monde. Elle fut au comble quand siégea, à Bourges, la Haute-Cour (mars, 1849), devant laquelle comparurent les accusés du 15 mai. L'hôtel de ville, l'hôtel Jacques-Coeur, avaient été fortifiés pour l'occasion. Des troupes occupaient tous les environs et remplissaient les villages. Ce qui n'empêchait pas les incendiaires de saccager la contrée et de répandre partout la terreur. Notre village aussi regorgeait de soldats; ma mère en logeait deux, bien qu'elle fût veuve. La sécurité publique était alors si compromise que les autorités municipales organisèrent des patrouilles de volontaires qui, se relevant de deux en deux heures, battaient les rues, les ruelles et les abords du village et de la ville. Ces prétendus gardes mobiles étaient surtout armés de fourches et de faux. Tout jeune que j'étais, je me mis de service comme tout le monde, et on disait que le petit cousin était « brave ! »
A ces troubles politiques vinrent encore s'ajouter des calamités publiques : la maladie des pommes de terre et une épouvantable famine. Les boulangeries étaient assiégées et il se passait fréquemment deux et même trois jours avant que je pusse obtenir la miche de 5 livres qui devait nous suffire pour la semaine. Acheter un sac de blé, c'était au delà de nos moyens. J'ai jeûné pendant des jours entiers sans jamais me plaindre, mais la digne femme de notre maître d'école s'en apercevait quelquefois, de même que Mme Guiral, et j'ai encore présents à mon souvenir les régals que ces bonnes dames me donnaient alors, une tartine ou un peu de nourriture. J'opine à croire que, là aussi, il y avait parfois gène, car notre pasteur se contentait d'une petite fille pour domestique. Il passait une partie de l'année en ville, à cause des membres de l'Église qui y habitaient, et c'est là que j'allais prendre mes leçons.
M. et Mme Guiral avaient une enfant, leur aînée, que je prenais grand plaisir à amuser. Un jour, Mme Guiral me dit : « François, je vais faire la toilette de la petite et tu iras la promener sur la place Seraucourt ! » Cela me fit peur. Mais ma mère m'avait toujours enseigné l'obéissance, quoi qu'il m'en coûtât. Je cachai donc mes terreurs, je pris dans mes bras l'enfant avec sa longue robe blanche et je partis. C'était un bel après-midi. La place Seraucourt, plantée de marronniers séculaires, était le rendez-vous du beau monde, des flâneurs, des enfants et des bonnes. Dès que je parus et que je me fus assis sur un banc à l'écart - je n'osais pas aller dans la foule - on me remarqua; il se fit, autour de moi, tout un attroupement de dames qui venaient admirer cette belle enfant et son étrange bonne. Et je ne sais combien de fois je dus décliner le nom de ses parents, M. le pasteur et Mme Guiral, et répéter que j'étais le fils de la mère Bonté. Ce dut être un phénomène pour les gens de cette ville archidévote d'entendre parler d'un pasteur protestant et de voir le fils d'une mère idéale. Je profitai d'un moment où le cercle s'était éclairci, je retournai, à grands pas, rendre le précieux fardeau à la mère qui me reçut ravie et riant aux éclats, et je me sauvai chez nous à toutes jambes. Une chose : je fus fier de la confiance dont, on m'avait cru digne, et, une fois le premier pas fait, je portais fréquemment la chère petite dans mes bras, à travers les rues, sur la grande promenade. Je n'y manquais pas d'admirateurs et de moqueurs, mais, tout timide que j'étais, je tenais tête à tout le monde.
Le pasteur était satisfait de mes progrès ou tout au moins de l'intérêt que je prenais à mes leçons. Il me présenta un jour à l'illustre avocat de Bourges, M. Berryer, avec qui il était très lié. Ma mère, qui l'avait entendu plaider dans une grande cause criminelle, m'avait dit de si belles choses que je regardais avec étonnement cet orateur célèbre. Il s'intéressa à ce petit paysan timide qui était là devant lui. Il m'adressa quelques paroles d'encouragement.
Une grande difficulté survint qui faillit compromettre mes études. Jusqu'à présent, je me servais, pour étudier, de livres empruntés. Mais notre instituteur alla avec sa famille s'établir à Orléans (5), de sorte que je restai sans livres. Il me fallait donc, ou bien me procurer des livres, ou bien renoncer aux leçons particulières de M. Guiral. Un soir, je le dis à ma mère. Elle devint pensive et parla peu de toute la soirée.
Pour elle, elle n'admettait pas la discussion; il me fallait des livres, plutôt que de renoncer à mes leçons. Mais alors cette alternative se doublait d'une autre : des livres ou du pain. « Mon petit enfant, disait-elle, je n'ai absolument que de quoi acheter la miche; faut-il y renoncer pour acheter des livres ? Dis. » - « Sans doute, répondis-je avec un sang-froid qui, à cinquante ans de distance, me fait encore rougir, achetons d'abord les livres. » Et elle redevint pensive. Elle tillait le chanvre en silence, puis : « Combien faut-il pour ces livres ? » - « Je ne sais pas, mais c'est une grammaire, un épitome et un César... puis, dis-je à demi-voix, un dictionnaire... » Plusieurs jours se passèrent, les leçons étaient interrompues faute de livres. Ma mère alla voir le pasteur et elle en revint convaincue de la nécessité de cet important achat. Elle rassembla jusqu'au dernier de ses oeufs, son beurre, son fromage, etc., et, un samedi, nous partîmes pour la ville : « Mon enfant, me disait-elle, en s'arrêtant tout court, je n'ai que de quoi acheter le pain, faut-il que nous nous en passions pour acheter ces livres? » - « Ma mère, comme vous voudrez, - je n'ai jamais tutoyé ma mère, - mais, M. Guiral vous l'a lui-même dit) si je dois étudier, livres il rue faut. » - « Eh bien, mon enfant, tu les auras, » fit-elle avec un soupir qui m'alla au coeur. Nous entrâmes dans une librairie et, cinq minutes après, j'étais en possession de mes livres. Mais à quel prix! Je m'en sentais honteux, si honteux qu'à la prochaine foire je vendis un bel agneau que j'avais élevé et que j'aimais beaucoup et donnai la somme à ma bonne mère. Je me mis à élever des lapins, et je pus ainsi me procurer, sans drainer les ressources de ma mère, le papier, les plumes, etc., dont j'avais besoin. Il le fallait bien, du reste, car tout allait mal : les vivres étaient chers, le travail rare, nos vignes restaient incultes et la misère menaçait de s'établir à notre foyer. La lutte devint désespérée (6).
Un jour, M. Guiral, le pasteur, vint visiter ma mère avec une grande dame (Mme Louis André) qui avait avec elle sa fille (Mlle Isabelle) et sa gouvernante (Mlle de Nilincourt). Ça ne m'étonnait pas du tout, car la personnalité du « père Bost » avait donné de la notoriété à notre église d'Asnières. Des messieurs et des dames, des pasteurs de talent et bien connus, comme je l'ai su depuis, venaient souvent faire un petit séjour à Asnières, et personne n'y venait sans visiter la mère Bonté. Je ne sais pas ce qui se passa dans cette visite de la grande dame. Mais ma mère pleurait le soir et me disait : « Mon pauvre petit, je suis vaincue, je ne puis plus lutter, nous mourrons de faim, ou bien il faudra que tu travailles aux vignes comme tes frères. » - « Eh bien, ma mère, je travaillerai, et le bon Dieu nous aidera ! » Et de fait, j'avais déjà commencé depuis longtemps; j'allais toujours avec un de mes beaux-frères qui m'avait pris sous sa tutelle, et je tenais à montrer que, moi aussi, je pouvais travailler. « 0 mon Dieu ! s'écriait une voisine en me voyant passer au petit jour, gaiement, le fossoir sur l'épaule, voilà donc, le petit cousin qui va devenir vigneron. Et nous disions qu'il serait pasteur ! » Un soir, à la veillée, ma mère me dit : « Cette grande dame, qui est venue me voir l'autre jour, veut te prendre chez elle, et M. Guiral dit qu'elle pourra nous aider, et te pousser, elle te protégera. » Et elle fondit en larmes. « 0 ma mère, lui dis-le, ne pleurez pas, je suis grand maintenant, je puis gagner ma vie et vous soulager. » M. Guiral m'appela et, dans un langage tout nouveau pour moi, me dit que cette grande dame s'était intéressée à ma mère et à moi, qu'elle voulait me prendre chez elle et me protéger. Ce dernier mot, je ne le comprenais pas; ma mère s'en était servie, et il ouvrait devant moi des perspectives bien brumeuses. Je ne savais trop qu'attendre. Mais la grande dame voulait me protéger !...
2. A. BOST, Mémoires, t. Il, p. 353. (Ed. F.)
3. Ici Coillard anticipe : Charlotte, fille de Catherine Coillard et de Pierre Berthault, née le 3 mars 1841, mourut le 16 avril 1849. (Ed. F )
4. Sur le Haut-Zambèze, Paris-Nancy, 1898, in-4, p 403. (Ed. F.)
5. M. Viéville fut remplacé par M. Frédéric Viénot, qui entra en fonctions le 16 mars 1848. (Ed. F.)
6. A cette époque déjà, l'instituteur d'Asnières, M. Frédéric, Viénot, qui fut toujours, ainsi que sa famille, plein de bonté pour Coillard, avait voulu faire entrer celui-ci à l'institut de Glay ; mais Coillard était trop jeune, le règlement fixant seize ans comme limite d'âge. (Rd. F.)
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
