
JUDITH RENAUDIN
1674-1731
-------
« Les lettres des exilés,
« les lettres de Hollande »,
comme on les appelait jadis avec
vénération dans ma famille, ont
habité, pendant un siècle et demi,
dans les placards du vieux salon
boisé ; elles fascinaient mon enfance
huguenote ; une aïeule, de temps à
autre, m'en lisait des passages, le soir. Pauvres
nobles lettres, aux écritures d'un autre
âge, aux encres jaunies sur des papiers
rudes... Je les touche comme des choses
sacrées. » Ainsi Pierre Loti
décrit-il dans la préface de Judith
Renaudin, drame en cinq actes, les
précieuses reliques que son fils, M. Samuel
Loti-Viaud, a bien voulu nous confier et dont nous
avons extrait les passages qui suivent.
Ces lettres furent envoyées au vieux
père resté en France, Samuel
Renaudin, procureur fiscal en l'île
d'Oléron, l'un des ancêtres maternels
de Loti. C'est à peine si l'on y sent planer
la grande ombre de la séparation
définitive. D'une grosse écriture
appliquée, au bas des pages, une fillette,
Jeanne Renaudin, la nièce de Judith, affirme
parfois à son grand-père qu'elle est
« sa très
humble et obéissante servante » et
les petits frères, Isaac et Samuel, signent
après elle. Tout cela respire la patriarcale
union d'une pieuse famille. Et pourtant, quelle
tourmente avait brisé ce faisceau !
On comprend qu'un Loti ait été
fasciné par ces « encres jaunies
sur des papiers rudes », que scelle un
cachet rouge portant un amour volant au-dessus de
deux mains jointes, avec cette devise en
exergue : « Si la foy manque,
l'amour périra ». Mais la
pathétique aventure d'amour qu'il nous a
contée dans Judith Renaudin est surtout
fille de sa rêverie. Aux vieux parchemins,
elle n'a guère emprunté que le nom de
l'héroïne. La véritable Judith,
née du mariage de Samuel Renaudin avec
Elisabeth Chauvet, n'avait que onze ans lorsqu'elle
signa sur le registre des abjurations, le 28
septembre 1685. Plus tard, vers l'année
1700, elle alla rejoindre à Amsterdam un
oncle, Jean Renaudin, de son métier
« faiseur de chandelles », et
un frère, Samuel,
« traiteur », qui s'y
trouvaient établis.
Il fallait gagner son pain. Fille pratique
et débrouillarde, Judith entreprit le
commerce des eaux-de-vie et verjus, dont elle se
fournissait auprès de son père. C'est
ainsi qu'elle rencontra un honnête marchand
de vins de Leyde, Samuel Robert, originaire de
Saint-Fort en Saintonge, qui la demanda en mariage.
Judith sollicita la permission de son père.
« Tu dois bien prendre garde à
mettre peu de chose avec rien, répondit-il.
Les enfants viennent par la suite, et il faut que
tout le monde vive ; outre que les maladies se
mettent bien souvent de la partie. Fais-y tes
réflexions. »
Cependant, le futur beau-père
s'était mis en route de Saint-Fort pour
faire la demande officielle ; mais le mauvais
temps l'arrêta à Marennes, d'où
il écrivit : « N'étant
pas dans notre disposition de tenter les vents et
la tempête, toute notre ressource à
présent est de vous
écrire pour vous prier très
humblement d'agréer la recherche que mon
fils a déjà faite de Madame votre
fille. Je souhaiterais qu'elle vous fût aussi
avantageuse qu'elle me fait de plaisir. »
Le 24 mars 1702, les fiancés comparurent
devant le consistoire de Leyde. Judith avait 28
ans.
Les débuts du ménage Robert
furent difficiles, mais courageux et heureux. La
maison prospéra. L'un des fils de Judith
devint pasteur et fut le père de Jean-Samuel
Robert qui exerça le ministère
à Amsterdam pendant près de quarante
années, jusque vers 1823.
La correspondance que nous avons eue entre
les mains s'arrête brusquement en 1706. Sans
doute l'aïeul de France, qui se plaignait
souvent de sa « santé
débile », est-il mort vers cette
époque, et a-t-il été
enterré clandestinement au fond de son
jardin de Saint-Pierre d'Oléron,
« à l'entrée du petit bois,
au bout de la vigne », peut-être
à la place même où un myrte,
aujourd'hui, ombrage la tombe solitaire du plus
glorieux de ses descendants.
À CONSULTER : Pierre Loti, Judith Renaudin, Paris, 1898 ; Le Roman d'un Enfant, Paris, 1890 ; Le Château de la Belle au Bois-Dormant, Paris, 1910. J.-W. Marmelstein, Les ancêtres de Pierre Loti en Hollande, 1928. F. de Vaux de Foletier, dans Revue Hebdomadaire, 29 janvier 1927.
UN MÉNAGE DE RÉFUGIÉS.
Leyde, ce 26 avril 1702.
Mon très cher et honoré
père, je ne doute point que vous ne soyez
surpris de ce que j'ai été si
longtemps sans vous écrire, mais j'attendais
d'être à mon nouvel
établissement, avant que de me donner cet
honneur.
Celle-ci est donc pour vous remercier
très humblement de l'approbation que vous
avez donnée à notre mariage, que
j'espère, moyennant Dieu, qu'il sera
heureux, puisque je trouve en mon cher époux
les qualités que j'ai toujours
souhaitées en celui que la Providence me
destinait, c'est-à-dire celles d'un
véritablement honnête homme et bon
ménager, exempt de bien des défauts
dont la jeunesse d'aujourd'hui est
entachée ; et ce qui augmente encore
mon plaisir, c'est de le voir estimé de tout
ce qu'il y a d'honnêtes gens et des meilleurs
bourgeois de cette ville.
Je vous dirai donc que nous (nous)
sommes épousés le mardi 11 du
courant. La noce se fit à Amsterdam, chez
mon oncle, où nous fûmes
traités comme si ç'avait
été leur propre fille, n'ayant point
voulu que j'aie entré en compte de toute la
dépense qui se fit, considérant que
je n'étais point en état d'en faire
aucune. Vous jugez bien, mon cher père, ce
qui me peut rester de mon capital, après mes
habits de noce levés ; qui est (c'est),
je vous assure, très peu de chose, lorsqu'il
faut faire ménage nouveau, quoique je n'aie
acheté que ce dont je ne me pouvais
nécessairement passer.
Mon mari partit, hier au soir, pour
Amsterdam, afin de faire venir quelque peu de vin,
que son père nous a envoyé, avec deux
pièces de toile qui viennent, je vous
assure, fort à propos. Nous
reçûmes une lettre de lui, mardi
dernier, qui m'a fait un plaisir sensible, puisque
je remarque qu'ils ont pour nous toute la tendresse
possible, ce qui fait que je ne doute point qu'ils
ne nous aident en tout ce qui se pourra. Celle que
vous m'avez toujours marquée, mon cher
père, fait que je me flatte que, de votre
côté, vous ferez tous vos efforts. Mon
beau-père nous marque que les vignes sont
gelées en leurs quartiers
et que les vins enchérissent tous les
jours...
Leyde, ce 21 septembre 1702.
Vous voulez bien, mon cher père, que je
vous entretienne un peu sur notre nouvel
établissement. Je vous dirai donc que, peu
de temps après (avoir été)
mariés, nous achetâmes des vins,
espérant que nous y ferions quelque chose et
qu'ils enchériraient immanquablement. Ce qui
s'est trouvé tout le contraire, par le peu
de débit qu'il y a, le temps étant si
mauvais que tout le monde se retranche. Cela
n'empêche qu'il ne faut payer, lorsque le
terme est échu. Ainsi nous (nous) sommes
trouvés, je vous assure, fort en
peine ; et ne sais même comme quoi nous
aurions fait sans le secours de nos amis...
Quelques amis que nous avons en cette ville, qui
connaissent mon mari pour un fort bon
ménager, n'ont pas fait difficulté de
lui confier une petite somme, assez
considérable, toutefois, en payant de bons
intérêts, ce qui emporte, comme vous
pouvez croire, la meilleure partie du profit que
nous pouvions faire...
Mon frère Pierre était de
relâche à Plymouth. Je ne sais s'il
vous a écrit. J'en reçus une lettre,
il y a trois mois, de Portsmouth, par laquelle il
me priait de lui donner de vos nouvelles et vous en
donner des siennes. Il me marquait qu'il devait
faire son examen la semaine qu'il m'a écrit,
et ensuite être second chirurgien
(1).
Leyde, ce 3 janvier 1703.
... J'en reçus aussi une (lettre), en
même temps de Londres, de notre belle-soeur
prétendue, qui me marque
que mon frère Pierre était prêt
à partir pour les Indes d'Espagne. Je compte
que, si Dieu le conserve, les longs voyages lui
seront plus avantageux que ceux qu'il a faits
ci-devant, et souhaite qu'il vous donne plus de
satisfaction...
Mlle Pelon reçut, il y a quelques
jours, une lettre de Mme et de Mlle de La
Barouère ; elles se portent
passablement bien. Je me propose, moyennant Dieu,
d'aller, la semaine prochaine, leur souhaiter une
bonne année. Les voitures sont si commodes
en ce pays, que la rigueur de la saison
n'empêche pas d'entreprendre de voyages,
n'ayant non plus de fatigue qu'en sa maison et
aussi à couvert, ce qui fait qu'on ne
s'aperçoit pas du mauvais temps...
Pour mon frère Jean Renaudin (sur la même lettre).
... J'ai une joie sensible de ce que tu me marques que tu as une femme qui a pour toi toute l'amitié et tendresse que l'on peut souhaiter. Le grand Dieu vous maintienne en cette belle union, qui est plus estimable que tous les biens du monde. J'en parle comme l'ayant expérimenté, puisque le grand Dieu m'a fait la grâce d'avoir un même sort que toi, c'est-à-dire de rencontrer un véritable et bon mari qui a pour moi toute l'amitié qu'une femme peut souhaiter. Ainsi, mon cher frère, rendons-en grâce à nôtre (Dieu) ; et que la paix de ce grand Dieu, qui surmonte tout entendement, garde nos coeurs et nos sens, nos entrées et nos sorties, dès maintenant et à tout jamais... Mon mari t'embrasse comme ma chère soeur, et vous souhaite dans peu un gros garçon...
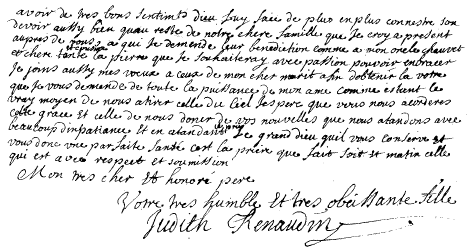
Leyde, ce 31 décembre 1705.
Mon très cher père... Je
m'étais proposé d'envoyer à
chacune de mes soeurs une pièce d'indienne
pour leur étrenne, autant jolie que mon
pouvoir qui n'est pas grand l'aurait pu permettre,
mais on m'a dit que le capitaine ne s'en voulait
point charger, attendu que c'est de contrebande.
J'en suis bien fâchée. Il faut
attendre une autre occasion. En attendant, qu'elles
se contentent de ma bonne volonté et de la
joie que j'aurai de leur faire connaître la
véritable tendresse que j'ai pour elles.
Je vois par votre dernière que ma
soeur Jeanneton n'a point encore d'enfant, ni
espérance d'en avoir jusqu'à ce
temps-là. Il n'y a rien à
désespérer. Elle a du temps assez
pour avoir du mal. J'ai été
près de deux ans et demi sans en
avoir ; mais le temps est venu, si bien que je
crois en avoir trois en moins de deux ans. Et ce
qui est encore de plus fâcheux, c'est que je
ne les puis nourrir. Les nourrices sont ici fort
chères ; le moins qu'on donne, c'est 90
écus par an. Vous jugez bien qu'on a assez
de peine. Enfin, ce qui me console, c'est que mes
petits enfants sont fort aimables, et, grâce
au Seigneur, aussi avancés qu'on le peut
souhaiter.
Je suis assez contente, pourvu que Dieu
me fasse la grâce d'avoir toujours du pain
à leur donner et surtout de les
élever en sa crainte et en son amour. Je
vous demande votre bénédiction pour
eux et me flatte que vous me l'accorderez.
Contentez-vous qu'en reconnaissance je pousse mes
voeux les plus ardents vers le ciel pour vous, et
soyez persuadé que je suis avec toute la
soumission possible, mon très cher et
honoré père, votre très humble
et obéissante fille,
Leyde, ce 18 février 1706.
Je vous dirai que nous gagnons doucement notre
vie, avec peine et l'aide de nos amis. Comme je
n'aspire point à des richesses et que,
d'ailleurs, il faut être content de
l'état auquel Dieu nous met, je le serais
assez, pourvu que Dieu me fasse la grâce de
vous embrasser encore une fois. C'est là ma
plus grande ambition et où je borne tous mes
souhaits...
Nous nous proposons, ma soeur
(2) et
moi, de
faire un voyage à Amsterdam, à la fin
de ce mois. Après quoi, nous devons sevrer
nos enfants, quoiqu'ils n'auront que dix mois. Ils
se donnent, aussi que nous, assez de peine à
élever leur petite famille. Leur
négoce va passablement. Chez mon oncle, ils
se portent tous bien et prospèrent de jour
en, jour. Ma tante a tiré cette semaine
mille francs à la loterie. On nous a dit que
mon oncle, avec un de ses amis, en a aussi
tiré cinq mille. Il nous faudrait une
pareille aventure.
(En post-scriptum). Je crois que vous
recevrez en peu un fromage, par la voie de mon
beau-père.
MARIE GEBELIN
vers 1668-1729
« Et huit jours avant la
mort de
Louis XIV, en 1715, ce fut un garçon de
vingt ans, Antoine Court, qui eut l'audace de
constituer, avec quelques prédicants et
quelques « laïcs
éclairés » le premier
synode du Désert, et de
« replanter » ainsi
l'Église que le roi agonisant croyait avoir
détruite. » (G. Goyau, Histoire
religieuse de la Nation Française, p. 467).
La mère de ce grand
« replanteur » du
protestantisme s'appelait Marie Gebelin.
Elle naquit vers 1668 au mas de Gebelin,
commune de Saint-Pons, près de
Villeneuve-de-Berg (Ardèche). À seize
ans, elle épousa Jean Court, cardeur de
Villeneuve (contrat du 27 avril 1684). À
trente et un ans, en juin 1699, elle était
veuve avec trois enfants, Antoine, Jeanne et
Suzanne. Elle mourut à soixante et un ans,
le 18 octobre 1729, à Villeneuve.
(Renseignements communiqués par Charles
Bost.)
Fervente huguenote, dévouée,
toute bonne, mais très ferme et
sévère, recommandant au maître
d'école de recourir au fouet si Antoine
n'était pas docile. Elle
allait aux assemblées de culte tenues par
des prédicantes. Son fils adolescent l'y
accompagna, et y fit maintes fois la lecture et la
prière ; il voulait devenir
« prédicateur ».
Cinq lettres de Marie Gebelin dans les
« Papiers Court ». Trois
parlent de la peste qui éclata en 1720 et
fit d'horribles ravages en Provence et en
Languedoc. Nous y voyons très
énergiquement formulée cette
idée qui domina la pensée religieuse
des Réformés aux XVIIe et XVIIIe
siècles, à savoir que toute
souffrance, individuelle ou collective - maladie,
épidémie, persécution - est un
châtiment infligé par Dieu à
l'homme à cause de ses
péchés.
B.S.H.P.F. Copie des Papiers Court de la
Bibliothèque publique de Genève, 601,
Lettres à A. Court, t. II, p. 224, 336, 779,
889 (Texte Original, n° 1, t. II, f. 215, 299,
589, 655.)
À CONSULTER : Ed. Hugues, Antoine Court, Histoire de la Restauration du Protestantisme en France au XVIIIe siècle, Paris, 1872.
LA PESTE DE 1720 ET 1721.
À Villeneuve-de-Berq, ce 25 août 1720.
Mon cher fils, ... Je vous prie de vous perfectionner toujours de plus en plus et de vous avancer dans la vocation que Dieu vous a fait la grâce de faire... Quant au bruit du mal contagieux qu'on dit être à Marseille, on compte qu'il est que trop véritable, car on fait garde dans toutes les villes, tant du Languedoc, Provence, Dauphiné et presque par toute la France, et on doute bien d'autre chose. C'est la cause qu'on fait garde partout avec tant d'exactitude, que personne ne peut presque aller ni venir, ni commercer en aucun endroit. C'est pourquoi je vous prie de demeurer encore quelque temps à Genève.
12 décembre 1720.
Les afflictions que nous avons sont grandes, mais il les faut prendre comme venant à cause de nos péchés, et se soumettre tous entre les bras de sa divine Providence. Nous avons bien langui d'avoir tant tardé à recevoir de vos chères nouvelles... Nous espérons d'avoir le bonheur de vous embrasser tout de bon, moyennant la grâce de Dieu, pourvu que ce mal contagieux se passe ; donc il est fort allumé par toute la Provence, et il y a toujours des nouvelles qu'il s'allume davantage, et nous vous demandons avec grâce de prier Dieu pour notre conservation.
12 octobre 1721.
Quant à ce grand fléau dont nous sommes, menacés et qu'il est à notre porte, cela fait beaucoup de peine, mais toutefois la volonté de Dieu soit faite et non pas la nôtre. Ce mal contagieux n'est qu'à quatre ou cinq lieues de chez nous, car il est à Saint-Ginieys (Saint-Genest de Beauzon), à demi-lieue en delà de joyeuse, et reconnu être en plusieurs villages de ce côté-là, où l'on fait continuellement des lignes, gardées par des gens de guerre, afin qu'aucune personne ne passe en deçà d'Ardèche, à peine d'être fusillée. Nous travaillons actuellement à clore tous nos faubourgs en y laissant des portes aux principales avenues et faisant garde continuelle. Veuille le Seigneur nous en préserver par sa sainte grâce... Vous nous marquez que vous aviez donné ordre à de vos amis de nous faire savoir de vos nouvelles. Cependant nous en avons point reçu depuis votre dernière lettre, que nous en étions fort en peine.
21 janvier 1722.
Je suis ravie d'entendre les bons témoignages qu'on rend de vous, et surtout que vous profitez de plus en plus. Agissez toujours avec prudence dans vos affaires, et souvenez-vous qu'en vain auriez-vous fait un bon commencement, si vous ne continuez ; car ce ne sera pas votre commencement qui couronnera votre ouvrage, mais la fin, car la fin couronne l'oeuvre. Je ne vous marque rien de nouveau que comme l'ordinaire, (jamais) la santé mieux établie dans ces endroits, et jamais tant de crainte du mal. Enfin c'est un bruit confus que personne n'y peut rien comprendre. Il faut bien croire que ce sont nos péchés qui nous attirent ces choses...
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
