
CHAPITRE ONZIÈME
-------
EN DANGER SUR LES MERS. - RAROTONGA. - DÉMÉNAGEMENT SENSATIONNEL. - RÉCIT DE PAPEIHA. - FEU DE JOIE. - GNATANGEIA. - FIN DE L'IDOLÂTRIE A RAROTONGA. - CONSTRUCTION D'UN TEMPLE. - JOHN WILLIAMS FIXE LA LANGUE DE RAROTONGA, ET ÉCRIT LES PREMIERS LIVRES. - TRADUCTION DE L'ÉVANGILE DE JEAN. - LE COPEAU QUI PARLE. - RETOUR A AVARUA. - UN NOUVEAU CODE. - COUTUMES BARBARES. - KUKUMI-ANGA. - HO-ANGA. - KAÏ-KAIN-GA.
LE 26 avril 1827, les familles Williams et
Pitman s'embarquèrent sur un petit voilier.
Le 5 mai, après une traversée de neuf
jours, on arrivait devant Rarotonga. La mer
était démontée, le vent
hurlait et sifflait dans la mâture et les
voiles, les vagues s'élevaient à une
grande hauteur. On décida d'attendre au
lendemain pour essayer de descendre dans la
chaloupe et gagner la rive. Mais le lendemain, loin
de se calmer, la tempête faisait toujours
rage, et John Williams fut d'avis que sans plus
attendre on essayât de gagner l'île. Il
fallait quitter le bateau en pleine mer, à
une lieue de Rarotonga à peu près. La
chaloupe fut mise à l'eau.
« Jamais je n'oublierai ce jour,
écrit Mr. Pitman : John Williams
faillit perdre la vie. La mer était toujours
démontée ; alors que le pied appuyé au rebord
de
la chaloupe, les bras tendus, Williams attendait
que la vague élevât l'embarcation pour
pouvoir prendre le bébé qu'on lui
tendait du navire, il fut projeté cri avant
avec une grande violence. Il venait de saisir
l'enfant ! Ma chère femme voyant le
danger, se suspendit aux basques de son habit,
l'attirant avec force dans la chaloupe, ce qui
empêcha qu'il perdît
l'équilibre. Autrement à vues
humaines, l'enfant et lui eussent été
écrasés entre la goélette et
l'embarcation.
« Mrs. Williams déjà
assise au fond du bateau et la figure recouverte,
ne vit pas le danger, ce que je regarde comme
providentiel. Eût-elle fait un mouvement pour
aller au secours de son mari, notre esquif aurait
certainement chaviré. »
Les passagers ne sont pas encore au
port ; leur esquif grimpe au haut de vagues
géantes, ce sont de vraies collines liquides
qu'on redescend avec une rapidité
vertigineuse pour escalader la colline
suivante ; les passagers sont reconnaissants
quand les vagues s'arrondissent au lieu de
s'écrouler comme un mur verticalement
(1). Au
fond de
l'embarcation, Mrs. Williams puise l'eau sans
arrêt. On avance difficilement, lentement. De
la rive, couverte d'indigènes, on suit avec
angoisse la marche du canot, on a le coeur
serré chaque fois qu'il disparaît, et
on respire quand on l'aperçoit à
nouveau sur la crête d'une vague.
Aussitôt que les passagers touchèrent
le rivage, la foule les entoura, tous voulant les
saluer à la mode anglaise, par la
poignée de mains. L'énergie de
celle-ci devant prouver la sincérité
de l'affection, John Williams en
reçut de si nombreuses et de si
énergiques que son pauvre bras en ressentit
longtemps les effets.
Il restait à bord presque tous les
bagages des missionnaires et les provisions de
bouche dont ils s'étaient munis. Sage
précaution à prendre en se rendant en
un pays isolé du reste du monde et sans
relations commerciales. Malheureusement, la mer
restait mauvaise, rendant le débarquement,
sinon impossible, du moins dangereux. Au
troisième jour, le capitaine envoya une
lettre aux missionnaires. « Le navire
avait subi de graves avaries au cours de la nuit,
écrivait-il, et il était
obligé de repartir sans plus
attendre. »
« Aussitôt, Mr. Pitman et
moi nous prîmes notre bateau et
retournâmes à bord pour
débarquer vêtements et provisions
diverses, et écrire quelques lettres. Ceci
fait, nous prîmes congé du capitaine
et quittâmes le navire. Nous étions
à peine en mer que nous comprîmes le
danger de notre situation : un bateau
lourdement chargé, l'Océan toujours
démonté, une seule paire de rames, et
de, huit à neuf kilomètres à
couvrir. Providentiellement, d'une pirogue double
qui était allée chercher quelques
indigènes à bord, on vit notre
dangereuse situation et on vint aussitôt
à notre aide. Après plusieurs heures
difficiles, nous arrivions enfin à
destination. Nous n'avions malheureusement pas pu
prendre toutes nos provisions, beaucoup
restèrent sur le navire. Cependant nous
fûmes heureux de ce que nous avions pu
apporter : farine, sucre, thé,
etc...
« Le Mercredi, nous
assistâmes à un service au temple,
écrit Mr. Pitman. Celui-ci était
absolument bondé ; la
prédication fut faite par Tibério,
l'ami de Papeiha. Quelle joie
pour moi que de voir cet immense édifice
rempli d'indigènes sortis récemment
du paganisme, écoutant gravement la
prédication d'un indigène d'une autre
île que la leur. Je ne puis décrire
mes sentiments et ma grande émotion !
Comment ne pas s'écrier :
« Quelles grandes choses Dieu a
faites ! ... »
Durant la semaine qui suivit
l'arrivée des missionnaires, tout le peuple
d'Avarua se transporta de l'autre côté
de l'île pour y bâtir un second
village, où devait rester Tibério.
Pourquoi ? Les missionnaires n'étaient
pas au courant, et ils suivirent le mouvement
général. La chose avait
été décidée avant leur
arrivée.
Le déménagement ne manqua pas
de comique et d'imprévu. Une forte pluie
avait rendu le chemin presque impraticable ;
mais comme les indigènes voulurent
absolument porter les blancs et leurs bagages,
cette promenade sous bois à travers
l'île s'accomplit avec un minimum de fatigue.
Ils étaient là des milliers
d'indigènes chacun voulant porter quelque
chose : qui une poêle, qui une
bouilloire, qui une boîte, un autre l'une des
pièces d'un lit, etc... La plupart
brandissaient l'objet très haut dans
l'espace tout fiers d'avoir pu s'emparer de quelque
chose, et désirant le faire admirer. Le roi,
lui, avait trouvé particulièrement de
son goût un objet de faïence
décorée qu'on ne peut nommer, et il
s'était chargé de le porter à
destination. Ce qu'il fit avec la gravité
convenant à un homme de sa situation, et
sans rien perdre de sa dignité. Cette
multitude joyeuse, ces cris, ce bizarre
déménagement, le moyen de locomotion,
tout ceci nous amusa prodigieusement.
Pendant la marche, je demandai à
Papéiha de me dire tout
ce qui s'était passé depuis l'instant
qu'il était arrivé seul sur le
rivage, tandis que nous faisions voile vers
Raïatéa.
« Eh bien, dit-il, quand je retournai,
je vis les guerriers sur le rivage, ils
brandissaient leurs lances vers moi, et ils dirent
: « Qu'on l'emmène à
Makéa. » Alors ils me conduisirent au
roi qui, me regardant, demanda : « O homme,
parle-nous, que nous sachions pourquoi tu persistes
à venir ?
- Je viens, leur dis-je, pour que vous
appreniez à connaître le vrai Dieu, et
pour que vous fassiez comme tous les gens des
îles éloignées : que vous
preniez vos dieux de bois, de plumes d'oiseaux et
d'étoffe et que vous les brûliez.
»
Quand il m'entendit, le peuple poussa un cri
d'horreur et de rage.
« Quoi ! brûler les dieux ! Et
que ferions-nous sans eux, criaient-ils? Ils
étaient en fureur contre moi, mais quelque
chose les empêcha de me tuer.
Un jour, j'entendis des cris, des appels, un
grondement furieux, comme celui que ferait un
rassemblement de gens en démence. J'allai
pour me rendre compte, et je vis tout autour des
dieux un très grand rassemblement de peuple
qui leur offrait de la nourriture. Les
prêtres s'étaient passés la
figure au charbon et ils s'étaient
bariolé le corps de grandes raies rouges et
jaunes. Les guerriers avaient une haute coiffure de
plumes d'oiseau et de coquillages blancs.
Je courus au milieu d'eux et leur dis :
« Pourquoi agir aussi follement ? Vous prenez
un morceau de bois, vous le sculptez et puis vous
l'adorez comme un dieu, et vous lui offrez de la
nourriture. Ce n'est bon qu'à être
brûlé. Et bientôt ces dieux vous
serviront de combustible. »
Et comme ils étaient frappés
d'étonnement et que cette fois ils
m'écoutaient, je pus leur dire l'histoire de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus.
Alors ils me demandèrent : - Où
est-ce qu'il vit ton Dieu ?
- Il remplit les cieux et la terre de sa
présence, leur dis-je.
- Nous ne pouvons pas le voir ? S'il
était aussi grand que tu dis, nous pourrions
le voir ?
- Et ne nous heurterions-nous pas à
lui, dit un autre ?
- La terre est remplie d'air, mais nous ne
le voyons pas et ne trébuchons pas
contre... »
Ce fut le commencement. Ensuite je leur ai
souvent parlé sur une grande pierre au
milieu des bananiers, ou au village, ou sous les
palmiers, et quelques-uns abandonnèrent
leurs dieux pour servir Jésus-Christ.
Un jour, je vis l'un des prêtres des
faux dieux venir à moi ; il m'amenait
son petit garçon de dix ans :
« Prends soin de mon fils, dit-il. Je
vais brûler mon dieu et je ne voudrais pas
que sa colère tombât sur mon enfant.
Demande à ton Dieu qu'il le
protège. » Puis il s'en alla. Le
lendemain, il revint de très bonne heure,
marchant péniblement et ployé en deux
sous le poids de l'idole. Derrière lui, la
foule furieuse hurlait :
« Fou ! Fou ! Le dieu va te
tuer ! » - « Hurlez si
vous voulez, dit le prêtre, d'une voix
saccadée, à cause de la charge qu'il
portait, vous ne me ferez pas changer. Je veux
adorer Jéhovah, le dieu de
Papeiha. » Alors il jeta l'idole à
mes pieds. Mon frère Tibério, qui
était arrivé, courut chercher une
scie. D'abord nous avons scié la tête,
et ensuite le reste en gros morceaux. Une partie du
peuple se sauva terrifié. D'autres
indigènes - même quelques-uns des convertis - se
cachèrent
derrière les arbres et dans la brousse pour
voir de loin ce qui allait se passer. J'allumai un
feu et y jetai les morceaux de l'idole. Alors que
les flammes du brasier s'élevaient, les
prêtres de cette même idole qui
alimentait le feu me crièrent :
« Tu mourras, tu
mourras ! »
Pour leur montrer que ce n'était
qu'un feu ordinaire, je pris un régime de
bananes et le mis sur des braises. Une fois les
bananes rôties, nous nous assîmes,
Tibério et moi, et les mangeâmes.
La foule regardait, comme frappée de
stupeur, s'attendant à nous voir tomber
morts, mais rien n'arriva. Immédiatement
après, un chef nommé Tinomana, nous
invita, Tibério et moi, à aller le
voir dans les montagnes. Nous partîmes ;
et quand il nous vit il dit :
« Je veux être
chrétien ; que dois-je
faire ?
- Détruis ton maraë et
brûle tes idoles, fut notre
réponse.
- Venez avec moi, et voyez-les
détruits, répondit-il. »
Alors il prit une torche allumée et partit
mettre le feu au temple (maraë), à son
autel (atarau) et aux pièces de bois
sculpté nommées unus - choses
sacrées -, qui décoraient le
maraë. On apporta aussi quatre grandes idoles
qu'on mit à nos pieds. Alors je lus ce
passage devant le peuple qui s'était
rassemblé:
« Les soixante-dix revinrent avec
joie disant : Seigneur, les démons
mêmes nous sont assujettis par ton nom. Et il
leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel
comme un éclair. Voici, je vous donne le
pouvoir de marcher sur les serpents, sur les
scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et
rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont
soumis,
mais
réjouissez-vous de ce que vos noms sont
écrits dans les cieux. »
Ensuite nous avons jeté les faux
dieux dans les flammes. Mais une partie du peuple
était rempli de fureur. Les femmes
hurlaient, se lamentaient et s'enduisaient de
charbon ; elles se lacéraient les mains
et la figure avec des coquillages pointus et des
dents de requin, et elles criaient :
« Hélas ! hélas !
les dieux de Tinomana le fou, les dieux de l'homme
lunatique sont donnés aux
flammes. »
Cette même semaine, le grand chef Pa -
celui qui avait eu la victoire sur Tinomana - nous
envoya chercher, nous faisant savoir que lui aussi
voulait devenir chrétien. Nous
partîmes. La nuit, comme nous étions
assis près de Pa et parlions avec lui, un
homme qui paraissait en proie au délire
arriva en hurlant et en se donnant comme
possédé par Tangaroa, le grand dieu
de Rarotonga. Et il criait :
« Pa ! Pa Donne-moi ces deux
hommes ! Pourquoi reçois-tu ces deux
bâtons vermoulus, ces deux épaves que
les vagues ont rejetées sur notre rivage.
Pourquoi écoutes-tu cette écume de la
mer ? Je suis le grand Tangaroa. Donne-les
moi, je les mangerai. »
Et comme il se rapprochait de nous, je dis
à Tibério en plaisantant :
« Si nous prenions nos couteaux pour
l'ouvrir, et pour chercher le grand dieu
Tangaroa ! » Alors Pa, le chef,
parlant à son tour au prêtre en
délire, dit : « N'entre pas,
Papeiha et Tibério sont tout prêts
à t'ouvrir avec leurs couteaux pour essayer
de trouver Tangaroa. »
C'est ainsi que la vie des fidèles
missionnaires raïatéens fut
préservée encore cette fois. Les
païens redoutaient de toucher à ceux
qui pouvaient impunément détruire
maraës et faux dieux. Et dans les mois qui
suivirent, toute l'île
imitant l'exemple des chefs Tinomana et Pa, rejeta
le culte des idoles.
En entendant ce récit, en
évoquant ces grands feux de joie dont le
combustible était fourni par les idoles,
Williams voyait en pensée une grande lueur
se projeter sur le Pacifique, une splendide
lumière faisant sa trouée dans les
ténèbres du paganisme ; et
Papeiha et les chrétiens de l'île lui
semblaient comme autant de phares qui allaient
projeter leurs feux bien au delà des plages
de Rarotonga.
Cependant, on était enfin
arrivé à Gnatangeïa, où
on conduisit les missionnaires dans l'une des
maisons élevées pour les
évangélistes indigènes. Les
voyageurs trouvèrent le repos
délicieux. Mais dès le lendemain,
John Williams se mettait à l'ouvrage. Son
séjour à Rarotonga pouvait être
court, il n'avait pas de temps à perdre,
songeait-il.
Les chefs et le peuple furent
convoqués, et d'un commun accord, tous
décidèrent d'élever d'abord la
maison de Dieu. Le jour suivant, ils étaient
à l'oeuvre ; une semaine après,
on avait coupé et transporté tout le
bois nécessaire. « Alors que nous
travaillions à la charpente, les chefs
exprimèrent le désir qu'on
dépouillât deux de leurs faux dieux de
leurs ornements pour en décorer des poutres.
Nous acceptâmes ; et tandis qu'ils
apportaient les idoles d'Avarua, comme je leur
disais : « Voici les dieux que vous
avez adorés », ils me
répondirent : « Il est vrai,
mais nous étions alors dans la
nuit. » Le prince des
ténèbres doit avoir grincé des
dents à cette vue, écrit Mr.
Pitman.
Quelques jours après notre
arrivée à Gnatangeïa, Papeiha et
Tibério vinrent nous demander de nous
asseoir sur la place, devant les maisons. Nous le fîmes ;
et
bientôt nous vîmes une longue
théorie d'indigènes portant leurs
idoles. Ils arrivaient devant nous et à
mesure qu'ils passaient, les jetaient à nos
pieds. Quelques indigènes portaient à
plusieurs sur leurs épaules de lourds
fardeaux : c'étaient d'immenses idoles
dont la plus petite avait cinq mètres de
haut. Elles étaient faites du bois de
l'aïto (2) : longue colonne
surmontée
d'une tête grossièrement
sculptée ; à l'autre
extrémité, une figure obscène,
autour du cou un collier de perles taillées
dans la nacre des huîtres
perlières : l'âme de l'idole,
disent les païens. Le buste est entouré
de plusieurs tours d'étoffe indigène.
Quelques-unes furent immédiatement
brûlées ; d'autres furent
utilisées comme bois pour le temple en
construction, l'une d'elles fut gardée pour
être expédiée au Musée
des Missions à Londres, où elle se
trouve aujourd'hui. « Malheureusement,
elle a beaucoup perdu comme apparence, ajoute John
Williams. Les fonctionnaires de Sa Majesté
britannique, craignant que le corps ne fût
creux et qu'on y eût caché quelque
article payant des droits, mirent l'idole en
pièces. Moins habiles à faire des
dieux qu'à sauvegarder les droits du pays,
ils n'ont qu'à moitié réussi
la reconstruction. » Après avoir
décrit l'idole des pêcheurs
fixée à l'avant de la pirogue, et
avoir dit que jamais l'indigène
n'entreprendrait quoi que ce soit sans avoir fait
une offrande à son dieu et l'avoir
prié, Williams ajoute :
« Voici des païens qui implorent la
bénédiction de leurs dieux sur leurs
travaux quotidiens. N'y a-t-il pas ici une
leçon pour beaucoup ? Chrétien,
va, et fais de même ! »
Pendant qu'aidé de Mr. Pitman, de
Papeiha et de Tibério, Williams travaillait
à l'érection du temple, il
écoutait les conversations indigènes,
notait ce qui différenciait le langage de
celui des Îles-sous-le-Vent ; et le soir
venu, il travaillait encore, vérifiant les
remarques faites au cours de la journée.
Bien que Papeiha et Tibério eussent fait
l'école régulièrement, les
chrétiens de Rarotonga n'étaient pas
arrivés à apprendre à lire.
Ceux de Raïatéa étaient-ils
beaucoup plus intelligents ? Ne fallait-il pas
plutôt incriminer les différences de
langage ? C'est pourquoi Williams voulait
arriver à comprendre parfaitement la langue
de l'île pour pouvoir l'écrire et pour
mieux se faire entendre.
« Je résolus de me mettre
à rédiger quelques livres en leur
langue, et à traduire l'évangile de
Jean et l'épître aux Galates.
La langue tahitienne a quantité de
hiatus. Ceux-ci, dans le langage de Rarotonga, sont
remplacés par des k et des gn. Ainsi le mot
tahitien pour nourriture est ma'a ; et en
rarotogan : ma-gna ; maïtaï
(bon) devient maitaki. De plus, les
indigènes de l'archipel ne peuvent prononcer
les h ni les f. Ces lettres ne sont pas dans leur
langue. Et ceci modifie de manière assez
sensible le langage. Ainsi pour le mot
tahitien : ha'eha'a, humble ; les deux hs
sont supprimés et les deux hiatus
amendés ; le mot devient alors akaaka.
Avec cette même règle et en
remplaçant la lettre f par un a, fa'i
devient aaki... »
Le lecteur reste confondu devant un
semblable labeur, labeur de tous les instants et
qui fait appel à toutes les forces de
l'être : spirituelles, intellectuelles,
physiques. Williams manie le marteau ou la varlope,
mais il écoute ce qu'on dit autour de lui,
il note les différences ; il
les
classe en sa pensée le soir il écrit,
il compare.
Il s'initie à la mythologie, aux
légendes du pays : Raïatéa
y joue une place assez grande. Les deux îles
étaient-elles vraiment voisines autrefois et
furent-elles éloignées -
amputées aussi peut-être par un
séisme ?
En très peu de temps, John Williams
fixe la langue. Il rédige alors des
traités de lecture et il traduit quelques
livres de la Bible : l'évangile de Jean
ainsi que l'épître aux Galates, qu'il
fait imprimer à Huahiné. Dès
que Rarotonga reçut des livres de lecture en
rarotongan, ses progrès furent
extraordinaires. À ce point qu'il se trouve
maintenant plus de chrétiens sachant lire
à Rarotonga que nulle part ailleurs.
Un jour que John Williams arrivait sur le
chantier, il s'aperçut qu'il avait
oublié son équerre. Prenant un
copeau, il y écrivit quelques mots avec du
charbon, puis appelant un chef qui surveillait la
partie de construction dévolue à son
district, il lui demanda de porter le copeau
à Mrs. Williams.
Ce chef avait une apparence assez
bizarre : il était extrêmement
vif et avait été autrefois un
très grand guerrier. Dans l'un des nombreux
combats où il s'était trouvé,
il avait perdu un oeil. Me regardant de l'autre
avec une expression indescriptible et si
drôle, il me dit : « Lui
porter cela ! Elle m'appellera fou et me
grondera de lui avoir porté ce fragment de
bois.
- Non, elle ne te grondera pas. Prends, et
va tout de suite. Voyant que j'étais
sérieux, il le prit et demanda : Et que
dirai-je ?
- Tu n'as rien à dire,
répondis-je, le morceau de bois dira tout ce
qu'il faut dire. » Regardant alors le
morceau de bois avec étonnement et
mépris, il me dit :
« Comment cette chose pourrait-elle
parler ? A-t-elle une
bouche ? »
Je lui expliquai que j'étais vraiment
très pressé et qu'il me rendrait un
grand service en partant tout de suite ; il
partit enfin porter l'éclat de bois à
Mrs. Williams qui, après avoir lu ce que j'y
avais écrit le jeta, et partit prendre
l'équerre dans là boîte
à outils.
Le chef était allé sur ses
talons pour essayer d'éclaircir ce qui
était pour lui un grand
mystère ; et, recevant
l'équerre, il dit :
« Un moment, ma fille, comment
sais-tu que c'est cela que demande Mr.
Williams ?
- Mais ne viens-tu pas de me porter un
morceau de bois, maintenant ?
- Oui, répondit le guerrier
étonné ; mais je ne l'ai pas
entendu parler.
- Mais moi, j'ai compris ce dont mon mari a
besoin. Pars bien vite lui porter
l'équerre. » Le chef bondit hors
de la maison, ramassa le copeau, et brandissant
celui-ci d'une main, l'équerre de l'autre,
il traversa le village en criant :
« Voyez la sagesse de ces Anglais, ils
peuvent faire parler les copeaux ! »
En me remettant l'équerre, il me demanda de
lui expliquer comment il était possible de
parler avec des personnes au loin. Je fis tout mon
possible pour lui faire comprendre l'affaire, mais
celle-ci restant mystérieuse pour lui, il
fixa une cordelette au copeau qu'il attacha
à son cou, et pendant plusieurs jours nous
le vîmes entouré d'une foule de gens
à qui il racontait l'histoire « du
copeau qui parle ».
Une fois les travaux de construction
terminés, MMr. Williams et Pitman ouvrirent
une école. Les indigènes
baptisés et ceux qui étaient
candidats au baptême furent répartis
en vingt-trois classes - chacune
comprenant de vingt-cinq à vingt-huit
familles. Deux des indigènes les plus
sérieux et les plus intelligents
étaient promus au titre de moniteurs sur
chaque classe, pour aider à l'enseignement
et veiller à la présence de chacun
des membres inscrits.
Les auditoires du Dimanche à
Gnatangeïa étaient de trois à
quatre mille personnes. Cependant trois mois
s'étaient écoulés en travaux
divers, et les gens d'Avarua qui devaient retourner
chaque semaine sur leurs plantations pour se
ravitailler désiraient retourner dans leur
village. Mais ils n'y voulaient point partir sans
John Williams. Celui-ci avait appris bien des
choses pendant les trois mois
écoulés : les rivalités
existantes, les divisions politiques, les grandes
distances séparant les districts les uns des
autres, l'impossibilité pour les gens d'un
district de se procurer des vivres ailleurs que sur
leurs terres, le pouvoir relatif de chacun des
différents chefs, etc... Pour toutes ces
raisons, deux postes missionnaires étaient
nécessaires, et il serait peut-être
bon par la suite d'en créer un
troisième,
Comme nous pensions n'avoir plus
guère à passer que deux ou trois mois
à Rarotonga, il fut donc
décidé que notre collègue et
ami Mr. Pitman s'installerait à
Gnatangeïa, tandis que nous retournerions avec
les indigènes d'Avarua pour demeurer avec
eux jusqu'au moment du départ. On retrouva
le village en bien triste état :
maisons démolies, barrières abattues,
champs et jardins couverts de mauvaise herbe. Le
temple aussi avait beaucoup souffert. Ici encore il
fallait bâtir. Le reste du temps fut pris par
la prédication et l'instruction.
« Depuis que nous sommes ici,
écrit Williams au Comité de Londres,
nous avons prêché presque chaque jour. Le service
terminé, notre maison se remplit
d'indigènes venus pour quelque explication.
Leur attention est très
grande... » Williams en profite pour
essayer de les convaincre des effets pernicieux de
quelques-unes de leurs coutumes, et leur demande
d'y renoncer. En même temps, il se met
à traduire en langue du pays le code de
Raïatéa. Ainsi, de temps
immémorial, les indigènes de
Rarotonga s'adonnaient au vol malgré les
vengeances terribles qu'exerçait la partie
lésée. Les amis et parents allaient
à la maison du voleur et ils s'emparaient de
tout ce qu'ils voulaient,
même de la natte où dormait le voleur.
Parfois sa maison était mise en
pièces, ses bananiers coupés, toutes
les plantations détruites. D'autres fois, le
voleur était tué immédiatement
et il arrivait que par ordre du roi il fût
coupé en morceaux, et que ceux-ci fussent
suspendus en divers endroits de la
propriété où il avait
été voler. Les chefs de Rarotonga
comprenaient que cette façon d'exercer la
justice n'était pas compatible avec les
enseignements de l'Évangile ; et
très souvent ils venaient nous voir pour
nous soumettre les délits. Rarotonga passait
par l'époque de transition qu'avait connue
Raïatéa et les autres îles. De
tout notre pouvoir, nous essayâmes de faire
accepter aux chefs l'institution d'un jury
souhaitant vivement que cette barrière
fût dressée devant l'injustice et la
tyrannie sous lesquelles les habitants de ce si
beau pays ont longtemps gémi.
Les articles du code que nous avons
rédigé mon collègue et moi, se
rapportent au vol, aux diverses offenses, à
la spoliation des terres - en langue
indigène : « manger la
terre », aux choses perdues, à
l'observation du Dimanche, la rébellion, le
mariage, l'adultère, enfin à
l'institution d'un jury, à la nomination des
juges, etc... Nous laissâmes de
côté les lois relatives au crime, ne
sachant quelle pénalité
édicter (3).
En un tout autre domaine, celui de la
pluralité des femmes, nous avons
été longtemps perplexes. La polygamie
existait avant l'introduction du christianisme.
Lorsqu'un
indigène demandait le baptême à
Papeiha ou à son collègue, s'il avait
plusieurs femmes, il avait été averti
d'en choisir une, et de renvoyer les autres, mais
de pourvoir à leurs besoins. Cette mesure
réussit au delà de ce qu'on aurait pu
espérer. Sur le très grand nombre de
ceux qui acceptèrent de s'y soumettre, il
n'y eut guère que vingt à vingt-cinq
personnes qui causèrent quelques
difficultés. Parmi elles, le roi. Nous
eûmes de nombreuses conversations avec les
indigènes à ce sujet : les uns
nous dirent être retournés à la
femme renvoyée parce qu'ils n'avaient pas pu
choisir à leur guise ; d'autres dirent
n'avoir pas compris que la séparation devait
être définitive. Bref, après
mûres réflexions, nous
décidâmes, Mr. Pitman et moi, d'avoir
une assemblée générale :
ceux qui étaient mécontents,
choisiraient publiquement devant tous la femme
qu'ils désiraient garder, et les deux
seraient ensuite unis par la
célébration du mariage religieux
devant toute l'assemblée. L'homme devait
continuer de subvenir à l'entretien de la
femme ou des femmes renvoyées. Ceci
n'était pas aussi facile qu'à Tahiti
ou aux Îles-sous-le-Vent. Là, les
provisions de toutes natures sont abondantes ;
mais à Rarotonga, une femme dépend
presque complètement de son mari.
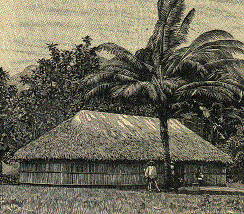
CASE INDIGÈNE
Sachant que l'exemple du roi créerait un
précédent, nous le priâmes, lui
le premier, de choisir l'une de ses trois femmes.
Il choisit la plus jeune qui lui avait donné
un bébé, la préférant
à sa propre soeur de qui il avait trois
enfants et à sa première femme,
mère de neuf ou dix autres. Makéa fut
donc marié religieusement avec sa
troisième femme en présence de son
peuple.
Le lendemain, Pivai, la femme principale,
prit sa natte, ses maillets
(4) et
quitta la
maison du roi pour s'établir dans une autre
résidence. Tous ou presque tous dans le
village pleurèrent en la voyant
s'éloigner... Nous aussi nous sympathisions
avec elle, car elle était estimée de
tous et elle était digne de cette estime.
Quelques jours avant son départ, elle
était venue voir Mrs. Williams. Et elle lui
avait dit que malgré sa très grande
affection pour Makéa et la peine qu'elle
éprouvait à l'idée de
séparation, elle sentait cependant que la
chose était préférable puisque
c'était sa jeune femme qu'il aimait... Elle
choisit une absence de son mari pour s'en aller.
Quand il rentra de l'école et qu'il sut son
départ, il s'en montra très
affecté. Le roi lui fit cadeau du revenu
d'une vingtaine de propriétés :
les fermiers devaient obéir à ses
ordres et travailler sous sa direction. Pivaï
employa le temps de son veuvage - qui dura trois ou
quatre ans - à faire des vêtements de
tapa pour Makéa et ses enfants, faisant avec
le plus grand soin tout ce qui était pour
son ancien mari. Au bout de quatre ans, la femme de
Tinomana - chef dont nous avons déjà
eu l'occasion de nous entretenir - mourut. Tinomana
épousa Pivaï, et nous avons toute
raison de croire que ce chef était vraiment
un très brave homme.
« Je sais qu'il peut y avoir
divergence d'opinions sur ce sujet délicat,
écrit John Williams, mais je crois qu'une
étude impartiale des circonstances qui
existaient alors montrera que les décisions
prises furent à la fois heureuses et
salutaires. Si ceux qui avaient repris leurs
nombreuses femmes avaient eu notre sanction,
c'était la restauration
générale de la polygamie, et
l'annihilation de
l'oeuvre commencée par Papeiha. En lisant
les récits missionnaires, j'ai souvent
regretté que leurs auteurs laissassent sous
silence les difficultés qu'ils avaient
rencontrées et les mesures qu'ils avaient
prises... Il me semble que ces récits ne
devraient pas donner que ce qui pourrait être
écrit par des personnes n'ayant jamais
laissé le pays natal, mais exposer les
situations complexes et la manière dont
furent résolus les problèmes qui se
dressaient devant eux. Leurs successeurs, leurs
collègues pourraient ainsi profiter des
expériences faites : en les imitant
s'il y a lieu, en évitant de tomber dans
leurs erreurs s'ils se sont trompés.
« Il y avait une collection de
coutumes dont nous aurions voulu provoquer
l'abolition. L'une d'elles, nommée Kukumi
anga, dressait le fils contre le père.
Dès qu'un fils atteignait la
virilité, il combattait contre son
père pour essayer de le vaincre. S'il avait
le dessus, il prenait possession du bien de ses
parents qu'il chassait alors, les laissant
destitués de tout.
« Une autre coutume navrante
était le ao anga. Si une femme perdait son
mari, les parents du mari, au lieu de venir la
consoler, s'emparaient de tout ce que laissait le
défunt (tout ce qui avait quelque valeur),
puis ils chassaient la mère et les enfants,
s'emparant de la maison, des terres, des
provisions. Il y avait aussi le Kaï-Kainga,
l'appropriation injuste des terres. La terre est
d'un grand prix à Rarotonga, et aucun sujet
ne provoque plus de querelles et d'animosité
que celui-ci... Il nous a semble prudent de
recommander aux chefs de laisser les choses en
l'état pour l'instant.
« Une fois le code de lois
achevé - après de longues
délibérations avec mon
collègue Pitman et les chefs - il y eut une
assemblée générale de toute
l'île ; chaque article fut lu devant
tous et discuté par tous. Finalement le code
fut accepté et on décida la mise en
vigueur immédiate.
« Ces mois passés à
Rarotonga, furent donc des mois de labeur
ininterrompu, une saison difficile sous plus d'un
rapport ; et sentant notre manque de sagesse,
nous avons demandé celle-ci à Dieu,
sachant qu'il donne libéralement et sans
rien reprocher. On m'objectera peut-être
qu'un missionnaire n'a pas à s'occuper des
affaires civiles d'un peuple. Sur ce point, je ne
puis entrer dans une longue discussion... Je dirai
seulement que le missionnaire serait criminel si,
cherchant à élever le niveau moral
d'une communauté, il négligeait de
donner les avis ou le concours qu'on demande de
lui... Nous ne croyons pas que le missionnaire
doive assumer aucune autorité politique. Au
contraire, il doit se tenir à
l'écart, à moins qu'un mot de lui
fasse plus qu'une année de palabres pour
arranger une affaire, terminer une dispute,
etc...
« Sur ce point, j'aimerais ajouter
deux mots. On a accusé les missionnaires des
Mers du Sud de s'être arrogé des
droits royaux. À ceci je répondrai
qu'aucun missionnaire travaillant dans les Mers du
Sud n'a assumé semblable autorité, et
que l'influence exercée par eux est purement
morale. Enfin je puis dire que je ne connais pas de
missionnaires qui aient exercé cette
influence morale aussi peu dans leur
intérêt propre, et davantage pour le
bien public. »
(1) Ceci donne une très pénible impression de vide, et c'est aussi fort dangereux ; les remous de la vague peuvent remplir l'embarcation.
(2) Bois de fer. Ce bois est très lourd et a cette particularité qu'il tombe au fond de l'eau.
(3) Peu après une femme tuait son mari malade, aidée par un homme qui voulait l'épouser. Tous deux furent condamnés à mort. À la demande des missionnaires cette peine fut changée en celle du bannissement. « Mais je ne suis pas certain que nous ayons eu raison », ajoute Williams.
(4) Sortes de battoirs en bois de fer dont on se sert pour faire étoffe indigène.
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
