
CHAPITRE HUITIÈME
-------
RETOUR. - EN DANGER. - EXAUCEMENT. - UNE LETTRE DE TAMATOA. - VISITE DES DÉLÉGUÉS DE LA SOCIÉTÉ DES MISSIONS DE LONDRES. - NOUVELLE ÉPREUVE. - DÉPART ENVISAGÉ. - PRIÈRE ET GUÉRISON. - LA LÉGENDE DE RAROTONGA. - CROISIÈRE SUR « LA MATAMUA ». - LETTRE PASTORALE. AÏTUTAKI. - ROMATANE. - ATIU, MITIARO, MAUKE.
LA santé de Mrs. Williams - qui laissait fort à désirer à
l'arrivée en Australie semblait tout à fait rétablie. Son mari se
portait beaucoup mieux, et achevait aussi rapidement que possible les
préparatifs du retour à Raïatéa. La goélette qu'il avait achetée
partirait après avoir terminé son chargement. Dès le 23 avril 1922, la
famille Williams quittait Sydney sur un navire qui faisait escale en
Nouvelle-Zélande. Là, John Williams descend à terre à plusieurs
reprises. Il s'aperçoit qu'il peut se faire comprendre des indigènes
et tient plusieurs conversations avec eux. Certain jour, en débarquant
sur le rivage, il voit la tête coupée de Henakee, l'adversaire vaincu
de Shungee. « La tête est en parfait état de conservation...
Henakee reçut paraît-il quatre balles avant de tomber. Schungee (le
chef qui est allé en Angleterre) et un autre surnommé Roi George se
précipitèrent alors sur le blessé, lui coupèrent
la tête, et se mirent à boire avidement son sang. Et comme si ce
n'était pas suffisant, ces monstres découpèrent le corps, firent rôtir
la chair et la mangèrent. Les pirogues qui reviennent de la guerre
sont décorées de têtes à l'arrière et à l'avant. Il y a même des têtes
à vendre ; on les échange à des chrétiens (1)
pour des mousquets et des balles !... Ce pays est peuplé ;
les indigènes sont groupés en villages. Oh ! que n'envoie-t-on un
plus grand nombre de missionnaires ici ! ...
« Les Néo-Zélandais aimeraient nous voir rester. Notre
petit garçon a près d'eux un grand succès. Je ne veux pas négliger de
vous signaler que nous avons encore eu ici des marques de la bonté de
Dieu. Le capitaine Henry craignant de ne pouvoir se ravitailler
suffisamment dans la Baie des Îles, où des baleiniers venaient de
passer, s'arrêta devant le cap Nord. Aussitôt, le pont fut envahi par
les indigènes, et bien qu'ils fussent assez gênants, nous
n'appréhendions aucun danger jusqu'au moment que Mr. Henry et Mrs.
Williams désirèrent descendre dans le carré (2). Un
chef qui s'était assis près de l'escalier se dressa et leur barra le
passage. Ce que voyant, j'allai immédiatement vers eux ; mais un
Tahitien m'avait devancé et jetait le Néo-Zélandais hors du chemin.
Celui-ci se redressa blanc de rage et tira son couteau 'pour tuer le
Tahitien qui se sauvait jusqu'à la batterie. Là il s'empara d'un sabre
et fit front à l'ennemi. Tous deux gardaient leurs distances, mais le
Néo-Zélandais hurlait : « Tue-moi !
Tue-moi ! » On réussit à les séparer avant qu'il n'y eût
effusion de sang. Mais le pont restait, couvert d'indigènes :
« Ils avaient envoyé leurs pirogues à terre,
dirent-ils, pour rapporter des porcs et des pommes de terre. » Le
vent était tout à fait tombé. C'était le calme plat. Quand les
pirogues réapparurent, elles étaient uniquement chargées
d'hommes : vingt à trente par pirogue. Point de femmes ni
d'enfants ! Ce que voyant, le capitaine commanda d'amener tous
les mousquets sur le pont et de charger les deux canons. Puis il
ordonna à tous les Néo-Zélandais de quitter le navire (3).
Enfin quand les pirogues furent à portée de voix - à
quelque 90 mètres - il fit savoir que si on s'approchait davantage il
ouvrirait le feu. Aussitôt les pirogues s'arrêtèrent, et un conseil de
guerre fut tenu qui dura longtemps. D'après ce qu'ils firent ensuite,
nous comprîmes qu'ils complotaient de s'emparer du navire ; ils
restèrent à quelque distance. Certes, nous étions armés, et s'ils
s'étaient approchés, il semble que nous les aurions facilement
repoussés. Cependant nous étions dans une situation critique et nous
redoutions que la nuit survînt avant que le vent fût levé. Très
inquiet, et alors que nous craignions une attaque d'un moment à
l'autre, je descendis dans ma cabine et là j'exposai toutes choses à
« Celui qui secourt en temps de danger ». Lorsque je rentrai
dans le carré, le capitaine Henry y arrivait et à ma grande joie il
annonçait que la brise se levait. En moins d'une demi-heure, nos
craintes se transformaient en un cantique de délivrance. Oh ! si
seulement nous avions plus de sainte confiance en Dieu (4) !
... »
Après avoir touché à Rurutu où John Williams encourage
les évangélistes qu'il y a envoyés, les voyageurs arrivaient enfin à
Raïatéa le 6 juin 1822, huit mois après l'avoir quitté. On les reçut
avec toutes les démonstrations de la joie la plus vive. En leur
absence, un complot avait été ourdi contre Tamatoa et son
gouvernement, complot qui fut découvert avant d'avoir pu être exécuté.
Dix de ceux qu'on avait surpris les armes à la main furent jugés et
condamnés à mort ; peine qui fut rapportée sur l'intervention de
Mr. Threlkeld et changée en celle de l'emprisonnement à vie, avec
travail d'entretien des routes.
Lorsque la goélette achetée arriva à Raïatéa avec Mr. Scott,
les indigènes - et surtout le roi - se montrèrent extrêmement
reconnaissants. Tamatoa (5), à
l'insu des missionnaires, rédigea et adressa une lettre aux directeurs
de la Mission à Londres, lettre dont nous donnons la teneur
ci-après :
Raïatéa, 9 juillet 1822.
« CHERS AMIS,
« Que la paix et la santé vous soient, frères, par Jésus-Christ
notre véritable Seigneur.
« Mes frères, voici ma parole. N'imaginez pas de votre
argent qu'il est perdu. Nous réunissons maintenant des marchandises
pour acheter l'argent employé, et nous vous le renverrons. Ne supposez
pas que la dette ne sera pas payée. Elle le sera, soyez-en certains.
Ne dites pas : « Les fonds que nous recevons ne sont pas
destinés à acheter des bateaux. » Un bateau est utile : par
son moyen, nous recevrons ce qui nous est
nécessaire et nos corps seront décemment vêtus. Mais voici un autre
emploi du bateau : quand nous ferons savoir notre amour aux
terres qui nous environnent et que nous leur enverrons des
missionnaires pris parmi nous. Voici, deux d'entre nous sont déjà
partis à Rurutu et deux autres à Aïtutaki. Ils enseignent la Parole de
Dieu en ces deux pays qui ne connaissaient pas le nom de Jésus-Christ,
et ils montrent aux païens le chemin du salut. Ils nous ont envoyé les
dieux de néant de Rurutu, qui sont maintenant en notre
possession ; et ils adorent Jésus-Christ le vrai Dieu.
« Mon coeur est plein de reconnaissance de ce que vous
avez envoyé des missionnaires en notre pays de ténèbres et de ce que
maintenant nous connaissons le vrai Dieu. Nous donnons de nos produits
pour que la Parole de Dieu soit répandue. Et voici encore l'un des
bienfaits du bateau. Quand nous voudrons revoir ceux d'entre nous qui
sont partis évangéliser, ou si nous voulons leur, envoyer de nos
produits, nous en avons maintenant la possibilité. Les lettres
pourront aussi leur parvenir qui leur diront la bonne parole que nous
entendons ; et par le moyen de ce bateau, ils seront tenus au
courant des bonnes coutumes et comment il faut faire. Mon coeur se
réjouit de ce que vous nous avez prêté de l'argent, de sorte que ce
bateau a pu être acheté, ce dont nos corps bénéficieront.
« Puissiez-vous avoir santé et paix dans vos demeures en
Angleterre par Jésus-Christ.
Au mois d'octobre, MM. Tyerman et Bennet, délégués de la Société des
Missions de Londres, venus pour visiter les champs missionnaires en
Polynésie, admirèrent sans réserve l'oeuvre accomplie par les
missionnaires de Raïatéa. Une lettre qu'ils écrivirent aux directeurs
à Londres, après quelque temps de séjour durant lequel ils visitèrent
les écoles, assistèrent aux cultes, firent une tournée d'inspection
dans l'île, etc..., se termine ainsi :
« ... Les résultats obtenus par l'oeuvre missionnaire ici,
sont la preuve que la bénédiction de Dieu repose sur le travail de ses
serviteurs ; ils prouvent aussi que la prédication de l'Évangile
est le moyen le plus certain, le plus direct, le plus efficace, non
seulement pour la transformation morale, mais encore pour la
civilisation d'un peuple. Si vos efforts, Messieurs, n'avaient comme
résultats que ce que nous voyons dans cette île, nous estimerions
qu'ils ont été abondamment récompensés. »
Le 13 novembre 1822, John Williams avertit les directeurs de la
Société des Missions que la goélette « l'Entreprise » a
presque complété son chargement ; les indigènes préparent déjà
une seconde cargaison, nous croyons que le produit des marchandises
expédiées en ces deux voyages suffira pour achever de payer le navire.
« Tout prospère au delà de tout ce que nous espérions. Les
indigènes ont déjà débroussé, préparé, planté, de cent vingt à cent
cinquante vastes plantations, et je me perfectionne dans l'art de
sécher le tabac et de bouillir le sucre. Nos Raïatéens ont aussi
appris à bouillir l'eau de mer et ils ont préparé trois à quatre
tonnes de sel. Vous jouiriez de les voir tous si occupés. Même les
femmes cultivent de petits carrés de tabac
qu'elles échangent pour des cotonnades et objets d'habillement. Nous
désirons pouvoir importer ces articles sans qu'il en coûte rien à la
Mission. »
Vers la fin de l'année, l'épreuve vint à nouveau visiter le
foyer des Williams. « La maladie dont ils souffrent est telle -
écrivent les envoyés de la Mission de Londres - que nous craignons
qu'ils ne soient obligés de partir pour un pays plus froid. S'ils
doivent en arriver là, LA PERTE POUR LA MISSION SERA TRÈS GRANDE (6). »
Effectivement, Mr. et Mrs. Williams étaient fort éprouvés dans
leurs santés et le jeune missionnaire - alors que partout il voit des
fruits de ses travaux - songe à nouveau au départ. Non pas tellement à
cause de lui-même que pour sa chère femme. Pour la seconde fois elle
venait de donner naissance à un bébé mort-né ; quelques jours
après, une forte fièvre se déclarait et pendant cinq semaines elle fut
entre la vie et la mort.
Les missionnaires, les délégués de la Mission de Londres, tous
conseillent le départ pour un climat moins débilitant, en tout cas un
changement immédiat de poste missionnaire. En principe, le départ est
résolu. Mais John Williams désire voir l'achèvement des plantations en
cours, et de semaine en semaine il recule le moment des adieux.
« Nous avons tout ce qui peut combler de joie un coeur
missionnaire, écrit-il, excepté la santé. Si nous la possédions aussi,
notre coupe déborderait. Peut-être le Seigneur a-t-il ailleurs une
oeuvre encore plus grande à faire. Nous voulons dire : « Que
ta volonté soit faite. » Mais la seule pensée de laisser un
peuple qui nous est si attaché et auquel nous
sommes tellement attachés nous-mêmes est une dure épreuve. Je rentre
maintenant de notre « réunion pour questions ». Et là, un
brave homme me dit : « Tu demandes que nous priions pour que
Dieu aplanisse ton chemin et que tu discernes clairement sa volonté.
Moi je ne lui demande pas d'aplanir ton chemin, mais d'y dresser des
barrières de toutes parts. Ma prière n'est-elle pas bonne
aussi ? » Oh ! que n'ai-je santé et force, non pour les
consacrer aux choses vaines de ce monde, non pour amasser toutes les
richesses de l'Orient, mais pour les dépenser au service des païens
qui périssent et me dépenser aussi pour eux. » (7).
John Williams a maintenant le moyen de locomotion rêvé, il
pourrait atteindre ces archipels païens auxquels il pense constamment.
Quelle douleur de renoncer à l'oeuvre tant de fois caressée !
Mais si sa vie ne lui est point précieuse, l'état de sa femme l'oblige
à Songer à des adieux définitifs. Cependant l'Eglise continuait de
prier pour la famille missionnaire affligée, et à nouveau Dieu
entendit et exauça. L'état de Mrs. Williams s'améliora si rapidement
qu'il fut possible de songer à une sérieuse prolongation de séjour à
Raïatéa. L'année 1822 touchait à son terme. Que d'actions de grâce
montèrent vers Dieu ! Quel tribut de reconnaissance ;
reconnaissance, d'un peuple tout entier, que la seule pensée du départ
des Williams avait plongé dans le deuil.
La petite goélette achetée par J. Williams et rachetée par
Tamatoa avait été nommée par lui : « Te Matamua » (8).
En revenant de Sydney, où la cargaison
du bateau avait été vendue, « Té Matamua » toucha à
Aïtutaki, et en rapporta d'excellentes nouvelles. Papeiha envoyait à
son missionnaire un rapport des plus encourageants et ce message de
l'un des chefs : « Dis à Wiriamu que s'il vient nous visiter
nous brûlerons nos idoles, nous détruirons nos maraës et recevrons la
Parole de Dieu. »
Ce fut assez. Williams mûrit le projet longtemps caressé d'un
voyage aux Îles Hervey, pour y répandre l'Évangile dans tout
l'archipel. Il apprend qu'il y a à Aïtutaki des indigènes de
Rarotonga, l'île que Cook a vainement cherchée. Il essayera de la
découvrir.
Un Raïatéen (9) avait dit à
John Williams la légende de Rarotonga, et Williams se sentait
particulièrement attiré vers cette île.
« Autrefois, dit le vieillard, Rarotonga se trouvait tout
près de Raïatéa, mais les dieux l'emportèrent au loin. Les gens de
Rarotonga avaient fait un immense tambour nommé Tai-Moana, et ils
voulurent l'offrir à Oro, le dieu de la guerre à Raïatéa. Ils
l'envoyèrent donc avec des messagers : des prêtres, par pirogue à
Raïatéa. Ceux de Raïatéa furent remplis de joie et se mirent à danser.
Ensuite ils entrèrent en colère contre les gens de Rarotonga et ils
les tuèrent. Alors les dieux furieux, pour punir Raïatéa,
transportèrent l'île de Rarotonga et toits ceux qui l'habitaient bien
loin dans les mers.
- Et où donc ? demanda John Williams.
- Je ne sais pas bien, dit le vieillard en fronçant les
sourcils ; mais je crois que c'est par là » et il désignait
le sud-ouest.
Le missionnaire raconta la légende à ses collègues : MM.
Bourne et Threlkeld, et il fut décidé que MM. Bourne
et Williams iraient d'abord à Aïtutaki pour prendre contact avec les
évangélistes qu'on y avait laissés l'année précédente.
Tamatoa et les chefs mirent généreusement « Te
Matamua » à la disposition de leurs missionnaires. Aïtutaki, et
surtout Rarotonga se trouvent situées bien plus au sud que Raïatéa.
Plus rapprochées du pôle, ces îles jouissent d'un climat tempéré, et
les Raïatéens caressaient l'espoir que ce changement d'air suffirait
pour le complet rétablissement de Mr. et Mrs. Williams.
Le départ était fixé au 4 juillet. La veille, au cours d'un
solennel service d'adieux, six indigènes avaient été consacrés pour
l'oeuvre missionnaire dans les îles qu'on espérait visiter (10).
L'enthousiasme fut tel parmi les indigènes qu'ils comblèrent de
présents ceux qui allaient partir, leur donnant tout ce dont ils
avaient besoin, non seulement pour le voyage, mais pour leur
installation future
Quelle émotion le lendemain, quel concours de peuple au moment
du départ ! La plage est couverte d'indigènes venus pour dire un
dernier adieu aux partants : au premier rang les parents et les
amis des missionnaires choisis.
Le voyage dura cinq jours. John Williams en profita pour
rédiger une lettre pastorale destinée aux missionnaires raïatéens.
Cette lettre nous révèle sa pensée, et nous la traduisons aussi
fidèlement que possible, en y laissant les polynésianismes (11).
Toutefois nous avons fait quelques coupures.
En mer, à bord de la goélette « Te Matamua », 6
juillet 1823.
Chers frères,
Soyez sauvés par Jésus-Christ, et dans l'accomplissement de l'oeuvre
pour laquelle vous avez été choisis par l'Eglise de Raïatéa. Cette
oeuvre est nouvelle pour vous ; il est donc bon que je vous donne
quelques conseils pour le moment de l'arrivée au pays où Dieu vous
conduira. Au commencement, vous aurez peut-être des difficultés par
vingtaines ! Mais ne vous laissez pas abattre !
Souvenez-vous que ce que Jésus a dit à ses premiers disciples,
Il vous le dit aussi : « Voici ! Je suis toujours avec
vous jusqu'à la fin du monde. » Jamais Il ne vous oubliera ni ne
vous rejettera. Sa Parole aussi doit croître nécessairement. Ceci ne
peut être empêché, Vous, vous-même, vous connaissez la force de sa
Parole qui a renversé le royaume de Satan à Raïatéa et dans les îles
voisines. Il peut arriver que la croissance se fasse lentement dans le
pays où vous irez ; mais ne vous découragez pas. S'il plaît à
Dieu d'éprouver votre foi et votre patience, c'est son affaire. Il ne
peut se tromper en tout ce qu'Il fait. Si vous êtes éprouvés,
souvenez-vous des missionnaires dans vos îles. Que d'années ils ont
travaillé avant de voir croître la semence.
Souvenez-vous de la mort de Jésus, et songez que les indigènes
habitant les îles où vous allez sont rachetés par son sang.
Souvenez-vous aussi de ce que la puissance de Jésus a déjà fait à
Raïatéa, à Rurutu, et dans vos propres coeurs, et ne cédez pas au
découragement.
Travaillez bien, priez beaucoup ; la prière c'est
« la puissance avec Dieu ». Peut-être serez-vous les témoins
de toutes les coutumes corrompues et dégradantes que vous avez
rejetées. Vos coeurs seront remplis de reconnaissance envers Dieu de
ce qu'Il a ouvert vos yeux...
Voici quelques conseils pour votre conduite:
I. En ce qui vous concerne : Veillez sur vos coeurs. Que
votre foi ne devienne pas languissante. Soyez fervents dans la prière
secrète, et ayez entre vous telle conversation qui maintiendra la vie
dans vos coeurs. Même si les païens n'observent pas immédiatement le
dimanche, vous, employez-le à rechercher auprès de Dieu la force. Il
faut une grande force pour le travail excellent dans lequel vous vous
engagez. Vous n'aurez pas de missionnaire près de vous pour vous
vivifier et vous exhorter. Vous n'aurez pas de frères à vos côtés pour
veiller sur vous et vous encourager. Satan en prendra avantage et il
vous attaquera avec furie sachant que vous n'avez plus de tuteur pour
vous soutenir. Nous-mêmes nous avons senti combien cela nous manquait.
Que ferez-vous ? Ceci : les rivières étant taries, vous irez
à la fontaine des eaux vives : Jésus. Tenez-vous constamment tout
près de Lui, vous souvenant de ce qu'Il dit : hors de moi vous ne
pouvez rien faire. Nous prierons Dieu sans cesse que vos coeurs soient
gardés par le Saint-Esprit, que votre foi augmente, que vous soyez
persévérants, et que le succès couronne vos travaux.
Il. Pour ce qui est de l'extérieur : Vous êtes maintenant
comme la cité construite sur une montagne. Les yeux sont fixés sur
vous ; ceux de l'Eglise à Raïatéa, ceux de vos frères des îles,
ceux des missionnaires, ceux des directeurs de la Société de Londres,
et surtout les yeux du Seigneur Jésus. Le ciel et l'enfer vous
regardent et les païens parmi lesquels vous travaillerez. Ceux-ci vont
vous surveiller avec « des yeux de rats » pour découvrir
quelque recoin tortueux en votre conduite. Conduisiez-vous avec
circonspection. Prenez garde de montrer le moindre désir de leurs
biens. Prenez garde à l'orgueil du coeur ! Ne regardez pas les
païens avec dédain mais ayez de l'amour pour eux, vous souvenant de
Celui qui a fait de vous des hommes nouveaux.
Veillez aux petites difficultés. S'il s'en présente, ayez une
explication affectueuse et arrangez-la. Que les païens ne soient pas
les témoins de divisions entre vous.
III. Prenez garde à l'envie et aux mauvaises pensées :
Nous recommandons cela de façon toute particulière à vous et à vos
femmes. Voilà les choses les pires... Et Satan désire qu'elles
existent... car il y trouve un grand avantage. Ne dites jamais de mal
l'un de l'autre... Si sur quelque point vous n'êtes pas d'accord,
laissez la chose et priez Dieu qu'Il vous dirige ; puis
reparlez-en ensemble. Si vous êtes encore d'opinion différente, que
l'un de vous cède, et quand nous vous visiterons, nous arrangerons
l'affaire. Longtemps vous nous avez suivis, Mr. Threlkeld et moi,
Imitez-nous dans la mesure que nous avons suivi Jésus.
VOTRE TRAVAIL
I. Souvenez-vous que vous travaillez pour le Seigneur Jésus-Christ.
Ce n'est pas la force de l'homme qui vous fera
prospérer. Le Saint-Esprit doit agir. Sans Lui, le travail est vain...
II. Vous enseignerez les adultes et les enfants. Vous
prêcherez, baptiserez et donnerez la Sainte Cène. C'est pour cela que
vous avez été mis à part. Voici les principales doctrines que vous
enseignerez : la création de toutes choses par Dieu l'homme bon
avant la chute ; les effets de la chute le grand amour de Dieu
fournissant Lui-même le sacrifice pour nous ; la mort et la
résurrection du Seigneur Jésus-Christ, source unique de pardon et de
justification devant Dieu ; la méchanceté et la faiblesse du
coeur humain ; la nécessité du Saint-Esprit pour changer le coeur
et le rendre bon... Ces doctrines et plusieurs autres du catéchisme,
vous les enseignerez et vous les prêcherez ; mais n'enseignez que
ce que vous comprenez bien ; n'essayez pas d'expliquer ce qui est
difficile ; que tous vos discours ne soient pas dirigés contre
l'esprit mauvais (12), mais
exaltez le Seigneur Jésus-Christ et son Évangile ; dites bien et
complètement son grand amour envers nous et l'efficacité de son sang
pour purifier l'âme et la sauver. Voici le sujet de vos
discours : Jésus. Comme les apôtres et les prophètes, ne craignez
pas d'annoncer Jésus. Il est notre Ami, notre Chemin, notre Refuge,
notre Nourriture, notre Médiateur, notre Sauveur. Ne vous contentez
pas de prêcher le dimanche. À toutes les grandes réunions des païens,
à toutes leurs fêtes, allez au milieu d'eux et prêchez l'Évangile.
Quand les prophètes auront commencé leurs déclamations et les prêtres
leurs harangues, dites la bonne Parole. Proposez-leur quelque problème
en présence de tous et ils seront vite confondus.
Pensez constamment à l'oeuvre à faire. À cette oeuvre, donnez vos
mains, vos bouches, vos corps, vos âmes, et Dieu bénira vos travaux.

LA PLAGE, TAHITI
Ill. Concernant le Baptême : Si Dieu fait selon nos désirs, vous
aurez à baptiser. Mais n'agissez pas avec trop de hâte... Quand
quelques personnes auront rejeté leurs idoles, ayez une réunion
semblable à notre réunion du Vendredi et expliquez-leur l'origine,
l'objet du baptême ; et ce que doit être la conduite de celui qui
est baptisé.
IV. À propos de la Cène du Seigneur : Ne négligez pas de
communier et de commémorer ensemble la mort du Seigneur. Si le moment
vient que des croyants veulent se joindre à vous, acceptez-les.
N'admettez personne parce qu'il est chef ou occupe une haute
situation. Ne regardez pas seulement à l'extérieur. Que les personnes
que vous accepterez aient une bonne conduite sans rien de tortueux,
que leur repentance soit sincère et qu'elles croient vraiment au
Seigneur Jésus-Christ. Seulement ceux pour qui il en est ainsi peuvent
être admis dans l'Eglise.
Il est possible qu'on vous pose des questions sur des sujets
difficiles. L'un d'eux sera peut-être celui-ci - quand un homme se
convertit et qu'il a deux femmes, que doit-il faire ? - Qu'il en
renvoie une si la femme est d'accord ; sinon qu'il garde les
deux. Mais il vaut mieux qu'une des deux soit renvoyée. Employez-vous
à atteindre ce but, mais uniquement par la persuasion. Mais si l'une
des deux femmes meurt, ce serait pécher pour le converti que d'en
prendre à nouveau une seconde. La femme qui a deux maris (13)
doit en renvoyer un... Je vous écrirai plus en détail
sur ce sujet. Mais aussitôt que vous le pourrez, introduisez la
cérémonie du mariage.
Ne vous hâtez pas de proposer des lois. Vous pouvez dire aux
chefs ce qui s'est passé dans nos îles, laissez-les désirer une même
transformation et la proposer. Toute chose est bonne en sa saison. On
ne nourrit pas les enfants avec de la nourriture solide.
Veillez à ne pas donner un caractère sacré aux choses
d'importance secondaire ; les indigènes ne sont que trop portés à
cela. Travaillez à faire disparaître les mauvaises habitudes, telles
que se couper et taillader le corps en saison de tristesse, aller nu,
se tatouer, manger le poisson cru, etc... Mais occupez-vous d'abord
des plus grands maux ; vous songerez ensuite aux moindres.
Soyez diligents pour ce qui est des choses de cette vie. Un
missionnaire paresseux est tout à la fois un être vilain et inutile.
Faites-vous de bonnes maisons, qu'elles contiennent le
nécessaire ; et que cela aussi soit bien fait. Que votre maison
soit en exemple au peuple. Enseignez aux indigènes tout ce que vous
savez : à faire des maisons, une charpente, du plâtre, des lits,
des sièges, à fabriquer de l'huile et de la fécule d'arrow-root... Que
vos femmes enseignent aussi aux femmes indigènes à coudre, à tresser
des chapeaux, des nattes, à faire de l'étoffe, de telle sorte qu'elles
puissent se couvrir décemment.
Ne vous hâtez pas de commencer les réunions du soir. Si vous en
faites, qu'il n'y en ait pas plus d'une ; par semaine, de peur
que cela ne devienne une occasion de faire le mal. -
Parlez et enseignez dans le langage de Raïatéa (14)
pour
que les indigènes puissent se servir de nos livres. C'est tout ce que
j'avais à vous dire. Veillez chacun sur son propre coeur. Nous ne
cesserons pas de prier pour vous, afin que tout aille bien et que le
succès couronne votre travail. Écrivez-nous et dites-nous les petites
choses dont vous pouvez avoir besoin. Nous ne vous négligerons pas.
Nous ne pensons pas avoir plus de six ou huit missionnaires à la fois
afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous aurez des moyens de
communication par notre goélette, et s'il arrive que l'un de vous
veuille retourner à son foyer pour voie ses amis et nous donner, de
ses nouvelles, qu'il vienne, qu'il n'hésite pas ; nous serons
heureux de le voir. Le bateau repassera bientôt pour vous remettre des
livres. Aimez Jésus et l'Évangile d'un coeur sincère. Sondez sa
Parole, et priez-le de ne pas vous laisser, de ne pas vous abandonner.
Puissiez-vous avoir santé et paix par notre Seigneur
Jésus-Christ.
John Williams.
Le cinquième jour on arrivait à Aïtutaki. La goélette s'est à peine
immobilisée sur ses ancres que des pirogues sillonnent la mer,
entourent le bateau missionnaire ; les indigènes saluent les
arrivants. Mais John Williams refuse de laisser monter personne tant
qu'il n'a pas vu l'un des chefs ou l'un des missionnaires laissés dans
l'île, bien que les indigènes en saluant les voyageurs assurent que la
Parole de Dieu a pris racine à Aïtutaki.
Enfin Tapati, le chef (15), arriva,
et à sa grande joie John Williams entendit confirmer les bonnes
nouvelles : les maraës étaient détruits, les idoles brûlées, un
grand temple avait été construit pour Jéhovah et on attendait que le
missionnaire vînt pour y prêcher la Parole.
Puis Papeiha et Vahatapa arrivèrent à leur tour. Quelle joie
pour eux de revoir leur missionnaire, leur ami Après les effusions du
revoir, tous : le chef, les missionnaires raïatéens, MM. Bourne
et Williams descendirent à terre.
« Toutes les espérances que nous avons fondées sur le
ministère indigène sont dépassées, écrit John Williams dans son
journal. Nous avons ici une démonstration de sa capacité, de son
efficacité. J'ai félicité nos missionnaires pour l'excellent exemple
qu'ils avaient donné à Aïtutaki. Leurs habitations sont bien
construites, divisées en cinq chambres... Et maintenant les indigènes
se mettent à construire. Des maisons sont même terminées et déjà
meublées. Les lits y sont entourés de rideaux de percale blanche comme
le sont ceux de leurs missionnaires. Quels changements où que nous
portions nos regards ! Mon coeur se réjouit... Il y a dix-huit
mois seulement que nos deux missionnaires s'établissaient ici au
milieu des sauvages !... Mais il faut que Christ soit glorifié,
que les païens soient sauvés et l'empire de Satan renversé... J'espère
de grandes choses, je prie pour de grandes choses, et je les attends
en réponse à ce labeur... »
Après deux jours passés à Aïtulaki, après avoir prêché dans le
beau temple (16), tenu des
réunions, et installé d'autres évangélistes dans l'île, les voyageurs
reprirent le chemin du rivage pour s'embarquer. John Williams avait
dit qu'il pensait aller à Rarotonga, et plusieurs
indigènes de cette île, transportés malgré eux à Aïtutaki, demandèrent
à prendre passage, ce qu'on leur accorda. Comme John Williams
approchât du rivage, son attention fut attirée par des cris, des
lamentations, et il se trouva en présence de femmes qui s'étaient fait
des incisions à la tête, à la figure, à la poitrine, aux bras, aux
jambes. Le sang coulait et leur apparence était des plus répugnantes.
' « Pourquoi ces horribles cris, et pourquoi se blessent-elles si
cruellement, demandèrent les missionnaires ? - C'est à cause du
départ de leurs amis. » Nous leur expliquâmes que cette coutume
est incompatible avec la profession de christianisme. Mais elle est
tellement répandue qu'il n'y a probablement pas une femme, dans l'île
dont les membres et le torse ne soient couverts de cicatrices. Le
vieux chef qui nous accompagnait se comporta dignement. Il dit un
cordial adieu à tous ses amis en frictionnant vigoureusement son nez
avec le leur, et sans avoir l'air d'entendre les cris hideux qu'on
poussait de tous côtés. Les indigènes nous comblèrent, nous apportant
des présents de tout ce que produisait leur île.
Papeiha s'était bravement offert comme pionnier pour planter
l'Évangile à Rarotonga. Le petit navire leva l'ancre, hissa ses
voiles, gagna rapidement la passe et l'Océan, et prit la direction du
Sud à la recherche de l'île dont Williams avait tellement entendu
parler, par le vieillard raïatéen et par Auura.
Plusieurs jours on navigua vers le Sud et Williams profita de
cette traversée pour entendre tout au long le récit des expériences du
fidèle évangéliste qui, laissant un champ d'activité donnant déjà des
fruits, s'était proposé pour annoncer l'Évangile en un pays dont les
indigènes étaient réputés pour leur grande férocité et leurs cruautés.
« Quand nous fûmes seuls à Aïtutaki, dit Papeiha, ils nous
prirent et nous conduisirent au maraë, et nous consacrèrent aux dieux
dont nous voulions détruire le culte. Ils ne nous firent pas de mal,
nous vivions au milieu d'eux, et leur parlions de Jéhovah ; mais
la guerre éclata entre deux tribus, et le parti adverse vint et prit
tout ce que nous avions : habits et provisions. Trois fois la
guerre recommença ; mais nous savions que nous étions entre les
mains de Dieu et qu'Il pouvait se servir même de la guerre pour mettre
fin à l'idolâtrie. La dernière guerre terminée, nous fîmes le tour de
l'île en annonçant Jésus. Un jour qu'une grande foule nous écoutait,
un prêtre très très vieux survint pour s'opposer à nous :
« C'est Te-erui qui créa le monde, criait-il ; c'est lui qui
fit Aïtutaki.
- Non ! Dieu seul a le pouvoir de créer, lui
répondîmes-nous... Mais le vieillard continuait de crier :
« Te-erui est grand ! Il est le, premier homme. » Alors
je lui dis : « Et qui est son père ? - C'est Tetareva
qui vint d'Avaïki, qui est au-dessous. Tetareva monta de la place
en-dessous jusqu'à ce qu'il fut arrivé au sommet.
- Alors, lui demandai-je, cette terre existait avant que
Tetareva vînt ?
- Très certainement.
- Alors Te-erui ne l'a pas créée puisqu'elle existait déjà
quand son père est venu d'en-dessous ? »
« Le pauvre vieillard, perplexe, ne savait que répondre et
il se ridait le front pour trouver quelque chose. Alors, moi et
Vahapata nous commençâmes à annoncer le Dieu qui est de tout
temps : l'Éternel. Les indigènes écoutaient dans le plus grand
silence ; si le moindre bruit s'élevait, quelque voix criait :
« Mamu » (17), « Mamu »,
« Silence ! Écoutez ! » Et, quand je leur parlai
de l'amour de Dieu envoyant son fils dans le monde pour sauver les
hommes, ils s'écrièrent : « C'est ici la vérité ; notre
religion n'est que mensonge. »
« Alors, quelques indigènes dirent qu'ils voulaient servir
le même Dieu que nous ; mais d'autres se levèrent et firent les
plus grandes menaces, parlant même de tuer ceux qui abandonneraient le
paganisme : « Qui sont ces gens, criaient les païens en nous
désignant, Vahapata et moi ? Deux épaves, deux morceaux de bois
jetés par la mer sur nos rivages. Ils disent que leurs amis viendront
les voir sur une grande pirogue avec des ailes blanches, mais ce n'est
pas vrai. »
« Peu après, le peuple courait vers le rivage. Le vaisseau
que vous nous aviez annoncé arrivait à Aïtutaki. Le capitaine
descendit à terre et offrit aux chefs des présents : des haches,
des porcs, des chèvres.
« Alors, le peuple dit : « Voilà ceux que vous
nommez des épaves ! Ils ont cependant des amis qui leur envoient
un grand bateau de Parétané (18), et
ils envoient des choses extraordinaires que nous n'avons jamais
vues. »
« Alors le peuple demanda que nous leur disions encore les
paroles du vrai Dieu, et dirent qu'ils voulaient rejeter les idoles.
Toutefois, un vieillard, le grand-père du chef d'Aïtutaki, refusait
absolument d'abandonner le culte des idoles. Un jour qu'il faisait une
grande fête en l'honneur de ses dieux, sa fille qu'il
chérissait tomba malade. Tous ses prêtres vinrent alors pour supplier
les dieux de lui rendre la santé, priant trois fois le jour : le
matin, à midi, le soir et tous les jours ainsi, mais la jeune fille
mourut.
« Alors, le vieillard courroucé dit à son fils le
lendemain matin : « Va, brûle-les ! » Son fils
partit et il mit le feu au maraë et aux idoles du maraë de son père.
Le dimanche suivant, les indigènes vinrent nombreux, chargés de faux
dieux qu'ils jetèrent à nos pieds... »

PAPÉJHA
Nous ne pouvons donner en cette biographie tous les détails des
transformations qui suivirent l'introduction du christianisme à
Aïtutaki. Le peuple s'est tourné vers Dieu. Il faut l'instruire,
l'occuper. La construction d'un temple a été décidée. Les évangélistes
aidés par les indigènes ont préparé du bois et entassé dessus du
corail pour faire la chaux. « Quand le peuple vit les flammes
monter au ciel, il se mit à danser de joie en chantant et
criant :
« Oh ! Ces gens qui viennent d'un pays lointain, ils
cuisent les pierres ! Venez cyclones, détruisez nos bananiers et
nos arbres à pain, nous ne souffrirons plus de la faim ; les
hommes du pays éloigné nous montrent à cuire les pierres ! »
Le matin, lorsqu'ils virent une jolie poudre blanche, leur étonnement
fut extrême ! Ils blanchirent leurs chapeaux et leurs habits et
se mirent à se promener et à s'admirer mutuellement. Vahapata et moi
nous avions déjà préparé une partie du mur avec des branches
entrelacées. Alors, nous avons pris du sable humide que nous avons
mêlé avec « les pierres rôties », puis nous ayons recouvert
les branches de notre préparation et ensuite nous avons mis des nattes
pour empêcher les indigènes de toucher avant que le ciment fût sec. Le
lendemain, les chefs et toute l'île vinrent de bonne heure pour nous
voir enlever les nattes. Quel étonnement lorsqu'ils virent le mur
blanc ! Ils vinrent de près l'examiner, ils y frottèrent leurs
nez, ils le sentirent, quelques-uns l'égratignèrent ; d'autres
prirent des pierres et les jetèrent dessus pour en essayer la
solidité... « Merveilleux ! Merveilleux !
répétaient-ils ! Les pierres mêmes de la mer et le sable du
rivage deviennent utiles entre les mains de ceux qui adorent le vrai
Dieu... »
Tandis qu'il écoutait son fidèle Papeiha, les yeux de John
Williams sondaient l'horizon, essayant de découvrir l'île que Cook
avait inutilement cherchée. Après huit jours de traversée, il dut
renoncer à trouver Rarotonga, et on se dirigea vers Mangaia, où le
capitaine Cook avait passé quarante-cinq ans auparavant. Après Cook,
un baleinier s'était approché de l'île. Alors que les Mangaians
trafiquaient avec les gens du bateau, Tairoa frappa un blanc de sa
lance et le tua. Puis, sautant dans sa pirogue, il
s'éloigna promptement. Lorsqu'il fut à une distance qui lui semblait
raisonnable, Tairoa s'arrêta pour essayer de voir ce qu'on faisait à
bord du navire. Un long bambou était pointé vers lui, semblait-il,
puis un éclair, un coup de tonnerre, et Tairoa tombait mort au fond de
sa pirogue.
Aussi quand les indigènes virent apparaître un grand bateau
dans le genre de celui de « Tuté » (19), c'est-à-dire
un bateau sans balancier qui avançait sans rames et tout seul, ils se
souvinrent du « bambou qui donnait la mort » et ils
attendirent avec des sentiments de frayeur et un désir de vengeance,
tout en hissant un drapeau blanc. À bord du « Matamua » on
fait de même. Mais les indigènes méfiants refusent de venir, malgré
toutes les invitations et toutes les offres de John Williams. Alors,
avec l'assentiment de son missionnaire, Papeiha descendit et se fit
conduire dans l'embarcation du bord jusqu'aux récifs (20).
Une fois là, il plongea dans la mer où il attendit
que se formât une forte vague venant du large : lorsqu'il la vit
courir, il se jeta sur son passage, avec elle traversa les récifs et
atteignit le rivage. Ce trait de courage frappa les indigènes qui
restèrent muets. Papeiha dit alors que le bateau missionnaire était un
messager de paix, et qu'il amenait des missionnaires pour annoncer les
paroles du vrai Dieu. On l'écouta avec plaisir et on lui dit que les
missionnaires pouvaient venir, ils seraient bien
accueillis. « Retourne à la grande pirogue et
ramène-les ! »
Papeiha gagna le récif à la nage, puis monta dans l'embarcation
qui le ramena au navire.
Après quelques hésitations, et Papeiha assurant qu'il n'y avait
point de danger, les deux évangélistes et leurs femmes firent leurs
préparatifs et leurs derniers adieux, et ils descendirent dans le
canot avec Papeiha. Comme ils atteignaient le récif, ils virent que
les indigènes étaient armés de frondes et de lances. Papeiha cria
qu'on mît de côté les armes, ou bien les missionnaires n'iraient point
jusqu'à terre. Les indigènes obéirent : le bateau fut alors lancé
dans la mer intérieure et les apôtres polynésiens atterrirent.
À peine avaient-ils mis le pied sur le rivage qu'ils étaient
entourés, saisis, pillés. Une scie fut brisée en trois morceaux que
les chefs suspendirent à leurs oreilles comme ornements, une caisse de
chapeaux destinés à faire des présents tomba à l'eau ; les
paquets contenant les pièces des lits furent brisés : celui-là
s'emparait d'un morceau, un autre prenait une colonne, etc... Les
bambous contenant de l'huile furent ouverts et les Mangaians se firent
d'abondantes onctions. Les deux porcs qu'on voulait offrir en présent
furent saisis sur l'ordre du chef. Jamais, on n'avait rien vu de
semblable ! Ce sont des dieux, dit le chef, qui place sur eux les
insignes de sa dignité et fait conduire les porcs au maraë. Un cri
perçant éclate dans tout ce bruit, celui de la femme d'un
évangéliste ; il est suivi d'un autre cri. Les évangélistes
veulent aller au secours de leurs femmes, on leur fait un
croc-en-jambe, ils sont jetés à terre et on les y maintient tandis que
les femmes sont emmenées. Papeiha veut bondir sur
les ravisseurs. On lui jette sur la tête un tiputa, sorte de cape avec
un trou et on va l'étrangler. Mais, prompt comme l'éclair, il passe
ses deux mains dans l'orifice pour protéger sa gorge. Aurait-il réussi
à échapper à ses bourreaux ? C'est peu probable.
Tout à coup, une formidable détonation retentit. Du navire, on
suit ce qui se passe à terre et on vient de tirer « un coup de
canon. Les sauvages sautent en l'air de frayeur, comme s'ils avaient
été tous touchés, puis ils s'enfuient vers la forêt. Seul, le chef est
resté. Et Papeiha indigné va vers lui : « Comment oses-tu
nous inviter à descendre, lui demande-t-il, et tu permets qu'on nous
mette en pièces ! Est-ce là la conduite d'un chef ? »
Le chef baissa la tête et se mit à pleurer, puis il dit :
« Ici, toutes les têtes ont la même hauteur » (voulant dire
par là que son autorité était inexistante).
Lorsque la goélette eut recueilli ceux qui s'étaient donnés
avec tant de joie pour l'évangélisation de Mangaia, John Williams fit
diriger le navire vers Atiu, où quelques semaines auparavant on avait
laissé deux missionnaires envoyés par Bora bora. Il tardait à John
Williams de savoir comment ils étaient traités. L'île apparut
enfin : une terre basse, dominée au centre par un plateau assez
élevé et couverte de verdure jusqu'à la mer, où les aïto géants (bois
de fer, sorte de conifères) laissent retomber les fines aiguilles des
branches basses. Pas de port. La goélette doit croiser au large. La
côte de formation corallienne est percée de profondes cavernes où la
mer s'engouffre avec fracas. Bientôt, on vit des pirogues se détacher
du rivage et venir vers la goélette. Dans l'une d'elles on
peut discerner deux hommes amaigris, à peine vêtus, l'air misérables.
Les évangélistes envoyés par Mr. Orsmond sont méconnaissables. On leur
a tout pris, on a refusé de les nourrir et on a refusé de les
entendre.
Voici maintenant l'embarcation royale : embarcation formée
par deux pirogues réunies par une haute plate-forme, où est assis le
roi. La pirogue royale est habilement manoeuvrée par un double
équipage et avance avec une grande rapidité. Le roi est grand, élancé,
il a un maro (21) autour des
reins, sur le torse une chemise, - ces vêtements ont très probablement
été volés aux missionnaires, - ses longs cheveux d'un noir d'ébène
flottent au vent, et son corps se balance en cadence avec le mouvement
qu'impriment les pagayeurs à l'embarcation.
À peine est-il à bord que le chef d'Aïtutaki le prend par la
main et le conduit à l'écart pour l'avertir des grands événements
survenus a Aïtutaki... « Nous avons cessé d'offrir des hommes et
des jeunes filles en sacrifices sur les maraës, dit-il. Ces sacrifices
sont inutiles, puisque Dieu ne les accepte pas pour pardonner et
puisque Jésus est mort à notre place... »
La figure du chef Atiu exprime un grand étonnement à l'ouïe de
ces paroles. Le chef d'Aïtutaki parle encore et se fait
pressant : « Fais comme moi, dit-il, accepte le vrai Dieu,
brûle tes idoles. Viens voir celles que nous n'avons pas encore
brûlées », et il le conduisit vers l'endroit où étaient entassés
les dieux d'Aïtutaki comme le seraient des charges de bois ordinaire.
C'était un samedi. Et l'on persuada à Romatane de passer la nuit à
bord. Le dimanche matin, il se joignit aux autres
pour le service divin. John Williams avait pris son texte au livre des
Psaumes et dans celui du prophète Esaïe, et il commenta les passages
concernant les idoles (22). La
pensée de Romatane fut vivement impressionnée par les descriptions des
écrivains sacrés, très particulièrement par les mots : « Il
en fait aussi du feu pour cuire du pain, il cri fait aussi un dieu et
se prosterne devant lui, il en fait une idole et il l'adore. Il en
brûle au feu une moitié et avec cette moitié il prépare sa viande, il
la fait rôtir, il se rassasie... Puis du reste de ce bois il fait un
dieu, son idole ; il l'adore et se prosterne, il le prie et
dit : délivre-moi car tu es mon dieu... »
Aucunes paroles ne sauraient faire plus d'impression sur la
pensée d'un chef polynésien que ces versets inimitables de la Parole
inspirée... Les indigènes ont deux mots qui ne sont pas très
différents, mais qui s'appliquent à des choses opposées : ce sont
mo'a et no'a. Mo'a désigne ce qui est sacré. No'a, le contraire. Tout
ce qui se rapporte aux dieux, ce qui touche aux dieux, est le
superlatif de mo'a, et tout ce qui touche à la nourriture, à la
cuisson de la nourriture est no'a. Et, avec une force irrésistible,
Romatane sentit la grande folie qu'il y avait à faire avec la même
pièce de bois deux choses si opposées : un dieu et la cuisson
d'aliments et d'unir ainsi deux choses extrêmes, le mo'a et le no'a
qui ne peuvent s'unir : le sacré et le vil. D'abord, il sembla
plongé profondément dans ses pensées et resta silencieux puis il
reprit la conversation avec le chef d'Aïtutaki, conversation qui se
prolongea fort avant dans la nuit. Au matin, Romatane s'était donné au
vrai Dieu. Et il retournait à terre avec la
résolution de détruire ses maraës, ses idoles, et d'élever un temple à
Jéhovah.
Apprenant qu'il y avait encore deux autres îles dans les
environs, îles dont Romatane était aussi le chef, nous lui demandâmes
de bien vouloir nous y accompagner et de s'employer à ménager un
accueil favorable aux évangélistes si durement traités à Mangaia. Il
accepta aussitôt notre invitation. Nous désirions aussi le garder le
plus longtemps possible auprès de nous pour continuer l'oeuvre
commencée en son coeur. Le voyage à Mitiaro et à Mauke nous en
fournissait l'occasion.
La première preuve de la sincérité de sa conversion fut l'ordre
qu'il donna à son peuple avant de le quitter : « Je pars
pour un temps, je reviendrai : que personne ne se déchire la
figure avec des dents de requins et ne se lacère la poitrine avec des
pierres. » Le peuple obéit, tout en se demandant pourquoi le roi
interdisait les anciennes coutumes.
Mitiaro est une petite île, le point le plus élevé au-dessus de
l'Océan, à vingt mètres à peine. Les pirogues se détachèrent du rivage
pour accoster « à la grande pirogue avec des ailes
blanches » [notre goélette]. Les indigènes qui se présentèrent à
bord furent tout étonnés et effrayés d'y voir leur grand chef :
Romatane. « Dites au chef de Mitiaro de venir me voir »,
commanda-t-il ! Aussitôt, ou s'empressa de porter le message du
roi. En grande hâte, le chef de Mitiaro donna des ordres pour qu'on
construisît rapidement une maison pour Romatane, et, tout tremblant,
il se présenta à bord, devant le cruel despote qui, - quatre ans
auparavant, - avait commis toutes les atrocités en ce pays. Des hommes
et des femmes, pieds et poings liés, avaient été
jetés vivants et hurlants d'horreur dans l'immense four des
cannibales ; on avait brisé la tête des petits enfants sur les
rochers, sous les yeux de leurs mères. D'autres, par deux et trois,
furent embrochés ensemble par la tête transpercée au niveau des
oreilles. Enfin pour lancer à la mer les grandes pirogues de guerre
par-dessus le banc de corail, au lieu des troncs de bananiers, on
avait employé comme rouleaux des corps vivants d'hommes et de femmes.
Le voilà bien le bonheur des peuples sans Dieu !
On comprend l'effroi du chef de Mitiaro lorsqu'il vint se
présenter à Romatane. Mais lorsque celui-ci dit : « Tu vas
détruire et brûler les maraës, et tu abandonneras le culte des faux
dieux ; je veux te laisser un homme qui t'enseignera le culte du
vrai Dieu... » Le chef se demanda si Romatane était dans son bon
sens ; ou bien si le monstre préparait quelques nouvelles
tueries ?
« Eh quoi ! s'écrièrent le chef et ses
suivants :
- Détruire les maraës ? Les dieux seront furieux et ils
nous étrangleront.
- Non ! répondit Romatane. Une pièce de bois que nous
avons couverte d'ornements et nommée dieu, est incapable de tuer.
- Faut-il aussi se défaire de Taria-Nui ? [« Grandes
oreilles. » Le roi lui-même était le prêtre de Taria-Nui].
- Oui ! répondit Romatane sans une seconde
d'hésitation ; cessez de l'adorer ainsi que tous les autres
mauvais esprits. Je vais vous laisser quelqu'un qui vous enseignera.
Traitez-le bien ! Donnez-lui une maison, de la nourriture, et
écoutez ce qu'il vous dira. Je ne me servirai pas de la maison que
vous faites pour moi. Faites-en une maison où vous
prierez Jéhovah, le grand Dieu. Tana (23) vous
dira comment faire.
- Tu as ordonné que nous préparions une grande fête avec
danses. Reviens-tu pour cette fête ?
- Je reviendrai, mais pas pour cela. Pour savoir si vous
traitez bien Tana. »
Et le chef étonné retourna vers Mitiaro, pour exécuter les
ordres qu'il venait de recevoir.
La goélette leva l'ancre et, sur les indications de Romatane,
on mit le cap sur Mauke, petite île où aucun navire n'avait encore
touché. Dès qu'on fut en face de l'île, des pirogues remplies
d'indigènes se détachèrent de Mauke, s'avançant vers le petit navire.
À leur grand étonnement, ils virent leur roi appuyé au bastingage qui
surveillait leur arrivée. Une fois. à bord, ils furent encore plus
étonnés de voir des blancs. MM. Williams et Bourne étaient les
premiers hommes blancs qu'ils eussent jamais vus. Ils prirent leurs
mains, les sentirent, relevèrent le poignet de la chemise pour
découvrir le bras, et s'émerveillèrent de sa blancheur. « Ce sont
de grands chefs » se dirent-ils l'un à l'autre.
John Williams leur apporta quelques hameçons, mais ils les
regardèrent avec un grand mépris, ignorant encore la force du métal.
Et montrant au missionnaire des hameçons taillés dans des noix de
coco, et dans des nacres perlières, ils lui dirent :
« Vois ! Si les poissons brisent parfois nos hameçons, de
quoi les tiens pourraient-ils servir ? » On amena des
chèvres pour les faire descendre dans l'embarcation, qui devait aussi
mener à terre l'évangéliste, sa femme et le roi.
Jamais les indigènes n'avaient encore vu de chèvres. Et ils
s'écrièrent en appelant leurs compagnons : « Venez !
Venez voir ces oiseaux avec de grandes dents sur la tête [les cornes
de l'animal]. »
Enfin le canot partit vers l'île. Le roi la quitta un peu avant
les brisants et se jeta à la mer sur la crête de la septième grande
vague qui vint déferler sur la rive. Dès que ses pieds touchèrent le
sol, il dit aux indigènes et au chef qui s'empressaient autour de
lui :
« Je suis venu vous dire de recevoir la Parole de Jéhovah,
le vrai Dieu, et vous recommander un missionnaire et sa femme :
ils vous instruiront. Détruisez les maraës, brûlez les mauvais
esprits... Vous construirez une maison pour le service du vrai
Dieu. »
Le peuple restait muet. Quoi ! détruire ces dieux devant
lesquels même le roi avait toujours tremblé ! Enfin, surmontant
leur étonnement et leur émotion, ils répondirent qu'ils feraient selon
que le roi voulait. Puis ils ajoutèrent : « Viendras-tu au
Takarua (24) ? »
- Toutes ces coutumes sont abolies, répondit Romatane. Quand je
viendrai, ce sera pour me rendre compte de la manière dont vous
acceptez la Bonne Parole. » Puis il dit adieu aux évangélistes et
à ses sujets étonnés et sauta dans l'embarcation ; nos hommes
ramèrent aussitôt vers la goélette qui mit le cap sur Atiu.
Durant le voyage de retour, la pensée de John Williams allait
constamment vers Rarotonga, l'île restée invisible. Il en parla à
Romatane. La connaissait-il ?
« Oui, dit-il, c'est à une distance d'un jour et une nuit
d'Atiu. »
Cette réponse nous fit le plus grand plaisir, mais quand nous
lui demandâmes la situation de l'île, il nous indiqua deux directions
différentes, ce qui nous jeta dans l'indécision. Toutefois, peu après,
nous étions au clair sur les indications du chef. Les indigènes
n'entreprennent pas leurs voyages de n'importe quel point de l'île.
Celui-ci est unique. D'après leurs destinations, ils partent de
certains endroits. Là, ils ont des points de repère qui leur servent à
prendre la bonne direction, et ils s'embarquent de façon à pouvoir se
guider par les étoiles quand ils perdent de vue les points de repère
terrestres. Nous décidâmes d'adopter le plan indigène et dirigeâmes
notre goélette jusqu'au point de départ. Là, nous fîmes tourner
lentement le navire tandis que le roi regardait les poteaux servant de
signaux. Lorsque ceux-ci furent exactement l'un devant l'autre, il
cria : « Voilà ! Voilà ! » Je regardai
aussitôt la boussole et vis que la direction donnée était
Sud-Ouest-Ouest (25).
La goélette retourna alors vers le village. Les missionnaires
remirent au roi plusieurs haches qu'il avait demandées « pour
abattre des arbres et faire les colonnes du temple de Jéhovah ».
On lui donna encore plusieurs présents de choses
utiles. La grande pirogue royale, avec sa plate-forme, revint alors se
ranger auprès de notre petit navire et Romatane nous fit d'affectueux
adieux. Ensuite, prenant place sur son siège élevé, il se mit à battre
la cadence pour les
pagayeurs qui le ramenèrent dans l'île où il se hâta de mettre à exécution ce qu'il avait résolu.

LA PLAGE. PAPÉITÉ
La fougue, la décision que ce roi avait mises au service des faux
dieux et des cruelles exigences du paganisme, il les mettait
maintenant au service du vrai Dieu. En comparant sa conduite avec
celle du chef de Mangaïa, homme sans énergie pour le bien comme
pour le mal, les paroles sacrées se présentent à la mémoire :
« Tu n'es ni froid ni bouillant !... Ainsi parce que tu es
tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche. »
Le roi cruel, le cannibale féroce pour qui la vie humaine ne
compte pas, le païen tremblant devant ses idoles est devenu en
quelques heures le fougueux apôtre du Dieu d'amour. Assurément, il ne
sait que peu de chose encore sur le Dieu vivant, mais ce qu'il sait il
l'applique sans délai. En une semaine, dans les îles sur lesquelles il
règne, il ordonne l'abolition du paganisme, de ce paganisme qui à
travers les siècles, avait maintenu les indigènes dans la misère et
toutes les terreurs d'atrocités sans nom.
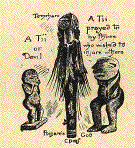
L'IDOLE PRINCIPALE DU ROI POMARÉ
À gauche : un démon
A droite : l'idole à laquelle on sacrifiait quand on voulait nuire au prochain
(1) C'est John Williams qui souligne.
(2) Chambre au bas de l'escalier. Tout autour sont rangées les cabines.
(3) Tous les indigènes nagent comme des poissons.
(4) Abrégé d'une lettre de John Williams écrite de Nouvelle-Zélande à sa famille.
(5) Tamatoa avait appris que la Société désapprouvait cette acquisition.
(6) Ces mots ne sont pas soulignés dans le texte anglais.
(7) To spend and to be spent among the perishing heathen.
(8) Le Commencement.
(9) Un ancien prêtre païen, converti au christianisme.
(10) Quatre faisaient partie de l'Eglise raïatéenne, deux étaient de Tahaa.
(11) Polynésianismes que retrouve aisément quiconque connaît le tahitien. Nous avons abrégé le texte pour la biographie française.
(12) Les indigènes désignent ainsi l'idole et l'idolâtrie.
(13) La polyandrie comme la polygamie existaient en Polynésie.
(14) La langue parlée aux îles Cook est légèrement modifiée par l'adjonction des k.
(15) L'un des premiers indigènes d'Aïtutaki qui embrassa l'Évangile.
(16) Pour ce service d'inauguration Williams prit pour texte Jean III : 16.
(17) Prononcer : Mamou.
(18) Le mot Bretagne tahitianisé (La Grande Bretagne).
(19) Prononcer Touté : Nom tahitianisé de Cook.
(20) Il n'y a pas de passage pour les bateaux dans le récif qui encercle Mangaia. Pour que les pirogues rentrent de l'Océan dans la mer intérieure, on les lance sur la crête d'une forte vague venant du large.
(21) Ceinture.
(22) Esaïe XLIV. Psaume CXXXV.
(23) Le nom de l'évangéliste.
(24) Grande fête où le festin était suivi de cérémonies abominables et de la plus odieuse obscénité.
(25) Si je mentionne ce fait, dit John Williams dans son livre « A NARRATIVE OF MISSIONARY ENTERPRISES », c'est parce que je crois que son importance est générale et peut servir aux membres des expéditions scientifiques, lesquels font appel aux indigènes pour certains renseignements. Il faut laisser les indigènes donner leurs indications à leur manière. En lisant l'autre jour le discours de R. King, le chirurgien de l'expédition au Pôle Nord, j'ai été frappé par la justesse de ses remarques : « L'expédition n'a pas su profiter des renseignements donnés par les indigènes : on les a accablé de questions, on a laissé voir des doutes au lieu de les laisser libres de dessiner une carte à leur manière avec du charbon sur une planche. »
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
