
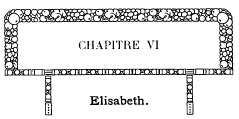
(Suite)
Je montai sur une éminence. Quoique
voilée, la lune, pleine alors,
éclairait la lande. Je me représentai
le jour où pour la dernière fois je
serais sur cette colline... il arriverait ce jour,
hélas ! bientôt ! Je m'en
irais dans l'obscurité, sans but, sans
espérance, toujours plus loin, jusqu'au
moment où, harassé, pauvre bête
blessée, je me réfugierais dans un
hôpital pour y mourir. Je vis briller les
lumières de la petite cité, je
distinguai celles du Cheval-Blanc. Il me sembla y
voir la vieille servante ranimer le feu, arranger
les tables, allumer les lampes, tout
préparer pour recevoir les
hôtes ; les figures connues arriver, les
places se remplir... J'avais droit à la
mienne encore ; je pouvais quitter la colline,
abréger ma promenade solitaire, passer
devant la cure, m'arrêter un instant pour
saluer Elisabeth en pensée ; je pouvais
traverser librement le long corridor du
Cheval-Blanc et entrer dans notre salle de
réunion.
Dans la rue les enfants me saluaient
encore avec de bons sourires et surtout je pouvais,
le dimanche, entrer à la cure par le jardin.
La porte de la maison s'ouvrait comme à un
ami ; le pasteur me souhaitait cordialement la
bienvenue ; Elisabeth me tendait la main avec
son doux sourire, rayon de soleil de ma
vie.
Plus que six mois et tout sera fini pour
moi. Au printemps, un autre jeune homme remplira
mon emploi, occupera ma place au casino. Dans la
rue les enfants lui souriront. À son tour il
prendra le chemin du presbytère et je serai
oublié. Quelquefois encore mon nom sera
prononcé parmi les souvenirs des excursions
du dimanche, puis, petit à petit, on ne
pensera plus à moi. Taudis que j'errai seul
à l'étranger, sans foyer, ma
pensée reviendra dans cette chère
petite ville ; elle ira frapper aux portes
aimées, mais personne ne lui
ouvrira.
Plus que six mois !
Alors je me posai cette audacieuse
question : Pourquoi ne pas me créer un
foyer stable dans cette ville où, pauvre
voyageur fatigué, J'en ai trouvé un
passager ? En entrant dans ma demeure sombre
et déserte, je me
demandai : serait-il possible qu'un jour
Elisabeth m'en ouvrit la porte, que je la prisse
par la main pour l'accompagner dans
« notre chambre ? »
Oh ! passer la soirée sous son doux
regard, entendre toujours sa voix
mélodieuse ! M'est-il permis de
rêver un tel avenir !
Ce soir-là, pour la
première fois, je n'allai pas au casino. Il
me fallait être seul avec mes
pensées.
Assis dans l'obscurité, je
regardai longtemps la lumière du
réverbère vaciller sur la paroi de ma
chambre ; j'entends le vent de la lande
souffler dans la rue déserte et la pluie
fouetter mes fenêtres ; puis, de grandes
et douces espérances vinrent, peu à
peu, remplir mon coeur ; ma jeunesse
réveillée fit valoir ses
droits ; je vis, au devant de moi, longue
encore, ma vie pleine de promesses ; je me
représentai mon entrée à la
cure, comme prétendant, - oui, j'en aurais
le courage - je me rappelai les cordiales
poignées de main d'Elisabeth, ses regards
affectueux..... Mon espoir devint de la
certitude.
Il me sembla voir notre demeure, mon
cabinet d'étude... Oh ! avec quel
zèle, avec quel courage
je travaillerais quand les yeux d'Elisabeth
reposeraient sur moi !
Je pensai à tout ;
j'examinai tout. Les ombres de mon passé
vinrent aussi se présenter à mon
esprit. Des plaintes et des accusations retentirent
à mes oreilles, un triste cortège de
femmes parut à mes yeux mais je
n'hésitai point devant elles.
« Venez seulement, leur dis-je, troublez
mon repos, tourmentez-moi ; vous en avez le
temps encore ; mais une heure viendra
où je serai délivré de vos
obsessions. »
Elle viendra un soir, cette heure tant
désirée. Elisabeth et moi, nous
serons seuls, dans une demi-obscurité ;
elle, près du feu ; moi, à ses
pieds. Je lui raconterai tout... oui, tout, depuis
mon entrée dans la « chambre
à part » du quartier Saint-Paul,
jusqu'à mon départ de Munich ;
je lui ferai une pleine et entière
confession ; je lui dirai combien il lui sera
difficile de m'élever jusqu'à
elle ; mais je lui promettrai en même
temps de saisir sa main comme un naufragé
saisit une planche de salut et de la garder
toujours dans la mienne. Alors, les ombres
mauvaises disparaîtront pour ne jamais
revenir. L'éclat de sa
belle âme luira sur moi, réveillera
les bons instincts endormis dans la mienne. Mes
tourments seront arrivés à leur
terme ; ma vie aura un grand et noble but...
0, Elisabeth !
Tels furent ce soir-là mes
rêves, mes espérances, mes
joies ! Jamais, depuis mon enfance, je n'avais
été aussi heureux. La jeunesse a
droit à l'espoir et j'espérais... 0,
Elisabeth !
Aujourd'hui, en me rappelant ces
rêves, je me demande si je dois les taxer
d'insolente audace, me traiter de fou, d'avoir cru
me libérer si aisément du fardeau de
mon affreux passé. Dois-je chasser cette
soirée de ma mémoire, la bannir de ma
pensée comme le mirage d'une heure de
folie ? Justice équitable, mais
sévère, tu ne m'as que trop tôt
montré l'inanité de mon
rêve ! Tu m'as replacé sous le
joug de mon passé en m'y liant avec des
chaînes plus lourdes encore : mais
accorde-moi, au moins, de garder intact le
précieux souvenir de mes espérances
d'alors. Permets que cette heure m'éclaire
toujours comme une étoile
prophétique, que son éclat me dise
que, même pour l'être le plus dégradé, l'heure
de la délivrance arrive une fois.
Dès le matin, je vis l'avenir
sous un aspect différent. Les menaces de
l'hiver avaient fait place à un beau soleil
d'automne ; il éclairait ma chambre, en
chassait mes rêves et me montrait la
réalité. Je ne renonçai pas
immédiatement à mes hardis projets,
mais j'y réfléchis avec calme. Je
compris la hauteur du but auquel j'aspirais, les
immenses obstacles placés entre lui et
moi ; mais plus il était difficile
à atteindre et plus me semblait
désirable le prix de la victoire :
Elisabeth et une nouvelle vie à
côté d'elle ! Je repris mon
projet avec courage ; je voulais essayer de
l'exécuter, quelle que dût être
l'issue de ma tentative. Dès le matin, je me
rendis au bureau avec une résolution
sérieuse dans l'âme.
Comment commencer la réalisation
de mon plan ?... En faire la confidence au
juge ? Certes, j'avais confiance en lui !
Mais si mes espérances étaient
anéanties, il l'apprendrait, et cette
pensée m'était insupportable. Je
décidai de ne me confier à personne.
De la bouche même d'Elisabeth, un refus ne pouvait
être ni dur, ni
blessant. Je résolus de lui faire ma
demande, directement, l'un des prochains
dimanches.
Les jours s'accourcissaient. Selon une
vieille habitude, on n'allumait pas les lampes au
tribunal avant le 20 décembre.
Jusque-là, on quittait le travail à
la nuit tombante et je faisais à ce moment
ma promenade du soir. Dès ce jour, je passai
chaque fois devant la cure ; je m'en sentais
le droit. Un soir, comme j'arrivai devant la porte
du jardin, Elisabeth en sortit. Nous
échangeâmes quelques mots. Elle
était, comme à l'ordinaire, calme et
douce ; moi, embarrassé, confus,
troublé... Je voyais si distinctement
l'abîme qui nous séparait !
Comment le combler ?... Sa vie et ma vie...
quel contraste entre les deux ! Ses regards se
posaient sur moi, innocents et purs, vrai miroir de
son âme qui ne soupçonnait pas ce
qu'avait été mon existence. Mes
révélations ne lui causeraient-elles
pas un mortel effroi ?
Je tâchai de secouer ces
pensées, mais elles revinrent sans cesse
m'assaillir. Il me fallut les examiner encore
à fond.
Sera-t-il absolument nécessaire,
me demandai-je d'abord, de
mettre Elisabeth au courant de ma conduite
passée ? Ne pourrai-je lui cacher les
coupables souvenirs qui me tourmentent ?...
Impossible ! Les tristes ombres du
passé me poursuivront sans
relâche ; une sombre mélancolie
m'accablera... J'aurai la force de la refouler dans
mon âme ; par amour pour Elisabeth je ne
lui en laisserai rien voir ; je m'y
abandonnerai seulement la nuit, quand elle dormira
du sommeil de l'innocence... mais, si elle m'aime,
elle verra, sur mon visage, les traces de mes
tourments. En public, le fripon peut jouer le
rôle de l'honnête homme ;
l'être dégradé, celui de
l'homme vertueux ; l'être qui, la nuit,
dans des heures d'insomnie, lutte contre les
souvenirs d'une vie souillée, peut
réussir, durant le jour, à
paraître heureux et content de
lui-même. Mais l'oeil de l'amour
pénètre sous tous les masques. Une
mère ne voit-elle pas la souffrance
secrète de son fils, cachée à
tous les yeux ? Une épouse aimante,
bien mieux encore, celle de son
époux.
Je me représentai encore
l'instant de mes révélations :
Un soir d'été, nous promenant sous
nos ombrages, Elisabeth me dira tendrement :
« Avoue-moi, mon bien-aimé, ce qui
pèse sur ton âme ; je le vois, je
le sens, quelque chose manque à ton bonheur.
Fais-moi partager ta souffrance. À nous deux
nous en chasserons la cause. » Ou bien ce
sera pendant une nuit de tempête. Assaillant
mes fenêtres, la pluie et le vent me semblent
être les voix accusatrices de mon
passé ; le trouble et l'agitation
s'emparent de moi. Dans sa tendresse
inquiète, Elisabeth me demande :
« Qu'as-tu donc ? tu souffres ;
pourquoi ne pas me le
dire ? »
Je pourrais mentir. Ai-je jamais
reculé devant un mensonge depuis mon
premier, lors de mon funeste début au
quartier Saint-Paul ? Il me serait facile de
lui dire : « Un ancien camarade
m'écrit qu'il se trouve actuellement dans
une position malheureuse et cela me tourmente,
voilà tout ! Elle sympathisera
tendrement avec mon inquiétude et, d'une
manière touchante, cherchera comment nous
pourrions aider mon ami à sortir de
peine.
Ce serait facile, en effet, mais cela
n'aura pas lieu. Jamais je ne ferai un mensonge
à Elisabeth. Arrière, funeste
pensée ! Esprit mauvais qui as tant exigé
de moi, ne te flatte pas d'obtenir jamais
cela.
Si, un jour, j'épouse Elisabeth,
il me faudra tout lui dire. Je ferai défiler
sous ses yeux le cortège des femmes avec
lesquelles j'ai eu des relations coupables ;
je lui dirai mes soucis au sujet de ce que sont
devenues ces malheureuses. Elle saura que son mari
a corrompu l'innocence des unes et donné aux
autres le dernier coup qui les a jetées pour
toujours dans la fange. Comment Elisabeth
supportera-t-elle ces
révélations ?... Cette question
me tourmentait jour et nuit et je continuai
à l'étudier à fond.
L'indécision me tiraillait
l'âme. Cependant, je ne perdis pas tout
espoir ; je comptais sur un rayon de
lumière pour me montrer mon chemin.
Ce rayon fut l'idée de soumettre
à Elisabeth elle-même, sous la forme
d'une fiction, la question qui me troublait et de
lui demander de la résoudre : Que
pensez-vous de ce cas, mademoiselle
Elisabeth ? comptais-je lui dire :
« Un homme, coupable d'un meurtre,
épouse une pure et noble femme.
Qu'arrivera-t-il si elle apprend ce crime ? Comment
supportera-t-elle
cette
découverte ? Croyez-vous qu'elle pourra
aimer encore son mari et l'aider à porter le
poids de ses remords ? »
Si elle répondait
affirmativement, ma résolution était
prise : je lui demanderais sa main ; j'en
aurais le courage... si elle me l'accordait...
quelle félicité ! 0,
Elisabeth ! ... Mon salut, ma
délivrance !...
Je résolus d'exécuter ce
plan le dimanche suivant. Elisabeth était
invitée à passer l'après-midi
de ce jour-là dans une cure voisine, pour
fêter l'anniversaire d'une amie. Elle s'y
rendait seule et son père allait la chercher
le soir. La rencontrer, comme par hasard, dans la
lande, ne serait point frappant..... je m'y
décidai.
Viens donc remplir ces pages, dimanche
sacré ; tu occupes une si grande place
dans ma mémoire que j'y retrouve
ineffaçables les incidents de chacune de tes
heures, les plus importantes de toute ma
vie.
C'était un beau dimanche
d'octobre. Le matin, un épais brouillard
couvrait tout ; mais ce brouillard d'automne
semblait ne voiler que momentanément le
soleil et dire à l'homme :
« Le
bonheur que tu espères est caché pour
un instant. Tu vas le voir
apparaître. »
Je fis ma toilette avec soin, me parant
pour la première fois d'une cravate
brodée par Agathe pour ma fête. En
nouant cette cravate je désirais ardemment
que ma soeur pensât à moi, plus que de
coutume encore, en ce jour solennel ; elle
était mon bon ange et j'avais, en cette
heure, un si grand besoin de me sentir sous la
protection d'un bon ange ! ... J'allais
demander la main d'une pure jeune fille...
moi !
Dans cette petite ville, on allait
chaque dimanche, sans manquer, à
l'église. J'ignore si l'on y était
meilleur qu'autre part, mais chacun y sentait la
poésie religieuse du dimanche matin :
son des cloches, gens endimanchés, paix du
sabbat, chants sacrés accompagnés de
l'orgue, etc. À l'église, depuis de
nombreuses générations, chaque
famille occupait les mêmes places.
Grâce à son long séjour dans la
ville, le juge avait acquis un droit à l'un
des bancs réservés aux membres de
l'église et de l'école et où
avait sa place aussi le référendaire
en charge qui devait, selon un
vieil usage, accompagner son supérieur
à l'église. Cette obligation semble
ridicule de nos jours, vu les idées modernes
sur la liberté de l'individu et la
liberté de conscience.
Notre pasteur devant prêcher tous
les quinze jours dans un village voisin, le service
divin commençait de bonne heure chez nous.
À la première cloche, le brouillard
couvrait encore la ville. Dans une joyeuse attente,
je me mis à la fenêtre et regardai les
passants avec l'intérêt
qu'éprouve un être heureux pour ses
semblables. Des enfants se rencontrèrent et
se firent part gaîment de leurs projets pour
la journée. De tout mon coeur, je
désirai pour eux un beau soleil en pensant
qu'un jour, peut-être, j'aurais
moi-même des enfants. Quelle peine je me
donnerais pour les conserver honnêtes et
vertueux et leur faire réparer, si possible,
les fautes de leur père. Je vis un groupe de
jeunes filles se rendre à l'église.
Avec mélancolie je souhaitai que jamais un
homme tel que moi ne se trouvât sur leur
passage. Je vis encore un vieillard, appuyé
sur son bâton, s'acheminer lentement vers la
maison de Dieu. Je lui souhaitai
de se reposer paisiblement, à son retour,
assis au soleil devant sa maison et pensant
à de vieux et chers souvenirs. Pour tous je
désirais du bonheur... j'espérais, ce
jour-là, être si heureux
moi-même !
À la dernière cloche, le
soleil perça les brouillards ; il
pénétra dans l'église par la
porte, grande ouverte, comme pour bénir les
arrivants. Elisabeth, ses parents et moi, nous
entrâmes en même temps ; cela me
sembla de bon augure, ainsi que le choix des
cantiques et le sermon dont j'ai gardé
quelques passages dans ma mémoire. Pour
finir, le pasteur indiqua le chant de la
bénédiction. À cette
phrase : « Seigneur, donne-leur la
paix », il me sembla que le père
nous bénissait ensemble, sa fille et moi.
Mon âme planait dans de hautes
sphères. Je me croyais arrivé au
bonheur : Elisabeth partageant ma vie et moi,
par son amour, devenu honnête, capable,
laborieux, un homme enfin ! Heure de bonheur
ineffable !
Je voulais, à la sortie, attendre
un instant pour saluer Elisabeth; mais le juge me
proposa immédiatement une promenade et je
dus le suivre dans une avenue de marronniers qui
fait le
tour de
la ville. Tout parlait de l'automne : les
enfants récoltaient des marrons ; les
feuilles tombaient lentement des arbres ;
déjà le pied en foulait de
sèches ; mais cela ne me disposait
point à la mélancolie ; le ciel
était si merveilleusement clair !
À droite, la petite ville dont les
fenêtres luisaient sous les rayons du
soleil ; à gauche, la lande immense
avec la verdure de ses bouleaux solitaires et sa
ravissante floraison, fraîche encore,
où les abeilles faisaient leurs
dernières provisions avant l'hiver.
Dans le cours de notre entretien, le
juge me parla d'un triste événement
arrivé la veille : le fils d'une
famille, depuis longtemps établie dans la
localité, s'était brûlé
la cervelle à la suite d'un délit de
moeurs. Vivement impressionné par ce
récit, je m'écriai :
« Ah ! le malheureux ! il n'en
serait pas arrivé là s'il avait eu
à côté de lui une vertueuse et
noble épouse pour le guider, pour
l'encourager au bien ! » Le juge
garda quelques moments le silence, puis il
s'arrêta et me dit, en appuyant sur les
mots : « Une femme ne peut nous
sauver. »
Je ne savais pas les détails de
la vie du juge ; mais
l'émotion avec laquelle il prononça
cette courte phrase me fit penser qu'il connaissait
la souffrance. Des souvenirs lointains avaient-ils
fait sortir de ces lèvres ces mots :
« Une femme ne peut nous
sauver ! »
L'incident fut clos et nous
achevâmes notre promenade sans renouer
l'entretien.
Ce que peut une parole ! Une
parole
de son père a montré à
Alexandre le Grand, dans son enfance, le chemin
d'une gloire immortelle. Une parole de la jeune
fille qu'il aime met un jeune homme au comble du
bonheur ; ils s'épousent ; ils
sont heureux ensemble, puis une parole amère
ou rude vient les désunir... Une parole de
Dieu a suffi pour créer le monde.
Ce que peut la parole ! Ce qu'a
fait en moi celle-ci : « Une femme
ne peut nous sauver ! » Elle ne m'a
pas enlevé immédiatement le courage
d'exécuter mon projet, mais elle a rouvert
dans mon coeur le chemin du doute.
« Une femme ne peut nous
sauver ! » Était-ce la
vérité ? Pauvre Elisabeth !
Ma dépravation était-elle si profonde
qu'elle ne pût être vaincue par ton
innocence et ta chasteté ! Un jour
pourrait-il venir où
mes mauvaises passions se
réveilleraient ! Le doute me
força à me peindre ce moment
funeste : Elisabeth, tout en larmes, me
rappelle la foi jurée, nos jours de
bonheur..... C'est en vain... je succombe, l'amour
subit la honte, le déshonneur... Elisabeth
victime de mes honteuses passions ! Ce serait
la plus sombre parmi les sombres heures de mon
existence. Non jamais ! Rendre Elisabeth
malheureuse, non plutôt être malheureux
moi-même jusqu'à mon dernier
soupir !
« Une femme ne peut nous
sauver ! » J'ignore si c'est
vrai ; Je me demande, aujourd'hui encore, si,
malgré sa longue expérience de la
vie, le juge ne s'était pas
trompé ; mais je ne veux pas chercher
s'il eût mieux valu pour moi qu'il
n'eût pas prononcé cette phrase. Une
chose est certaine : elle avait chassé
de mon coeur sa joyeuse assurance. Dans le grand
silence de midi, je restai longtemps au bout de
l'avenue, absorbé, le regard perdu dans la
lande, l'âme en proie au doute, à la
crainte.
Une vieille légende nous parle de
courageux héros, toujours à la
recherche de querelles
dangereuses et sanglantes ; un jour vint
pourtant où leur courage faiblit, où
leurs genoux tremblèrent. Néanmoins,
ils partirent pour le combat, mais ils y furent
vaincus. Le célèbre Tilly sentit
faiblir son assurance avant la bataille de
Brestenfeld ; malgré ses craintes, il
entreprit la lutte, n'y fut pas victorieux et
perdit sa renommée. Craintif comme lui, mais
voulant, malgré tout, exécuter mon
projet, je m'acheminai vers la lande.
Ce qui se passa ensuite, tu t'en
souviens, mon pauvre coeur ! ... Je savais
quel chemin devait suivre Elisabeth. Non loin de
là, se trouvait une éminence de
laquelle on pouvait reconnaître les
promeneurs à leur sortie de la ville.
J'allai m'y asseoir sur un banc de mousse
entouré de petits sapins qui me cachaient
à la vue des rares passants. Je comptais
voir venir Elisabeth, aller au-devant d'elle et
l'accompagner pendant quelques moments.
La journée tenait les promesses
du matin l'azur foncé du ciel
s'élevait en voûte au dessus de la
lande dont on distinguait les fermes, les routes,
les sentiers, et même on apercevait au loin les
clochers
de Lunébourg.
Partout régnait la grande paix du
dimanche. Aucun vent n'agitait le feuillage
léger des bouleaux ; ils se reposaient
avant d'être livrés aux tempêtes
de l'hiver. La bruyère pouvait jouir encore
de sa douce beauté avant de se
flétrir sous les baisers glacés du
gel. Au delà du marais, un clair soleil
d'automne luisait sur le toit délabré
d'une pauvre chaumière. L'ange de la paix et
de la joie planait sur toute la lande et la
bénissait. Oh ! comme., je le suppliai
de me bénir aussi ! ... J'étais
venu chercher le bonheur ; je savais où
le trouver ; les joies bruyantes et mauvaises
ne m'attiraient plus ; je n'en voulais
plus ; J'aspirais à un bonheur
paisible, là où règnent la
vertu, l'amour, le travail...
O sainte paix du dimanche ! Aucun
bruit ne la troublait. À peine entendait-on
des cloches lointaines appelant au
catéchisme la jeunesse des villages.
C'était ce grand silence après lequel
parfois soupirent les êtres fatigués
du trouble et du tumulte des villes. Je lui
demandai de pénétrer en moi, d'y
arrêter le son des voix accusatrices. Je ne
voulais plus les entendre, elles
ne devaient plus rien avoir à me dire...
Elles n'avaient pas fini et continuèrent
leurs plaintes. Le compte de toute une jeunesse de
dépravation était si long que deux
années ne suffisaient pas à le
faire.
Mais, à ce moment décisif,
je ne voulais, à aucun prix, laisser parler
ces voix. Ce fut une lutte acharnée entre la
paix et le trouble, entre le bonheur et le malheur,
entre la vie et la mort. Il me fallait en finir
avec mon affreux passé : combat
gigantesque ! Mais en danger de mort, l'homme
acquiert des forces surnaturelles. Aux attaques
violentes des voix accusatrices j'opposai ce que
j'avais en moi de plus puissant : mon amour
pour Elisabeth ; elles redoublèrent de
violence... la lutte fut longue :
« Silence ! » leur
criai-je ; « Non,
répondirent-elles, nous ne nous tairons
pas ! » -
« Arrière, voix
maudites ! » - « Non, nous
restons ! ... »
Et leurs plaintes continuèrent.
Le droit était de leur
côté ; du mien, le rêve et
les inutiles souhaits. Rêves et souhaits sont
puissants en temps de paix, mais inertes, sans
force à l'heure sérieuse du combat.
Les voix eurent la
victoire ; elles étouffèrent le
son lointain des cloches, le doux murmure du vent.
Je n'entendis plus qu'elles. Non seulement elles me
criaient leurs accusations, mais elles me disaient
aussi « Écoute nos conseils, nos
avertissements considère ce que tu es ;
laisse en paix cette chaste jeune fille ; elle
ne peut être à
toi... »
Je ne vis plus la lande
ensoleillée, ni les paisibles sentiers, ni
les cabanes solitaires... Je ne vis plus que les
tableaux de mes heures les plus mauvaises. Comme
les voix, ils m'avertissaient, me menaçaient
et me répétaient :
« Renonce à cette jeune
fille ; laisse-la passer en paix ; entre
elle et toi se trouve un abîme
insondable.
Je vis venir Elisabeth vêtue de
blanc et gardée par son bon ange. En la
voyant ainsi le matin à l'église, je
m'étais demandé :
« S'est-elle peut-être parée
pour moi ? » Quel changement depuis
lors ! Sa robe immaculée me
disait : « Arrière ! ne
me profane pas de tes cyniques
regards ! », ses yeux me suppliaient
de m'éloigner, de ne pas venir la
troubler ! L'éclat de sa chevelure
dorée me criait « Que ta main
souillée ne me touche pas !...
Elle allait passer devant
l'éminence où je me tenais
caché. « Voici l'instant
suprême, me dis-je ; il ne reviendra
plus... » et je voulais sans retard
m'avancer, me jeter aux pieds de cette enfant, lui
dire ma misère, lui avouer mes fautes...
mais les voix me crièrent de nouveau leurs
accusations et leurs avertissements alors, je
murmurai tout bas : « Va en paix,
jeune fille, va en paix, ne crains rien. Je
continuerai seul ma route. »
Elle passa tranquille et sereine devant
moi, sans soupçonner la gravité de
cette minute ; elle ne l'apprendra jamais. En
écrivant ces lignes je la vois
s'éloigner légère et
gracieuse, disparaître sous les arbres et
reparaître encore. Elle s'arrêta sur
une petite éminence et promena ses regards
au loin où tout était
clarté ; elle ne put me voir dans les
ténèbres dont m'enveloppait ma
misère.
Je pense aujourd'hui avec angoisse
à l'heure douloureuse que je passai encore
dans la lande sans avoir la force de retourner chez
moi. Que m'importait la splendeur du soleil
couchant dont les rayons parlaient
d'espérance ? Je ne voyais que le sable
gris et je tâchai d'en compter les grains
pour apaiser l'agitation de mon
âme. J'évitai les bandes d'enfants
joyeux ; je me détournai du chemin pour
fuir mes connaissances et j'arrivai à ma
demeure comme un malheureux fugitif. Anéanti
par ma douleur, je rêvai longtemps assis vers
ma fenêtre. La lune vint luire dans ma
chambre ; le vent de la lande vint me chanter
sa mélodie : tout m'était
indifférent. Inerte ma pensée ne
chercha Elisabeth qu'un instant ; je me
dis : elle rentre à la cure sous la
garde de son père.
Le lendemain matin, brisé de
corps et d'âme, je sortis péniblement
de mon rêve. J'employai un reste de force
morale à refouler ma souffrance au fond de
mon coeur. Puis la tête haute, le visage
impassible, je partis pour le tribunal. Je cherchai
tout de suite à m'entretenir seul avec le
juge. Quelques allusions suffirent pour lui faire
comprendre mon désir de quitter au plus
tôt la ville. Il me promit de m'en faciliter
le moyen, de m'aider à quitter ma charge
d'une manière honorable, et à partir
en paix.
Depuis longtemps à l'abri des
soucis, des désirs, des orages de la
jeunesse, ce vieillard n'était devenu ni
dur, ni égoïste; il me comprit, me témoigna un
sincère intérêt et tint
fidèlement sa promesse. Au bout d'une
semaine, je reçus l'avis de mon
transfert.
Je fus obligé de prolonger encore
quelque temps mon séjour dans cette ville
où, heureusement, personne ne
soupçonna le motif de mon départ.
M'armant de courage, je pris un air
indifférent et calme. Chaque soir je me
rendis au casino ou je conservai l'assurance d'un
homme du monde, même en entendant des
allusions à mes fiançailles
possibles. Personne ne put se douter qu'elles me
brisaient le coeur.
Je fis mes visites d'adieu avec la
même assurance. J'allai en dernier lieu
à la cure où je réussis
à cacher mes sentiments sous le voile de
l'indifférence. Après une
conversation banale sur nos souvenirs communs, nous
nous séparâmes avec cordialité,
en exprimant le voeu de nous rencontrer encore. Je
réussis à comprimer, jusqu'au bout,
mon émotion. Je ne retins pas un instant la
main d'Elisabeth dans la mienne ; mon regard
ne lui dit pas un mot intime... Je sortis avec
calme de la cure et ne me retournai pas une seule
fois...
Elisabeth m'a-t-elle suivi des
yeux ? A-t-elle, depuis lors, pensé
quelquefois à moi ?...
Ayant refusé toute soirée
d'adieux, je terminai rapidement mes
préparatifs de départ et je pus aller
enfin me recueillir dans la solitude de la
lande.
Inconsciemment, je me rendis sur
l'éminence où, quinze jours
auparavant, j'avais attendu le passage d'Elisabeth.
Mon désespoir y éclata avec violence.
Longtemps je pleurai sur ma vie perdue, sur mon
bonheur envolé.
Glissant dans un ciel pur, quelques
nuages me disaient : « c'est
passé, passé pour ne plus
revenir ! » Dans les pins le vent
gémissait sur les souffrances humaines. Un
désir ardent s'éleva dans mon coeur
de voir Elisabeth passer devant la colline, de
l'attirer à moi, de m'enfuir avec
elle...
Mon pauvre coeur ! il fallut
abandonner ces désirs insensés. C'en
était fait ! je ne devais plus revoir
celle que j'aimais...
Gardée par ses anges
tutélaires, elle se reposait dans sa riante
demeure... et je restais seul,
abandonné...
Deux ans se sont écoulés
depuis cette lugubre et douloureuse soirée.
Ma blessure saigne encore, mais mon
désespoir n'est plus de la démence. J'ai compris
le
sens des événements. On accuse
souvent la vie d'être injuste. Parfois elle
l'est, en effet. Cependant, elle n'est pas assez
mal organisée pour qu'un homme, après
une jeunesse adonnée à tous les
vices, puisse jouir en paix du plus grand bonheur
qu'il y ait en ce monde : l'amour d'une chaste
épouse, le repos du foyer, les
bénédictions de la famille. Non, elle
n'est pas organisée de telle sorte qu'une
innocente et pure enfant soit obligée de se
sacrifier pour un libertin endurci.
J'ai compris cela ; la violence
de
mon désespoir a fait place peu à peu
à une douleur plus calme, et je me suis
résigné au sort que je me suis
préparé moi-même.
Je ne veux pas recommencer ma folle et
coupable vie, chercher l'oubli dans l'orgie et la
débauche, je ne veux pas boire l'eau du
Léthé à la coupe de la
volupté ; je ne veux rien
oublier.
Silencieuse mélancolie,
désormais ma fidèle compagne, sois la
bienvenue.
En terminant ces pages,
Elisabeth !
je te le demande à genoux : permets-moi
de garder comme un bien sacré ton souvenir
au fond de mon coeur. Dans
l'âme de l'être le plus avili, il peut
se trouver encore un point sans tache, une sorte de
petit sanctuaire ; il est bien étroit
chez moi, bien misérable, ce sanctuaire,
cependant, je t'en supplie, Elisabeth, fais-y ta
demeure. Seul je saurai que tu l'habites. Personne
n'apprendra jamais que tu vis dans mon souvenir. Je
t'y garderai pour moi seul. Le matin, tu es ma
première pensée, ma dernière
le soir et ce sera toujours ainsi, Elisabeth, tant
que je vivrai. L'été je
m'entretiendrai avec toi sous les ombrages, l'hiver
au coin du feu. Au bord dune rivière, je
verrai dans l'eau ton image ; le murmure du
vent dans les roseaux me rappellera la douce voix.
Et quand, solitaire et délaissé, je
serai étendu sur mon lit de mort, je le
sais, j'entendrai ton pas, je te verrai en
rêve t'approcher de moi. Ton nom sera ma
dernière parole, Elisabeth, et tu
recueilleras ma dernière plainte, mon
dernier soupir !
Assez, je vais poser la plume ;
demain je quitte le Rodenhof. Pour aller
où ? je ne sais. Mon âme n'a pas
trouvé la guérison dans cette belle
et paisible contrée. Aucun lieu ici-bas ne
lui rendra la paix ; ni les forêts des vallées,
ni les sommets
des montagnes, ni les flots d'une mer en furie.
Pourtant je quitte le Rodenhof avec reconnaissance.
En partant j'en salue avec cordialité tous
les hôtes ; toi surtout, noble ami qui
m'as permis de t'ouvrir mon coeur. En lisant ces
feuillets, tu verras la profondeur de l'abîme
où le vice peut entraîner un homme. Si
tu rencontres encore un voyageur dont le sort
ressemble au mien, aie pitié de lui, ne le
repousse pas.
Encore une fois, silencieuse
mélancolie, fidèle compagne, sois la
bienvenue. Nous partirons ensemble ; je ne
veux point te quitter. Ma vie n'a plus de sens que
liée à toi. Si je rencontre, sur ma
route, de joyeux groupes d'hommes, des bandes
d'enfants folâtres, je passerai sans ralentir
mon pas, de crainte de troubler leur
gaîté. Quand je verrai des êtres
souffrants et malheureux, je m'arrêterai pour
leur serrer la main. La mission de l'être
mélancolique est de sympathiser avec la
souffrance humaine.
Donne-moi ta main,
mélancolie ; nous sommes prêts
tous deux ; quittons ensemble le Rodenhof.
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
