
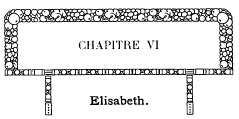
Les jours paisibles du Rodenhof vont finir.
Pourtant rien ne me force à quitter ce
pays : ni épouse, ni enfants
n'attendent mon retour ; aucun devoir, aucun
travail ne m'appelle.
Pourquoi ne pas rester ici ? j'ai
un grand besoin de paix et de repos ! ...
Ah ! c'est que le silence des forêts ne
les donne qu'à celui dont l'âme est
pure. Dans mon coeur habitent le remords, le
trouble, l'amertume, et la paix qui m'entoure
augmente mes tourments. Il me faut donc partir,
retourner dans la foule, dans le tumulte des
villes ; là seulement on peut
s'étourdir.
Ainsi, mon séjour au Rodenhof ne
m'a procuré ni l'oubli, ni le repos. Les
bruits du monde n'y arrivent pas, mais la voix du
passé m'y a poursuivi ; elle y a
retenti sérieuse et
puissante ; elle m'a tout rappelé, m'a
fait parcourir encore une fois ma vie
entière ; elle m'a parlé de mon
heureuse et pure enfance, m'a fait comprendre la
valeur de ce que j'ai perdu, m'a fait mesurer la
profondeur de ma chute. Il ne pouvait en être
autrement. Il ne sert à rien au
négociant endetté de brûler le
livre de ses dettes ; il faut qu'il puisse en
constater les sommes et
répéter : « Tout doit
être payé ». De même,
l'homme coupable ne doit à aucun prix
s'efforcer d'oublier ses fautes, il doit à
chaque instant s'écrier :
« Mon Dieu, aide-moi à expier mes
péchés »
Merci, paisible Rodenhof ! Tu
n'as
pas donné la paix à mon
âme ; c'était impossible ;
mais tu m'as empêché de chercher la
guérison dans un fol oubli. Non, je ne veux
pas oublier ; je veux porter ma croix.
Après cette douloureuse revue de
ma vie, permets-moi, Elisabeth, de me reposer, non
dans tes bras, cela m'est pour toujours interdit,
mais dans ton souvenir. Durant ces jours, j'ai
écrit bien des pages sombres, amères,
désolées ; laisse-moi, pour
finir, écrire un mot de reconnaissance et
d'amour, laisse-moi
écrire ton nom : Elisabeth ! Je te
jure sur ce qu'il y a de plus sacré - si un
être déchu comme, moi peut le faire -
je te jure que jamais les ombres de ma vie
n'obscurciront ta pure image dans mon
coeur.
Permets-moi, Elisabeth, de consacrer ma
dernière soirée du Rodenhof aux
souvenirs les plus chers de mon existence, de
revivre encore une fois des jours remplis d'un doux
espoir.
De retour à Hambourg, j'entrai
dans la maison de mon tuteur. Devenu vieux et,
n'ayant plus les forces, ni l'activité de la
jeunesse, il avait remis à son gendre la
direction de ses affaires. Les années
avaient adouci son caractère et ses
manières. Je m'en aperçus tout de
suite à l'affabilité de son
regard ; je sentis pourtant qu'il me
pénétrait à fond et,
involontairement, je restais muet en sa
présence. Devant d'autres personnes, je me
vantais hardiment de mes travaux artistiques ;
devant lui, impossible d'en dire un mot. Du reste,
dans sa maison la vie de tous était un
reproche sérieux pour moi. Tout le long du
jour on y travaillait sans relâche, avec
zèle, avec entrain, et quand retentissait la
cloche du soir, chacun,
fatigué de son labeur, s'accordait
joyeusement un repos bien mérité.
Pour moi, matinées, après-midi,
soirées se passaient également vides,
ternes, sans but. Pendant de longues années,
j'avais regardé avec dédain et
moquerie tous les travailleurs ; je les
appelais des « bêtes de
somme » ; je n'attachais de valeur
qu'à la vie d'oisiveté et de
plaisir ; j'en connaissais maintenant les
ennuis et les fatigues.
Je voulais quitter cette maison, quitter
Hambourg ; mais où aller ? Je pris
le parti de consulter mon tuteur ; l'orgueil,
défaut capital des âmes mesquines, m'y
fit renoncer. Heureusement, il me
prévint.
C'était un soir, la veille de
Pâques. Tous les jeunes gens de la maison
étaient sortis. Autrefois, mon tuteur se
faisait un plaisir d'accompagner ses petits-fils
dans leurs promenades ; maintenant, vite
fatigué, il préférait se
reposer solitaire dans sa tranquille demeure. Ce
soir, j'y restai aussi. Je n'aimais plus ces
courses en bandes joyeuses à travers les
rues pour aller chercher au loin la belle
nature ; je ne comprenais plus ces joies
simples, les seules vraies. Mon tuteur m'engagea à
prendre le
café avec lui, sur son balcon où
luisait un gai soleil de printemps. La vue n'avait
rien d'idyllique, cependant le port, les navires
à l'ancre, le quai presque désert
avaient un aspect agréable et
paisible.
Après quelques banalités,
mon tuteur aborda la question de mon avenir. Je lui
soumis différents projets. Il les repoussa
tous. Selon lui, je devais embrasser la
carrière en vue de laquelle J'avais fait des
études académiques.
- Je t'en prie, me dit-il, fais-en au
moins la tentative ; mets-toi à la
disposition de l'État comme
référendaire. Ce champ
d'activité te plairait peut-être plus
que tu ne le penses. Tu ne connais pas encore la
satisfaction causée par une vie
régulière de travail sérieux.
Goûte-la enfin !
Mon tuteur m'apprit alors qu'il avait
déjà fait des démarches pour
m'ouvrir un chemin dans cette direction. Un de ses
amis était juge au tribunal d'une petite
ville de la lande lunébourgeoise ; il
lui avait écrit à mon sujet ; sa
réponse venait d'arriver et disait :
« Ta demande me parvient à un
moment favorable : mon
jeune employé me quitte ; je proposerai
ton protégé au président du
tribunal ; il est mon ami et ne le refusera
pas. Il s'agit seulement de savoir si ton pupille
est disposé à émigrer dans
notre silencieuse petite
ville ! »
Certes, je n'en avais nulle
envie !
Mais il fallait m'occuper ; je le sentais
bien. Je n'aspirais pas à m'élever
à des régions idéales.
L'ardeur des âmes jeunes, chantée par
les poètes, était éteinte dans
la mienne, mais je voulais au moins essayer d'une
vie qui voilerait aux yeux des autres ma
dégradation morale. Je me décidai
donc à accepter cette offre et, au bout de
peu de jours, l'affaire fut en
règle.
Je quittai Hambourg pour la
troisième fois. Il y a quinze ans, je m'en
allais l'âme tourmentée de remords.
Plus tard, en parlant pour Munich, elle
était remplie des plus folles illusions.
Cette fois-ci, j'allais commencer une
carrière. Belle phase de la vie si l'on y
entre avec la volonté ferme d'y faire
quelque chose de sérieux, de complet !
Moi, j'y entrais comme ces gens pour lesquels les
étudiants allemands ont inventé le
nom de philistins. Je n'avais ni désirs, ni
buts élevés ; sans aspiration vers
l'idéal, ma pensée se mouvait
bourgeoisement dans le petit cercle d'idées
banales dont s'occupent partout les hommes du gros
monceau.
Le juge m'attendait à la gare de
sa petite ville ; il fixa sur moi un regard
scrutateur, mais son visage ne trahit pas son
impression sur ma personne ; il me tendit la
main et me dit :
- Nous ne tarderons pas,
j'espère, à faire bonne
connaissance.
Pensant que mon court voyage ne m'avait
point fatigué, il me conduisit
immédiatement au bureau, m'expliqua en peu
de mots le champ de mon activité, m'indiqua
la place occupée par mon
prédécesseur, où
j'étais, me dit-il, le
vingt-cinquième à m'asseoir ;
puis il alla reprendre la sienne et tout rentra
dans le silence. On n'entendit plus que le
grincement des plumes et le bruissement des
feuillets des « actes ». Il en
fut de même tout le jour et tous les
jours.
Cet état de chose aurait pu
continuer indéfiniment pour moi.
Après la mort du vieux juge, J'aurais pris
sa place ; je serais devenu un bon bourgeois
utile à l'État ; ma tare intérieure n'y
aurait
point fait obstacle. Les voix troublantes auraient
fini par se taire en moi ; je serais
arrivé à la vieillesse, connu et
respecté dans toute la ville ; durant
ma promenade du soir, les enfants m'auraient
salué avec vénération...
Pourquoi n'en a-t-il pas été
ainsi ?... Satisfait d'avoir une position
supportable, je m'habituai rapidement à ma
nouvelle existence. Cette petite ville et son genre
de vie me plaisaient. Pas assez sot pour
m'enorgueillir d'avoir vécu dans une
capitale, je ne me vantais pas des plaisirs que j'y
avais eus. Du reste, je n'ai jamais compris qu'un
individu se sente fier d'être un
numéro dans le troupeau d'un grand centre.
Mieux que l'habitant de la capitale, celui du
village ou de la petite ville peut se rendre compte
de sa valeur personnelle et la mettre en relief.
Dans les grandes agglomérations
humaines, il est facile à chacun de prendre
une apparence trompeuse. Un scélérat
peut y circuler des années sous le masque
d'un honnête homme. On dit souvent que le
séjour des grandes villes éveille
l'intelligence et l'esprit ; c'est surtout
l'opinion du citadin lui-même. Il est
aisé de s'expliquer ce
fait ; chaque jour la nature nous en fournit
des exemples, entre autres celui des
grenouilles : dans l'isolement, à peine
font-elles entendre de rares et faibles sons ;
réunies en grandes masses, elles poussent
à l'envi des cris immodérés.
Il en est ainsi de l'homme : une foule
nombreuse fait retentir en choeur les mêmes
paroles, les mêmes opinions et chaque
individu croit être une puissance. Le nombre
impose toujours ; il impose doublement
à celui qui en est l'un des chiffres. Il
n'est pas besoin de dire qu'il n'y a rien de
réel derrière ce sentiment
présomptueux. Pour l'honneur du genre humain
je ne veux pas admettre que l'homme acquière
de l'intelligence et de l'esprit par le fait seul
qu'il est membre d'un troupeau
considérable.
Je fus assez adroit pour ne pas
gâter mes débuts par des
fanfaronnades. La présence de mon
vénérable juge, avec lequel je fis
mes premiers pas dans la société, me
préserva d'écarts de ce genre.
Dès le premier soir, il m'introduisit au
Casino. Pour nous y rendre nous traversâmes,
par un mauvais temps d'avril, la petite ville
silencieuse, à peine éclairée
par quelques lanternes à l'huile ; mais mon
guide en
connaissait
assez les étroits passages pour n'avoir pas
besoin d'une vive lumière. Pendant
trente-deux ans, me dit-il, j'ai fait ce trajet
tous les lundis et tous les jeudis. J'ai vu de
nombreux visages entrer dans notre club, puis en
disparaître. Le pasteur et moi nous en sommes
les plus anciens membres.
La place du marché formait un
carré autour duquel s'élevaient de
vieilles maisons à l'aspect
vénérable. L'une d'elles était
notre but, la très ancienne auberge du
Cheval Blanc, dont l'entrée, bien
éclairée, invitait les passants
à s'y arrêter, surtout quand la
tempête faisait rage. Comme nous en
approchions, un vieux monsieur en atteignait le
seuil. Fermant soigneusement son immense parapluie,
il gravit l'escalier avec dignité :
c'était le pasteur. Nous le suivîmes
de près.
Ce soir-là, je me dis que cette
auberge me serait ouverte pendant de longues
années. Il n'en a pas été
ainsi. Néanmoins, ma pensée s'y
reporte avec joie ; tous les détails en
sont encore présents à ma
mémoire : une salle longue et basse
dont le plafond est soutenu par de solides poutres
de chêne brut, colorées en brun par le
temps et par de nombreuses
générations de fumeurs. Les larges
embrasures des fenêtres indiquent
l'épaisseur des murs. Involontairement, on
se représente les fils et les filles de
cette maison, assis là, dans les
siècles passés et contemplant la
vaste lande. Un témoin des temps
reculés aussi, l'antique poêle de
faïence décoré de pieuses
scènes de la Bible et de scènes
violentes de l'histoire. Tout à
côté se trouve, un vieux
canapé. Qui sait combien de fois on en a
renouvelé l'intérieur et
l'extérieur ? Selon une très
ancienne coutume, il est toujours
réservé aux membres les plus
âgés du casino. Le pasteur et le juge
seuls s'y asseyaient alors. Une place me fut,
assignée au bas de la table.
Nous fumes quelques moments seuls, nous
trois ; cela me permit de faire tout de suite
la connaissance du pasteur dont les traits
exprimaient une grande bonté. Comme pour
l'affligé, son regard était un rayon
de soleil pour l'être déclin. Il me
témoigna de la satisfaction à me voir
entrer dans leur cercle où, disait-il,
j'apporterais de la variété par mes
récits de Hambourg.
Peu à peu arrivèrent en
grand nombre des membres du club dont tous les
citoyens de la ville avaient le droit de faire
partie. Il était établi, par
égard pour les membres venant du dehors, de
ne parler que le bon allemand. Nombre de petits
bourgeois, effrayés de cette règle,
se retiraient dans la salle à boire publique
où ni la grammaire, ni les règles
phonétiques n'étaient prises en
considération. Avec le temps s'était
formé un cercle à part,
composé du pasteur, du docteur, du
pharmacien, des membres du tribunal et de
l'école, puis d'un ancien candidat en
théologie ; il s'était souvent
présenté pour une place de pasteur,
mais toujours sans succès, et finalement il
y avait renoncé. Le soir où je fus
introduit au casino, le maire n'y vint pas ;
il avait eu une petite querelle avec le pharmacien
et il était d'usage en pareil cas de
s'abstenir quelque temps de paraître aux
réunions.
Ces soirées avaient du charme
pour moi. Les premiers temps, en regagnant mon
logis, je me voyais finissant dans cette petite
ville ma vie manquée et y retrouvant un peu
de paix intérieure. Le
« sans-patrie » s'y serait fait une
sorte de patrie,
une
sorte de « foyer ». Dans notre
cercle, on ne remuait ni hautes ni profondes
pensées ; on n'y faisait aucun plan
pour changer l'état de la
société ; on y traitait petits
et grands sujets facilement sans se creuser la
tête. On y jouissait surtout d'une
atmosphère pure et calme qui permettait
d'oublier quelque temps soucis et fatigues, erreurs
et fautes. Les coeurs se rapprochaient, non par une
profonde sympathie mais par une bienveillante
cordialité. Bref, on se sentait parfaitement
à son aise.
Le meilleur moment de la soirée
était celui où nos deux vieux membres
voulaient bien nous raconter quelque tradition de
la lande ou quelque dramatique histoire sur
d'anciennes familles de la contrée. Le
pasteur surtout contait admirablement. Dès
qu'il commençait, le silence se faisait dans
la salle ; seul, le murmure du vent
accompagnait son récit de sa touchante
mélodie.
Bientôt, je fis des visites ;
ce ne fut pas long ; un jour y suffit. Je
commençai par la famille du pasteur dont les
fils étaient placés au loin et les
filles mariées, sauf la plus jeune, en
visite ce jour-là chez des amis. Je me rappelle
différentes
cures comme des lieux en dehors de tout bruit et de
toute agitation humaine ; celle-là en
était encore plus à l'abri que les
autres ; située un peu hors de ville,
elle avait un jardin qui s'étendait jusque
dans la lande. Dans cette radieuse journée,
une atmosphère de paix enveloppant la maison
entière se répandait dans la salle
commune, dans le cabinet d'étude, partout.
La demande aimable que me fit le pasteur de venir
souvent le voir, fit naître en mon âme
l'espérance d'un avenir heureux.
Peu de jours après, le pasteur me
fit inviter à passer une soirée chez
lui avec quelques membres du casino, entre autres
le juge. J'allai le chercher pour nous rendre
ensemble à la cure. Chemin faisant, il me
donna quelques détails sur la famille.
Chargés de nombreux enfants, le père
et la mère avaient traversé des
années difficiles, mais enfin le trouble et
les soucis avaient fait place au calme et au
contentement. Tous leurs enfants étaient
pourvus. Seule, Elisabeth, vrai rayon de soleil
pour ses parents, était encore avec
eux.
Arrivés à notre
destination, nous avions à gauche la vaste étendue
de la lande d'où soufflait un vent
glacé, comme pour nous dire :
« Il ne fait pas encore bon de ce
côté, allez plutôt vous chauffer
près du poêle ». En ouvrant
la porte du jardin nous vîmes briller les
lumières dans la salle de famille ;
nous arrivions les derniers.
Ce soir-là, je te vis pour la
première fois, Elisabeth. Tu nous ouvris la
porte et tu me tendis amicalement la main.
Malgré la demi-obscurité de
l'entrée, je pus voir la douce lueur de tes
regards. Tu ne me connaissais pas, tu ne savais pas
à quelles femmes j'avais serré la
main. Peut-être avais-tu entendu parler
déjà de la vie folle et coupable du
monde, mais tu ne pensais pas que ses vagues
bourbeuses viendraient un jour frapper à la
porte de votre lointaine et paisible demeure.
N'importe que tu aies soupçonné ou
non ce que j'étais ! Je te suis et te
serai éternellement reconnaissant de ton
salut de bienvenue si chaste et si affable ;
il réveilla les bons esprits qui dormaient
en moi ;ils m'ont tenu compagnie toute la
soirée. Je ne savais plus comment on
s'entretient avec des femmes vertueuses, mais je
n'avais pas besoin de te parler : il me
suffisait de
sentir La présence, d'entendre la voix, de
regarder de temps en temps ton pur et doux
visage.
Le repas fini, la table desservie, le
pasteur nous dit :
- Un bon souper est le prélude de
la soirée ; la meilleure partie en est
un bon cigare avec un verre de bon vin.
Pour la première fois depuis de
longues années, je me trouvais au milieu de
gens chez lesquels habitait la vraie joie ;
elle se manifestait d'ordinaire avec
simplicité : jeux innocents,
énigmes proposées, récits
divers et, pour terminer la soirée, un peu
de musique. Quelques-uns des invités
produisirent tant bien que mal leurs talents.
N'étant pas musicien, je me retirai
inaperçu dans un coin tranquille pour
écouter Elisabeth qui chanta quelques airs
populaires.
Je n'oublierai jamais le premier qu'elle
nous fit entendre. Que de choses peut exprimer un
simple lied ! Heureusement j'étais dans
l'ombre ! personne ne put s'apercevoir de mon
émotion. Des souvenirs m'assaillirent en
foule ; pas tous accusateurs, mais aussi de
chers et purs souvenirs : Agathe dans notre
enfance ; la
lande où si souvent s'était
calmé le trouble de mes sens et de mes
pensées ; le vieux tilleul au bord de
la Dalke, où nous inscrivions nos noms
d'écoliers. 0, Elisabeth ! entendre ta
voix toujours, toujours ! Ce serait la paix
pour mon coeur tourmenté.
En quittant la cure, j'accompagnai mon
chef chez lui, puis je m'acheminai au clair de lune
vers la lande pour réfléchir dans la
solitude à ce qui venait de m'arriver. Pour
la première fois depuis que j'avais
quitté ma soeur, je m'étais
trouvé dans la société d'une
jeune fille pure. J'avais rencontré sur ma
route des femmes en grand nombre. Certaines d'entre
elles devraient implorer mon pardon ; elles
m'ont entraîné dans le mal. La plupart
auraient le droit de m'accuser de leur
dépravation, quelques-unes dont j'ai
corrompu l'innocence et deux surtout avec
lesquelles je m'imaginais que notre liaison
était vraiment de l'amour ; j'en avais
pris le ton pendant quelque temps. Quelque
temps ! ... ces deux mots indiquent ce
qu'était cet amour. Ces deux malheureuses
m'ont oublié ; je l'espère pour
elles... Qu'elles se félicitent de mon
infidélité, et qu'elles estiment
l'heure où elles l'ont apprise comme la plus
heureuse de leur vie.
D'où provenait l'émotion
que je ressentais ce soir-là, Elisabeth, en
me promenant avec ton image dans le coeur ? Ce
n'était ni de la sensualité, ni de
l'amour. J'en repoussais avec effroi la
pensée, de crainte de te profaner.
C'était une humble admiration, une
vénération infinie. Tu m'apparaissais
comme l'opposé, de moi-même :
chez moi, souillure et fange ; chez toi,
pureté immaculée ; sur ma vie,
des ténèbres ; sur la tienne,
une vive lumière. Durant cette nuit dans la
lande, tu n'étais pas tout près de
moi. Je te voyais au loin, sur des hauteurs
éclairées par la lune.
Mes regards s'attachaient à toi
comme ceux du marin, par une nuit de tempête,
s'attachent au phare du port sauveur ; je
soupirais après toi comme le naufragé
soupire après le rivage où il
trouvera un asile. J'étais le marin perdu
dans la tempête ; j'étais le
naufragé. Autour de moi, une mer en furie,
la ruine, la perdition. Auprès de toi, sur
les hauteurs, Elisabeth, je trouvais le
salut...
Comment ne pas t'invoquer durant cette longue
nuit ? Âme
vierge de jeune fille, séjour de la
pureté, beauté parfaite,
mystère insondable
À l'aube, je quittai la
lande ; je passai devant, le
presbytère, non comme, un amoureux, en
envoyant inaperçu un salut matinal à
celle qu'il aime ; non, je jetai seulement un
timide regard dans la cour, en pensant avec bonheur
que l'entrée de la maison m'étais
désormais permise. Tu le sais, Elisabeth, je
ne cherchai point à me rapprocher de toi en
m'informant de tes sorties afin de te rencontrer
à seule, selon la coutume des adorateurs
secrets, et je ne fis qu'un usage
modéré de la permission d'aller
à la cure. Ton image vivait au fond de mon
coeur, mais, sois-en persuadée, jamais un
seul instant je ne l'ai profanée ; elle
épurait mes sens et sanctifiait mon
âme. Lorsque, dans mes nuits d'insomnie, des
pensées coupables venaient m'assaillir,
comme de noirs vampires, pour sucer de mon coeur
les dernières traces de vertu,
j'évoquais ton image et les mauvais esprits
s'enfuyaient. Le matin, je m'éveillais en
pensant à toi et je prenais de sages
résolutions ; je te sentais près
de moi pendant mon travail et je
l'accomplissais consciencieusement et avec
zèle ; mais jamais je n'ai tendu la
main vers toi, jamais cherché des rapports
intimes avec toi. En aucune occasion, nos
entretiens ne dépassaient les limites d'une
bonne camaraderie ; mais ainsi que parfois les
paroles d'une mère à son enfant ont
un sens profond, de même, nos conversations,
malgré leur insignifiance,
révélaient l'accord de nos
âmes.
Dans ces excursions du dimanche, nos
tête-à-tête se
multiplièrent et semblèrent tout
naturels. Cependant, selon l'habitude des petites
villes, on ne tarda pas à en causer dans le
public ; mais on avait pour Elisabeth tant
d'estime et d'affection que tout jugement
défavorable fut exclu d'emblée. Le
commérage, du reste, n'est pas toujours
méchant dans les petits centres. À ce
que j'appris plus tard, nous passâmes
très vite dans l'opinion pour être
fiancés. Elisabeth, ses parents et moi, nous
n'eûmes pas le moindre soupçon de ces
bruits; ils m'étonnèrent quand j'en
eus connaissance, car jamais nous n'avions
dépassé dans nos relations les bornes
que j'ai indiquées plus haut et jamais je
n'avais hasardé un mot ressemblant à une
déclaration. Le bonheur de me promener
à côté d'Elisabeth était
si grand que je ne désirais rien de
plus.
Souvent, quand, fatigués par la
chaleur, les autres se reposaient sur la mousse,
nous allions, elle et moi, dans la forêt.
Assis parfois au bord d'une route, absorbés
et silencieux, peut-être suivions-nous tous
deux la même pensée ! Ensemble,
nous gravissions au coucher du soleil quelque
colline de sable pour voir au loin les fermes et
les villages.
Le soir, au retour, nous cheminons dans
la brume, sous les saules, le long du fleuve. Tu me
priais souvent, Elisabeth, de te raconter les jours
heureux de ma vie. Je te parlais alors de notre
maisonnette au bord de l'Elbe, de mon vaillant
père, de ma douce et bonne tante, de tout ce
qui concernait ma soeur bien-aimée.
Quelquefois, en te parlant, il me semblait
être avec Agathe à regarder l'Elbe de
notre fenêtre. Je me retrouvais dans cette
chère demeure, si longtemps laissée
dans l'oubli. Les cordes du bien résonnaient
dans mon âme. Une pure et noble femme peut
les faire vibrer, même quand elles sont
détendues et discordées. Merveilleuse
influence, celle de la
femme ! Ayons de nobles et pures compagnes et
nous deviendrons des hommes purs et nobles.
Le dimanche, au retour de notre
excursion, nous étions presque toujours
invités, le juge et moi, à souper
chez le pasteur. Le couvert était mis sous
un vieux tilleul, devant la maison, et l'on se
reposait avec délices en repassant les
incidents de la journée. Le vent de la lande
rappelait au pasteur une vieille histoire ; le
clair de lune remémorait au juge une joyeuse
aventure de sa vie d'étudiant et chacun
d'eux nous faisait un spirituel récit.
Inspirée par le chant tardif d'un oiseau,
Elisabeth nous chantait ses plus beaux lieds. Ni le
vent de la lande, ni le clair de lune, ni l'oiseau
attardé ne me faisait conter ou chanter. Il
me fallait apprendre à me taire.
Jusqu'alors, j'avais eu le verbe haut dans les
réunions ; mais c'était à
Munich, à la Grotte bleue, et non à
la cure dans la petite ville de la lande.
La semaine, je voyais rarement Elisabeth
que les soins du ménage occupaient du matin
au soir. Je la rencontrais seulement, par hasard,
dans la rue quand elle allait aux emplettes. Elle
répondait
à mon salut avec un sourire qui me
disait : « À
dimanche ! »
Le soir, mon travail fini, les
« actes » remis en ordre, le
bureau fermé derrière moi, je
t'emmenais en pensée dans la lande,
Elisabeth. Nous cheminions le long du fleuve ;
nous prenions le sentier sous les sapins
jusqu'à la colline d'où la ville,
disparaissant aux regards, on ne voyait plus que la
vaste et paisible campagne. J'aimais à me
représenter des circonstances dans
lesquelles je pourrais te donner des marques de mon
infinie reconnaissance, de ma profonde
vénération. Par le mauvais temps,
J'imaginais la joie que j'aurais à me
dépouiller de mon manteau pour t'en
envelopper. Plus tard, que de fois J'ai
pensé à mes promenades solitaires du
soir et au bonheur que j'y trouvais. Je vois encore
tous les sentiers où je marchais seul avec
ton image dans le coeur, Elisabeth. Ah ! que
ce chemin était court et lumineux
comparé à la sombre et longue route
que j'avais parcourue auparavant ! il
m'appartient ce chemin si court. Que personne ne me
le prenne ! qu'il reste toujours libre et en
pleine lumière ! Arrière, ombres mauvaises du
passé !
Vous n'y avez aucun droit,
L'été s'écoula,
chaque semaine semblable à la
précédente, le dimanche m'apportant
la joie. Cela aurait pu durer longtemps
ainsi ; mais bientôt le jour vint
où ce modeste bonheur subit un changement.
Je n'en ai pas oublié la cause.
Le premier dimanche de septembre nous
fîmes une promenade ravissante par un temps
radieux. Le lundi survint une tempête. Ce
soir-là, le travail se prolongea plus que de
coutume au bureau. Il faisait nuit quand je le
quittai. La lande disparaissait sous une brume
grise ; un vent froid, précurseur de
l'hiver, balançait les aulnes ; les
premières feuilles tombaient dans la
rivière dont, elles descendaient lentement
le courant. Des pensées sombres
m'assaillirent. Depuis six mois dans cette ville,
J'y avais donc fait la moitié de mon
séjour, car, d'habitude, un
référendaire n'y restait pas plus
d'une année.
Qu'ils avaient été riches
ces six mois embellis par mon secret et paisible
bonheur ! Mais que m'apporterait
l'avenir ? que deviendrais-je lorsqu'il
faudrait reprendre mon bâton de voyage ?
Faudrait-il recommencer mon inutile et sombre
vie ?... Elisabeth remplissait ma
pensée ; mais il me semblait être
avec elle pour la dernière fois ; puis
il faudrait la quitter pour m'en aller plus
loin.....
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
