
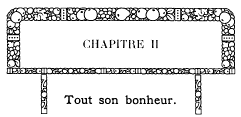
Voici son récit :
Mon foyer paternel était à
Hambourg, mais non dans le bruyant quartier de
Saint-Paul où l'on trouve souvent le plaisir
et la gaîté, rarement le bonheur. Mon
père s'était bâti une petite
maison du côté de l'ouest, où
la ville s'étend en longues rues solitaires.
De cette maisonnette, située au bord de
l'Elbe, le regard planait au loin sur le fleuve,
sur les coteaux paisibles et sur les hauteurs de
Blankenese.
Mon père étant marin, sa
demeure, évidemment devait être au
bord de l'eau.
Il fut nommé capitaine de la
marine marchande le jour même où je
vins au monde. Ma naissance fut chèrement
achetée : elle coûta la vie
à ma mère. Le jour des trois rois, à la lueur d'un
splendide
coucher de soleil sur l'Elbe, elle se fit apporter
son nouveau-né, mit sa main fatiguée
dans celle de son mari et s'endormit du sommeil
éternel.
Je perdais beaucoup d'amour, mais
beaucoup d'amour me restait. Mon père avait
une soeur. Pour elle et ses pareilles, les gens
sans coeur ont trouvé, l'appellation de
vieille fille. Pourquoi ce monde haineux et stupide
en aurait-il inventé une plus digne ?
Il ne voit pas les fleuves d'amour que nos soeurs
non mariées répandent sur notre
froide terre, apportant ainsi dans les recoins
obscurs de maintes vies humaines, des rayons de
soleil et la paix du coeur. La soeur de mon
père était une de ces âmes
riches qui sèment leurs richesses autour
d'elles. Elle avait pour nous un trésor
inépuisable d'amour. En cette soirée
d'hiver où l'Elbe murmurait son chant
d'adieu à ma pauvre mère, ma tante se
tenait debout, immobile au pied de sa couche. Ces
deux femmes échangeaient, leurs
regards ; ils exprimaient chez l'une, une
ardente prière, une promesse sacrée
chez l'autre. La mourante y puisa une consolation
pour son dernier voyage, l'autre, la force nécessaire
pour sa
tâche de dévouement et d'amour. Tante
Marie a été une vraie mère
pour nous.
Mon père était un homme de
belle stature. Je le vois encore sur le pont de son
vaisseau, l' « Elsa » nous
faisant ses derniers signes d'adieu au moment de
quitter la patrie. Il était d'une ancienne
race de marins. Les traditions de sa famille
remontaient au temps de la ligue
hanséatique. Malgré la rudesse de sa
profession, il avait un caractère doux, un
coeur tendre. Jamais chez nous, ce qui était
fréquent autre part, le séjour du
père dans sa famille, au retour de ses
voyages, n'assombrissait la gaîté de
son fils.
D'un an plus âgée que moi,
Agathe, ma soeur, était le soleil de notre
intérieur, un ange que Dieu m'avait
donné pour remplacer ma mère et me
préserver du mal de ce monde. Sa tendresse,
si pure, s'élevait comme un rempart autour
de mon coeur passionné. Une de mes plus
grandes fautes est d'avoir cherché à
franchir ce mur protecteur. Je me rappelle l'effet
des regards d'Agathe sur mon âme ; je
sens encore la tendre pression de sa main, plus
puissante que des chaînes de fer pour me retenir
dans la
bonne
voie. Tout cela est passé, fini. La main
d'une soeur ne peut plus me sauver. Agathe m'aime
aujourd'hui comme jadis, je le sais ; mais son
regard triste et las m'a dit, il y a longtemps
déjà, qu'elle aussi me croit
irrévocablement perdu.
Durant les voyages de mon père,
qui le retenaient au loin les trois quarts de
l'année, nous formions un heureux et
paisible petit cercle, ma tante, ma soeur et moi.
Mes plus lointains souvenirs me reportent à
une belle matinée d'hiver. Ma tante
enseignait le tricot à ma soeur assise
à ses pieds sur un tabouret. Je m'amusais
à faire disparaître les fleurs
dessinées par le gel sur la fenêtre,
et d'un oeil ravi, je regardais le paysage à
travers les petits espaces devenus libres dans les
vitres, sous ma chaude haleine. Bientôt je
suppliai ma tante de nous laisser sortir. Elle y
consentit et nous enveloppa de nos manteaux. Nous
suivîmes le fleuve dont la surface
gelée luisait sous les rayons du soleil. Les
collines neigeuses de Blankenese
étincelaient. Quelle splendeur !
J'entends encore mes cris de joie à la vue
de tout cet éclat. Bonheur d'enfant !
bonheur de vivre !
Et nos soirées ! Je vois
tante Marie assise près du
poêle ; ses traits réguliers sont
beaux encore, ses mains adroites font un
délicat ouvrage, ses yeux doux et calmes,
reflètent la bonté de son coeur. Je
vois ma soeur bien-aimée ; assise dans
sa petite chaise, elle s'appuie sur ma tante et
tient dans ses mains mignonnes son
abécédaire neuf où ses yeux
brillants cherchent à pénétrer
le secret des lettres. Toutes deux sont
absorbées par leurs occupations. Pourtant
elles lèvent parfois la tête pour me
regarder jouer et pour voir si je n'ai besoin de
rien. Une enfant encore, Agathe aussi jouait
volontiers, mais surtout pour faire plaisir
à son frère. Jamais je n'oublierai
non plus l'heure du crépuscule. Tante
s'occupait à la cuisine ou avait affaire en
ville.
Nous étions seuls, ma soeur et
moi, et nous regardions de la fenêtre le
paysage silencieux dans le jour mourant. Agathe me
donnait mes premières leçons de
choses. Me montrait la rive opposée de
l'Elbe, voilée à demi par la brume du
soir, elle m'apprenait que, là-bas aussi, il
y avait des habitants et, me disait, que
peut-être des enfants comme nous
étaient dans une maison, à une
fenêtre et regardaient de
notre côté. En m'indiquant des bateaux
qui descendaient le fleuve :
- L'eau devient de plus en plus large,
affirmait-elle, et puis elle n'a plus de rives,
plus du tout, père me l'a dit.
J'étais tout oreilles à
ses récits ; je n'en avais jamais assez
et quand ma tante allumait la lampe, je croyais
revenir d'un lointain voyage.
Tante Marie avait vu beaucoup de choses
et de gens dans sa vie. Orpheline toute jeune, elle
n'avait pu rester avec son frère, notre
père, qui devait faire tout seul son chemin.
L'existence d'une jeune fille isolée est
pleine de difficultés et de périls.
Les gens de ma sorte se chargent de placer des
épines et des ronces sur sa route. Les don
Juan sont de dangereux oiseaux de proie surtout
s'ils ont le coeur tendre et savent feindre la
pitié. L'intérêt, la
pitié qu'ils témoignent aux jeunes
filles pures sont pour elles des pièges
redoutables. Plus tard j'ai compris pourquoi ma
tante suivait parfois Agathe de si
mélancoliques regards. Un jour, assise
près de la table, ma soeur luttait de ses
petits doigts avec un ouvrage embrouillé.
Son ardeur au travail faisait
luire ses yeux et colorait ses joues. Les mains
oisives, tante occupant sa place accoutumée
regardait la fillette avec un profond
intérêt mais d'un air si triste
qu'elle semblait lui dire :
« pauvre, pauvre
enfant ! » Dieu merci, ses
douloureuses appréhensions ne se sont jamais
réalisées ! Son regard d'inquiet
pressentiment aurait dû plutôt se poser
sur moi ; mais elle n'avait pour son neveu que
des regards d'orgueil maternel et de joie
confiante.
De même, que notre
intérieur, notre rue était paisible.
Des gens isolés l'habitaient ; pour la
plupart de vieux couples, n'ayant plus d'enfants
autour d'eux. En été les vieilles
gens apportaient des chaises devant leurs maisons
et s'entretenaient au travers de la rue, en hiver
absolument déserte.
Nous n'avions pas de relations. Avec le
temps, nous avions perdu de vue, dans le tumulte de
la grande ville, les parents peu nombreux de mon
père. Plus tard, j'entendis parfois
mentionner l'un ou l'autre d'entre eux, comme
ruiné par sa vie
déréglée. Dans mon enfance je
ne souffrais pas de notre isolement ;
cependant j'éprouvais une joie intense lorsque
tante Marie
nous
envoyait tous deux faire quelque emplette au loin
dans la grande ville. La foule nous
ébahissait et nous amusait, les boutiques
nous ravissaient. Nous cherchions de nouveaux
chemins pour revenir à notre paisible rue,
et le soir, quand on allumait les
réverbères, nous hâtions le pas
pour rentrer chez nous. De tous les gens
pressés de regagner leurs foyers nous
étions bien les plus heureux de retrouver le
nôtre. Qu'elle était confortable notre
chambre de famille avec ses bons meubles
démodés ! Je les vois
tous : l'antique armoire dont les rayons
inférieurs étaient consacrés
à nos jouets ; la grande pendule,
apportée par ma mère de son pays
rhénan. La sonnerie s'en faisait entendre
trois maisons plus loin. Elle était depuis
des siècles dans la famille de ma
mère et j'y tenais beaucoup. Pendant que
tante écrivait et que ma soeur brodait, son
tic-tac me racontait maintes histoires sur les gens
et les choses des temps passés.
Tante Marie était une pieuse
femme. Quand le samedi, à six heures du
soir, les cloches sonnaient pour préparer
les âmes au recueillement du dimanche, le
travail devait être terminé dans notre petit
ménage. Nous allions an bord de l'Elbe
écouter les cloches. Des marins, sur leurs
gabares, répétaient des chants
inspirés par la paix du sabbat. Des gens
sérieux quittaient en hâte la foule
bruyante, pour jouir chez eux du repos
annoncé par les cloches. Des enfants
allaient attendre leurs parents à la sortie
du travail et revenaient avec eux en faisant de
beaux plans pour le dimanche. L'air heureux de tous
ces groupes me réjouissait et, pour en
exprimer mon plaisir, je me mettais à
gambader à côté de ma soeur.
Alors, de sa voix douce, elle me
disait :
- Attends d'être à la
maison pour gambader.
Désirant nous intéresser
et nous amuser plus encore le samedi soir que les
autres jours, tante Marie puisait dans le riche
trésor des légendes
chrétiennes et nationales et y trouvait de
belles histoires à nous raconter :
actions remarquables, combats
héroïques. Les anciens jeux d'enfants
avaient aussi pour nous un puissant
attrait.
Mes regards, souillés maintenant
par des spectacles obscènes, ne se posaient
alors que sur des choses et des
êtres purs et bons. Mes oreilles,
habituées aujourd'hui aux entretiens du
vice, écoutaient avidement jadis les
récits des grandes et nobles
actions.
Voix perdues, muettes pour moi
désormais ! À peine si j'entends
encore ma tante nous lire la prière du soir
dans un vieux livre de piété, qui
nous venait d'un arrière-grand-père,
hardi marin dont le navire avait doublé
vingt et une fois le cap de Bonne-Espérance.
Ce livre l'avait toujours accompagné et
contenait de nombreuses annotations de sa main,
mentionnant des tempêtes et des heures de
détresse sur une mer en furie. Plusieurs
passages y étaient soulignés. Je les
savais tous par coeur. Mon imagination d'enfant
joignait une histoire à chacun
d'eux.
La dernière de ces annotations,
dernier voeu, dernière prière,
s'adressait à mon père qui naviguait
alors sur des eaux lointaines. Nous faisions, en
nos coeurs, les mêmes voeux pour lui. Il le
savait, notre père, et la pensée de
notre fidèle affection mettait un rayon de
soleil sur chacun de ses jours.
À un étage, comme toutes
celles des marins, notre maison avait des mansardes dont
les fenêtres donnaient
sur l'Elbe. C'étaient nos chambres à
coucher. Ah ! si je pouvais encore y passer de
paisibles nuits ! Si du moins mon âme
pouvait s'endormir pour toujours en emportant
l'image de ces temps ! Elle demeure
indélébile dans mon souvenir et me
fait sentir la profondeur de ma
dégradation.
Je me vois à la fenêtre de
notre maisonnette, garçon sans tache alors,
contemplant l'Elbe éclairée par la
lune. Des remorqueurs sont à l'ancre au
rivage. Du côté hanovrien, les
collines de la lande se perdent dans la brume et
attirent mon âme pure au pays des
rêves. Je vois aussi ma tante, près de
mon lit me donnant sa bénédiction.
Combien de coupables efforts m'a-t-il fallu pour en
détruire l'effet ! Anéantir le
souvenir béni d'une fidèle et pure
affection est une des oeuvres les plus lentes, les
plus difficiles de l'homme déchu. Un
innocent arrivant au milieu d'une jeunesse
dépravée, se dirait :
« Ces gens en ont fini avec le
passé ; leurs coeurs en sont
détachés ; leurs regards
insolents, leurs entretiens légers, leurs
yeux troubles ne parlent que de leur
misérable présent ».
Cette apparence est trompeuse :
dans la solitude et le silence de la nuit, ces
jeunes égarés recommencent l'oeuvre
difficile d'ensevelir leur passé de
pureté. Elle n'a pas de fin cette oeuvre. Ce
passé se dresse toujours hors de la tombe
où ces pauvres fous, tâchant de
l'ensevelir, lui crient :
- Arrière ! images
importunes ! que me voulez-vous ? Je vous
croyais depuis longtemps disparues !
Je veux vous parler maintenant des jours
les plus heureux de mon passé : ceux de
l'école. Nous y entrâmes à la
même époque, ma soeur et moi.
Jusque-là, ma tante nous avait donné
elle-même les leçons
nécessaires ; elle s'y entendait et fit
de nous des écoliers dociles. Agathe fut
mise dans une école du voisinage, moi, au
collège. Pour y aller, il me fallait prendre
un des nombreux vapeurs qui aident à la
circulation dans cette grande ville. Je faisais mon
repas de midi chez un de mes professeurs, un ancien
ami de mon père.
Les souvenirs de mes premières
années de collège sont effacés
pour la plupart. Un seul me reste,
indélébile : mon retour à
la maison.
Mon bateau débarquait tout
près de notre maisonnette. Je la voyais de
fort loin, et, de loin aussi, une figure sur le
débarcadère : ma soeur !
... chaque jour, elle venait m'y chercher.
Après mes diverses leçons et ma lutte
avec les mots latins, suivies de mon long trajet de
retour, je me faisais l'effet d'un guerrier
victorieux. Ce sentiment d'orgueil ne
m'empêchait pas de sentir une vive et tendre,
reconnaissance pour ma soeur, dès que je
l'apercevais sur la rive.
O, ma soeur, quel
dévouement ! Dans les brûlantes
après-midi d'été, belle et
fraîche comme une fleur, tu m'attendais sur
le quai, malgré, l'odeur suffocante du
goudron et des vieux cordages. Dans la brume
hivernale, ta présence m'annonçait de
loin le confort et le repos de notre foyer. Les
jours de pluie ou de neige, un vent glacé
jouait avec tes boucles dorées, mais il
n'altérait pas la grâce de ton
sourire, et ne diminuait pas la tendresse de ton
accueil. Tous les hommes du port te connaissaient.
Chacun te disait : « Bonjour ma
petite demoiselle ! » Et l'on
n'entendait pas de jurons alors au
débarcadère. Nous prenions le chemin
de la maison en nous donnant la
main et ma soeur, heureuse de me retrouver,
écoutait avidement le récit des
événements de ma journée et
approuvait d'un sourire les idées et les
plans que je lui soumettais. Non, jamais je
n'oublierai tout-à-fait ces choses !
Plus tard quand, après une nuit d'orgie, je
rentrais dans mon logis solitaire, cette image de
ma soeur m'attendant sur le quai m'apparaissait
tout à coup. Mon coeur coupable et
tourmenté la voyait devant moi, dans
l'obscurité, me tendant la main et me
souhaitant, comme autrefois, la bienvenue.
Après ce rêve d'un instant, je passais
souvent des heures, assis dans les
ténèbres, à pleurer mon
bonheur perdu, et, dans mes longues nuits
d'insomnie, je me demandais :
« Pourquoi l'ai-je perdu, mon
bonheur ? Ne pouvait-il en être
autrement ? »
Non, je ne veux pas et je ne puis pas
détruire ces images. À Cologne,
pendant le carnaval, je me suis laissé
entraîner dans le tourbillon des
voluptés. J'ai connu des heures où la
conscience et l'honneur n'existent plus, où
la boue et l'ordure priment tout. Mais au milieu de
ce tourbillon, ces souvenirs, revenant à ma
mémoire, calmaient mon
ivresseet m'amenaient pour un
instant dans notre maison de l'Elbe. À la
vérité, ils ne réussissaient
pas à m'arrêter sur le bord de
l'abîme où j'allais me
précipiter, ils m'en faisaient seulement
apercevoir la profondeur..... Ensuite je
recommençais à boire à longs
traits à la coupe empoisonnée des
voluptés..... Il me fallait oublier.....
oublier à tout prix !
Mais je ne veux pas les oublier ces
souvenirs ; non, jamais ! Malgré
les tourments qu'ils me causent, ils sont mon
unique bonheur. Depuis longtemps la maison des
bords de l'Elbe n'est plus à nous. Mon
père et ma tante sont morts ; Agathe a
trouvé un nouveau foyer. Mais une force
irrésistible m'attire encore vers l'ancien
abri de notre paisible vie et, chaque fois que je
vais à Hambourg, je me rends le soir
près de cette chère maisonnette.
Caché dans un coin obscur je la contemple
longtemps. En été, mes regards
s'attachent à la fenêtre où
Agathe et moi nous faisions nos projets enfantins.
En hiver, malgré les tempêtes
glacées, j'attends que la lumière
paraisse dans la grande chambre pour y retrouver
à la lueur de la lampe, tous mes chers souvenirs.
Quelques heures passées en ce lieu, au moins
une fois chaque année, seront ma seule joie
pour le reste de ma vie.
Jamais je n'oublierai ce
temps-là ; mais je ne veux pas croire
que la fidélité de ce souvenir prouve
en moi un dernier reste de pureté ; je
méprise ceux qui prennent leurs remords pour
de la vertu. Le souvenir n'a pas une si grande
valeur ; il n'est que la dernière joie
des êtres perdus. La vieille femme dit
à la jeune fille : « Moi
aussi j'étais jadis jeune et
belle ! » L'être
dépravé peut crier aux heureux
restés purs : « Moi aussi
j'étais autrefois comme
vous ! »
Mon compagnon n'alla pas plus loin, ce
soir-là, dans son récit. Peu à
peu la violence de sa plainte s'était
apaisée ; il avait parlé moins
rapidement et d'une voix plus douce.
Fatigué, il s'appuya dans son fauteuil.
J'avais un vrai besoin de lui dire quelques paroles
encourageantes, mais je sentis en cette occasion
combien il est difficile de parler à la
douleur. Jamais on ne risque autant de s'attarder
à des banalités que lorsqu'on veut
consoler. L'Eglise catholique fait bien de ne pas
imposer aux
prêtres de discours sur la tombe. Le
chrétien évangélique
cultivé devrait l'interdire par son
testament. Outre quelques autres avantages, ce
serait un égard généreux
vis-à-vis du pasteur qui le conduit à
sa dernière demeure. Mon compagnon eut assez
de délicatesse pour m'aider à
échapper au danger des phrases inutiles et
banales. Au moment où j'allais glisser sur
cette pente, il m'interrompit en me priant de ne
former mon jugement qu'après avoir entendu
sa confession tout entière.
Je profitai de l'occasion pour garder
sagement le silence. Malheureusement, je devais
partir le lendemain pour un voyage d'une semaine.
Je le lui annonçai en pensant qu'il en
serait chagriné ; mais il me dit
tranquillement :
- Je repasserai seul ma triste histoire
je ne puis mieux employer mon séjour ici
qu'à repasser d'un oeil lucide tout le cours
de ma vie. Et il prit congé. Comme sa voix
était lasse en me disant :
« bonne nuit ! » comme la
pression de sa main était faible !
Pauvre pèlerin harassé ! De bon
coeur en te quittant, je te souhaitai une bonne et
paisible nuit.
Ainsi que ce soir-là, je
m'approche aujourd'hui de la fenêtre
après avoir écrit ce qui
précède. La tempête se
déchaîne en cette nuit glacée
d'hiver. Je pense à tous les malheureux qui
errent en cherchant un abri protecteur ; je
pense aussi à ceux qui ont trouvé un
gîte, mais dont l'âme tourmentée
erre dans des sentiers tortueux à la
recherche du chemin qui conduit à la paix.
Je leur souhaite à tous une bonne et
paisible nuit.
| Chapitre précédent | Table des matières | Chapitre suivant |
