
AVANT-PROPOS
-------
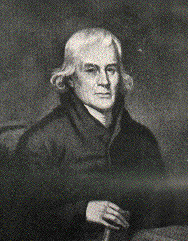
Premier évêque de l'Église méthodiste des États-Unis.
La première idée de ce livre me fut suggérée par le remarquable
article de M. Cucheval-Clarigny, sur Pierre Cartwright ou la
prédication dans l'Ouest, paru dans la Revue des Deux Mondes du 15
août 1859. Je rue livrai à des recherches dans la littérature
américaine sur le sujet et je publiai, dans le Chrétien évangélique,
de Lausanne. en 1863-1864, une étude sur les Prédicateurs-Pionniers.
Ces articles révisés et complétés parurent en 1876, à la librairie
Bonhoure à Paris.
L'édition était épuisée depuis longtemps, et il a
fallu l'initiative des méthodistes épiscopaux du Sud et de leur
Mission de Bruxelles pour provoquer la publication de cette nouvelle
édition. J'ai été heureux de seconder leur intention, en révisant mon
travail et en y ajoutant deux chapitres nouveaux.
MATTHIEU LELIÈVRE.
Sainte-Adresse (Le Havre), 1er septembre 1923.
INTRODUCTION
Origines de l'histoire religieuse des États-UnisOn connaît fort peu dans les pays de langue française l'histoire
religieuse de la grande république du Nouveau-Monde. Peu d'histoires
sont pourtant aussi instructives et aussi dignes d'être connues. Nous
avons pensé que nous ajouterions à l'utilité de cette seconde édition
des Prédicateurs pionniers de l'Ouest américain, en lui donnant comme
introduction l'étude préparée par le même écrivain, sur cette
histoire, pour l'Encyclopédie des sciences religieuses de
Lichtenberger. Il y a, dans ces origines du protestantisme américain,
et dans son influence sur la fondation des libertés des États-Unis,
des pages glorieuses trop peu connues en France et dans les pays de
langue française,
PREMIÈRE PÉRIODE
Temps antérieurs à la Révolution.Découverte par des expéditions espagnoles à la fin du XVe siècle,
l'Amérique fut partagée, par le pape Alexandre VI (1495), entre les
couronnes de Castille et d'Aragon. La bulle pontificale invoquait
l'intérêt des âmes comme motif unique d'une donation, contre laquelle
Grotius protesta plus tard, au nom du droit et de l'Évangile. Elle
était faite « dans le but d'exalter la foi catholique et la religion
chrétienne, et de subjuguer les nations barbares en les amenant à la
foi »; (ut fides catholica et christiana religio nostris proesertim
temporibus exaltelur..., ac barbarae nutiones deprimantur et ad fidem
ipsam reducantur). Sans se laisser arrêter par cet acte de bon plaisir
pontifical, d'autres États européens prirent pied de bonne heure en
Amérique. La France fut la première à avoir des établissements sur ce
continent où elle ne devait pas réussir à s'implanter définitivement,
et les noms de Jacques Cartier, Jean de Ribault, Laudonnière, de Monts
et Champlain figurent avec honneur dans les annales de la
colonisation.
Les réformés français eurent une part importante
dans ces premières tentatives, et il s'en fallut de peu que les
huguenots ne prissent dans l'histoire du Nouveau-Monde le rôle qui
devait échoir aux puritains. Une première expédition organisée par
Coligny (1562-1564) échoua misérablement, et ceux qui la composaient
furent massacrés par les Espagnols. Une nouvelle colonie fondée en
Acadie, au commencement du XVIIe siècle, sous la direction de de
Monts, gentilhomme protestant de la Saintonge, fut ruinée par les
Jésuites et détruite par les Anglais.
Ces derniers furent les vrais colonisateurs de
l'Amérique du Nord. Après y avoir fait planter le drapeau britannique
par Jean Cabot dès 1496, ils attendirent jusqu'au commencement du
XVIIe siècle avant d'entreprendre une oeuvre de colonisation. La
brillante tentative de Sir Walter Raleigh, en 1584, n'eut guère
d'autre résultat que de donner à une partie du continent américain le
nom de Virginie, en l'honneur d'Elisabeth, la vierge reine, et de
frayer la voie aux entreprises sérieuses.
En 1606, Jacques 1er divisa en deux cette partie de
l'Amérique qui devait former le noyau des États-Unis. L'une fut la
colonie du Sud (Virginie), et l'autre celle du Nord
(Nouvelle-Angleterre). Cette division ne fut pas arbitraire; elle
traça la ligne de partage entre deux courants de colonisation et de
civilisation fort distincts et encore reconnaissables aujourd'hui.
C'est la religion, bien plus que la politique ou que le négoce, qui a
fait la nationalité américaine. Il importe donc de montrer ici quelles
influences religieuses présidèrent aux origines des treize colonies
primitives.
Les colonies du Nord, quoique postérieures de
quelques années à la colonisation de la Virginie, méritent d'être
mises au premier rang, parce qu'elles furent le véritable berceau de
la nation. Elles formèrent ce qu'on a appelé la Nouvelle-Angleterre,
cette contrée située au nord-est de l'État de New-York, et qui
comprend les États actuels de Maine, New-Hampshire, Massachusetts,
Rhode-Island, Connecticut et Vermont. Ces diverses colonies, sauf la
dernière, naquirent de 1620 à 1640.
La plus ancienne, à laquelle s'attache un renom
immortel dans l'histoire de l'Amérique, fut celle qui se fonda, en
1620, à New-Plymouth, sur la côte de la baie de Massachusetts. Elle se
composait de puritains qui avaient fui l'Angleterre parce qu'il leur
semblait, comme le dit Milton, que rien ne pouvait les défendre de la
furie des évêques que le vaste Océan et les solitudes sauvages de
l'Amérique. Les Pères pèlerins, comme les a appelés la piété filiale
de leurs descendants, étaient originaires du petit village de Scrooby,
dans le Nottinghamshire, où, depuis 1602, existait une congrégation
d'Indépendants. Harcelés par la persécution, ils se réfugièrent
d'abord en Hollande, sous la conduite de leur pasteur John Robinson
(1608).
Comme les années s'écoulaient sans leur rouvrir les
portes de l'Angleterre, ils se décidèrent, pour demeurer fidèles tout
ensemble à leur patrie et à leur foi, à aller s'établir sur une terre
anglaise où ils fussent à peu près assurés de n'être pas inquiétés
pour leurs croyances. Ils quittèrent la Hollande le 22 juillet 1620,
mais ne s'embarquèrent définitivement à Plymouth pour l'Amérique que
le 6 septembre de la même année. Ils étaient une centaine, y compris
les femmes et les enfants, sur ce petit navire, le May flower, dont le
nom est resté célèbre. Ils abordèrent, après une traversée de deux
mois et demi, au cap Cod, sur une plage froide et aride, à laquelle
ils donnèrent le nom de New-Plymouth. Avant de débarquer, les pèlerins
rédigèrent un contrat, dans lequel les citoyens américains aiment à
voir le premier germe de leurs institutions républicaines. Il était
ainsi conçu:
« Au nom de Dieu, ainsi soit-il. Nous soussignés,
les fidèles sujets de notre redoutable seigneur, le roi Jacques, par
la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, d'Écosse, etc., ayant entrepris
pour la gloire de Dieu, l'avancement de la foi chrétienne, l'honneur
de notre foi et de notre patrie, un voyage à l'effet de fonder la
première colonie dans le nord de la Virginie, reconnaissons
solennellement et mutuellement, en présence de Dieu et l'un en
présence de l'autre, que, par cet acte, nous nous réunissons en un
corps politique et civil pour maintenir entre nous le bon ordre et
parvenir au but que nous nous proposons. Et en vertu dudit acte, nous
ferons et établirons telles justes et équitables lois, telles
ordonnances, actes, constitutions, et tels officiers qu'il nous
conviendra, suivant que nous le jugerons opportun et utile pour le
bien général de la colonie. Moyennant quoi, nous promettons toute due
soumission et obéissance. En foi de quoi, nous avons signé ci-dessous,
l'an du Seigneur 1620, le Il novembre. » (vieux style.)
Ce fut sur ces bases à la fois religieuses et
libérales que les pèlerins fondèrent, au milieu de toutes sortes de
difficultés, cette première colonie, mère de toutes les autres. Leur
régime politique, emprunté au système ecclésiastique des Indépendants,
fut la démocratie pure; les lois étaient discutées et votées par
l'Assemblée plénière des citoyens, comme aussi les affaires de
l'Église. « Une seule idée, dit M. Laboulaye, avait conduit ces
émigrants dans le Nouveau-Monde, celle de fonder une pure Église.
Cette seule idée leur a suffi pour établir une colonie au milieu
d'obstacles qui eussent glacé l'âme d'hommes ordinaires, malgré la
faim, le froid, la maladie, les Indiens, les bêtes sauvages. S'ils ont
conquis ce sol ingrat, s'ils ont ouvert la voie à ce vaste courant
d'émigration qui ne s'est point arrêté depuis plus de deux siècles,
c'est que la foi les a soutenus au milieu des périls et des ennuis de
la solitude, et leur a donné cette force qui transporte les montagnes
et féconde les déserts. » (Laboulaye, Histoire des États-Unis, t. 1,
p. 141.)
Ce fut en 1629 que se produisit le second exode
puritain qui fonda la colonie du Massachusetts, dans laquelle se
fondit plus tard celle de Plymouth. Cette émigration fut beaucoup plus
considérable que la première, tant par le nombre de ceux qui en
faisaient partie que par leur position sociale. Elle obtint de Charles
1" une charte fort libérale, qui se taisait, il est vrai, sur la
question de la liberté religieuse; mais ce silence n'était pas fait
pour gêner beaucoup les puritains. Leur but est clairement indiqué
dans les instructions envoyées par la corporation anglaise à Endicott,
qui fut le premier gouverneur: « La propagation de l'Évangile, y
est-il dit, est l'objet que les sociétaires ont surtout en vue en
établissant la colonie. » Dès leur arrivée, en effet, ils
constituèrent l'Église, avant même d'avoir posé les fondements de
l'État. Leur organisation ecclésiastique, essentiellement égalitaire,
servit de type à leur organisation politique, qui fut une démocratie
représentative jusqu'au moment où leur charte fut révoquée (1684). En
quelques années, des milliers de puritains, appartenant aux classes
moyennes ou à la petite noblesse, vinrent renforcer ce premier noyau;
Salem, Boston, Dorchester furent fondées, et avec elles la colonie qui
allait prendre la direction morale et religieuse de l'Amérique du
Nord.
La colonie du Connecticut fut fondée en 1633 par
des Puritains de New-Plymouth, suivis bientôt par leurs frères du
Massachusetts. Les commencements furent difficiles, à cause de
l'opposition des Indiens, contre lesquels les colons durent prendre
les armes.
La colonie de New-Haven, qui se fondit plus tard
dans celle du Connecticut, fut l'oeuvre d'un ministre puritain, John
Davenport, et d'un riche négociant de Londres, Théophile Eaton, qui
arrivèrent d'Angleterre en 1638, dans l'intention de créer un État
dont la constitution fût encore plus strictement biblique que celles
des autres établissements puritains.
Rhode-Island dut aussi sa colonisation à une
émigration partie du Massachusetts. Un jeune pasteur de Salem, Roger
Williams, n'avait pas craint d'attaquer vivement les principes
théocratiques sur lesquels reposait la colonie puritaine. Ses idées de
liberté religieuse étaient tellement en avance sur celles qui
régnaient autour de lui qu'elles lui attirèrent des persécutions qui
aboutirent même à un arrêt de bannissement. Williams se réfugia chez
les Indiens Narragansetts, auxquels il avait rendu des services et qui
le traitèrent en ami. En 1636, il fonda la ville et la plantation de
Providence, dont il fit un asile ouvert « à toutes sortes de
consciences », et où ne tardèrent pas à le rejoindre un certain nombre
de ses fidèles de Salem. Deux ans plus tard, la controverse
antinomienne amena de nouveaux proscrits du Massachusetts qui
créèrent, dans le voisinage de Roger Williams, un établissement où ils
voulaient librement professer et pratiquer leurs croyances. Cette
colonie prit le nom de RhodeIsland, et ce nom réunit bientôt, sous un
même régime de liberté civile et religieuse, ces deux émigrations
qu'animait un même esprit. Une charte, que Williams alla solliciter à
Londres, vint donner au nouvel établissement le titre légal qui lui
avait d'abord manqué, et sanctionner « une pleine et entière liberté
de conscience ».
Les colonies du Maine et du New-Hampshire durent
leur origine à des épiscopaux, jaloux de voir la Nouvelle-Angleterre
tout entière aux mains des puritains. Mais ces essais de colonisation
entrepris par le capitaine Mason et sir Ferdinando Gorges échouèrent
misérablement, et ce fut encore aux puritains qu'incomba la tâche de
coloniser ces régions.
Toutes ces colonies du Nord, connues de bonne heure
sous le nom de Nouvelle-Angleterre, furent filles, on le voit, du
grand mouvement non-conformiste du dix-septième siècle. Elles
donnèrent naissance à un peuple d'un caractère distinct et d'une
physionomie fortement accusée, qui a marqué de son empreinte la
nationalité américaine.
Les colonies du centre (Maryland, Delaware,
Pensylvanie, New-Jersey, New-York) eurent des origines fort diverses,
parmi lesquelles les préoccupations religieuses eurent aussi leur
part.
La colonisation du Maryland fut l'oeuvre de lord
Baltimore, gentilhomme catholique, qui voulut en faire un refuge pour
ses coreligionnaires persécutés. La charte octroyée par Charles II, ne
garantissait, il est vrai, d'après Hildreth, « aucune tolérance pour
un culte non autorisé par la loi anglaise »; mais c'était là une
concession faite aux préjugés régnants en Angleterre, et en fait, la
colonie fondée par lord Baltimore et son fils en 1633 fut bien
catholique, au moins à l'origine, comme les colonies de la
Nouvelle-Angleterre furent puritaines. Les premiers colons qui
débarquèrent dans une île du Potomac, en prirent possession « au nom
de leur Sauveur », en même temps « qu'au nom de leur roi ».
L'État actuel de New-York doit sa fondation aux
Hollandais, qui appelèrent la ville Nouvelle-Amsterdam et la province
Nouvelle-Hollande. La Hollande d'Amérique, comme celle d'Europe, se
montra hospitalière aux proscrits et pratiqua la plus grande tolérance
religieuse. Aussi vit-on se produire un vaste courant d'émigration qui
amena d'Europe un grand nombre de puritains et de huguenots. Ces
derniers accoururent en foule après la prise de La Rochelle et
fondèrent la Nouvelle-Rochelle. Vers le milieu du XVIIe siècle, ils
étaient si nombreux que les actes de la colonie se publiaient en
français aussi bien qu'en anglais et en hollandais. Au commencement du
XVIIIe siècle, d'après Smith cité par Bancroft (Il, 302), ils
formaient, après les Hollandais, la partie la plus considérable et la
plus riche de New-York. Le docteur Miller (Hist. of the Evang. Ch. of
N. Y.) raconte que les huguenots de la Nouvelle-Rochelle, pour
assister au culte public, franchissaient à pied, dans la nuit du
samedi au dimanche, les seize milles qui les séparaient de New-York,
où se trouvait leur temple. Et quand ils avaient assisté à deux
services, ils regagnaient leurs demeures dans la soirée du dimanche.
Le New-Jersey, cédé par le gouvernement anglais à
lord Berkeley et à sir George Carteret, fut colonisé en partie par des
quakers, qui venaient eux aussi demander à l'Amérique le droit de
professer librement leur foi, en partie aussi par des presbytériens
chassés d'Écosse par la persécution. Le fond de la population fut, dès
l'origine, essentiellement religieux et moral.
Le Delaware dut sa fondation à une généreuse pensée
de Gustave-Adolphe, qui voulait faire de la Nouvelle-Suède un refuge
ouvert aux protestants persécutés. Une émigration assez considérable
de Suédois se produisit, jusqu'au moment où la petite colonie,
abandonnée par sa métropole, tomba entre les mains des Hollandais, qui
durent eux-mêmes disparaître devant les Anglais.
La Pensylvanie fut l'oeuvre de William Penn et des
quakers. Fils d'un amiral anglais, mais converti par les quakers, il
avait été persécuté pour ses opinions, et avait plaidé avec éloquence,
par ses écrits et par sa parole, la cause de la liberté religieuse.
Voyant que l'Angleterre du XVIIe siècle n'était pas mûre pour
l'application de ces principes, il se décida à aller les réaliser
lui-même en Amérique. Héritier d'une créance de 16,000 livres sterling
sur le gouvernement anglais, il obtint de Charles Il en échange une
concession aux bords du Delaware. Il arriva en 1682 dans la colonie
pour y faire ce qu'il appelait « la sainte expérience » (holy
experiment). Il conclut avec les Indiens ce traité célèbre, « le seul,
disait Voltaire qui n'ait point été juré et qui n'ait point été rompu
»; il fit voter par les habitants une constitution d'un libéralisme
admirable; fonda Philadelphie, la cité de l'amour fraternel, et
attira, par des conditions exceptionnellement avantageuses, un grand
nombre d'émigrants venus de la Grande-Bretagne, de France, et surtout
d'Allemagne, où Penn avait répandu les doctrines des Amis.
Les colonies du sud, qui ont conservé jusqu'à nos
jours un caractère si différent de celui des autres colonies, s'en
distinguèrent dès l'origine au point de vue religieux. Tandis que la
Nouvelle-Angleterre servait d'asile. aux non-conformistes, le sud
attirait de préférence les épiscopaux.
La Virginie fut la plus ancienne des treize
colonies. Elle fut l'oeuvre d'une compagnie, constituée par charte
royale, et qui, à partir de 1607, envoya en Amérique de nombreux
convois d'émigrants composés en grande partie de gentilshommes. La
charte de la colonie y instituait le culte anglican, qui fut reconnu
par la première législature comme la seule religion officielle. La
compagnie recommandait expressément que l'on s'appliquât à « attirer
les naturels à la civilisation, à l'amour de Dieu et à la vraie
religion ». Devenue l'asile des cavaliers vaincus en Angleterre,
gouvernée longtemps par Sir William Berkeley, ce gouverneur qui
rendait grâce à Dieu de n'avoir « ni écoles ni imprimeries », la
Virginie représenta l'attachement exclusif à l'épiscopalisme anglican.
Les Carolines furent concédées sous Charles Il à
quelques gentilshommes, qui prétextaient un zèle pieux pour la
propagation de l'Évangile, mais qui songeaient surtout à accroître
leur fortune. L'un d'eux, lord Shaftesbury, fit préparer par le
philosophe Locke un projet de constitution pour le nouvel État, mais
la pratique en révéla le caractère absolument chimérique.
L'épiscopalisme y était proclamé la religion de l'État; mais les
autres cultes étaient tolérés. Grâce à cette clause qui survécut à
cette charte éphémère, les Carolines virent accourir puritains,
quakers et huguenots, ceux-ci en nombre considérable, en sorte que
l'élément non-conformiste domina de bonne heure.
La Géorgie est la plus jeune des colonies
primitives. Elle fut l'oeuvre d'un philanthrope, Oglethorpe, qui
voulut en faire un asile ouvert aux prisonniers pour dettes et aux
persécutés de toute nature. Parmi les premiers émigrants se trouvait
une colonie de Moraves, conduite par Zinzendorf. Les deux frères
Wesley et Whitefield y passèrent eux-mêmes quelque temps. On le voit,
si la religion eut une influence capitale dans les débuts de la
colonisation du nord, elle ne fut pas étrangère non plus aux causes
qui firent naître les établissements du sud. Ce rapide coup d'oeil
suffit à montrer que c'est bien le protestantisme évangélique qui a
donné naissance à la nationalité américaine.
SECONDE PÉRIODE
Temps postérieurs à la Révolution.D'après Baird, les églises existant, au moment où éclata la guerre de
l'Indépendance, comptaient environ 1,400 ministres et 1,940 lieux de
culte. Les épiscopaux (ou anglicans) faisaient des voeux pour la cause
britannique. Les congrégationalistes, les baptistes, les presbytériens
prirent parti en général pour l'émancipation des colonies. Ce fut le
vieil esprit puritain de la Nouvelle-Angleterre qui donna le signal de
la résistance et en demeura l'âme jusqu'au bout. Les pasteurs
dénonçaient du haut de leurs chaires « l'alliance du sceptre et du
surplis ». Un grand nombre s'enrôlèrent jusqu'au rétablissement de la
paix. Nous dirons plus loin comment les Méthodistes, qui étaient
d'origine récente, traversèrent la crise, grâce à la sagesse de
Wesley, et se jetèrent, avec un zèle admirable, dans l'évangélisation
du peuple qui venait de naître.
La rupture du lien entre l'Église et l'État ne fut
pas le résultat immédiat de la proclamation de l'indépendance des
colonies américaines, et elle ne fut pas davantage l'oeuvre du
Congrès. La Constitution se bornait à déclarer qu' « aucune condition
religieuse ne pourra être exigée comme condition d'aptitude pour
aucune fonction ou charge publique des États-Unis » (art. VI, § 3).
L'un des amendements proposés en 1789 et ratifiés en 1791 était ainsi
conçu: « Le Congrès ne pourra établir une religion d'État, ni défendre
le libre exercice d'une religion. » À ces deux articles se réduit
toute la législation religieuse renfermée dans le statut fédéral; mais
ils ont suffi pour assurer aux citoyens des États-Unis la plus grande
liberté religieuse qui fût jamais. Les États particuliers demeuraient
donc libres de se donner, s'ils le jugeaient bon, des Églises
nationales, et ce fut la force des choses, plus que l'attachement aux
principes, qui amena partout la dissolution du lien entre l'État et
l'Église.
La Virginie ouvrit la voie. L'Église épiscopale,
quoique seule légale, y était peu aimée. « Les ministres, plus jaloux
de percevoir jusqu'à la dernière livre de tabac dont se composait leur
prébende, que de remplir fidèlement les fonctions de leur ministère,
avaient de continuels procès avec leurs paroissiens; une bonne partie
de leur temps y passait, et ils consumaient le reste à la chasse et au
jeu. » (Baird, 1, 268.) Les épiscopaux patriotes ne pardonnaient pas à
leurs ministres leur froideur pour l'indépendance des colonies et le
départ pour l'Angleterre des deux tiers d'entr'eux. Aussi firent-ils
cause commune avec les presbytériens, les baptistes et les quakers
pour demander, dès 1775, à l'assemblée générale de la Virginie « de
renverser l'esclavage religieux en même temps que l'esclavage
politique ». Thomas Jefferson et ses amis appuyèrent, pour de tout
autres motifs, il est vrai, cette demande. Le 6 décembre 1776 furent
rapportées les lois qui avaient consacré l'union de l'Église et de
l'État, mais ce ne fut qu'en 1784, après de longues discussions,
qu'elle fut définitivement abolie.
L'exemple de la Virginie ne fut pas immédiatement
suivi par les autres États. Dans le Maryland, le New-York, la Caroline
du Sud, on abolit le privilège de l'Église épiscopale, en appelant les
autres Églises à participer à ce privilège. La législature
s'attribuait le droit de lever un impôt pour l'entretien de la
religion, mais elle laissait à chaque contribuable la faculté de
désigner la communion particulière à laquelle il entendait attribuer
sa quote-part d'impôt, à moins qu'il ne préférât l'affecter au
soulagement des pauvres. Ces restrictions finirent par disparaître. Le
New-Jersey, la Pensylvanie, le Delaware, les Carolines et la Géorgie
ne tardèrent pas à abolir l'obligation d'assister au culte et de
contribuer à ses frais. Le test religieux qui avait survécu à la
révolution fut aussi abandonné, et les fonctions publiques devinrent
accessibles à tous les citoyens, quelles que fussent leurs opinions
religieuses.
La Nouvelle-Angleterre fut la dernière à entrer
dans cette vole. Jusqu'en 1816, le congrégationalisme y demeura la
religion d'État. Les dissidents obtinrent alors l'abolition de la taxe
paroissiale, qui fut remplacée par un Impôt pour le culte, réparti
entre les diverses Églises conformément au voeu des imposés. Ce ne fut
qu'en 1833, à la suite de longs débats, que la législature du
Massachusetts abolit toute taxe obligatoire et laissa à chaque Église
le soin de pourvoir, comme elle l'entendrait, à ses propres besoins.
Si la séparation de l'Église et de l'État entraîna
à l'origine quelques souffrances, on peut affirmer qu'elle a eu
généralement des effets bienfaisants. Elle a développé à un rare degré
l'initiative individuelle, et, en enlevant aux gouvernements le souci
des intérêts religieux, elle en a fait l'affaire de tous. Les Églises,
sont bien plus nombreuses et bien mieux dotées qu'elles n'auraient pu
l'être sous le régime des religions nationales. Les cinq grandes
communautés protestantes (méthodistes, baptistes, presbytériens,
congrégationalistes et épiscopaux), ont reçu de leurs fidèles, dans
l'année 1872, un revenu de plus de 211 millions de francs; en comptant
les autres Églises de moindre importance, on peut estimer à 250
millions le revenu total des Églises protestantes. On évalue à 1,500
millions la valeur des immeubles dont elles disposent (1).
Si l'État s'abstient en Amérique d'intervenir dans
les affaires des Églises, il est loin d'être indifférent en matière
religieuse. La plupart des constitutions des États commencent par un
hommage à Dieu; celle du Massachusetts déclare que « le culte public
rendu à Dieu, l'enseignement de la piété, de la religion et de la
morale, favorisent le bonheur et la prospérité d'un peuple et la
sécurité d'un gouvernement républicain ». La constitution fédérale et
les lois des États considèrent le dimanche comme un jour férié. Dans
les circonstances solennelles, le congrès, le président ou les
gouverneurs d'État fixent des jours d'humiliation ou d'actions de
grâces. Dans la plupart des États, les Églises sont exemptes d'impôts,
et les pasteurs sont dispensés de tout service public dans la milice
ou dans le jury. L'État leur délègue les fonctions d'officiers de
l'état civil pour les mariages où leur ministère est réclamé. Les deux
Chambres du Congrès ont chacune un chapelain, pris tantôt dans une
Église tantôt dans une autre. La Bible est lue dans les écoles
publiques. Les faits montrent que, si l'État est séparé des Églises
aux États-Unis, il sait reconnaître dans la religion une force morale
et sociale digne de tous ses respects.
MATTH. LELIÈVRE
| - | Table des matières | Chapitre suivant |
