
A L'ECOLE PRÉPARATOIRE DE THÉOLOGIE PARIS
suite (2)
-------
Nous sommes allés, un ami et moi, chez Mme L., rue d'Enghien, dame d'une grande érudition, profonde politique, républicaine au fond de l'âme. A peine avions-nous mis les pieds dans la chambre, qu'elle nous a fait la confidence de ses sentiments politiques. Étrange dame, pensais-je ; sans nous connaître, elle nous parle pourtant comme à de vieilles connaissances; je doute fort que ce soit dans les règles de l'étiquette parisienne. Son mari n'est pas si bavard, il me paraît très sensible, il pleurait en m'apprenant l'arrestation d'un de 'ses amis. Ce sont de chauds partisans de Coquerel. M. L. définissait ainsi la prière : « Ce n'est qu'une simple, aspiration qui élève notre âme, mais cela ne peut durer qu'un moment et bientôt mille pensées viennent nous troubler. » Pour ma part, je crois que la prière est quelque chose de plus qu'une simple aspiration. Ces républicains ne comprennent la religion que dans des vues républicaines : « Nous obéissons à l'empereur; mais avant, nous sommes protestants, nous sommes protestants, c'est-à-dire d'une religion de liberté, et, lorsque l'empereur ira trop loin, nous saurons bien en faire usage. »
En voilà une drôle de religion ! Ah ! j'aimerais mille et cent millions de fois mieux être païen que d'être ainsi protestant. Je, suis protestant, c'est-à-dire je proteste contre le péché, et voilà tout; et, en protestant contre le péché, je proteste également de toute la force de mon coeur et contre les abus protestants et contre les abus romains; pour le reste, je ne suis et ne veux être qu'un fidèle serviteur de Christ. J'étais fort gêné sans l'être; je ne prenais point de part à la conversation et ne le désirais pas. Heureusement que mon ami faisait tous les frais. Enfin, on voulut m'introduire dans la conversation : « Monsieur, me dit cette dame, votre pays est légitimiste ou ... ? » je ne sais quel nom baroque. Ne sachant que répondre pour parler en vérité : « Vraiment, Madame, lui dis-je, je ne m'occupe point de politique. » Un peu confuse, elle me réitéra sa question et je lui répondis alors par un franc : « Je ne sais pas ! » Je ne voudrais pas avoir de telles gens comme amis; certes, j'aimerais mieux rester mille ans ignoré dans Paris.
Les vacances m'occupent. Je terminais la semaine avec une résolution de ne plus écrire de lettres. On ne peut écrire sans adopter un langage en vogue maintenant dans le monde chrétien; on y est contraint et je voudrais que cela n'existât pas. D'ailleurs, je ne crois pas que mes lettres fassent du bien, précisément parce qu'elles sont chrétiennes, pour ainsi dire. Je me souviendrai toujours de l'impression que j'ai reçue d'une lettre de Mme Pillivuyt. Elle ne jasait pas sur le christianisme, mais on sentait que sa plume était comme trempée dans la foi et que son coeur était plein d'un tendre amour pour son Sauveur. Quelle différence avec un jeune chrétien qui s'épuise pour dire du nouveau, tout en rabâchant toujours la même chose ! On peut bien dire ce que Fénelon disait de certain prédicateur, que, « pendant qu'il sue devant nous, nous sommes froids ».
Mardi 1er août -854. - « Mon désir tend à déloger pour être avec Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur; car Christ est ma vie et la mort m'est un gain! . Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. » (Phil. I, 21.)
Coillard n'avait jamais oublié ni Asnières, ni sa parenté, ni le pasteur E. Filhol, qui avait succédé à M. Guiral; il priait pour que l'Évangile pénétrât de vie ce milieu. Le 17 mai, à Paris, il avait rencontré une dame qui avait passé une ou deux semaines « dans son cher Asnières » et il s'écrie : « Quelle heureuse nouvelle ! Dimanche dernier, quatorze jeunes gens réunis près de M. Filhol, quatorze ! c'est inouï. Oh ! que le Seigneur est bon, Il n'a pas rejeté mes faibles prières et, puisqu'il a déjà commencé, il les exaucera. L'église d'Asnières se réveillera enfin; oui, par ton souffle, Seigneur, l'église d'Asnières, que je porte sur mon coeur, se réveillera. »
Il envoie à M. Filhol un plan d'organisation d'école du dimanche pour Asnières, plan dans lequel les quatorze jeunes gens trouveraient leur place; ce serait « un moyen de les intéresser et de les faire avancer ». M. Filhol lui répond : « L'école du dimanche que nous avons, va aussi mal que possible ou plutôt ne va pas du tout. Nous pourrons peut-être commencer quand vous serez ici, et l'habitude que vous avez de la chose vous en rendra la mise en train plus facile. »
Coillard désirait retourner à Asnières, voir sa mère, réveiller les siens, leur faire part de ce qu'il avait reçu depuis son départ, en 1851. Mais ce désir ne va pas sans quelques appréhensions et c'était naturel : il avait quitté Asnières enfant, il y revenait ayant atteint, moralement comme physiquement, la stature « d'homme fait » (Éphés. IV, 13) et il avait un témoignage à rendre.
24 juin 1854. - Je bâtis pour les vacances châteaux en Espagne sur châteaux en Espagne. Je désire beaucoup m'occuper activement de l'école du dimanche, mais... je suis si ignorant.
1er juillet 1854. - J'espère aller en vacances mais je redoute ce temps; je l'approche d'une main, je l'éloigne de l'autre. Dans les lettres que J'ai écrites à mes parents, j'ai toujours sermonné, pour ainsi dire; ils doivent donc me croire un chrétien bien vivant, bien bouillant, puisque je ne peux leur écrire sans leur publier le salut. Que penseront-ils en me voyant si timide, si froid, si peu empressé à servir à la gloire de mon Dieu? Une autre crainte, c'est de savoir comment je m'occuperai de cette école du dimanche dont me parle M. Filhol.
8 juillet. - Je ne sais vraiment ce qui me trouble en pensant aux vacances. Je voudrais n'y pas penser, mais je ne puis faire autrement. Je tremble ! Vraiment, irais-je à Asnières pour y causer du scandale et rien de plus? 0 mon Dieu, je désirerais être humble et je suis si orgueilleux ! Me voilà, moi, ce beau Coillard, ce saint qui n'ai pu faire autrement que d'envoyer dans chacune de mes lettres à mes parents des sermons, j'irai chez nous, timide, orgueilleux, et que sais-je encore? 0 mon Dieu, je t'en supplie, change mon coeur ! convertis-moi ! Achève ton oeuvre! Amen, oui, amen.
18 juillet. - 0 ma bonne maman, combien je vous aime 1 Les vacances m'occupent beaucoup. Je rêve, même au milieu du jour, au grand bonheur que nous aurons à nous rejoindre. Le 10 août est bien loin encore et pourtant je ne désire pas le rapprocher, car je ne vais à Asnières qu'en tremblant. Et vous, maman, combien vous pensez à moi, je suis sur. Bientôt nous nous verrons.
Samedi 5 août 1854. - Encore Batignolles ! On peut croire que je pense aux vacances ! Un, deux jours... et je pars! Un, deux, trois, quatre, cinq ou six jours et je vais pleurer sur le sein maternel!
Mais que je suis mal préparé pour cet examen ! Je n'ose prier Dieu de me venir en aide ! Peut-être que si j'avais travaillé davantage !... Mais enfin...
Après avoir subi un examen, dont il ne nous dit rien, Coillard part, le 9 août, pour Asnières et, après s'être arrêté à Orléans pour voir un de ses frères et à La Ferté-Imbault pour revoir ses anciens maîtres, il arrive à Asnières où il se lance de suite dans l'activité : entretiens intimes, pressants et souvent douloureux avec les siens, école du dimanche, réunions de jeunes gens, leçons de chant, et tout cela, tandis que la maladie fait son siège en lui et le mine.
13 août 1854. - Le bonheur se comprend mieux qu'il ne s'exprime!
Jeudi 17 août. - Il faut enfin que je dise combien je suis heureux; mais je suis muet, les expressions me manquent. Hier, j'ai eu avec ma mère et ma soeur Catherine une conversation de deux heures au moins et sur le sujet principal. Mais combien peu je suis compris! Moi-même je me relâche. Je croyais méditer la Parole, mais je la néglige; j'espère bien qu'après que la moisson sera finie, je serai plus tranquille.
Dimanche 20 août. - Je dois le dire à la louange de mon Dieu, j'ai jusqu'ici moins eu à souffrir de l'orgueil que je ne le craignais. J'ai tant prié pour cela ! Dieu m'a entendu. Oh ! puisse-t-il m'entendre pour ma mère !
Dimanche -27 août. - Mon bon Père, oh ! combien je te remercie du plus profond de tout mon coeur de ce que tu daignes entendre mes soupirs ! Oh ! je t'ai prié pour cette chère mère que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup; oh! fais, fais toi-même, toi le Convertisseur des âmes, fais ton oeuvre dans ce vieux coeur protestant, dans ce coeur endurci. Agis, agis, Ô mon Sauveur, c'est ton affaire. La mienne est de prier, la tienne est d'exaucer ! 0 Dieu, que je voudrais lutter avec toi, comme Jacob, par la foi. Mais misérable que je suis! Mais pourtant... ! Enfin, j'en ai la foi, tu veux exaucer et agir, j'en ai la conviction intime. Ainsi, oh ! qu'ainsi soit-il, mon bon Père !
Lundi 28 août. - Jamais de ma vie je n'ai été si ému qu'hier à l'école du dimanche. J'ai prié avec une ferveur, une abondance qui m'a surpris; mais ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu.
Je sanglotais. Immédiatement après, j'ai dû prendre ma mère à part pour donner essor aux sentiments qui m'oppressaient. Je lui ai parlé avec conviction et franchise. Je l'ai affligée. Pauvre mère !
Jeudi 31 août. - Ah ! mon Dieu, jusques à quand!...

Que je suis fatigué de la vie! Je voulais aller me coucher, mais j'avais bien faim et bien soif. J'ouvre ma Bible : psaume LXXX. O chère Bible, mon trésor! Mon Dieu, pense à cette vigne dévastée, je t'en prie !
Dimanche 3 septembre 1854. - Singulière journée ! J'ai fait l'explication générale à l'école du dimanche. Ça a été assez bien. Puis, au culte de l'après-midi, j'ai fait quelques réflexions sur Luc XV, l'enfant prodigue. J'étais mécontent de moi-même. Puis leçon de chant avec les jeunes filles et réunion intéressante avec les garçons jusqu'au soleil couché.
* Je ne puis pas dire que je suis plus vivant. Je puis mieux prier à haute voix, mais...
J'ai causé avec M. Filhol qui est revenu de Foëcy. Il m'a reproché de manquer de hardiesse pour parler aux pauvres pécheurs et c'est bien vrai.
Je me couche heureux et content.
Mardi 12 septembre. - J'ai beaucoup souffert et je souffre encore beaucoup de la tête. Je suis indisposé. Oh ! que je voudrais mourir, et surtout ici !
Mercredi 13 septembre. - Oh! que je suis heureux ! Douce mélancolie ! Que je serais heureux de mourir en ce moment pour aller vers mon Dieu! et pourtant... mon Passage sur la terre serait inutile.
Jeudi 14 septembre (1). - Je suis souffrant, mais heureux, oui, bien heureux. « 0 mort, où est ton aiguillon, Ô sépulcre, où est ta victoire? » Grâce au Seigneur Jésus-Christ qui, par sa mort expiatoire, m'a délivré de. la puissance du diable ! Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain !
-
Tout mon désir -
Est de partir -
Pour m'en aller vers mon Sauveur... -
Non, non, ce n'est pas mourir que d'aller vers son Dieu, que...
-
Mardi 19 septembre, soir. - Je suis toujours malade, mais toujours heureux., Grâces à Dieu ! Hier j'ai passé une journée bien douloureuse, c'est tout au plus si j'ai pu penser à mon Dieu Sauveur.
Ah ! que ferai-je à l'agonie? Je crois que j'ai divagué et battu la campagne. M. Filhol et Mme Viénot m'ont prodigué mille et mille soins. J'ai encore été bien malade aujourd'hui, mais sans garder le lit.
Le 23 septembre, la fièvre typhoïde se déclarait avec symptômes alarmants. M. et Mme Frédéric Viénot, qui aimaient Coillard pour lequel ils avaient eu mille bontés, faisant abstraction de leur nombreuse famille, Prirent le malade chez eux, dans la maison d'école, et l'installèrent dans la chambre de leur fils Charles (2). « C'est dans de pareils moments, écrit M. Viénot, qu'on regrette de ne pas être favorisé des biens de ce monde... Mais, je prends l'engagement devant Dieu, que Coillard ne manquera de rien. Il a déjà une bonne chambre, un bon lit. »
Le 27 septembre au matin, M. Viénot écrit : « La nuit a été meilleure que l'on ne pouvait supposer, à part la défaillance «lui n'a pas eu d'autre suite) de mon fils Charles qui, vers minuit, est tombé raide au moment où il devait appliquer un cataplasme. Le malade est dans une grande faiblesse. Le cerveau est libre et le malade a toute sa présence d'esprit. Le pauvre Coillard est préoccupé par les dépenses qu'occasionne sa maladie, il voudrait n'être à charge à personne. Pauvre ami 1 Il est tout à Glay et à la Société qui l'a soutenu jusqu'ici. Crainte de nous être trop à charge, il voulait qu'on l'emportât chez une de ses soeurs; mais, sur l'avis du médecin et après quelques paroles fraternelles de notre part, il a consenti, avec le sourire sur les lèvres, à rester dans sa chambre.
« Soir. - Le médecin est arrivé, il a quelque espoir. »
Le 15 octobre, le mieux se déclara et, une semaine après, Coillard était hors de danger; la fièvre avait presque complètement disparu.
Mais alors, sa mère tombait gravement malade ; la mère suivit son fils dans une convalescence rapide et le 3 novembre, Coillard quittait la famille Viénot dont les soins attentifs et dévoués l'avaient arraché à la mort. Il reprenait son journal.
7 novembre 1854. - Si seulement j'avais pu continuer mon journal pendant ma maladie! mais... Je me suis mis au lit un samedi, dans les dispositions les plus heureuses; je m'étais persuadé que je ne me relèverais que pour me faire porter à la Chaume'. Et que je trouvais de douceur dans cette pensée! Mourir! Mourir ! Et mourir à Asnières ! Quelle douce pensée! Quel bonheur! Eh bien, Dieu ne l'a pas voulu ! Que sa volonté se fasse !
J'attendais la mort, la mort ne vint pas; lorsqu'elle se présenta, déjà je ne l'attendais plus! Au plus fort de ma maladie, lorsque tous mes parents et mes amis se désolaient de me voir, pour ainsi dire, à l'agonie, aux portes du tombeau, pour moi je n'avais d'autre occupation que de m'entretenir avec mon Dieu. Jamais je n'ai été si calme et si heureux, si parfaitement heureux ! 0 doux, doux moment! Qui peut en comprendre la douceur?
(Autobiographie.) - Mes condisciples de l'École préparatoire trouvèrent à la rentrée ma place vide. Ils imaginèrent d'égayer les longues journées de ma convalescence en m'envoyant chaque semaine ce qu'ils appelaient La Gazette de l'Ecole préparatoire, où chacun avait son petit article : celui-ci faisait les faits divers, celui-là s'occupait de critique, cet autre étudiait une des questions qui nous intéressaient spécialement; un autre y insérait un sonnet. Aussi, cordiale et joyeuse fut la bienvenue qui me fut faite quand je rentrai parmi eux (décembre 1854).
Mais un nuage montait à l'horizon. C'était au temps de la guerre de Crimée; je devais passer à la conscription, rien ne m'exemptait du service. J'étais bien fils de veuve, mais le plus jeune de tous mes frères. Et, au cas où je tirerais ce que l'on est convenu d'appeler un mauvais numéro - et en ce temps de guerre, les bons numéros étaient fort rares - sept ans de service militaire m'étaient réservés et adieu la carrière missionnaire ! J'étais trop sûr de ma vocation pour ne pas l'abandonner entièrement aux soins de Dieu. J'attendais donc tranquille et confiant. Mais MM. Boissonnas et Grandpierre, dans leur sollicitude pour moi, pensaient que la prudence humaine n'est pas, en circonstances critiques, un manque de foi. Ils crurent qu'il y avait quelque chose à faire, et à faire promptement, car le gouvernement hâtait le recrutement annuel. Il s'agissait de m'envoyer à Strasbourg et de me faire admettre comme étudiant régulier à la faculté de théologie, ce qui me protégeait contre le service militaire. Ne pouvant rassembler le Comité dans cette saison, M. Grandpierre m'envoya, muni d'une lettre, auprès du président de la Société, M. le comte Jules Delaborde.
-
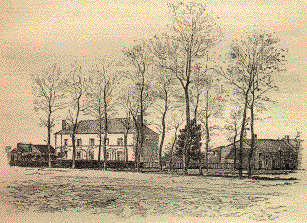
Asnières - L'école
-
Je ne l'avais jamais encore vu. Je me rendis à son hôtel; un domestique en livrée, après m'avoir toisé de la tête aux pieds, m'introduisit dans un vaste salon. M. Delaborde me reçut avec amabilité et debout, lut la lettre et écouta mon histoire; puis il me dit: « Je ne puis pas approuver votre projet. Ce n'est pas un malheur d'être soldat. Regardez, dit-il en me montrant une série de tableaux, ces portraits sont ceux de mes ancêtres, ils ont été des soldats. A l'armée vous pouvez être missionnaire aussi bien que chez les païens. » Puis, ouvrant la porte, il me congédia poliment.
Le coeur gros, je n'eus pas le courage d'aller frapper à la porte d'autres membres du Comité.
Je me rendis tout droit chez M. Adolphe Monod (24 décembre), qui me reçut avec une bonté toute paternelle. Dès qu'il eut appris l'objet de ma visite, il me dit : « Mon ami, vous n'avez pas de temps à perdre. Je prends toute la responsabilité de vos démarches, voici de quoi payer votre voyage, partez aujourd'hui même pour Strasbourg par le train de 8 heures. Nous vous enverrons, M. Grandpierre et moi, des lettres de recommandation pour les professeurs et des amis chrétiens. »
MM. Grandpierre et Boissonnas, réjouis de l'initiative qu'avait prise ce digne M. Adolphe Monod, me donnèrent leurs instructions, je fis ma malle.
A peine arrivé à Strasbourg, Coillard écrit à ses amis du Magny (28 décembre 1854), pour leur raconter son voyage :
« Je partis le jour de Noël, à 8 heures du soir, heureux, sans aucune inquiétude, et vous eussiez bien ri avec moi en voyant MM. les élèves de l'école me conduisant à la voiture, tous demi-joyeux, courant à qui mieux mieux, se chicanant pour porter mes affaires et arrêtant les curieux.
« Mais pourtant, en arrivant à Strasbourg, la difficulté n'était pas anéantie. Muni de lettres de recommandation, je me rendis en toute hâte, le même jour, chez un homme que vous connaissez je pense, le vénérable M. Cuvier. Il me prodigua ses conseils paternels et me promit tout son concours. Je me rendis chez M. Kreiss, en qui je trouvai un protecteur chrétien et de bon conseil ; c'est le directeur du Séminaire. Il me connaissait déjà par mes lettres de recommandation, me donna audience pour le lendemain à 9 heures. Je m'y rendis. Il me fit subir un examen de latin que je réussis à souhait. Je traduisis du Tite-Live. Ce bon monsieur me donna des lettres de recommandation pour les professeurs qui me devaient examiner, et m'assura d'avance du bon résultat de l'examen.
« Si, immédiatement, vous entrez avec moi chez M. S.) professeur d'histoire, la scène change. C'est un homme sec de parole comme de physionomie, qui, sur mes aveux trop sincères que mes cours d'histoire n'étaient pas complets, ne daigne pas même m'interroger, et qui se sert de ces aveux mêmes pour élever un rempart devant la porte du Séminaire. Pourtant il daigne m'embrouiller par quelques questions captieuses sur Othon, Charlemagne, etc., etc. ; bref, je sortis de chez lui, un peu plus mal à mon aise que je n'y étais entré. Je me dirigeai lentement chez M. B., professeur de philosophie, et si, pour une chose que J'avais plus ou moins étudiée, j'avais si mal réussi, jugez avec quelle assurance j'allais subir un examen de philosophie que jamais je n'avais travaillé. C'est pourtant celui que je réussis le mieux. M. B. est un homme très affable. « Vous venez pour que je vous examine; c'est tout simple que je doive voter votre admission au Séminaire. Qu'avez-vous donc vu en philosophie, cher ami? » « Rien, Monsieur, rien) » lui répondis-je franchement. « C'est égal, cet examen n'est qu'une formalité à remplir, je vais vous donner une bonne note; vous vous fortifierez dans la suite. » Bien. J'allai chez M. H., professeur de grec, bon vieillard qui vous donne toujours l'épithète de « très cher ». Il me mit Plutarque entre les mains (vie de Démosthène). Je fus aussi heureux que pour le latin, je compris et analysai à souhait, et m'attirai des éloges de M. H.
« A 4 heures, je me voyais inscrire sur ce gros livre, où la conscription ne peu[ envoyer ses gendarmes. M. Kreiss me donna une foule de bons conseils sur mes études, mon logement et ma conduite. Je suis donc élève du Séminaire, tout en suivant les cours du Gymnase. Je ne sais pas encore si J'entrerai en rhétorique ou en logique. M. Kreiss me conseille d'entrer en logique, d'autres en rhétorique. Les cours, commencent mercredi.
« J'ai pris une chambre chez Mme Roth, veuve du pasteur de ce nom, en face de chez M. Cuvier, rue de l'Ail, 21. Je suis bien tranquille; je crois cette dame pieuse. Je soupirais après la vie de famille, je serais bien heureux si je l'avais enfin retrouvée, quoique je l'achète cher. Je vais donc maintenant m'occuper de ce terrible baccalauréat, la bête noire des pensions; je ne m'en étais pas encore sérieusement occupé. On doit bientôt, à ce que m'ont dit des messieurs du Comité des Missions, ouvrir la Maison des Missions; leur regret, comme le mien, est que je n'y puisse pas compléter mes études missionnaires. Ces messieurs se sont enfin aperçus que des études classiques n'étaient pas pour cela missionnaires, et, en même temps, ils ont vu le danger qu'il y a à placer des élèves missionnaires avec des jeunes gens voués à une vocation différente. »
Ce même jour Coillard écrit au Comité pour le rassurer:
«Vous craignez, Messieurs, que dans une faculté de théologie, je chancelle dans nia vocation missionnaire; il n'est pas en mon pouvoir de vous persuader le contraire. Je ne puis, quand je le voudrais, parler de l'avenir, mais je puis et dois dire un mot du passé et du présent. Ce n'est pas la première fois que je suis en contact avec des jeunes gens d'une vocation différente. Ce -n'est, je l'avoue, qu'en tremblant, qu'à votre appel je venais m'asseoir à côté de futurs pasteurs sur les bancs de l'École préparatoire. Connaissant mon coeur rusé et inconstant en toutes ses voies, je priai, on pria pour moi, et le Seigneur répondit à ces prières. Il daigna me préserver des dangers et des tentations auxquelles j'étais exposé et m'affermit de plus en plus dans ma vocation missionnaire.
« Jamais je n'avais senti, comme auprès de M. Boissonnas, la beauté, l'urgence et la grandeur de l'oeuvre des missions; jamais, non jamais je n'avais senti battre mon coeur avec plus de force pour les pauvres païens qui périssent sans connaître le Dieu et le Sauveur que j'adore. Oh ! Messieurs, tel je suis encore et tel le Dieu qui m'a gardé à Batignolles me gardera aussi à Strasbourg. Dès mon enfance, j'aimais les pauvres sauvages et leurs dévoués missionnaires, et maintenant bien plus encore que lorsque je me suis présenté à vous pour la première fois. Je parle en toute franchise et vérité, je n'exagère, je ne colore rien, pardonnez-moi. »
Mais, si Coillard était « à l'abri des gendarmes », toutes les difficultés n'étaient pas levées. Il en restait une encore à l'égard de la Société des Missions : ce n'était pas cette Société qui, officiellement, avait envoyé Coillard à Strasbourg. Coillard, une fois dans cette ville, resterait-il élève missionnaire, dépendant de la Société de Paris ? De plus il était inscrit à la Faculté, mais, effectivement il ne devait suivre que les cours du Gymnase, pour arriver à prendre son baccalauréat; une fois bachelier, il aurait une bourse; mais, d'ici là, qui pourvoirait à son entretien ? La Société avait déjà fait beaucoup de frais pour lui.
Ces questions étaient angoissantes pour Coillard; il écrit au Comité qu'il va se mettre courageusement à préparer son baccalauréat; qu'en attendant, pour alléger les charges de la Société, il donnera des leçons; qu'enfin il a « un modique héritage » qu'il pourra vendre et ainsi pourvoir lui-même à son entretien à Strasbourg pendant un an, et il termine sa lettre par ces mots :
« Si le Comité venait à m'abandonner, certainement ce serait pour moi une épreuve bien cruelle et mon embarras pécuniaire ne serait pas moindre que celui de la conscription ; toutefois l'Éternel ne m'abandonnerait pas sans doute et vous me permettriez de me considérer toujours comme votre élève et soumis à vos ordres.
F. COILLARD,
encore et toujours votre élève missionnaire s'il plaît à Dieu. »
Cette lettre au Comité était accompagnée d'une autre à M. Grandpierre :
« Quoique je sois à Strasbourg, je n'en suis pas moins élève missionnaire et, quoi qu'il arrive, je me considérerai toujours comme élève de la Société de Paris. Mon désir le plus ardent est d'être missionnaire, voilà tout. Plus d'une fois déjà, cher Monsieur, j'ai pris plume et papier pour vous parler, à coeur ouvert et à satiété, de ces missions pour lesquelles je vis, mais jamais je n'ai osé vous présenter ces lignes, parce qu'elles n'étaient pas conformes au ton de Paris. »
Le Comité, considérant que Coillard lui avait donné jusqu'à ce jour une entière satisfaction, décida de faire les frais de sa pension et de le conserver au nombre de ses élèves. De son côté, Coillard s'engageait à avertir le Comité dès qu'il sentirait faiblir sa vocation missionnaire.
Quant à la conscription, il devait passer encore par ce qui n'était plus pour lui qu'une formalité, par le tirage au sort.
« Je désirerais beaucoup être libéré par le sort, écrit-il à M. Grandpierre (5 mars 1855), et rendre par là inutile le certificat 'de M. le Doyen, qui loyalement ne devrait pas me revenir, à moi, élève missionnaire et n'étudiant que pour les missions. »
(Autobiographie.) - Le jour du tirage arriva, j'eus un bon numéro, et, lors même qu'au conseil de révision je fusse déclaré « bon pour le service », je ne fus pas, appelé à servir sous les drapeaux; je n'avais aucun engagement envers le gouvernement. De toutes manières, j'étais libre et ma vocation était sauvegardée. Je n'avais jamais douté qu'il en fût autrement. Pendant que, mêlé à une foule de jeunes, j'étais à attendre dans l'antichambre du Conseil, j'étudiais, comme tout le monde, les physionomies de ceux qui entraient dans la salle ou en sortaient. Et comme la porte s'ouvrait constamment, ce n'est pas avec indifférence que nous entendions un des officiers crier à l'intérieur: « Bon pour le service ! » ou « Pas bon pour le service ! » Transposant mes réflexions dans un domaine plus élevé, je ne pouvais concevoir une cause de tristesse et de douleur plus grande que celle que j'éprouverais dans le cas où Jésus, mon divin Maître, pourrait dire d'un de ses conscrits comme moi: « Pas bon pour le service. »
1. Ce jour-là l'écriture est absolument changée. (Ed. F.)2. Né le 4 mai 1839, instituteur puis missionnaire à Tahiti, où il mourut le 11 juin 1903. (Ed. F.)
Chapitre précédent Table des matières Chapitre suivant
