
CHAPITRE XV.
Au coeur du paganisme.
-------
L'Honan.
L'HONAN, province plus grande que l'Angleterre
et renfermant environ trente millions d'habitants,
n'a encore (en 1890) que quatorze missionnaires, y
compris les femmes de
missionnaires !
Quand Jésus-Christ quitta
cette terre, il commanda à ses disciples
d'« ALLER DANS TOUT LE MONDE ANNONCER LA
BONNE NOUVELLE A TOUTE CRÉATURE. »
La Chine était alors à peu
près ce qu'elle est aujourd'hui,
civilisée et couverte de millions et de
millions d'habitants. Or mille huit cent
quatre-vingt-quatre ans après, l'Honan,
l'Hupeh, l'Hunan, le Kwang-si, le Kiang-si, le
Shing-King, la Mongolie, le Thibet, etc., provinces
contenant plus de deux cents millions d'habitants,
n'avaient encore aucun
missionnaire !
Il y a huit ans (1884) que les
premiers messagers de la Bonne Nouvelle, quelques
ouvriers de la China Inland Mission,
pénétrèrent dans l'Honan. Nous
venons d'y accompagner Miss Géraldine, et
nous trouvons à Shae-ki-Tien, pour
évangéliser ce grand peuple, trois
femmes et un homme. Ils ne sont pourtant pas
découragés. Notre amie écrit
à ses parents :
Shae-ki-Tien promet d'être un
centre où l'Évangile s'enracinera et
prendra de l'extension. Il ne s'y trouve ni
mandarins ni savants ; il ne s'y fait pas
de ces examens qui
amènent une multitude de lettrés qui
sont une cause de troubles, comme on le voit dans
beaucoup de grandes villes ; les classes
supérieures y sont peu,
représentées, et les
préjugés du monde officiel ne s'y
rencontrent guère. Cependant Shae-ki-Tien
est un grand centre de population, le second de
l'Honan. (1)
Elle
est prospère et commerçante ;
les étrangers y viennent de toutes parts
pour affaires. Elle n'a pourtant pas l'aspect d'une
grande ville. Ses rues sont larges et mal
entretenues ; on y remarque partout une
complète absence de recherche et de
prétention. Tout y paraît simple
et rustique ; les
habitants, ont l'air de bons paysans, sans malice,
pleins de candeur. « L'Évangile
est prêché aux
pauvres ; »
réjouissons-nous !
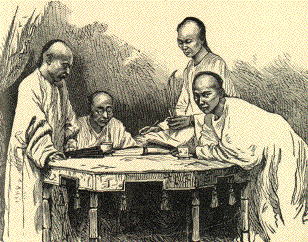
20 Mars 1889.
Cet après-midi mon professeur
étant absent, je n'ai pas eu ma
leçon, et je me réjouissais à
la pensée du temps que j'allais passer
à vous écrire toutes sortes de
nouvelles. Je me mis donc en devoir de vous faire
une longue lettre pour le prochain départ de
la malle-poste ; mais à peine avais-je
commencé, qu'on vint nous chercher pour un
cas d'empoisonnement ; il s'agissait d'une
jeune fille ; et c'était ici la
première fois que nous rencontrions ce cas
parmi les femmes.
Nous nous préparâmes
aussitôt à partir, Mme Taylor et moi.
La malade demeurait assez loin et la journée
était excessivement chaude. Nous
trouvâmes dans les rues une couche de
poussière d'une dizaine de
centimètres d'épaisseur, mais il
fallait aller vite, autrement nous aurions perdu de
vue les hommes qui nous conduisaient. Bientôt
nous arrivons dans une partie de la ville qui nous
est inconnue. La foule s'amoncelle sur nos pas et
nous nous trouvons bien vite en tête d'une
formidable procession. Quels nuages de
poussière font les enfants ! nous en
sommes aveuglées et suffoquées. Ces
foules qui nous suivent partout sont pour
l'étranger une des épreuves de la vie
à l'intérieur du continent.
(2)
Figurez-vous,
ne jamais pouvoir sortir cinq minutes sans qu'une
centaine d'yeux ne vous suivent et ne vous
épient ! Plusieurs centaines de
personnes nous ont suivies aujourd'hui ; ce ne
sont pourtant plus les milliers qui nous suivaient
les premiers jours. Enfin nous arrivons à
destination et nous constatons avec joie que la
pauvre fille n'a point pris d'opium il y a eu
erreur. Dieu fasse qu'il en soit toujours
ainsi !
Si nos soeurs sont ainsi suivies
par
la foule, ce n'est pas seulement parce qu'elles
sont des étrangères, c'est encore et
surtout parce qu'elles sont des femmes. Nous lisons
plus loin :
Dans ce pays païen, combien ou
est lié par les coutumes, vous ne vous en
faites aucune idée. Les femmes, - et nous ne
sommes que des femmes, - les femmes ne doivent pas
sortir comme nous le faisons en Europe. Il en
résulte que tout doit être fait par
les hommes. S'agit-il même d'acheter un
vêtement de femme ou d'enfant, il faut un
homme. On ne voit jamais ici une femme dans un
magasin. Jusque dans les plus petits détails
de la vie, la femme n'est rien et ne peut rien, si
ce n'est par son mari ou ses parents du sexe
masculin. Les hommes, au contraire, ont toute
facilité d'être et de faire tout ce
qu'ils veulent ; sauf qu'un homme du commun,
quand il sort, doit regarder tout droit devant lui,
ses yeux doivent être fixés sur le sol
à dix pas en avant, sans rien examiner de ce
qui l'entoure ; autrement, ce serait aspirer
à s'élever au dessus de la classe des
coolies.
Quant aux demeures chinoises,
elles
sont si différentes des nôtres !
Nous y sommes tous enfermés entre quatre
murs, sans aucune vue, si ce n'est un tout petit
coin de ciel, étroit ruban bleu que nous
voyons par dessus les maisons.
Nous avons grand besoin de vos
prières, plus que vous ne pouvez le penser.
En ce moment, nous restons chez nous bien
tranquilles ; c'est le Nouvel-an chinois, et
comme il n'y a jamais eu de dames anglaises en
cette ville jusqu'à maintenant, il est
préférable que nous ne sortions pas.
Du reste, nous ne pourrions faire que bien peu de
chose dehors, car le dialecte qu'on parle ici est
si différent de celui que nous avons appris,
que même M. Taylor a de la peine à se
faire comprendre. Nous nous bornons donc pour le
moment à étudier, à prier et
à attendre.
Mais dans cette sorte
d'inaction,
quel terrible danger de devenir étroit et
sec ! Je m'en rends si bien compte ! La
communion avec Dieu est notre sauvegarde.
Béni soit Dieu de ce qu'il est toujours
possible d'être gardé de
tout mal. Priez pour nous, que
nous croissions dans la grâce en dépit
de tous les obstacles.
Notre frère et nos soeurs
n'étaient cependant pas inactifs à
Shae-ki-Tien. Miss Géraldine écrit
plus tard :
Nous avons eu une belle
après-midi. On nous a invitées
à entrer dans au moins vingt maisons. Nous
avons accepté les invitations aussi
longtemps que le temps dont nous disposions nous
l'a permis. Chacun s'est montré si bon, si
cordial envers nous ! ... Il y a quelques
jours, je suis allée avec une de nos femmes
dans une partie de la ville où je
n'étais jamais allée, et là
j'ai pu avoir par deux fois un nombreux auditoire
dans un grand espace vide compris entre des
maisons. Tout le monde m'a écoutée
avec la plus grande attention, et j'ai pu leur
exposer l'Évangile avec clarté ;
quant à aller plus loin, ce serait difficile
maintenant...
Mon coeur est ici. J'aime ce
peuple.
À plusieurs égards, c'est le meilleur
de la Chine ; il nous donne les plus belles
espérances. J'aime ces pauvres femmes ;
combien il me tarde de les voir gagnées
à l'Évangile ! elles, tout
particulièrement, nous donnent les plus
grandes espérances. Que Dieu soit
loué !
Shae-ki-Tien, Juillet 1889.
C'est
dimanche matin, -
journée chaude, splendide.
Le culte est terminé et nous
sommes encore réunies dans la chambre des
femmes.
Plusieurs se préparent
à retourner dans leurs maisons, d'autres
s'entretiennent au sujet des réunions du
matin. Parmi ces dernières, se trouvent deux
femmes d'âge mûr qui
extérieurement n'ont rien de bien attrayant,
mais qui nous sont particulièrement
précieuses, car nous trouvons en elles un
réel amour de la
vérité.
Je vais m'asseoir auprès
d'elles et Tuan-Sao-Sao me fait l'accueil le
plus chaleureux ; elle
prend mes mains dans les siennes et les serre avec
une joie et un amour tout particuliers. Sa
compagne, Chao-Sao-Sao, veut être
baptisée ; elle me le dit avec un
accent qui dénote la grandeur de son
désir. Elle désire l'être
immédiatement pour aller ensuite chez sa
vieille mère lui parler de Jésus
avant qu'elle ne meure. La route est longue,
quarante li (environ 5 kilomètres) qu'elle
doit faire sur ses pauvres petits pieds
mutilés, car elle n'a pas les moyens de se
procurer un véhicule.
« Mais, dit-elle,
j'irai
si vite ! oh ! cela me semblera facile,
je soupire tant après le moment où je
verrai ma mère ! »
Puis elle ajoute :
« Si nous croyons en Jésus,
pouvons-nous faire entrer quelqu'un avec nous dans
le ciel ? »
« Oui ! répond
Tuan-Sao-Sao, qui ajoute aussitôt :
« Le
pouvons-nous ? »
Avec quel sérieux, quel
ardent désir, ces femmes m'adressaient ces
questions !
« Pourquoi demandes-tu
cela ? » dis-je à
Tuan-Sao-Sao, devinant sa
réponse.
« Ah ! mon
mari ! mon fils ! »
fit-elle.
« Quoi ?
dis-moi
tout, » répliquai-je.
Et j'écoutai avec le plus
profond intérêt l'histoire qu'elle
nous fit avec des larmes dans la voix.
Son mari est bon et aimable,
mais
très opposé à
l'Évangile ; son fils est plein de
respect et d'affection pour elle ; mais il
est, comme son père, tout imbu de
préjugés contre la
vérité. Au surplus, il est lié
par un voeu, ce qui fait craindre à sa
pauvre mère qu'il ne veuille pas entendre
parler de devenir chrétien. Étrange
histoire que ce voeu ! un trait pris sur le
vif qui nous fait pénétrer au plus
profond de la vie intime de ce peuple.
Cet hiver, Tuan-Sao-Sao tomba
très gravement malade pendant que son fils
était absent. Le fils revint et trouva sa
mère mourante et toute la famille
plongée dans la plus grande
affliction ; car Tuan-Sao-Sao est très
aimée de tous les siens.
Or, à sept cents li (environ
quatre cents kilomètres) de Shae-ki-Tien,
dans les montagnes, non loin de la Grande
Rivière (le Han), se voit, au sommet
d'immenses rochers à pic, un fameux temple
à peu près inaccessible, but
de nombreux pèlerinages.
Notre jeune homme prit la résolution d'y
aller confesser les péchés de sa
mère, brûler de l'encens et implorer
pour elle, pardon et guérison. Une
épaisse couche de neige couvrait la terre,
car on était au coeur de l'hiver (un hiver
de l'Honan !) ; il n'en fit pas moins le
voeu d'y aller nu-pieds, vêtu d'une mince
mousseline et chargé de chaînes de fer
d'un poids énorme.
La pauvre mère était
trop malade pour rien savoir de cette
résolution héroïque ; et le
fils eut soin qu'elle ne le vît pas quand il
partit par une matinée glaciale, sur une
terre gelée, à travers les
tourbillons d'une neige qui permettait à
peine d'ouvrir les yeux.
Le jeune homme commença par
visiter tous les temples de la ville ; il
brûla de l'encens devant toutes leurs idoles.
Cette longue et pénible tâche
accomplie, il entreprit son grand voyage. Il
n'avait jamais porté de fardeau ;
aussi, chargé, comme il était, les
quatre cents kilomètres lui parurent-ils
interminables. Enfin, après des souffrances
qu'on ne peut imaginer, il touche au but de son
voyage ; un dernier et suprême effort
l'amène au faîte des rochers ; le
voilà dans le fameux temple ; il se
prosterne devant la cruelle divinité ;
il lui offre, ses prières et son
encens ; il dépose ses lourdes
chaînes à ses pieds ; puis
s'engage solennellement à renouveler deux
fois son voyage dans les deux années qui
suivront, si la vie de sa bien-aimée
mère est épargnée et ses
péchés pardonnés.
Or, ce voeu le lie encore, car
sa
mère est mieux.
En écoutant ce récit
fait d'une voix émue, toute tremblante
d'émotion, en voyant ces yeux de ma
chère Tuan-Sao-Sao sans cesse baignés
de larmes, je comprends combien ce coeur de
mère est touché du dévouement
de son fils.
Et maintenant, voudra-t-il venir
à Jésus ? Il m'est dur de dire
à la pauvre mère que le voeu de son
fils et tous ses mérites ne peuvent servir
de rien ; mais je suis heureuse de lui
rappeler qu'il y a un mérite, un sacrifice
plus excellent, qui a été offert pour
eux, seul moyen d'obtenir le pardon et la
guérison du corps, et de
l'âme.
Nous ne pouvons pas douter que
cette
femme ne soit sauvée, qu'elle ne marche dans
« le chemin étroit qui mène
à la vie, » Dieu en soit
béni !
Et nous avons la grande joie de
la
compter au nombre des cinq premières femmes
qui recevront le baptême dans notre cher
Shae-ki-Tien.
Après notre entretien, nous
prions tous ensemble avec ardeur pour son mari et
pour son fils, ainsi que pour les quatre fils de
Chao-Sao-Sao dont un seul est
chrétien ; puis les deux femmes nous
quittent pour gagner leurs demeures.
Je suis seule ce soir dans ma paisible
chambre,
avec un tout petit bébé chinois de
sept mois, très malade d'une bronchite. Mon
coeur se reporte vers vous, dans notre cher home,
toujours le mien, malgré la
distance !
Quand la pauvre mère nous
apporta son enfant cet après-midi, elle
consentit à rester avec nous, étant
convaincue que nous ferions du bien à
l'enfant. Je leur donnai aussitôt ma chambre,
c'est ainsi que le petit bébé se
trouve maintenant à côté de
moi, dans le berceau du petit Howard. Nous avons
couvert de cataplasmes le dos et la poitrine du
pauvre petit, et tout près de lui nous avons
placé une grosse bouilloire qui lui envoie
une grande quantité de vapeur. Nous lui
donnons de l'aconit et de la belladone et nous
avons la confiance qu'il sera bientôt mieux.
Cher petit agneau ! La mère vient
d'aller dans la chambre de Mme Taylor voir le petit
Howard qui prend son bain ; chose absolument
inconcevable pour nos amies chinoises dont les
enfants n'ont jamais eu que des rapports
très éloignés avec l'eau et le
savon.
La nuit dernière j'ai
été appelée auprès d'un
autre lit de maladie et je m'attends un peu
à y être rappelée ce
soir.
C'est un cas
lamentable ! Une
femme de vingt-cinq ans qui venait d'accoucher
après deux jours et deux nuits de
souffrances épouvantables, et qui avait la
fièvre puerpérale ; sa
température était de 41 centigr. et
elle avait à peu près perdu
connaissance. Oh ! que j'étais triste
de la voir tant souffrir et de me sentir si
incapable de la soulager ! Mon seul refuge
était la prière, et plusieurs fois
pendant cette longue nuit nous nous
agenouillâmes tous ensemble sur le sol boueux
de la pauvre cabane et nous suppliâmes Dieu
de lui conserver la vie. Et j'ai confiance, je
crois qu'elle se rétablira, bien qu'à
vues humaines cela semble impossible. Comme ce
pauvre peuple souffre !
C'était extrêmement
touchant, la nuit passée, de voir l'amour et
le dévouement du mari et de la mère
de cette pauvre jeune femme. Le mari
particulièrement, bien qu'il eût
été sur pied pendant plusieurs nuits,
lui prodigua sans cesse les soins les plus tendres
et les plus assidus. Sans penser à sa
fatigue, il la tint dans ses bras toute la nuit,
prévenant ses moindres désirs, la
consolant et l'encourageant avec la plus grande
tendresse. C'était beau et touchant au plus
haut point. Les larmes remplissaient souvent mes
yeux quand je les regardais, et je bénissais
Dieu de m'avoir permis de constater, au moins une
fois, une réelle affection, sur cette sombre
et cruelle terre païenne.
15 Août 1889.
Dix jours se sont
écoulés depuis que j'écrivais
les lignes qui précèdent
journées si douloureuses, si remplies
d'occupations de toutes sortes, que je n'ai pu
terminer ce que je voulais vous dire. Nuit
après nuit, nous avons veillé
auprès du pauvre bébé malade,
nous attendant à chaque instant à le
voir mourir dans nos bras, et le voyant toujours
revenir à la vie, en réponse
certainement à nos ferventes prières.
Nous n'avons pas eu l'idée quand nous
l'avons pris qu'il pût devenir aussi malade,
autrement je doute que nous l'eussions reçu.
Car s'il était mort chez nous, les
conséquences auraient
été des plus
graves. Déjà les rapports qui
circulent dans la ville sur notre compte sont des
plus mauvais ; le démon essaye des
moyens les plus cruels pour tourner contre nous le
coeur de ce peuple.
Pour ajouter à ces rumeurs
hostiles, on a fait circuler en ville un
écrit qui nous rend responsables de la
longue et terrible sécheresse qui menace de
détruire les récoltes. On affirme
dans ce factum que chaque nuit nous soufflons sur
les nuages et empêchons ainsi la pluie de
tomber ! S'il s'était donc passé
chez nous un fait palpable qui n'eût pas
été en notre faveur, si par exemple
le bébé était mort dans nos
bras, les conséquences auraient pu
être désastreuses.
Quant à ce qui nous concerne,
nous ne nous en mettons pas en peine, mais c'est
pour l'avancement du règne de Dieu, pour la
gloire de notre Maître, que nous sommes en
souci. Notre reconnaissance a donc
été grande quand, après six
nuits de veilles et d'angoisses, le
bébé a commencé à
être mieux et quand la pluie, pour laquelle
nous avions prié avec tant de ferveur, a
commencé à rafraîchir la terre
de ses bienfaisantes ondées. À la fin
de la semaine, l'enfant était guéri,
et nous eûmes un ou deux jours de
repos.
La ville est remplie de monde.
Trois
grands Shi (théâtres) donnent des
représentations ; et comme l'un d'eux
occupe toute la rue (3), devant
notre porte, nous
pensons
qu'il est prudent de ne pas sortir avant que la
représentation ne soit terminée. Ces
Shi sont très curieux. Ce sont des
théâtres ambulants qui donnent leurs
représentations en plein air. Une
plate-forme carrée d'environ dix
mètres de côté est
placée en travers de la rue, assez haut pour
qu'on puisse circuler dessous. Derrière la
scène se trouvent des appartements
fermés, chambres des acteurs, etc. On ne
paie rien pour assister au spectacle, aussi des
milliers de gens se pressent-ils dans la rue les
yeux fixés sur la scène pendant des
heures
entières.
IL faisait à peine jour ce
matin lorsqu'on vint réclamer notre secours
pour un cas d'empoisonnement par l'opium ; il
s'agissait d'une jeune fille de seize ans. Mme
Taylor y alla et quelques heures après
rapporta de bonnes nouvelles de la jeune fille. La
difficulté de circuler dans les rues
était très grande.
Peu après midi, on vint nous
chercher pour un second cas ; cette fois,
c'était une femme âgée qui
avait pris le poison. Mme Taylor se rendit
auprès d'elle. Mais un moment après
son départ, un messager arriva
précipitamment de la maison où elle
avait été le matin, disant que la
jeune fille était beaucoup plus mal et qu'on
nous priait de venir tout de suite.
J'implorai ardemment
l'assistance de
Dieu, et me munissant de tout ce qui pouvait
m'être utile, je partis, un peu craintive,
accompagnée de Chang-Sao-Sao et d'un
homme.
Le théâtre battait son
plein au moment où nous parûmes sur le
seuil de notre porte. Devant nous, c'était
une mer de têtes, foule compacte de tous
côtés. Je jetai un regard sur les
figures grotesques qui étaient sur la
plate-forme, puis nous nous faufilâmes
au-dessous. De l'autre côté la foule
était moins grande, et nous pûmes
continuer notre chemin sans trop de
peine.
Les voix aiguës des acteurs
étaient presque couvertes par le fracas des
gongs, des cymbales et autres instruments aussi peu
harmonieux qui font retentir les airs tout le temps
de la représentation. Les scènes
qu'on jouait étaient pleines
d'horreur ; l'une d'elles, souvent
répétée, représente les
tortures de l'âme qui, après la mort,
passe par les sept enfers.
Heureusement pour nous,
l'attention
de tout le monde était rivée sur la
plate-forme, et nous pûmes passer sans
exciter beaucoup la curiosité ;
cependant un grand nombre de personnes nous
suivirent et leur nombre allait en augmentant, au
surplus les physionomies ne semblaient pas aussi
bienveillantes qu'à
l'ordinaire, aussi fus-je heureuse d'atteindre
bientôt la maison où nous
étions attendus.
Le jour baissait, et dans cette
misérable demeure, pleine de monde
c'était nuit noire, mystère. Avant
tout, il nous fallait une lumière ;
mais tout le monde semblait inerte et insensible.
Nous prions, supplions, admonestons : qu'on
veuille bien avoir la bonté de nous donner
une lampe, une chandelle ! il fallut plus d'un
quart d'heure pour qu'on nous apportât un
petit morceau de moelle de bambou dans une soucoupe
d'huile. C'est alors que nous, vîmes
où se trouvait la pauvre jeune
fille.
Le premier coup d'oeil me
convainquit qu'elle était mourante. Le corps
raidi, les lèvres pourpre, la face
enflée, la respiration pénible en
disaient assez, Sa mère ne l'avait pas
seulement laissée dormir, elle lui avait
donné à manger, du solide, une des
choses les plus funestes en pareil cas. Et
maintenant la pauvre femme se lamentait
auprès de sa fille mourante. J'appris
bientôt des voisins qui remplissaient la
chambre et qui n'épargnaient pas leurs
reproches à cette mère, que
c'était elle qui par sa dureté, sa
cruauté, avait poussé sa fille
à prendre l'opium.
Nous fîmes tout ce que nous
pûmes, mais c'était trop tard.
J'aurais voulu partir au bout d'une heure ou deux,
mais tout le monde me suppliait de rester. La
pauvre fille perdit bientôt connaissance et
chacun comprit qu'elle allait mourir. Tous se
mirent alors, à ma grande détresse,
à lui changer de vêtements ; ils
lui mirent tout ce qu'elle avait de plus beau, car,
disaient-ils, il fallait qu'elle mourût
respectable ! Ses pauvres petits pieds furent
repliés et comprimés dans la plus
petite de ses chaussures ; on lui mit son
costume le plus gai, sa plus belle coiffure :
écarlate, bleu et argent. Sa pauvre
tête tombait tantôt d'un
côté, tantôt d'un autre ;
ses yeux vitreux nous regardaient fixement ;
et chacun se hâtait d'accomplir sa
tâche, avec force bruit, bousculades et
clameurs.
Je regardais faire, le coeur
navré, quand, à ma grande surprise,
les hommes enlèvent la mourante et la
transportent dans la pièce voisine, dans
l'obscurité ; aussitôt les femmes
et les enfants éclatent en cris et en
gémissements. Appelant Chang-Sao-Sao, je
suis les hommes dans l'autre pièce, et je
vois la mourante étendue
à terre sur une natte tout près de la
porte, au froid et au courant d'air.
Indignée, je leur fais sentir son coeur et
ses mains et je leur montre qu'elle n'est pas
morte, qu'elle en a pour un bon moment
encore.
Un peu surpris, ils se regardent
les
uns les autres et s'en vont un à un, me
laissant seule avec la mourante, sa mère et
ses soeurs. Il est tard, mais nous ne pouvons les
abandonner. Les petites soeurs me tiennent les
mains en pleurant et toutes me supplient de rester.
J'envoie un mot à Mme Taylor ; et je
m'assieds par terre, prenant la mourante dans mes
bras.
Elle semble presque
étouffée par une matière
épaisse qui fait un bruit de râle
affreux dans sa gorge. Une fois, elle se
lève subitement, saisit ma main et regarde
autour d'elle avec des yeux suppliants. Nous
faisons, naturellement, tout ce que nous pouvons
pour la soulager et nous prions sans nous
lasser ; mais c'est trop tard, le poison
opère rapidement. Elle tombe de nouveau sans
connaissance dans mes bras et nous comprenons bien
qu'il n'y a plus rien à faire. Je prends un
pu-kai, je l'en enveloppe chaudement, puis je
m'assieds à côté d'elle sur le
sol, attendant la fin.
Les petites soeurs, chères
enfants de huit et dix ans, se blottissent
près de moi et la mère s'en va. Le
frère et les domestiques hommes (ces gens ne
sont pas du tout pauvres) dorment dans la chambre
à côté. C'est minuit, je pense
qu'ils sont fatigués.
Quelques minutes ne s'étaient
pas écoulées qu'une odeur d'opium,
quelque chose de lourd et d'écoeurant,
arrive jusqu'à nous. Qui donc peut fumer,
ici, à cette heure ? « C'est
ma mère disent les petites, elle fume
toujours. »
Le coeur brisé,
accablée de douleur et de honte, je laisse
tomber ma tête à côté de
cette chère enfant qui meurt auprès
de moi. Je suis navrée à la
pensée de la part que l'Angleterre a prise
au triomphe du démon ; c'est elle
surtout qui a amené cette plaie effroyable
de l'opium sur le peuple de mon adoption. Je me
sens solidaire du crime de ma patrie ; et,
désolée, je reste prosternée
le front dans la poussière. Le
péché de mon peuple est le mien,
oh ! puissent aussi ma douleur et ma honte
devenir les siennes !
Hélas ! la douleur et
les regrets ne servent plus de rien ici, à
cette heure. Je console les vivants et je pleure
sur celle qui meurt, c'est tout ce que
jepuis faire. Et pour mon peuple
aussi c'est trop tard, il ne réparera jamais
le mal qu'il a fait ; mal incalculable qui
justifie cette réponse amère que
faisait dernièrement un Chinois
lettré à un
missionnaire :
« Je ne sais rien du
ciel,
mais je sais qu'il y a un enfer, car la Chine en
est un depuis que vous lui avez apporté
l'opium. »
À la pointe de nos
baïonnettes, nous l'avons forcée
à prendre notre opium et c'est trop tard
pour défaire ce que nous avons fait, car
l'empire entier est maintenant saturé de ce
poison ! Il semble qu'il y ait à peine
une maison où il n'ait frappé
quelqu'un à mort.
Par la grâce de Dieu pourtant,
nous pouvons faire quelque chose pour les
vivants ; nous pouvons au moins prendre les
petits enfants par la main et les conduire dans des
voies meilleures. Nous leur avons donné
notre opium ; leur cacherions-nous notre Bible
et notre Sauveur ?
Ils demandent à grand cris la
Bible et la Lumière de la vie ; ils
tendent vers nous leurs mains vides et
suppliantes ; ils demandent que nous les
aidions à sortir du terrible, esclavage dans
lequel les a jetés notre drogue mortelle.
Oh ! que l'Angleterre chrétienne se
lève comme un seul homme, qu'elle donne ce
qu'elle a de meilleur, ses fils, ses filles, son
argent et son or ; décidée
à faire tout ce qui est possible pour sauver
ce peuple et décharger nos consciences du
fardeau de honte et de culpabilité qui les
oppresse.
Il est plus de minuit, il fait
froid
et sombre. La mourante est plus faible, le terrible
râle de la mort augmente et il est plus
rauque qu'auparavant. Les petites soeurs se sont
endormies, leurs têtes reposent sur le corps
raidi de la mourante. Je prends la plus petite dans
mes bras et je l'enveloppe de mon manteau ;
l'autre s'éveille et appuie sa tête
sur mes genoux. Chang-Sao-Sao est assise
près de nous, elle veille tranquillement,
mais avec une figure grave et triste. Pendant trois
longues heures nous restons ainsi immobiles ;
- trois heures affreuses, inoubliables ; dans
cette chambre froide, sombre ; en face d'une
mort horrible, et avec la conscience de tout ce
qu'elle signifie.
Ce matin encore cette jeune
fille
était gaie et bien portante ; en pleine
jeunesse, ne pensant nullement à mourir, et
maintenant....
Et, chaque mois, « un
million de Chinois meurent sans
Dieu ! »
La respiration est plus lente,
le
râle plus fort ; et, sauf nous, personne
ne s'en inquiète ! Maintenant il se
fait un long silence, - puis un faible soupir, un
frisson, - et tout est fini.
Je m'agenouille près d'elle,
et les jeunes filles se réveillent ;
elles me regardent tout étonnées de
voir mes larmes. Peu après, la mère
et les autres personnes entrent. Le frère,
sans dire un mot, va chercher un rouleau de papier
et le brûle sur le sol à
côté de la tête de la
défunte. Il dit que c'est pour lui envoyer
de l'argent dans le pays des ombres où elle
est allée. Le coeur navré, j'essaie
de leur parler de Celui qui a ôté
à la mort toutes ses terreurs ; mais
ils sont trop fatigués pour écouter,
et moi-même je suis trop triste pour leur
dire grand'chose.
Au moment où nous sortons
dans la nuit froide et sombre, les petites filles
me prient de revenir. Nous traversons la ville
silencieuse et endormie et nous rentrons chez nous
à trois heures et demie. Je m'assieds dans
la solitude pour réfléchir à
tout ce que je viens de voir.
Je vous ai raconté exactement
ce qui s'est passé. Mais aucune parole ne
pourrait dire combien cela fut triste. Et ce n'est
qu'un cas parmi des centaines de semblables qui se
produisent chaque jour, ici, dans ce grand
pays.
Il me serait impossible de dire
combien je suis reconnaissante d'être ici, en
Chine ; aucune expression ne serait assez
forte pour cela. Quelle perte ils font, ceux qui
pourraient venir et qui ne viennent pas ! Et
quel sera leur sort ? Dieu n'a-t-il pas
dit :
« Si tu négliges de
délivrer ceux qui sont traînés
à la mort, ceux qui vont être
tués, et si tu dis : « Je ne
le savais pas. » Celui qui pèse
les coeurs n'y prendra-t-il pas garde ? Celui
qui veille sur ton âme ne le saura-t-il
pas ? et ne rendra-t-il pas à chacun
selon ses oeuvres ? »
Votre dévouée ;
avec Jésus, cherchant ceux qui sont perdus,

| Chapitre précédent | Table des matières | - |
