
APPENDICE
-------
PRESQUE six mois après le triste
événement, le 6 avril 1840, la
nouvelle en était apportée en
Angleterre par le courrier des Indes. Un journal du
Bengale annonçait le meurtre de Williams, en
reproduisant un article paru dans une revue de
Sydney. Le 4 mai, le Comité de la
Société des Missions de Londres
était officiellement averti.
Immédiatement, les directeurs se
réunirent. Quelques jours après, la
nouvelle était communiquée à
la foule réunie à l'occasion de la
fête annuelle des Missions à Londres.
Un service funèbre fut
célébré au Tabernacle
(Moorfields), en souvenir du vaillant pionnier des
Mers du Sud. Le Rév. Timothée East,
de Birmingham, prononça l'oraison
funèbre devant la famille affligée et
les nombreux amis de Williams. Enfin sur
l'initiative du Comité de la
Société de Londres, une souscription
fut ouverte en faveur de la veuve du martyr, et de
ses enfants.
... Il serait difficile de trouver un homme
plus désintéressé que ne le
fut Williams, écrit son biographe : Les
autres, leurs difficultés, avaient toujours
la première place en son coeur. Du jour
où il s'était donné au
Seigneur et jusqu'à la fin il manifesta
toujours le même esprit d'abnégation
et de joyeux sacrifice. Tout ce qu'il avait,
appartenait il l'oeuvre missionnaire ; de
sorte qu'il put faire bien plus que ne l'aurait
permis le maigre salaire alloué aux ouvriers
travaillant en Polynésie.
Tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il
savait, tout son temps, toutes ses forces,
absolument tout, fut donné avec joie, avec
amour, sans compter... Et Dieu bénit
abondamment le travail de son serviteur...
Cependant, ni l'esprit de
consécration, ni l'habileté pour les
travaux manuels ne suffisent à expliquer
l'extraordinaire carrière du missionnaire et
ses succès. Le travail et la
persévérance, voilà le secret
de sa vie. C'est aussi celui de la vie des grands
hommes. Williams fut un travailleur dans toute
l'acception du mot. Il se donnait
complètement à tout ce qu'il
entreprenait. Commencer pour lui, c'était
aussi achever. Jamais il ne renvoyait à plus
tard le devoir qui se présentait à
lui. Dans sa vie, rien de capricieux, de
spasmodique, point
d'indécision. »
Il aimait les indigènes
(1). Où
qu'il fût, à la forge, construisant
une maison ou chez lui, les indigènes
l'entouraient, le regardaient faire, le
questionnaient. Il semble parfois fastidieux
d'avoir à répondre à des
questions puériles, d'être
entouré de gens au coeur endurci, à
l'esprit enténébré. Ce
n'était point le cas pour Williams :
très communicatif lui-même, il se
gardait d'éloigner les visiteurs et essayait
d'élever leur niveau en les amenant à
penser sainement ; en leur communiquant
quelque bienfait d'ordre matériel,
intellectuel ou spirituel. Chez lui l'exemple
allait avec le précepte : de quoi qu'il
s'agît, il était toujours le premier
sur la brèche. Il ne disait pas
« Allez », mais :
« Venez ».
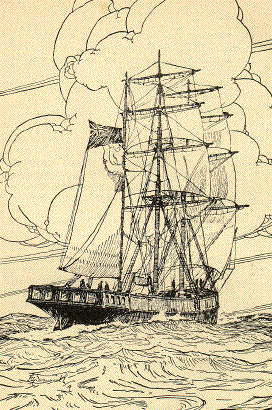
The John Williams I
Navire acheté par les enfants des Écoles du Dimanche d'Angleterre pour remplacer le « Camden ». Aujourd'hui le « J. Williams IV » parcourt le Pacifique.
Un autre trait du caractère de Williams
que j'ai souvent eu l'occasion d'observer quand je
travaillais à ses côtés, c'est
qu'il était de plain-pied avec
l'indigène. Le missionnaire qui trouve les
indigènes sales, mal
élevés, bruyants,
dégoûtants, celui qui les
relègue à la cuisine quand ils
viennent le voir, et qui se croit d'une autre
essence, manque des qualités essentielles
pour son activité. Telle n'était pas
l'attitude de Williams, non plus que celle de
plusieurs collègues encore à l'oeuvre
en Polynésie.
... Enfin nous voulons aussi relever ici sa
grande connaissance de la Bible. Si occupé
que fût Williams, la lecture du Livre et la
prière commençaient ses
journées. Il savait l'inutilité du
travail sans la bénédiction de Dieu.
Dans le cercle plus intime de la famille, Williams
est le même. Là encore il
déploie les mêmes qualités de
bonté, de compréhension, de patience.
L'intimité le grandit encore. Ce qu'il est
en chaire, il l'est aussi au foyer. Sa conduite est
exemplaire. Durant les années de vie
missionnaire, Mrs. Williams souffrit beaucoup du
climat, de la maladie, des longues
séparations ; mais tout ce qui pouvait
être fait, humainement parlant, pour lui
rendre les choses faciles et adoucir son existence
était fait ; elle était
entourée des mille petits soins que
suggérait la sympathie. La plus grande joie
de Williams était de deviner ce qui pouvait
lui faire plaisir, et de le lui procurer avant
qu'elle n'en ait formulé le désir.
À son foyer, Williams est encore le
missionnaire. Plus encore que toutes ses autres
qualités, sa piété donne le
secret de sa vie, le secret de ses succès.
Et la morale qui se dégage de cette
existence donnée au service de Dieu et des
autres, c'est que la bonté est la
véritable grandeur.
« J'HONORERAI CEUX QUI
M'HONORENT ».
[Ces lignes terminent la biographie
écrite par Ebenezer Prout, en l'année
1843, peu après la mort de Williams.]
NOTES EXTRAITES DU LIVRE ÉCRIT PAR JOHN WILLIAMS
IDOLES POLYNÉSIENNES. - CÉRÉMONIES PAÏENNES. - SACRIFICES HUMAINS. - LE DERNIER SACRIFICE HUMAIN A TAHITI. - INFANTICIDE. - FÊTES DE JEUNESSE.
Les Polynésiens adoraient les
ancêtres qui pour quelque raison
étaient devenus célèbres et
avaient été déifiés,
des idoles, des étous... Il y avait aussi
une vague croyance en un Être suprême,
Créateur de toutes choses - en particulier
aux Îles Samoa. Quelle occasion pour le
missionnaire de prêcher sur ce texte :
« Le Dieu que vous adorez sans le
connaître, c'est celui que nous vous
annonçons. » Le culte rendu
consistait en prières, incantations,
offrandes, en sacrifices humains, en blessures
volontairement infligées ;
c'étaient généralement les
incisives et les phalanges des doigts que les
indigènes des Îles Tonga offraient
à leurs divinités. Là, presque
tous les adultes ont les mains mutilées.
« Certain jour, écrit Williams, je
remarquai qu'une jeune femme de dix-huit ans
à peu près, fille de chef, avait
dû récemment se couper un doigt. Comme
je lui en demandais le pourquoi, elle me
répondit que sa mère avait
été gravement malade, et qu'elle avait
fait
cela pour obtenir sa guérison.
- Et comment as-tu séparé la
phalange ?
- J'ai pris un coquillage coupant et j'ai
tailladé jusqu'à ce que le doigt soit
séparé, puis j'ai laissé le
sang couler. C'était mon offrande aux dieux
en faveur de ma mère. »
Généralement ce sont les petits
doigts qui sont ainsi sacrifiés, phalange
par phalange -, et quand ils ont été
complètement amputés, l'homme ou la
femme fait saigner la plaie fermée en la
frottant avec des pierres pointues.
Mais la plus horrible pratique était
celle des sacrifices humains, pratique très
répandue aux Îles Australes, à
Tahiti, Mooréa et aux
Îles-sous-le-Vent, dans l'archipel de Cook,
etc... Pour le Raumatavehi raa, fête de la
Restauration qui avait lieu après le
départ d'une armée ennemie
victorieuse, il fallait sept victimes.
Pour l'installation d'un grand roi, la
coutume voulait qu'on ajoutât un morceau
à la Ceinture rouge - Maro ura - bande de
filet de 2 mètres de long et de 16
centimètres de large, à peu
près, dans ce filet, on entrelaçait
des plumes rouges. Lorsque la ceinture était
étendue pour ce travail, on immolait une
première victime (mauraa titi). Lorsque le
nouveau morceau était ajouté à
la ceinture (fatu raa), nouveau sacrifice. Lorsque
le travail était achevé et qu'on
reprenait la ceinture : (piuraa), nouvelle
victime. Nommer quelqu'un Roi de la Ceinture rouge
était le plus grand honneur qu'on pût
lui faire. Tamatoa, roi de Raïatéa, qui
la possédait, me la remit pour que je
l'envoie au Musée des Missions à
Londres, où elle se trouve
(2).
Au moment d'entreprendre une guerre, de
livrer une bataille, on offrait
encore des sacrifices. Lorsqu'un fils de chef
naissait à Rarotonga on offrait
aussitôt deux hommes sur l'autel... La
manière dont les victimes étaient
choisies illustre ce que dit l'Écriture du
paganisme. Dès que le prêtre avait
annoncé qu'il fallait un sacrifice humain,
le roi envoyait des messagers aux chefs des
districts. En entrant dans une case les serviteurs
royaux demandaient au chef :
« N'as-tu pas une calebasse
fendue ? » Ou encore, une mauvaise
noix de coco ? Ces expressions et d'autres
semblables étaient comprises.
Aussitôt, par un mouvement de la tête
ou de la main, le chef désirait l'individu
à prendre. Il gardait
généralement auprès de lui
quelques indigènes destinés -
à leur insu - au sacrifice. Les messagers du
roi n'étaient armés que d'une pierre
ronde, noire, cachée dans la paume de la
main : ils lançaient aussitôt
celle-ci avec force sur la nuque de
l'indigène désigné ;
leurs suivants se précipitaient alors et
achevaient la victime qui était
transportée au maraë avec des cris
sauvages et des chants de triomphe.
D'autres fois la victime
désignée était paisiblement
occupée dans sa maison. Celle-ci
était alors entourée et les
pourvoyeurs du roi se faisaient un jeu de viser
l'homme par les ouvertures de sa case : entre
les bambous, par le toit, etc... Le malheureux
courait alors d'une cloison il l'autre, se jetait
en tous sens, hurlait de douleur sous les coups.
Où qu'il se jetât, la pointe d'une
lance le perçait... Alors, sentant que la
fuite était impossible, il se couvrait la
tête de « tapa » ou de
quelque autre objet, s'étendait par terre au
centre de la hutte et attendait la mort.
Ce qui était plus effroyable encore
si possible, c'est que toute la famille de la
victime, tous les hommes, étaient dès lors
voués aux sacrifices. Il ne leur servait de
rien de s'enfuir en une autre île. Leur
histoire était vite connue, et c'est
là qu'ils étaient tués et
offerts sur le maraë. J'ai eu à mon
service un individu qui était le dernier
d'une famille sacrifiée. Huit fois il avait
été poursuivi avec des chiens jusque
sur les montagnes. Mais comme c'était un
excellent coureur, et qu'il savait déjouer
les ruses, il put échapper jusqu'au moment
où, l'Évangile étant
accepté, les sacrifices humains furent
abolis.
Voici comment fut saisi le dernier
indigène de Tahiti offert en sacrifice.
C'était à la veille d'une grande
bataille dont l'issue devait, ou confirmer la
royauté dans la maison de Pomaré, ou
consommer sa ruine. Pour se rendre propices les
dieux, il offrit sur l'autel d'immenses rouleaux de
tapa, des porcs, des poissons, des monceaux de
fruits et de légumes. Malgré cela le
prêtre demanda un tabou (ou sacrifice).
Pomaré envoya alors deux messagers pour
chercher la victime nécessaire. Celle-ci fut
choisie parce que l'indigène avait
accepté l'Évangile.
Les serviteurs du roi allèrent donc
pour se saisir de lui, mais ne trouvèrent
que sa femme. À leurs questions elle
répondit qu'il faisait une plantation de
bananiers à tel endroit. - « Nous
avons soif, dirent-ils, donne-nous des
cocos. » Comme elle leur répondait
qu'elle n'en avait pas à la maison, ils lui
demandèrent le « O »
(Morceau de bois de fer (3) aiguisé
qui sert à
ôter la bourre du coco et à ouvrir la
noix). Elle leur donna ce qu'ils demandaient et ils
s'en allèrent. Mais peu après, un
horrible soupçon vint en son coeur :
elle partit sur les traces des
indigènes et arriva à l'instant que
son mari était frappé et qu'il
tombait. Alors elle courut vers lui, mais elle ne
put le rejoindre étant aussitôt saisie
et ligotée. L'homme fut alors placé
dans une immense corbeille faite en feuilles de
cocotier et emporté vers le maraë. (Il
ne fallait pas que la femme ou la fille ou aucune
femme touchât la victime destinée au
sacrifice, ou qu'elle respirât seulement
près de celle-ci, ce qui dans la
pensée indigène pouvait rendre le
sacrifice inutile, la femme étant
considérée comme impure).
Pendant qu'on le transportait vers le
maraë. l'homme reprit ses sens et dit à
ceux qui l'emportaient : « E homa
(amis), je sais ce qui m'attend - vous m'emportez
pour m'offrir comme tabou à vos dieux
cruels. Je sais qu'il est inutile d'en appeler
à votre pitié, et que je suis
condamné. Mais si vous pouvez tuer le corps,
vous ne pouvez toucher l'âme... Car j'ai
commencé de prier Jésus, celui que
les missionnaires annoncent. » Alors les
porteurs déposèrent à terre
leur fardeau, placèrent une pierre plate
sous la tête de l'homme garrotté et
avec une autre frappèrent jusqu'à ce
que le crâne fût mis en pièces.
Ces faits parlent assez haut et n'ont point besoin
de commentaires. Certain jour, l'un des assassins
voyageait avec moi ; il me confirma ces faits
et me raconta plusieurs autres incidents du
même genre.
Aux Fidji, où les chefs ont de vingt
à cent femmes - selon leur rang - si l'un de
ceux qui ont une certaine puissance vient à
mourir, son corps est exposé en grande pompe
sur une vaste pelouse à la vue de la foule
accourue. La première épouse est
alors ornée, décorée, embellie
à la manière indigène ;
tout l'art fidjien se déploie en cette
occasion. Cela terminé, elle traverse la
pelouse et va s'asseoir à côté
du défunt.
Une corde est alors passée autour de
son cou, huit à dix indigènes
réputés pour leur force s'attellent
à chaque extrémité et tirent
jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Une
seconde épouse prend alors sa place, puis
une troisième et une quatrième.
Ensuite le défunt et ses quatre femmes sont
déposés dans la même fosse -
l'une sous lui, l'autre au-dessus, les deux autres
à droite et à gauche. La raison
donnée de cette horrible coutume c'est qu'il
ne faut pas que l'esprit du chef fasse seul le
voyage vers le monde invisible -, de plus, cette
offrande lui vaut un bonheur immédiat.
Les Polynésiens croient à une
vie future : à un endroit de
délices, Roohoutou noanoa,
c'est-à-dire Roohoutou parfumé, et
à un lieu dégoûtant
nommé Roohoutou namounamou. Ceux qui
quittent ce monde vont habiter en l'un ou l'autre
de ces endroits.
Pour les Rarotongans le ciel est un immense
édifice entouré d'arbustes et de
fleurs. Ceux qui l'habitent jouissent d'une
jeunesse perpétuelle et s'amusent sans
cesse. Quant aux autres, ils sont condamnés
à ramper autour de cette demeure, à
voir les plaisirs, les joies de ses habitants, sans
jamais pouvoir y entrer.
Les conditions d'admission sont absurdes.
Pour l'obtention de ce ciel, le défunt
devait être orné au mieux des
possibilités de sa famille, et
couronné de fleurs. Puis un porc
était cuit entier et placé sur le
corps qu'on entourait ensuite de fruits et de
légumes. Cela fait le père du
défunt, s'il s'agissait d'un fils, disait au
mort : « Mon fils, alors que tu
vivais je t'ai traité avec bonté, et
quand tu es tombé malade j'ai fait de mon
mieux pour te guérir. Et maintenant que tu
es mort, voici ton momoéo, le présent
de ton entrée (au séjour des
bienheureux). Va, mon fils, sois introduit dans le
palais de
Tiki, et ne reviens pas en ce monde nous effrayer
ou nous alarmer. »
Le tout était alors recouvert de
terre, et si rien de fâcheux ne survenait
dans les quelques jours qui suivaient, les parents
considéraient que tout s'était bien
passé et que le mort était
auprès de Tiki. Mais s'ils entendaient un
« grillon », la chose
était considérée comme un
mauvais présage. Aussitôt la famille
faisait entendre les plus lugubres plaintes, sorte
de hurlements, et se répandait en
lamentations : « Oh notre
frère n'est pas au paradis ! Soit
esprit n'a pu y entrer ! Il souffre de la
faim, il tremble de froid. »
Aussitôt la tombe était ouverte, et on
répétait la première
cérémonie avec une nouvelle offrande
de vivres ; cette seconde offrande
était généralement la
dernière.
À Tahiti, à Mooréa, aux
Îles-sous-le-Vent, la mise a mort des
nouveau-nés était presque de
règle. Dans ce dernier groupe toutes les
femmes avec qui j'ai parlé de l'horrible
coutume ont confessé qu'elles avaient
tué de nombreux bébés avant
l'introduction de l'Évangile.
Un jour, je fus appelé en hâte
auprès d'une femme de chef qui se mourait et
qui était dans une grande angoisse. Elle
avait appris à lire à 60 ans, elle
était devenue monitrice d'un groupe
d'adultes et s'était montrée
fidèle au service de Christ depuis sa
conversion. Quand j'arrivai, elle
s'écria : « O serviteur de
Dieu, entre ! Dis-moi ce que je dois
faire ? » Voyant qu'elle
était dans une grande détresse, je
lui en demandai la cause :
« Je vais mourir ! Je vais
mourir ! Mes péchés, mes
péchés ! Je vais
mourir ! »
Je lui demandai quels étaient les
péchés dont le souvenir l'assaillait
en cet instant, et elle me répondit :
« Mes enfants ! Les petits
bébés que j'ai tués. Et je
vais les rencontrer maintenant au tribunal de
Christ. - Combien donc en as-tu tué ?
demandai-je. - Seize ! Et maintenant je vais
mourir. »
Saisi d'étonnement et d'horreur parce
que je venais d'apprendre, je dis à la
pauvre femme après quelques secondes de
silence : « Tu l'as fait quand tu
étais païenne, quand tu n'avais pas
encore accepté Christ. Or, c'est une chose
certaine que Christ est venu pour sauver les
pécheurs. »
La conscience réveillée de la
malheureuse parlait avec force. Je revins la voir
souvent pendant les huit jours que dura la maladie,
et avec le secours de Dieu, je réussis
à détourner ses regards de ses
péchés pour les porter vers Celui qui
avait pris sur Lui le poids de son iniquité
et payé sa rançon.
Au regard de cette abominable coutume et de
ces faits, on comprend aisément toute la
joie qui accompagne nos fêtes de jeunesse, et
combien éloquemment celles-ci manifestent la
puissance de transformation de l'Évangile.
À certaines fêtes, de cinq à
six cents enfants sont réunis, puis ils
traversent le village en chantant et se rendent au
temple. Ils portent des bannières qu'ils se
confectionnent, où sont des inscriptions
comme celles-ci : « Quelle
bénédiction que
l'Évangile ! »
« Les chrétiens d'Angleterre nous
ont envoyé la Bonne Nouvelle »
« Sans l'Évangile nous aurions
été tués dès la
naissance », etc... D'autres
bannières ont comme inscriptions des versets
de l'Écriture : « Voici
l'Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde »
« Laissez les petits enfants venir
à moi », etc...
Quand les enfants sont entrés au
temple, l'examen commence ; les parents y
assistent, le roi préside...
Certaines figures respirent la joie et
l'orgueil ; d'autres la douleur. Il y a dans
l'assistance des parents qui n'ont plus d'enfant.
Un jour, lors d'une semblable fête, un
vieillard à cheveux gris, un chef, se leva,
et dit d'une voix vibrante d'émotion :
« Il faut que je parle, laissez-moi
parler ! » Et lorsqu'il y fut
autorisé il dit :
« Oh ! que n'ai-je connu
l'Évangile ! Que n'ai-je su qu'il
viendrait jusqu'à nous ! Alors,
j'aurais sauvé. mes enfants
(4). Je
les ai
tous tués. Il ne m'en reste plus un
seul ! » Puis se tournant vers le
président, il continua en disant :
« Toi, mon frère, tu m'as vu tuer
enfant après enfant, et tu n'as jamais saisi
cette main cruelle, tu ne m'as jamais dit :
Arrête, frère, Dieu va nous
bénir, l'Évangile va venir
jusqu'à nous ! » Puis le
vieux chef, après avoir maudit les faux
dieux qu'il avait servis, ajouta :
« Je vais mourir seul, et j'ai
été cependant le père de
dix-neuf enfants. » Puis s'asseyant, il
se mit à pleurer. J'ai été le
témoin de cette scène, et je pourrais
citer bien d'autres faits semblables.
L'une des raisons données pour cette
abominable coutume, c'est la guerre. Celle-ci
était si fréquente, si soudaine, si
affreuse, que les mères, pour éviter
les horreurs et les douleurs infligées
à quiconque avait, des enfants,
préféraient tuer ceux-ci. Une autre
raison, c'était la différence de
situation entre les époux. Si le mari
était de rang inférieur a la femme
les enfants étaient tués. Il fallait
la mort de deux, de quatre ou de six enfants, pour
que le mari fût élevé au
même rang que sa femme. La troisième
raison qu'on m'a donnée,
c'est que l'allaitement fatigue la femme et
détruit rapidement sa beauté.
Le bébé était
étouffé, ou étranglé,
ou enterré vivant. Une planche était
placée au-dessus de la tête pour
empêcher que l'enfant fût
écrasé. La méthode la plus
cruelle consistait à briser les
premières phalanges des doigts et des
orteils au moment de la naissance. Si l'enfant
survivait à ce barbare traitement, on
disloquait les chevilles et les poignets, puis,
s'il était nécessaire, le genou et
l'épaule. Ceci terminait
généralement les souffrances du
pauvre petit être. Sinon, on
l'étouffait enfin.
Ces faits que nous pourrions multiplier
jettent une triste lumière sur la nature
humaine sans Dieu. Il ne paraît guère
probable que l'homme, s'il s'y employait, pourrait
jamais convaincre les bêtes des champs de
détruire leurs petits. Même le tigre
des forêts et l'ours cruel se laissent tuer
pour les défendre...
L'homme, où qu'il soit, a besoin de
l'Évangile. Seule, la Bonne Nouvelle petit
le sortir de la dégradation où l'ont
plongé la superstition et le
péché...
Que ce soit donc l'ambition et l'honneur du
chrétien de répandre le glorieux
Évangile qui, seul, peut
régénérer l'homme et le rendre
heureux de façon permanente. »
John WILLIAMS
COMMENT L'OEUVRE EN POLYNÉSIE FUT CÉDÉE A LA SOCIÉTÉ DES MISSIONS DE PARIS (5)
« La conversion des indigènes
n'avait pas été chose superficielle.
À l'époque, les marins s'en
plaignirent. « Les belles habitantes de
la Nouvelle Cythère, écrivait
Chateaubriand, vont au prêche et expient dans
l'ennui la trop grande gaieté de leurs
mères. » Duperrey est
frappé par le respect du dimanche, la
réserve des femmes, la disparition de
l'idolâtrie...
« La nouvelle des victoires de
l'Évangile s'était répandue en
Europe, et en 1833 le pape Léon XII confiait
aux Pères de la Maison de Picpus la
tâche de convertir toutes les Îles du
Pacifique. En 1834, les RR. PP. Caret et Laval
arrivaient aux Gambiers avec Tahiti pour
objectif : il fallait détruire
l'hérésie.
« Pour défendre l'île
contre les matelots déserteurs et les
forçats évadés, la reine
Pomaré et les chefs avaient promulgué
une loi interdisant à tout étranger
de débarquer sans autorisation.
Malgré cette loi qu'ils connaissaient, les
RR. PP. Caret et Laval débarquèrent
à Tahiti en 1836, et refusèrent de
partir. On dut les emporter -
sans les molester cependant - à bord d'une
goélette en partance. Tels sont les
faits.
« Le P. Caret rentra en France
pour solliciter une
« réparation » à
Paris et à Rome. Il gagna sa cause, et
Louis-Philippe ordonna à Dupetit-Thouars
d'exiger de la Reine des excuses et une amende.
Pomaré céda devant la menace d'un
bombardement et signa un traité qui
permettait aux Français de s'installer
à Tahiti...
« Un aventurier fut nommé
consul de France. Sa conduite vis-à-vis de
la reine, sa vie privée, des dissensions
politiques furent cause d'une guerre qui dura
quatre ans.
« Les missionnaires anglais,
à l'exception d'un seul, avaient du quitter
Tahiti. En 1860, la reine Pomaré et
l'Assemblée législative des
États du Protectorat s'adressèrent il
la Société des Missions
évangéliques de Paris pour obtenir
des missionnaires protestants
français. »
Le rédacteur du Journal des Missions
fait précéder la pétition
qu'il publie, de ces lignes : « Les
Îles de la Société
placées aujourd'hui sous le protectorat de
la France ont été
évangélisées par des
missionnaires anglais de la Société
des Missions de Londres, compagnons et successeurs
du célèbre Williams,
« l'Apôtre de la
Polynésie ».
« On sait que malgré la
présence et les travaux des missionnaires de
l'Eglise romaine arrivés à la suite
des Français, l'immense majorité des
Tahitiens sont restés fidèles
à leur première foi, et que leurs
Églises, desservies par des pasteurs
indigènes sous la direction d'un pasteur
anglais resté seul en fonctions dans le
pays, sont prospères et pleines de
vie... »
« Les troubles et les
négociations avec l'Angleterre continuèrent
jusqu'en
1863. MM. Arbousset et Atger furent envoyés
en réponse à la requête de la
Reine. Et en 1865, la Société des
Missions évangéliques de Paris
prenait complètement la direction de
l'Oeuvre missionnaire à Tahiti et
Mooréa. »
Aux Îles-sous-le-Vent, c'est en 1893
que la Mission de Paris prit effectivement la
succession de la Mission de Londres, en envoyant
comme missionnaires M. et Mme Brunel, pour
remplacer Mr. et Mrs. Richards.
Mr. Richards était mort peu
auparavant, à Outouroa, chef-lieu de
l'île.
(1) Extrait d'une lettre de Mr. Ellis.
(2) Prononcer tous les u : ou.- (3) Aïlo : casuarine.
(4) Ce chef était un ancien arioï du rang le plus élevé ; et la loi de cette association veut que tous les enfants soient détruits.
(5) Extraits d'un rapport de M. Allégret et du « Journal des Missions de Paris ». (Juillet 1861).
| Chapitre précédent | Table des matières | - |
