
TROISIÈME PARTIE
LA SYNTHÈSE - 1921-1934..
-------
Henri Junod était revenu en Europe.
Il devait y passer la fin de sa vie. Peu d'hommes
ont eu le rare privilège qui lui fut
accordé de rassembler tous les
matériaux accumulés pendant
l'enfance, l'adolescence et la maturité,
pour leur donner une forme sinon définitive,
du moins aussi complète que possible. Les
années qui vinrent furent remplies par une
activité ininterrompue, aussi
considérable à bien des égards
que celle qui la précéda, une
activité toujours organisatrice, plus
réfléchie encore. L'ascension ne fut
jamais arrêtée. Nous aurons ici
l'occasion d'insister un peu plus longuement sur
les idées et les ouvrages de Henri-A.
Junod.
Le 15 juillet Henri Junod quitte la
maison missionnaire d'Auvernier et son cher pays de
Neuchâtel. Après un été
à Champéry, où il fut
appelé à faire les cultes de la
communauté protestante en
villégiature là-haut, et où il
apprit à connaître et à aimer
sa future belle-fille, Mlle Idelette Schnetzler,
Henri Junod fut appelé par la Mission
à prendre le poste d'agent à
Genève. Il vint s'établir dans la
maison Sautter, cette dépendance de la
vieille maison de Saussure, dans la campagne
Frommel, où tant d'amis vinrent le voir.
C'était une de ces maisons de l'ancien
temps, mais une maison pleine de charme et de
cachet qu'Henri Junod avait tout de suite
découverts. Car, malgré son esprit
toujours ouvert, il était
extrêmement attaché à tout ce
qui avait une histoire, à tout ce qui
rappelait un passé un peu désuet mais
empreint de poésie. Chère vieille
maison... où il installa peu à peu
ses collections : ses deux grandes armoires de
papillons et de coléoptères
africains, deux beaux meubles sur lesquels
était gravée la parole du
psalmiste : « La terre est pleine de
tes richesses », sa collection
ethnographique, avec le précieux sachet
d'osselets de Spoon-Elias, et mille objets divers
récoltés au cours de ses longues
campagnes africaines, tous soigneusement
étiquetés et classés ; sa
bibliothèque bien fournie, surtout en
ouvrages sur l'Afrique. Chère vieille
demeure... coins et recoins, escaliers en
colimaçon à casse-cou, réduits
borgnes ou aveugles ! C'est là qu'Henri
Junod s'établit.
Il était bien l'homme nécessaire à la Mission à Genève, siège de la Société des Nations, centre de propagande missionnaire, où les diverses sociétés à l'oeuvre en terre païenne doivent user d'un tact infini et de beaucoup de charité et d'amour chrétiens pour ne pas froisser les susceptibilités naturelles et les positions acquises. Comme Henri-A. Junod avait à un haut degré le respect de la personnalité d'autrui (il la respectait même chez ses enfants), il sut vite se faire sa place dans la Genève ecclésiastique. Indépendant par sa naissance, j'entends dire indépendant neuchâtelois, attaché à l'idée de l'Eglise séparée de l'État, il avait assez de largeur d'esprit pour comprendre le point de vue de ceux qui se rattachaient à un autre type d'Eglise. Il fut inscrit sur le registre des pasteurs auxiliaires de l'Église nationale de Genève, tout en demeurant attaché à l'Église libre de l'Oratoire.
 |
|
 |
|
|
|
formés par lui à Rikatla. |
En septembre 1921, il eut la joie de
bénir le mariage de son fils
aîné avec Mlle Idelette Schnetzler,
peu avant leur départ pour cette Afrique
à laquelle l'attachait tout son
passé.
Ce départ fut une joie,
malgré ce qu'avait d'étreignant pour
nous tous le retour du père au pays, juste
au moment du départ du fils.
Sa fille Anne-Marie fonde à ce
moment le groupe missionnaire des Unions
chrétiennes de jeunes filles et commence une
activité féconde au sein des
Sociétés missionnaires de jeunesse.
Henri Junod donna beaucoup de son temps et de son
expérience à ce milieu missionnaire,
plein d'entrain et de vie. Il commença aussi
à ce moment un cours de science missionnaire
dans les Facultés libres de Lausanne et de
Neuchâtel.
Son principal travail fut toutefois
celui de l'Agence. Il réorganisa le groupe
de ses collecteurs et collectrices, reprit la
direction des comptes, et s'efforça de
créer un centre d'intérêt
missionnaire vivant dans son propre foyer. Il
reprit aussi ses conférences et
prédications missionnaires dans les diverses
Églises du canton, et suivit, en
l'encourageant de tout son pouvoir, l'extension de
la base de notre Mission dans la Suisse
alémanique.
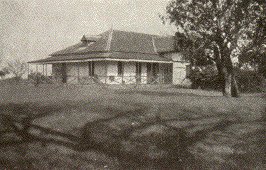 |
|
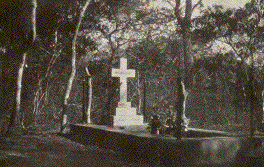 |
|
|
|
Tombe
de
Mme H. Junod-Kern
à Rikatla,
toute proche de celle de M. Paul Berthoud. Ici reposent aussi les cendres de M. H.-A. Junod. |
À cette époque, en 1922,
après un séjour à Chaumont, il
retrouva son ami, M. A. Freire d'Andrade,
délégué du Portugal à
la Société des Nations. Celui-ci
témoigna à Henri Junod sa
réelle amitié et son estime, en
venant souvent dans la vieille maison de
Grange-Canal, surtout quand fut publié le
fameux rapport de l'Américain Ross, sur le
travail forcé dans les colonies portugaises.
Le vieil administrateur colonial et l'ancien
missionnaire s'efforcèrent d'atténuer
l'impression extrêmement fâcheuse
produite par ce rapport. Ils avaient sans doute des
idées bien différentes et des buts
aussi différents : Henri Junod avait
connu dans les détails le problème
indigène dans les colonies, et le but de M.
Freire d'Andrade était avant tout de
modifier l'impression dans les milieux politiques.
Mais tout en restant dans la vérité,
Henri Junod savait aussi comprendre et soutenir le
Portugal. Il s'efforça toujours de faire
abolir le système du
« chibalou » ou travail forcé. Mais, ceci
dit, il
s'efforça aussi de faire comprendre à
Genève les droits imprescriptibles du
Portugal sur ses colonies. Il suivit avec un grand
intérêt le fonctionnement de la
Commission des Mandats et me disait souvent que le
simple fait de son existence et de ses droits de
contrôle créait peu à peu une
mentalité toute différente en
matière coloniale.
En 1923, Henri Junod publiait une
saynète africaine, intitulée
« La jeteuse de sorts ». Il
avait déjà écrit
précédemment « L'homme au
grand coutelas » et « Les
perplexités du vieux
Nkolélé ». On peut voir
dans ces petits drames qu'Henri Junod avait non
seulement de réels dons d'observation, mais
qu'il savait créer ad usum Delphini un vrai
théâtre africain. Il y a dans
« La jeteuse de sorts », par
exemple, une adaptation dés faits de la vie
et de la mentalité indigène pleine de
charme et d'imagination artistique et bien propre
à faire comprendre le milieu bantou. Ces
petites saynètes ravirent les milieux de la
jeunesse missionnaire, et contribuèrent
à faire comprendre l'Africain et sa
mentalité jusque dans les villages
reculés de nos campagnes.
Le 11 mai 1923, H. Junod apprit avec
grande joie la naissance de sa première
petite-fille Violaîne-Idelette, née
à Lourenço Marques. Le
télégramme l'apprenait au
grand-père deux jours plus tôt qu'au
propre père de l'enfant, perdu au fond de la
brousse...
Henri Junod professa un cours à
l'Université de Lausanne sur la
mentalité bantou et la science missionnaire.
Il était entièrement maître de
son sujet et restait au courant des nouvelles
publications ethnographiques et anthropologiques.
Collaborateur de plusieurs revues scientifiques,
comme Folklore, Man, Africa, Anthropos, où
il publia un intéressant article sur
« Deux enterrements à 20 000 ans
de distance » (une comparaison entre
l'ensevelissement thonga et la sépulture de
l'homme moustiérien préhistorique),
il mit tout son effort à
expliquer la mentalité bantou aux
Européens civilisés. Il eut plusieurs
occasions de contact prolongé avec M. Raoul
Allier, qui préparait ses livres sur les
non-civilisés, et aussi avec M. Lucien
Lévy-Brühl, qui l'admirait beaucoup. Il
me racontait, entre autres, une conversation
où le grand savant de Paris, le protagoniste
de la mentalité prélogique chez les
primitifs, lui avait demandé ce qu'il
pensait de sa théorie sur les
« participations ». Comme Henri
Junod croyait à des faits plus complexes que
M. Lévy-Brühl ne les
représentait, il s'efforça, avec sa
politesse coutumière, de ne pas contredire,
tout en faisant des réserves.
En 1924, il fit un séjour en
Normandie, visita l'Exposition de Wembley et donna
des cours à l'Université de Londres.
Revenu à Genève, il prépara
une intéressante étude sur
« Le mouvement de Mourimi »,
qui fut publiée dans le journal de
Psychologie de Paris. Il y note certains
caractères de l'Africain en transition,
constate la pérennité de la
séquelle des rites anciens et la tendance
nettement monothéiste plus moderne. il y
ajoute cette intuition si juste, si
élevée, des phénomènes
religieux, qui est un des caractères
distinctifs de toute sa production ethnographique.
Évolutionniste, sans pousser à
l'excès la théorie
déterministe darwinienne, et conscent de
tous les phénomènes qui semblent
contredire cette théorie dans la
réalité (régressions, etc.),
il avait compris que la vie sous toutes ses formes
est mouvement et énergie, mais il ne
demeurait pas prisonnier des mots.
Il commença aussi un cours de
trois ans à la Faculté de
théologie de l'Université de
Genève.
L'année 1925 fut une des belles
années de la vie d'Henri-A. Junod. La
synthèse qui, peu à peu,
s'opérait dans son oeuvre scientifique,
voyait aussi le jour dans le domaine missionnaire.
Ce fut l'année du jubilé
cinquantenaire de la Mission
Suisse Romande, et l'occasion de la visite du
pasteur Calvin Mapopé en Suisse. À la
Cathédrale de Lausanne, Henri-A. Junod,
debout dans la chaire de la vieille église,
à côté de Calvin Mapopé,
lui tout blanc, à côté de son
collègue noir, introduit ce
dernier :
« C'est avec une surprise
profonde, émue et joyeuse que je me trouve
dans cette chaire avec le pasteur C. Mapopé.
Le réformateur Viret, installant la
Réforme dans cette cathédrale,
n'avait pas prévu alors qu'un noir y
prêcherait. Il me semble que sa
présence dans cet endroit est une
illustration admirable de la beauté de cette
journée, parce qu'elle nous montre la
puissance extraordinaire de l'Évangile de
Jésus-Christ. Lorsque, il y a trente-cinq
ans, j'ai rencontré le pasteur Mapopé
pour la première fois, il était alors
instituteur. C'est lui qui m'aida dans mes
premières traductions dans la langue
indigène, il a été mon
maître et je ne pensais pas que je lui
rendrais ce service dans la cathédrale de
Lausanne... »
« Calvin Mapopé avait,
dans le temple de Saint-François,
remercié les gouvernements anglais et,
portugais pour ce qu'ils font en faveur de son
peuple. Puis avec infiniment de tact et de
précautions oratoires nuancées, il
fit respectueusement entendre quelques-unes des
revendications de ses compatriotes ; il laissa
percer quelque chose de l'angoisse qui est celle de
milliers d'Africains en songeant à
l'occupation, par les Européens, du pays de
ses pères. Dès ses premières
paroles, il avait conquis la sympathie de
l'auditoire, et termina son exposé en
exprimant sa confiance dans l'action
combinée des gouvernements et des
Missions. » (Bulletin missionnaire,
supplément mai-juin 1925.)
Henri Junod accompagna le pasteur
indigène dans plusieurs Églises de la
Suisse romande. Et c'est une vision qui reste dans
beaucoup de mémoires comme le symbole de ce
jubilé cinquantenaire : celle du vieux
missionnaire, blanchi par l'âge, avec son
collègue indigène : une sorte de
réponse chrétienne et vivante
à la politique de la séparation des
races. Car Henri Junod
désirait la collaboration et non la fusion
des races. En vrai anthropologue, il ne voyait que
des désavantages à la fusion des
noirs et des blancs, et il savait que l'intuition
profonde des premiers, comme celle des seconds,
s'affirme contre ces mélanges. Mais il
savait aussi que le seul chemin est celui de la
collaboration, de la compréhension mutuelle
et du respect réciproque.
Le 6 mars, une nouvelle naissance en
Afrique, celle de Mireille-Anne-Marie, venait
réjouir le coeur du grand-père, en
Suisse.
À l'occasion du jubilé
cinquantenaire de la Mission, l'Université
de Lausanne décerna à Henri-A. Junod
le diplôme de docteur ès lettres,
honoris causa. MM. les professeurs G. Bonnard,
doyen de la Faculté des lettres, G.
Chamorel, doyen de la Faculté de
théologie, et F. Olivier, chancelier de
l'Université de Lausanne, vinrent à
Genève dans la vieille maison de
Grange-Canal, et, dans une cérémonie
tout intime, proclamèrent H. Junod docteur,
« en reconnaissance de ses beaux travaux
dans le domaine de la linguistique, du folklore et
de l'ethnographie du Sud de
l'Afrique ».
Peu après, Henri Junod avait la
joie de voir son second fils Blaise baptisé
à la Chapelle de l'Oratoire. Il avait
commencé par baptiser sa fille Anne-Marie,
comme enfant. Mais ensuite, sous l'influence de ce
qu'il vit au sein de l'Eglise indigène, et
aussi en meilleure connaissance de cause, il se
décida à présenter ses autres
enfants, convaincu que la vraie signification du
baptême chrétien n'est complète
que pour un adulte. Il est possible qu'un jour la
Mission fasse ressaisir à l'Eglise cette
vérité essentielle.
Après un séjour
d'été à La Sage, H. Junod
reprit le travail de l'Agence et commença
à s'intéresser tout
spécialement au Bureau international pour la
Défense des indigènes (races de
couleur), dont le siège était
à Genève. Ce Bureau avait
été fondé par un certain
nombre de philanthropes qui virent la
nécessité de lutter contre les
injustices dont les races de couleur sont souvent
victimes.
Henri Junod s'intéressa vivement à ce
Bureau, dont il accepta la présidence. Le
caractère international de cette
organisation lui conférait une parfaite
impartialité, et plusieurs
représentants de la race noire vinrent
à Genève lui exposer leurs
aspirations et cherchèrent à agir par
ce moyen sur la Société des Nations.
Avec beaucoup de tact, sous la direction d'Henri
Junod, le B. I. D. I. éconduisit les
éléments extrémistes et
s'efforça de faire certaines
représentations quand cela fut jugé
nécessaire.
Dans la maison de Grange-Canal arrive un
jour un homme qui avait fait la guerre, un
chrétien au service des Unions
chrétiennes de jeunes gens, Thomas Haslett.
Il avait perdu sa femme dans des circonstances
douloureuses, avait été
grièvement blessé ; mais
à la fin de la guerre il avait repris son
activité parmi les jeunes et venait à
Genève pour un temps. Il s'entendit si bien
avec les habitants de la vieille maison qu'il vint
y habiter. En 1926, il se fiançait à
Anne-Marie Junod... Qu'allait devenir le vieux
ménage ?
« La vie d'une Tribu sud-africaine. »
En 1926, Henri Junod avait rassemblé de
nombreux matériaux nouveaux et se mit
à reprendre son grand ouvrage :
« The Life of a South African
Tribe », pour en publier une seconde
édition considérablement revue et
augmentée. Il est temps maintenant de parler
de ce travail, si important qu'il valut à
son auteur une renommée universelle. L'un
des anthropologues les plus connus du monde
scientifique actuel n'hésitait pas à
dire qu'il s'agit d'un ouvrage unique. En effet, M.
Malinowsky, lors de la récente
Conférence sur l'Éducation,
réunie à Johannesbourg, me disait,
sans ombre de flatterie, que cette oeuvre
monumentale était le seul ouvrage synthétique,
embrassant
toutes les manifestations de la vie dans une tribu,
qui donnât entière satisfaction. La
raison de ce succès est la
personnalité même de l'auteur,
à la fois savant, missionnaire,
éducateur et homme religieux. Mais ce
résultat ne fut pas obtenu d'emblée.
Henri Junod fut à la fois gardé du
danger de publier trop vite, et de celui, non moins
grand, de ne publier jamais, par souci de
perfection. On peut suivre le développement
de sa méthode et de sa documentation depuis
son étude encore rudimentaire du folklore
« Les Chants et les Contes »,
en passant par sa première grande
étude ethnographique « Les
Ba-Ronga » et son intéressant
roman « Zidji », jusqu'à
la première édition du
« Life », et surtout jusqu'au
résultat final de l'enquête, la
seconde édition de cette Somme
ethnographique et missionnaire.
Déjà en 1908, H. -A. Junod
avait fait un exposé complet de sa
méthode dans un article du Journal de la
Société pour l'avancement de la
science de l'Afrique du Sud, intitulé
« The best means of preserving the
traditions and customs of the various South African
Native Races » (Les meilleurs moyens de
conserver les traditions et coutumes des
différentes tribus indigènes de
l'Afrique du Sud).
Les deux grands volumes du
« Life » comprennent plus de
1200 pages. Le premier volume traite de la vie
sociale de la tribu. Après un chapitre
préliminaire sur la distribution
géographique et l'histoire, la
première partie traite de la vie
individuelle (le premier chapitre :
évolution de l'homme ; le second :
celle de la femme). La seconde partie expose la vie
de la famille et du village. La troisième,
la vie nationale.
Le second volume est consacré
à la vie mentale. La quatrième partie
s'occupe de la vie des champs et de la vie
industrielle, la cinquième traite de la vie
littéraire et artistique, la sixième
de la vie religieuse et des superstitions. Quelques
chapitres en guise de compléments
d'information, puis les conclusions pratiques et la
conclusion finale. Un index permet de se retrouver
dans le dédale
d'informations de tout genre qui abondent dans cet
ouvrage.
Henri Junod ne croyait pas que le
dernier mot de la science anthropologique
résidât dans les ipsissima verba des
indigènes, comme semblent le croire un trop
grand nombre de savants de nos jours. Quand il
décrit une coutume, il le fait avec toute sa
conscience et son intelligence. Mais il ne se borne
pas à décrire : il rassemble,
compare. Son ouvrage n'est pas statique, immobile.
Il décrit la vie dans le mouvement de la
vie, et s'efforce toujours de discerner les
tendances de celle-ci.
En ce sens, il était bien un
Latin. Il gardait la conviction que le vrai travail
scientifique n'est pas purement descriptif, mais
qu'il reste en éveil de toutes parts et peut
formuler des hypothèses, tout en se rendant
compte que ce sont des hypothèses. Aussi son
livre est-il vraiment une Somme missionnaire et
anthropologique. Il prouve combien sont arbitraires
et injustifiées les attaques que certains
esprits, soi-disant avancés, lancent contre
les Missions. Récemment, un des hommes
d'État les plus en vue de l'Afrique du Sud
osait affirmer, à propos de la
Conférence sur l'éducation, que les
Missions ont eu une influence
« disruptive » sur la
mentalité indigène, par quoi il
voulait exprimer que l'influence missionnaire avait
introduit dans la vie indigène, un
élément de
désintégration. Que reste-t-il
d'accusations pareilles en face de l'oeuvre d'Henri
Junod ? Sans doute il est arrivé
à certains missionnaires de sous-estimer la
valeur réelle des bases de la
mentalité indigène. Mais qu'est-ce
que cela en face de l'action dissolvante de la
Civilisation, sinon une bagatelle ? On peut,
en réponse à de pareilles
accusations, donner la conclusion du
« Life ». Elle fera
peut-être réfléchir ceux qui la
considéreront avec soin :
« La population africander
(les Boers et les Anglais fixés dans
l'Afrique du Sud), formée par l'amalgame de
certaines des meilleures souches de la race
aryenne, a devant elle, à coup sûr, un
brillant avenir. Puisse-t-elle être
bénie sur les rivages
ensoleillés et sur les hauts plateaux de
l'Afrique du Sud. Puisse-t-elle s'enrichir, et
enrichir l'humanité, en amenant à la
lumière le merveilleux minerai caché
dans les rochers de cette ancienne terre. Mais si
l'expansion de la race africander devait être
obtenue au prix de la ruine des premiers occupants
du pays, ce serait un immense malheur et une
flétrissure indéniable. Car, si
brillant que l'avenir des Africanders puisse
être, l'Afrique ne serait plus l'Afrique,
s'il n'y avait plus d'Africains !... Que Dieu
préserve la vie de la tribu
sud-africaine ! (« Life »,
vol. II, p. 663.)
C'est là le testament
scientifique d'Henri Junod. Puissent ceux qui
maintenant tiennent en main le pouvoir, s'inspirer
de ces paroles, et leur influence sera aussi peu
« disruptive » que celle de ces
hommes intègres qui ont planté en
Afrique le drapeau du Christ ! Car l'avantage
du missionnaire sur l'anthropologue est clair et
net. Il vient avec un message, une force de vie
positive et constructive. Il peut admirer les
vieilles coutumes, mais la poésie du
passé ne lui cache pas les devoirs du
présent. Et il sait que seul son message
peut redonner une vie nouvelle au coeur de
l'indigène africain désemparé
dont l'équilibre moral, social et religieux
a été détruit par la
civilisation matérialiste de l'Occident.
La santé d'Henri Junod fut bien
vacillante dès 1926. Il voyait son travail
intellectuel devenir de plus en plus difficile. Ses
migraines ophtalmiques le faisaient souffrir. Il
était sans cesse ébloui. Sa fille
s'était fiancée et l'avenir
n'était pas clair. Mais jamais il ne
s'opposa aux désirs légitimes de ses
enfants. Sa foi lui permettait de se reposer
entièrement sur les directions du
Père. À cette époque, il donna
de nouveau un cours à la Faculté
indépendante de Neuchâtel.
Le 9 janvier 1927, Mme Edouard Kern - de
Schulthess mourait à Zurich. Henri Junod
sentit douloureusement ce départ. Maman Kern
était une de ces âmes qui embellissent
la vie de ceux qui les entourent et vivent
près d'elles. En été, la
famille fit un séjour de montagne à
Kiental avec M. Gustave Kern et les siens et, le 14
septembre, le mariage d'Anne-Marie Junod et Thom
Haslett était célébré
à Genève. Henri Junod reprit son
cours à la Faculté de
théologie de Lausanne.
En avril et mai 1928, Henri Junod fit un
voyage en Palestine.
Il donna ensuite plusieurs
conférences sur le sionisme. Il
rédigea un mémoire intéressant
pour le B. I. D. I. sur le mécontentement
dans les colonies et fit des conférences au
Comité d'études nationales à
Paris. Il en profita pour ébaucher un
contrat avec une librairie pour la publication du
« Life » en français. Le
10 avril était né son premier
petit-fils, Henri-François. Il en eut une
grande joie. Il avait assez vécu en Afrique
pour y fortifier son amour du clan... et la
naissance de son premier petit-fils lui donna une
légitime satisfaction. En novembre, nous
arrivions à Genève pour un
séjour en Suisse, après notre
première campagne d'Afrique. Toute notre
famille s'installa dans la maison grand-paternelle.
Peu après, Thom Haslett et sa femme nous
quittaient. Ce fut un grand déchirement pour
Henri Junod. Sa fille aînée avait su,
avec son intuition et le charme de sa nature,
recréer pour son père le milieu
« congenial », comme disent les
Anglais. Elle avait su l'entourer de cette
atmosphère qu'il aimait. Car la
présence de la grâce féminine
fut toujours d'un prix inestimable pour Henri
Junod. Heureusement sa belle-fille arrivait, et
elle put prendre en main la direction de la vieille
maison. Elle fut malheureusement atteinte d'une
grave maladie, qui fit craindre pour sa vie, mais
au bout de longues semaines d'angoisse, elle se
remit, et le vieux ménage reprit son cours
normal.
Thom et Anne-Marie Haslett avaient
gagné la Chine, Shanghaï, où ils
se consacrèrent à l'oeuvre de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens. Henri Junod prit
grand intérêt à leurs
récits. Il s'intéressait à
tout l'homme et à tout homme ; aussi
les nouvelles qui lui arrivaient de Chine lui apportaient-elles
des foules
de
renseignements nouveaux, et il se plaisait à
les comparer avec ses expériences d'Afrique.
Il semble qu'il ne puisse y avoir aucune
comparaison possible entre le Chinois et le Bantou,
entre l'homme de la vieille civilisation et celui
qu'on appelle primitif. Et pourtant, sur bien des
points, il y a similitude : la politesse
d'Extrême-Orient, par exemple, est
très près de l'étiquette
compliquée des indigènes
sud-africains.
Nous fîmes, en été
1929, un séjour délicieux au Col des
Montets. On peut comprendre combien ces moments
nous furent précieux, car, pour la
première fois de ma vie, nous nous trouvions
ensemble pour une période vraiment
prolongée. Nous avions la même
vocation et les mêmes goûts. Soeur
Elisabeth Junod, la directrice de l'Hôpital
Pourtalès, soeur d'Henri Junod, était
avec nous. C'était un spectacle charmant que
le bonnet blanc de la diaconesse à
côté de la tête blanche de son
frère, leur admiration devant les merveilles
de la flore alpestre qu'ils connaissaient si bien,
et cette remarquable vivacité d'esprit
qu'ils avaient gardée, cette
nécessité d 'action si
étonnante qui vient, dit-on, du
côté Dubied de la famille.
De retour à Genève, Henri
Junod reprit la présidence du B. I. D. I. et
ses cours à l'Université.
En 1930, petite Violaine était
atteinte d'un mal grave qui la força
à une immobilité complète
pendant une année. Henri Junod prit part
à nos souffrances à ce
moment-là, et sa
sérénité, cette
tranquillité qui n'avait rien de l'apathie
d'un vieillard, mais qui venait de sa longue
expérience de la direction de Dieu dans les
vies qui Lui sont données, cette paix
profonde nous furent d'un grand secours. Au mois
d'août, alors que nous étions aux
Ormonts, Henri Junod rédigea une
conférence des plus intéressantes
sur : « Le sacrifice dans
l'ancestrolâtrie africaine ». Il y
reprenait ses observations sur les diverses
« timhamba » ou sacrifices des
Ba-Thonga, pour en analyser l'essence et faire,
à cette lumière, l'examen des
théories présentées par les
savants pour l'explication des rites sacrificiels.
Ce travail était préparé pour
un Congrès des langues et
civilisations africaines, qui devait se tenir
à Paris, en octobre 1931. « Au
point de vue du développement de la
religion, comment faut-il les juger (ces
rites) ?
» Dans la conclusion de son grand
ouvrage « Essai historique sur le
sacrifice », M. Loisy déclare ne
reconnaître aucune valeur objective au
sacrifice, à tous les sacrifices.
« L'action sacrée, dit-il, se perd
dans le vide. Son histoire apparaît comme
celle de l'illusion la plus tenace dont ait
été possédée
l'humanité. Action magique à son
point de départ, le sacrifice n'a jamais
cessé de l'être. » M. Loisy
ne fait pas de distinction entre le
« mouri » (remède) et la
« mhamba » (sacrifice).
Pourquoi ? Parce que, à son point de
vue, le monde divin n'existe pas.
» Remarquons qu'en disant cela, on
sort des limites de la science. Ce n'est plus un
jugement scientifique, c'est un jugement de valeur.
La science ne tranche pas la question de la
transcendance. Elle ne s'en occupe pas. Que M.
Loisy prenne position à son égard en
la niant, il en a parfaitement le droit. Mais nous
avons le même droit à l'admettre. Et
alors, combien tous ces efforts de l'homme primitif
ou de l'homme civilisé à la recherche
de Dieu dans le sacrifice prennent une autre
valeur ! Si Dieu existe, s'il est le
Père tout-puissant et plein d'amour
vis-à-vis duquel l'homme éprouve ce
sentiment d'absolue dépendance qui est son
bonheur le plus noble, nous osons croire que Dieu
s'est fait connaître. Cette connaissance a
été progressive, car
l'humanité a mis des siècles à
accomplir son évolution religieuse. La phase
de l'ancestrolâtrie n'a pas été
inutile dans ce développement. La
dépendance de l'enfant vis-à-vis de
son père est un fait naturel. Ce sentiment
se prolonge et s'amplifie dans le culte des
descendants pour leurs ancêtres. Il ne peut
pas encore être ce sentiment d'absolue
dépendance de la religion parfaite, parce
que la notion du dieu-ancêtre est encore bien
inférieure, bien incomplète, bien peu
morale. Le vrai Dieu ne s'est pas encore
révélé dans sa
plénitude. Ces dieux-là, les Thongas
leur offrent leurs
« timhamba ». Ils sentent que
la vie pleine et heureuse n'est pas possible sans
eux. Sans
doute ce
culte est-il bien intermittent on y recourt surtout
quand on veut échapper au danger. Il
proclame cependant la nécessité de
partager avec les dieux les biens de la famille et
de les faire participer à toutes les
circonstances. C'est un avant-goût encore
lointain de la communion divine qui illumine
l'âme de celui qui se sent enfant de
Dieu.
» Aussi, lorsque je vois le vieux
chef de famille thonga assis au milieu des siens,
mettant à la bouche une boulette d'herbe
à demi digérée, prise dans les
estomacs de la chèvre immolée, y
joignant un peu de sa salive, et faisant
« tsou » en invoquant
Tlotlomane et ses autres ancêtres, il m'est
impossible d'appeler cet acte-là une
ineptie. Dans cette manifestation primitive de la
vie religieuse, je crois apercevoir un bouton de
fleur encore informe et fermé, mais un
bouton de fleur qui s'épanouira
magnifiquement lorsque apparaîtra le soleil
radieux de la religion du Père
céleste, le soleil de la religion de
l'Esprit. »
J'ai cité cette page
entière, parce qu'elle dessine la figure
d'Henri Junod anthropologue, missionnaire et homme
religieux, mieux que beaucoup d'autres. Surtout ce
« sentiment d'absolue
dépendance » fut le sentiment
dominant de sa vie, et le ressort essentiel de sa
piété. C'est aussi par là
qu'elle donne un précieux enseignement.
Pendant quatre ans Henri Junod fut
président de la Société
évangélique de Genève. Il
était très attaché à
toutes les activités de l'Eglise, et prenait
part aux délibérations de la
Compagnie des pasteurs.
Un jeune collègue
m'écrit :
« J'ai le souvenir d'une
séance mensuelle de la Compagnie des
pasteurs où M. Sauvin nous parla du
Pentecôtisme, après la visite de
l'évangéliste Scott. M. Junod prit
alors la parole avec tant de sagesse et de
discernement spirituel. »
À ce moment, en 1930,
Étienne Junod fit son instruction religieuse ;
Henri
Junod
suivit avec une sollicitude de tous les jours le
développement religieux de son fils
cadet.
Mais les propriétaires de la
vieille maison, qui en avaient besoin
eux-mêmes, ne pouvaient laisser Henri Junod
en disposer plus longtemps. Après bien des
hésitations, il se décida à
acheter une très jolie campagne, au chemin
de la Chevillarde, et la famille y
déménagea le 27 avril 1931. Pendant
tous ces mois, je m'étais mis au grand
travail de traduire les deux tiers du
« Life » en
français ; le dernier tiers avait
été traduit par Anne-Marie
Haslett.
La santé de notre père
commença à nous inquiéter
beaucoup. L'artériosclérose l'avait
peu à peu amoindri. Il eut une forte crise
cardiaque et néphrétique et ne put
venir avec nous à la montagne, à
Lens. Il alla chez son vieil ami le docteur
Liengme, puis à la clinique de La
Lignière, près de Gland.
Henri Junod avait gardé une
fraîcheur d'âme tout à fait
exceptionnelle, dans sa vieillesse. Lors de la
maladie de petite Violaine, il avait
rassemblé avec Mireille, aux Ormonts, un
herbier ; toute une collection de plantes des
Alpes, aussi complète que possible, et
plante après plante avait été
séchée et soigneusement
étiquetée auprès du lit de la
petite malade. Alors que sa belle-fille
était absente, le grand-papa se fit une
règle de lire chaque soir à ses
petites-filles un chapitre du célèbre
livre de Mme de Ségur : « Les
mémoires d'un âne », et il
lut si bien qu'il leur fit penser qu'il
était lui-même prodigieusement
intéressé par les exploits de
Cadichon !
Mais ce beau temps arrivait à sa
fin. Il fallut se résoudre au départ.
Henri Junod fut admirable en ces circonstances. Je
n'oublierai jamais ses paroles lors de notre
réunion d'adieux à la Salle Centrale.
Il parla après nous et fit comprendre
à son auditoire que la Mission était
grande par le sacrifice accepté,
volontairement consenti. Il parla avec un
enthousiasme, une profondeur et
une maîtrise de lui-même qui
contribuèrent à nous donner les
forces qui nous manquaient. Un ami très cher
m'écrit à ce sujet :
« Ce fut d'une grandeur chrétienne
admirable, quand il dit sa joie, sa conviction
missionnaire, et qu'il donnait à la cause
missionnaire son enfant, acceptant sans phrases de
ne plus le revoir peut-être sur la
terre. » C'était en effet le
sentiment que nous eûmes tous deux, sans nous
le dire. Il était bien fragile, miné
dans ses forces vives par une maladie qui ne
pardonne pas, ou plutôt par une usure du
corps qui ne peut plus être
arrêtée. Toute notre vie, notre
départ restera dans notre mémoire.
Henri Junod était dans son grand lit
italien, dans sa chambre, et nous vînmes nous
grouper auprès de lui, pour recevoir sa
bénédiction.
Quand nous eûmes prié tour
à tour, je m'assis sur le bord de ce lit, et
regardai cette chère tête blanche pour
la graver pour toujours dans ma mémoire, et
nous nous embrassâmes. Je n'oublierai pas
cette étreinte, prémonition
peut-être ? Qui pourrait le dire ?
Ces expériences spirituelles n'ont pas le
contour net des expériences scientifiques.
Et nous nous arrachâmes l'un à
l'autre.
Heureusement sa soeur Elisabeth, son
aînée de deux ans, terminait ses
cinquante années d'activité comme
diaconesse, et elle vint auprès de son
frère. Dieu miséricordieux permettait
que nous laissions celui qui nous était le
plus cher au monde aux bons soins de ma marraine.
Il est précieux de pouvoir dire que l'ami le
plus cher est un père. Nous pouvons le dire
en toute vérité. De
l'éducateur qu'il fut dans notre enfance et
notre adolescence, il devint le conseiller des
débuts en Mission, puis l'ami le plus cher,
celui auquel on n'a rien à cacher, celui qui
comprend et corrige par amour, celui qui conduit,
conseille et console.
Étienne Junod était pour
quelques mois à Glarisegg. Blaise terminait
ses études à l'École
Polytechnique de Zurich. Les deux frère et
soeur âgés étaient seuls dans
la maison de la Chevillarde. Mais une
précieuse correspondance continuait entre Henri
Junod et sa fille
aînée alors en Chine. C'était
la période de l'attaque de Shanghaï par
les japonais, et Henri Junod suivit avec une
indignation croissante le développement de
la politique nipponne en
Extrême-Orient.
À la fin de janvier 1932,
Anne-Marie Haslett revenait ; ce fut une joie
immense pour son père de l'avoir de nouveau
pour, quelque temps auprès de lui.
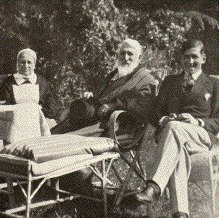
A la Villa Rikatla, Chevillarde, Genève.
Soeur Elisabeth Junod, M. Henri-A. Junod, Etienne Junod.
Henri Junod continuait à produire. Deux
intéressantes brochures des
« Actualités
missionnaires » paraissaient sous son
nom. Dans l'une il examinait le Problème
indigène dans l'Afrique du sud. Il y faisait
l'histoire des relations interraciales, examinait
la nature du problème présent. Dans
une première partie il exposait le
problème politique. On y retrouve l'esprit
scientifique qui le gardait des exagérations
et des passions qui faussent le
jugement :
« Les indigènes sont
maintenant des sujets, ils ont perdu leur
indépendance politique. Je ne suis pas de
ces idéalistes qui s'en indignent.
C'était une nécessité
pratique. Nul ne peut servir deux maîtres.
L'Afrique du Sud, état moderne et
civilisé, ne pouvait laisser leur
entière souveraineté à des
peuplades semi-primitives, incultes. » Il
montre que cette privation de leurs droits civiques
a pourtant eu pour les noirs de très graves
résultats, en leur ôtant leur
« sens de
responsabilité ». Il examine la
politique de Shepstone au Natal, puis celle des
territoires du Transkei, enfin les lois du
général Hertzog, proposées par
lui au Parlement, mais encore à
l'état de projets aujourd'hui. Il donne un
sérieux avertissement en ce qui concerne la
question des « passeports » que
chaque indigène est contraint de porter avec
lui, une mesure qui blesse leur dignité, et
aussi en ce qui concerne l'administration de la
justice. Puis il aborde le problème
économique. il entame la question des
protectorats, et montre le mauvais usage que les
indigènes
sont tentés de faire des possibilités
que leur offre la civilisation, et la
nécessité d'une surveillance beaucoup
plus active de la part de la Couronne anglaise dans
ces territoires. Il aborde ensuite la question
économique dans l'Union. Il montre combien
la loi agraire de 1913 rendue plus
sévère encore par les amendements de
1927, a aggravé la position
économique des noirs. Il passe au crible la
situation faite aux noirs dans les
« réserves »
indigènes beaucoup trop exiguës, dans
les fermes occupées par les blancs, puis
dans les « locations »
urbaines.
 |
|
 |
|
à la chasse aux papillons, à Shilouvane. |
|
et le pasteur Calvin Mapopé à Genève, 1925. |
Il se réjouit de la création des
Conseils d'Européens et indigènes
dans plusieurs centres, parle de la
Conférence d'étudiants des deux races
à Fort Hare en 1930, et conclut en montrant
la tâche qui s'impose à la
Mission :
« Je suis missionnaire. je le
suis avec conviction et j'aurais bien voulu montrer
en terminant ce que la Mission a fait dans le
passé pour la solution de ce problème
et la tâche qui se présente
maintenant. Je n'en ai pas le temps. Qu'il me
suffise d'affirmer qu'elle a été
dès l'origine le bouclier des noirs et que
si des institutions laïques s'organisent
à côté d'elle, elle est
à l'origine de presque tous ces mouvements.
Son rôle aujourd'hui est d'une importance
extrême. Elle doit non seulement appeler
l'indigène à la vie spirituelle,
former son caractère, l'instruire, le
soigner dans ses hôpitaux et dispensaires,
comme elle l'a toujours fait. Il faut qu'elle
l'exhorte à la patience, qu'elle cherche les
moyens de le sortir de sa misère, qu'elle le
détourne des idées folles de
révolution et de vengeance, qu'elle rende
aux noirs la confiance en la race blanche que
beaucoup ont perdue. Elle doit faire régner
l'Esprit de Christ chez les blancs comme chez les
noirs, esprit de sacrifice, d'amour, de mutuelle
compréhension. Si elle y réussit, il
y aura encore de beaux jours pour l'Afrique du Sud.
Les blancs seront délivrés du
cauchemar qui les hante et qui est le
problème indigène, et les noirs
marcheront avec joie vers la
prospérité et vers une
véritable civilisation. »
Dans l'autre brochure, publiée en
1931, Henri Junod parle du « Noir
africain. Comment faut-il le
juger ? »
Il entreprend de répondre
à cette question en consultant
l'anthropologie physique tout d'abord.
« Qu'eût dit Gobineau, ce grand
apôtre de l'inégalité des
races, s'il avait su que les noirs partagent ce
caractère physique (la
dolichocéphalie) avec les nobles
aryens ? Puis il montre que les données
de la linguistique sont, elles,
convaincantes : « Je ne puis
m'empêcher d'éprouver un
véritable agacement lorsque j'entends des
coloniaux affirmer avec un suprême
dédain que les langues africaines sont
barbares, sans valeur, indignes d'être
conservées, et qu'il faut les faire
disparaître au plus vite. Si j'en avais le
pouvoir, j'obligerais les auteurs de ces jugements
superficiels et injustes à apprendre par
coeur dix des plus jolis proverbes bantou, et
à les répéter en expliquant
leur signification, qui a souvent tant de
profondeur et de finesse. Ils ne parleraient plus
de la stupidité des langues
africaines. »

La famille réunie, en décembre 1928.
Rang supérieur : Étienne Junod, Henri-Philippe Junod, Thom Haslett.
Rang inférieur : Mme H.-Ph. Junod-Schnetzler avec
Henri-François, M. Henri-A Junod, Viclaine Junod, Mme Anne-Marie Haslett-Junod,
Mireille Junod, Blaise Junod. (Manon Junod naquit plus tard.)
Il passe à l'examen du folklore, touche
à l'histoire comparée de l'art, au
système musical africain, à l'art
sculptural, aux techniques. Il note la stagnation
des Bantou, et donne, en explication de ce fait
alarmant, les conditions climatériques et
l'isolement.
Puis il examine la psychologie
primitive. Il parle de la prétendue
mentalité prélogique et magique. Ses
remarques ici sont la conclusion et la
synthèse de toutes ses études
anthropologiques : équilibre des
qualités du coeur, de celles de l'esprit et
de celles de l'âme.
Sa conclusion est que l'indigène
africain est un
« attardé », et se
basant sur des expériences récentes,
il montre en terminant que cet attardé est
parfaitement développable.
« 1° L'Africain est un
homme. Il possède la dignité de
l'être humain. Il a donc son but en
lui-même et ne doit pas être
envisagé par l'Européen comme un
simple moyen, un moyen pour acquérir plus de
richesse ou de gloire. Le colon attelle son cheval
à sa voiture. Il en a le droit. Le cheval
est un animal.
Mais il ne doit pas réduire le
noir à une forme quelconque d'esclavage et
le contraindre par le travail forcé à
faire réussir ses entreprises personnelles.
Que le noir travaille librement. Il travaillera. La
collaboration des deux races est nécessaire
à l'humanité. Elle est
désirable. La colonisation n'est pas
mauvaise en soi. Mais que la colonisation prenne
garde à ses méthodes. Elle ne sera
légitime qu'à cette condition :
que le noir y trouve son avantage aussi bien que le
blanc.
» 2° L'Africain est un homme,
mais il n'est pas exactement semblable à
l'Européen. Il représente un type
d'humanité qui a le droit d'exister et de se
maintenir. Sans doute il est appelé a se
transformer beaucoup pour se civiliser
véritablement, et c'est à nous de lui
en donner les moyens. Mais il a ses dons
particuliers, ses traditions, un génie qui
est bien à lui. Respectons-les. Respectons
sa langue. Ne cherchons pas, par une assimilation
hâtive, à faire de lui une copie
servile du blanc.
» Si ces principes sont loyalement
observés, nous préparerons à
l'Afrique un avenir lumineux. Sinon ce pourrait
bien être la catastrophe. »
J'ai dit plus haut que cette
dernière période de la vie d'Henri A.
Junod fut celle de la synthèse. Il me semble
que ces textes en donnent la preuve.
Il eut encore la satisfaction de voir
son fils cadet faire profession de foi en acceptant
le baptême, et le 6 juillet 1932, il se
réjouissait de la naissance de sa
dernière petite-fille, Manon, à
Prétoria. Mais une nouvelle
séparation lui fut imposée. Ses
enfants Haslett repartaient, le 7 juillet, pour
l'Australie.
La santé d'Henri Junod devenait
très précaire. Mais sa soeur,
fidèle et dévouée, prenait un
soin jaloux de ses forces. Elle avait compris
qu'elles étaient bien diminuées. Et
nous, au loin, nous sentions que la flamme de cette
grande lumière commençait à
vaciller.
Il put pourtant encore se consacrer
à un grand travail, un dernier hommage à sa
vocation : la rédaction de la
biographie des deux pionniers de la Mission Suisse.
En 1933 paraissait ce beau volume de 247 pages
intitulé : « Ernest Creux et
Paul Berthoud ». Je n'ai pas ici à
en faire l'examen. Il parle de lui-même.
J'aime à penser, cependant, que la
dernière oeuvre d'Henri Junod fut
consacrée à la Mission qu'il aimait,
à laquelle il avait donné sa vie, et
pour laquelle, en dernière analyse, il
publia toutes ses oeuvres, depuis les plus petits
opuscules, si nombreux, jusqu'à
l'exposé de toute la vie d'une tribu
sud-africaine.
Et c'est en tremblant que j'écris
ici la conclusion de son dernier
ouvrage :
« Puissent les missionnaires
actuels, par la grâce de Dieu, continuer
l'oeuvre qu'ils leur ont laissée, avec le
même désintéressement, la
même énergie et aussi le même
succès qu'Ernest Creux et Paul
Berthoud. » Le moment est venu d'ajouter
« et Henri-Alexandre Junod. »
La fin.
Quelques semaines avant sa mort Henri Junod
rédigea une lettre qu'il envoya au
président de la Conférence du
Désarmement, pour demander que les grandes
puissances suppriment l'aviation militaire. Lors de
mon séjour en Suisse j'eus l'occasion
d'étudier de près la question de la
guerre chimique et j'en parlai souvent à mon
père, que la question commença
à troubler sérieusement. Il voyait
bien cette sorte de fatalité qui conduit la
science à un suicide universel
inévitable, si toutes les consciences du
monde ne se révoltent pas. Il continuait
aussi à s'occuper de ses collections. Dans
une lettre du 19 février 1934, il
m'écrivait :
« J'ai constaté que ma
vue se trouble passablement ; il faut renoncer
le plus possible à employer mes yeux. J'ai
eu beaucoup de peine à recoller une antenne
de longicorne. »
Après bien des hésitations
(j'avais compris que je ne reverrais pas mon
père) je persuadai ma femme d'aller le voir
avec notre petit Henri-François. Dans toutes
ses dernières lettres, il attendait avec
impatience leur arrivée. Il se
réjouissait aussi de voir paraître une
petite étude que je devais publier dans
« Africa » sur les cas de
possessions chez les Ba-Ndjaou. Hélas !
elle arriva trop tard.
Il écrit le 29 mars à sa
fille aînée : « Je me
suis mis au piano un petit moment et j'ai
tâché de retrouver les notes de ce
beau cantique : « Vois-tu, seul en
Gethsémané... » C'est un
cantique vraiment magnifique :
« Dans les angoisses de la nuit, regarde
à Lui ! » Puis nous avons
pris le thé. Et alors tu ne sais pas ce que
nous avons fait ? J'ai demandé à
ta tante de m'accompagner le bel air de Bach de la
Passion selon saint Matthieu :
« Gerne will ich mich
bequemen ». Elle ne s'en est pas mal
tirée, et moi pas trop mal, quand même
je me trouvais une voix cassée ; ainsi
nous avons communié ensemble avec le Christ
souffrant, avec le grand chrétien
qu'était Bach et avec toi dont la
pensée est si présente à notre
souvenir. Oui, il fait beau pouvoir chanter l'air
de Gethsémané en comprenant la
douleur du Christ, et aussi sa victoire à
laquelle il nous associe. Il faut remporter cette
victoire toutes les fois que l'on se sent faiblie,
et dans les mauvais moments, le long des nuits
d'insomnie, jusqu'au moment où nous
entrerons dans la Maison du
Père. »
Sa dernière lettre du 15 avril
est toute remplie de l'attente du revoir. Sa
belle-fille et son petit-fils allaient arriver.
Cette lettre est inachevée.
Ils arrivaient le vendredi 20 avril
à onze heures et demie du soir... Ils se
hâtèrent de gagner la maison
paternelle et y trouvèrent mon cher
père qui les attendait. On se
précipite dans ses bras. Le lendemain,
journée de joie intense. Le
grand-père est enchanté de revoir son
petit-fils, qui lui ressemble si fort. Il
s'émerveille de voir ces petites mains qui
arrachent les longues racines des mauvaises
herbes : « Il me fera du bon travail ce
petit
bonhomme-là. » On parle de la
petite Manon, grand-papa aurait bien aimé la
voir, mais il ajoute : « Entre les
deux tu as bien fait de choisir celui-là,
Manon m'aurait quand même
oublié. »
« Dimanche matin
(1),
le collier
recommence à s'égrener, chaque minute
passée près du grand-père est
une perle bien rare, hélas ! et l'on
n'en connaît pas assez la valeur. On
déjeune en famille. Papa est animé.
Il parle beaucoup de son fils aîné, de
son travail à Prétoria, des
condamnés, des Boers, du mouvement d'Oxford.
Dehors, il pleut, le ciel est tout triste. Puis
c'est la sieste. Nous allons prendre le thé
au salon. Grand-père demande des nouvelles
de ses petites-filles. Il aime la nature douce de
Violaine, il admire, le caractère de
Mireille, il croit au charme de petite Manon. Il se
lève, s'assied au piano,
égrène quelques accords, replace le
feutre de travers sur les touches, et remonte au
bureau, où tante Elisabeth lui aide à
terminer un cadre de papillons qu'il destine au
Secrétariat, et que le Dr Sechehaye doit
emporter mercredi. La tâche est ardue ;
le travail minutieux fatigue les yeux de
grand-père. Nous causons. Il aimerait tant
aller à Lausanne pour l'Assemblée des
délégués, mais ses forces sont
insuffisantes. Il se recouche. Après le
dîner du soir, il téléphone,
puis il s'étend et je descends auprès
de lui. La petite lampe verte éclaire sa
belle tête blanche, il a les mains jointes.
Nous causons. Il parle surtout de ses deux jeunes
fils. Le temps passe. À 9 heures et quart,
il dit : « Je crois qu'il faut que
j'essaye de dormir, je ne me sens pas très
bien, j'ai un peu d'écoeurement,
j'espère que cela va passer et que j'aurai
de bonnes journées ». Sa soeur lui
donne ses derniers remèdes. Nous nous
installons de l'autre côté de la
paroi. Il toussote. Il toussote encore. Soeur
Elisabeth dit : « Pourvu qu'il ne
fasse pas une pneumonie, ce serait la fin, je
n'aime pas cette toux. » Nous allons
auprès de lui. Il est 9 heures et demie. On
lui donne de l'ammoniaque anisée, on prend
son pouls, je vais appeler le médecin.
Déjà il lutte contre la mort, le souffle ne veut
pas
venir. Vite deux injections. Sa soeur
l'encourage : « Laisse aller ton
serviteur en paix ». Papa reprend :
« La paix du corps. » Encore
quelques instants de lutte :
« Ça se ferme ! »
Il devient très blanc. L'âme s'est
envolée...
» Une grande lumière s'est
éteinte. Dieu soit béni qui l'a
repris à Lui. Petit Henri-François a
voulu revoir son grand-père. Il l'a
trouvé si beau qu'il est retourné
auprès de lui trois fois dans la
journée du mardi... »
(D'après une lettre de Mme H. -P.
Junod).
Les télégrammes volent
vers Wahroonga et vers Prétoria.
« Papa endormi paisiblement. »
Et l'on répond : « Plus que
jamais : Sursum corda », et
« Christ est ma vie et mourir m'est un
gain. »
Ars longa, vita brevis. Dans la noble
lignée des grands missionnaires,
Henri-Alexandre Junod est venu prendre sa place. Si
brève que soit l'existence d'un homme sur
cette terre, si la charité la remplit, si
toutes les facultés y sont mises à la
disposition du Maître et au service des
frères, l'influence d'un homme
demeure ; longtemps encore, elle stimule et
inspire. L'âme aux écoutes, sans cesse
disponibles, prêts à suivre les
directions divines, nous nous avançons
paisibles et délivrés à jamais
du pessimisme fondamental que les turpitudes
humaines rendent inévitable pour quiconque
réfléchit.
Dans la préparation de
l'adolescence, dans l'épanouissement de la
maturité, dans les belles moissons de la
vieillesse, tout est harmonie. Nulle note
discordante, même dans la douleur. Partout on
sent la main du Père. Rien n'est fortuit.
Rien ne conduit à la révolte ou au
désespoir. L'homme peu à peu
s'élève « les yeux
fixés sur cette éternité
sereine, qui est plus près de nous que nous
ne le croyons. » Il grandit dans la
connaissance des beautés de la vie humaine,
dans la contemplation quotidienne des merveilles de
la création et dans l'initiation progressive aux
« principes plus grands encore qui
régissent les enfants de
Dieu. »
Si nous reprenons le serment de
consécration, si nous en examinons les
termes admirables, nous retrouvons l'harmonie
complète. La vie s'est conformée
à leurs sérieuses
exigences ;
« Avancer l'honneur et la
gloire de Dieu avant toutes choses, exposer sa vie,
corps et biens, s'il est requis, renoncer à
tout profit particulier pouvant nuire au saint
ministère, être uni avec les
frères, éviter toute secte et
division dans l'Eglise. »
Si nous reprenons le mot d'ordre qui fut
placé au point de départ :
« Pais mes agneaux », nous
voyons qu'elles sont nombreuses les brebis
rassemblées dans le bercail du bon Berger
par l'influence d'une telle vie. Ils sont nombreux
maintenant les compatriotes de Zidji qui s'avancent
les yeux fixés sur l'Étoile du
matin.
Dans le travail pour le Maître,
scientifique, manuel ou religieux :
continuité. Effort pour ne rien laisser
échapper dans tout l'horizon entrevu.
Continuité encore.
Devant la mort, dans les heures les plus
tragiques, l'âme se ressaisit, et lorsqu'elle
défaille, dans un suprême effort, elle
contemple l'invisible et, tranquille,
présente aux âmes des
bien-aimés qui s'en vont les certitudes
éternelles. Elle n'oublie pas les
détails de la vie matérielle de ceux
qui restent. Elle va de l'avant dans l'oeuvre
d'amour, avec plus de douceur, de patience et de
foi. Elle remporte, après le Maître,
la victoire de Gethsémané, elle la
remporte toutes les fois que l'on se sent faible,
jusqu'au moment où elle entrera dans la
Maison du Père.
Attachée par les fibres les plus
profondes de l'être au sol natal, elle
accepte les déracinements douloureux sans
jamais oublier la patrie bien-aimée.
Eugène Pittard a
dit :
« La vie de Junod nous
apparaît comme une belle harmonie.
Scientifique et humaine, elle accorde la recherche
désintéressée et les
applications morales et sociales.
L'objectivité de la science avait
pénétré cette âme et
avait aussi aidé à l'élever
au-dessus de nos pauvres contingences
journalières. Elle planait, dominant nos
marécages, leurs pestilences et leurs
fièvres. Magnifique vertu de la recherche
libre, sans buts vulgaires, sans soucis de l'argent
à acquérir, et si rare
aujourd'hui ! Dans la ronde insensée
autour du veau d'or qui caractérise notre
époque, des existences de droiture, comme
celle de Junod, où l'âme a la part
principale, sont des bienfaits et des
enseignements. Elles nous incitent à les
imiter le mieux que nous pouvons.
» Comme je voudrais que les jeunes
générations comprennent la
beauté d'une telle vie ! Qu'elles
comprennent ce que signifie ce mot sublime de
liberté - la liberté de
soi-même ! ... »
Sur la colline sablonneuse de Rikatla,
dans le petit cimetière abandonné
sous les arbres de la brousse qu'il a tant
aimée, à côté des restes
de Paul Berthoud, de la tombe de sa
bien-aimée, les cendres d'Henri-Alexandre
Junod reposeront. La grande parole de saint Paul
planera sur eux tous : « Lirandu a
li lahleki » (l'Amour ne périt
jamais). Dernier témoignage de vies
données, ces tombes proclament
l'Évangile éternel de la
charité. Dieu parle ! Les martyrs
d'aujourd'hui unissent leurs voix aux martyrs
d'autrefois. Puissent les jeunes
générations entendre cet appel !
Le silence des espaces infinis est devenu la voix
du Père ! Tenons ferme, nous aussi,
comme voyant Celui qui est invisible.
| Chapitre précédent | Table des matières | - |
